Garçía Lorca, Dalí, Buñuel et les autres... Le labo artistique du Madrid des années 1920
Extraits
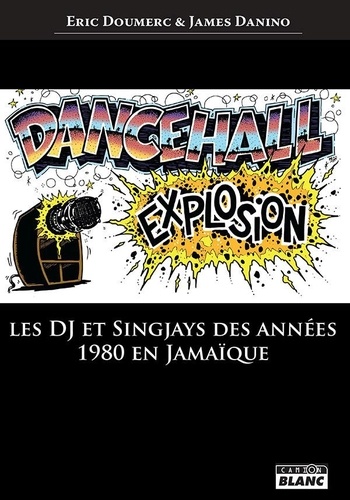
Histoire de la musique
Dancehall Explosion. Les DJ et Singjays des années 1980 en Jamaïque
02/2021
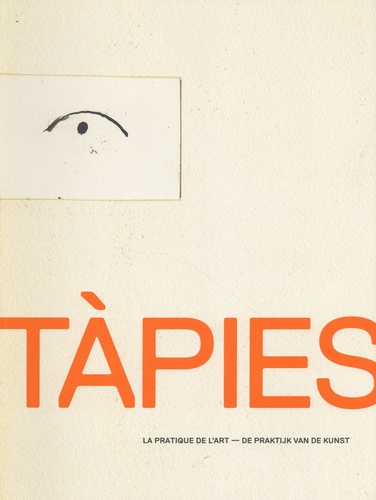
Monographies
Antoni Tàpies. La pratique de l'art, Edition bilingue français-néerlandais
09/2023
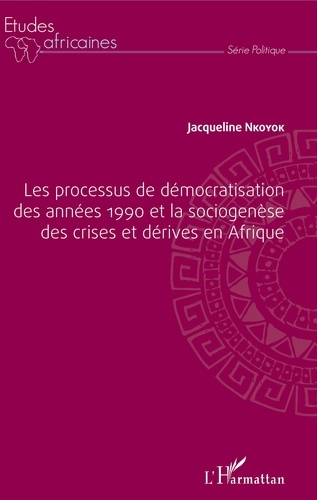
Sciences politiques
Les processus de démocratisation des années 1990 et la sociogenèse des crises et dérives en Afrique
12/2017
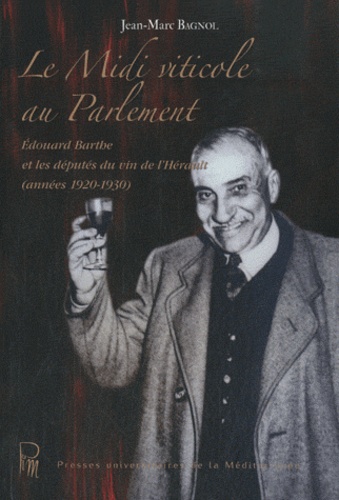
Histoire de France
Le Midi viticole au Parlement. Edouard Barthe et les députés du vin de l'Hérault (années 1920-1930)
10/2010
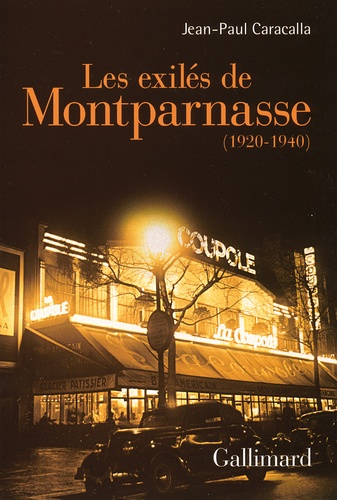
Beaux arts
Les exilés de Montparnasse (1920-1940)
09/2006
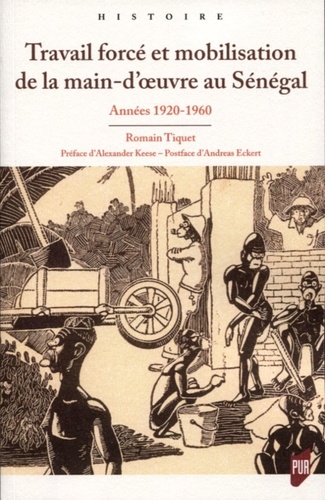
Histoire de France
Travail forcé et mobilisation de la main d'oeuvre au Sénégal. Années 1920-1960
03/2019
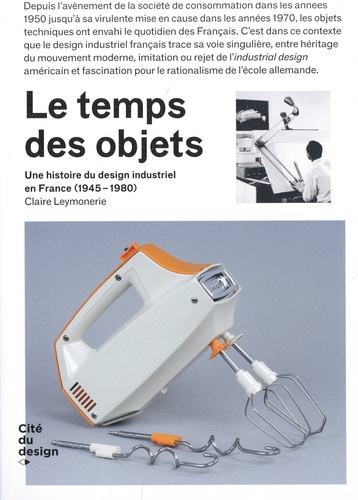
Design
Le temps des objets. Une histoire du design industriel en France (années 1950-1980) 2e édition
04/2022
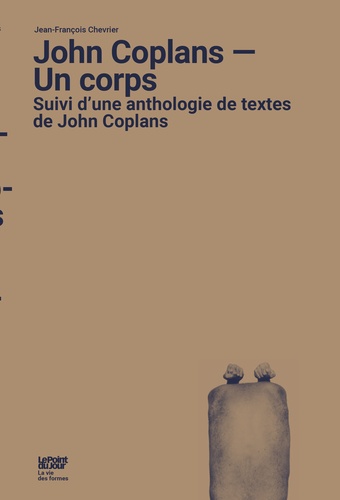
Essais biographiques
John Coplans - Un corps. Suivi d'une anthologie de textes de John Coplans
11/2021
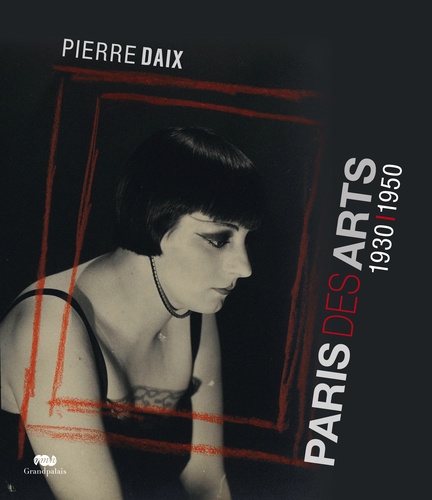
Beaux arts
Paris des arts 1930-1950
05/2011

Histoire de la pensée économiq
Les espaces d'interaction des élites françaises et allemandes (1920-1950)
09/2021
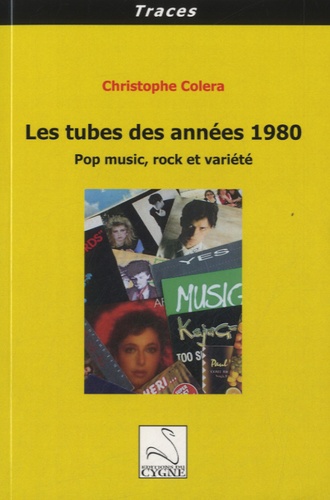
Musique, danse
Les tubes des années 1980. Pop music, rock et variété
05/2013
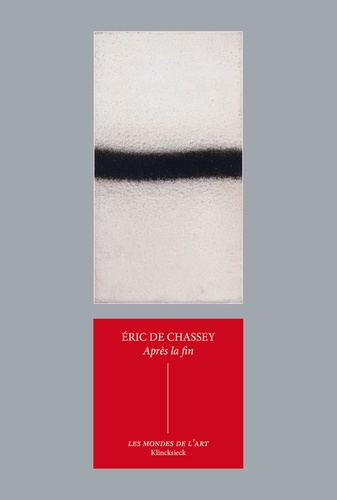
Beaux arts
Après la fin. Suspensions et reprises de la peinture dans les années 1960 et 1970
12/2017
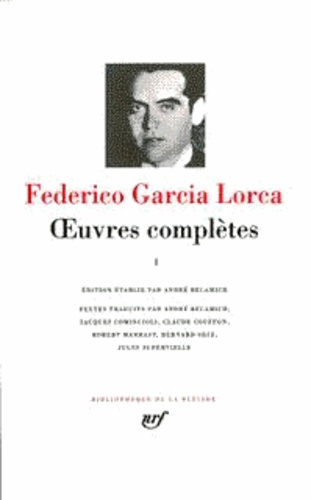
Pléiades
Oeuvres complètes. Tome 2, Théâtre, Interviews et déclarations
09/1990
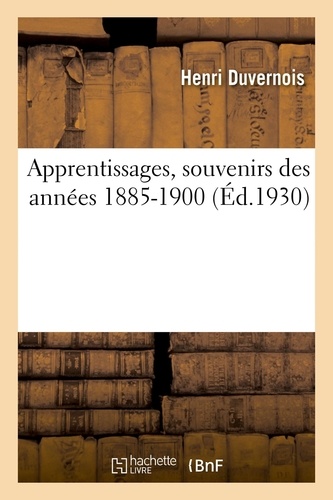
Littérature française
Apprentissages, souvenirs des années 1885-1900
01/2021
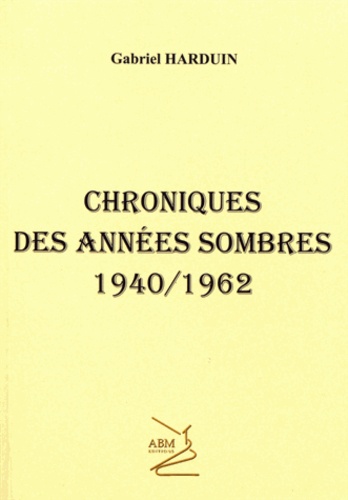
Histoire de France
Chroniques des années sombres 1940/1962
05/2018
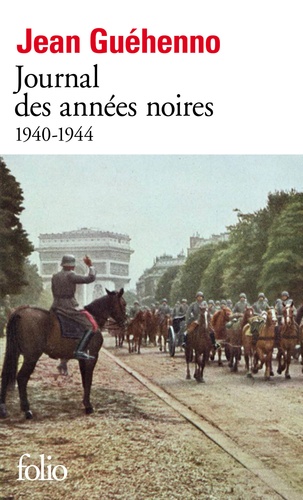
Histoire de France
Journal des années noires. 1940-1944
07/2014
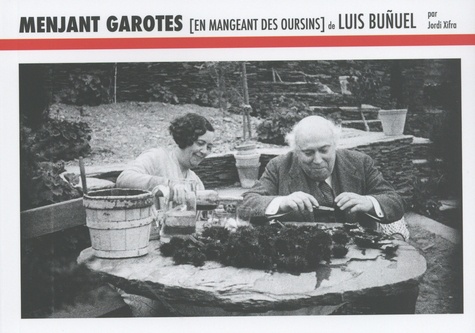
Cinéastes, réalisateurs
MENJANT GAROTES de Luis Buñuel. [en mangeant des oursins
10/2023
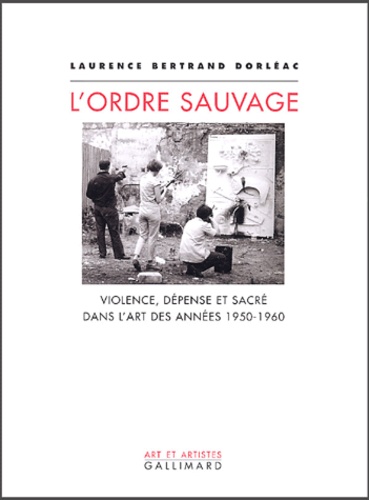
Beaux arts
L'ordre sauvage. Violence, dépense et sacré dans l'art des années 1950-1960
09/2004
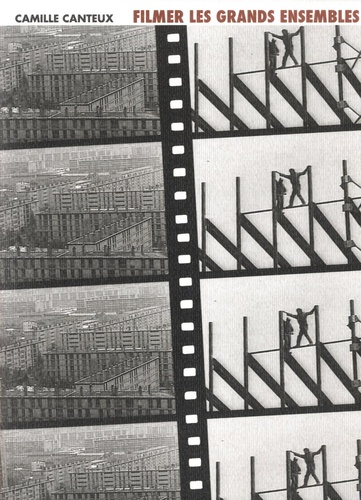
Sociologie
Filmer les grands ensembles. Villes rêvées, villes introuvables, une histoire des représentations audiovisuelles des grands ensembles (milieu des années 1930 - début des années 1980)
10/2014
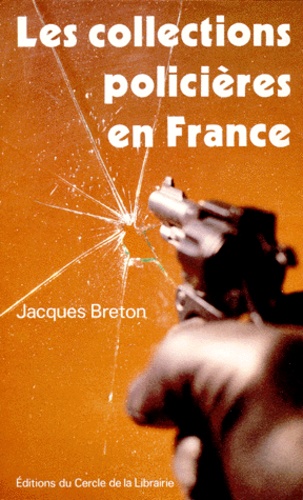
Critique littéraire
LES COLLECTIONS POLICIERES EN FRANCE. Au tournant des années 1990
01/1992
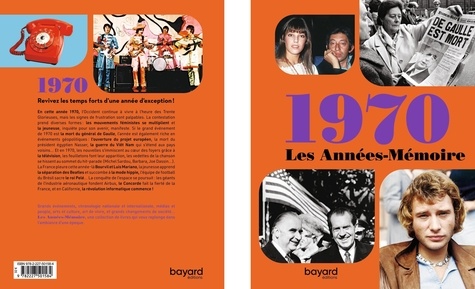
Arts et traditions populaires
Les années mémoire 1970
09/2023
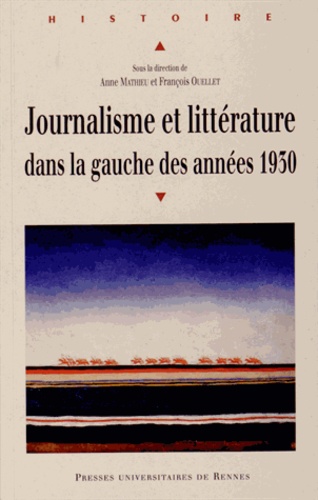
Histoire de France
Journalisme et littérature dans la gauche des années 1930
12/2014
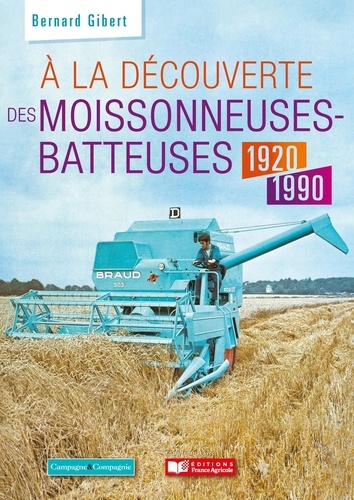
Sports
A la découverte des moissonneuses-batteuses 1920-1990
10/2020
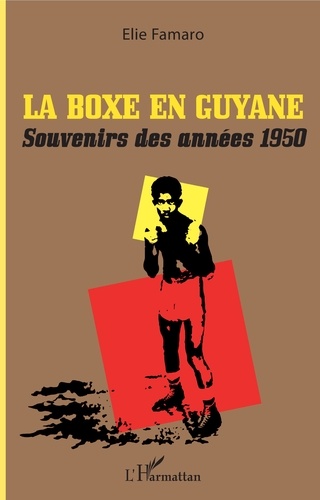
Sports
La boxe en Guyane. Souvenirs des années 1950
06/2020
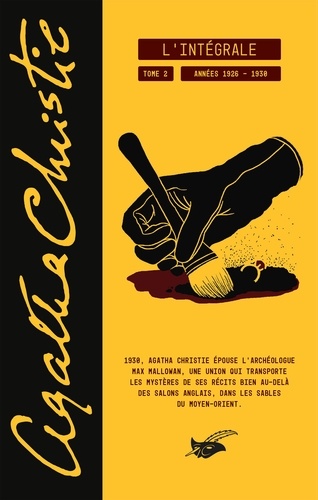
Romans policiers
Agatha Christie, L'Intégrale Tome 2 : Les années 1926-1930
06/2024
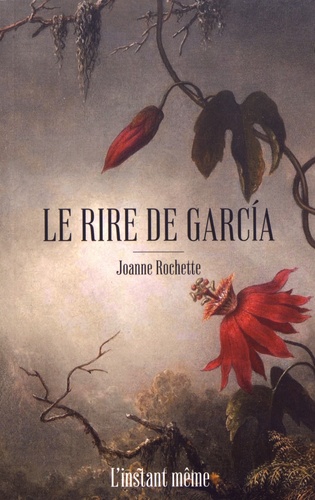
Littérature française
Le rire de Garcia
02/2020
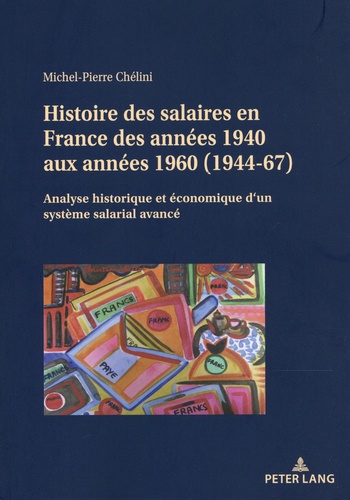
Economie
Histoire des salaires en France des années 1940 aux années 1960 (1944-1967). Analyse historique et économique d'un système salarial avancé
01/2021
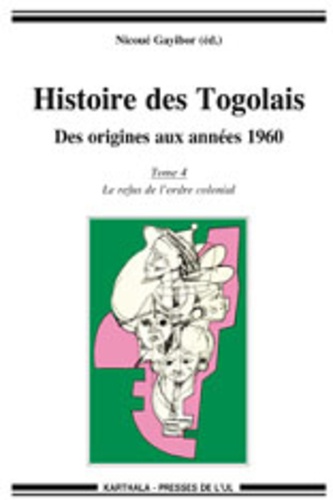
Histoire internationale
Histoire des Togolais, Des origines aux années 1960
06/2011
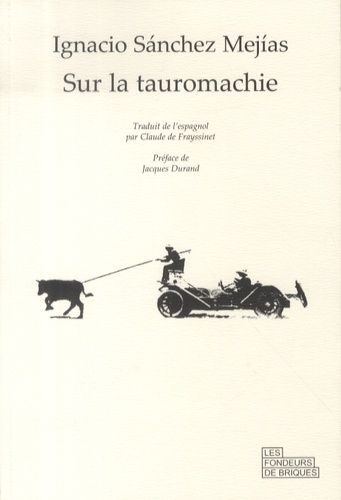
Tauromachie
Sur la tauromachie. Oeuvre journalistique, conférences et interviews
03/2021
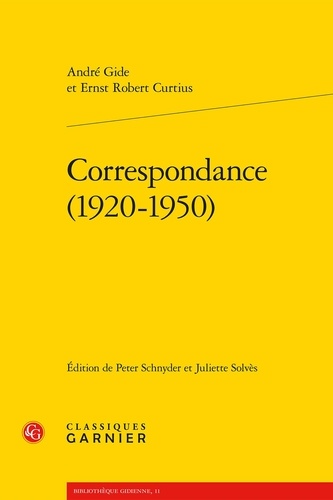
Critique littéraire
Correspondance. (1920-1950)
12/2019

