Droits d'
Extraits
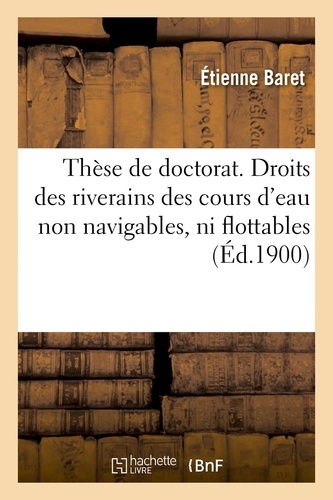
Histoire du droit
Thèse de doctorat. Droits des riverains des cours d'eau non navigables, ni flottables. au point de vue du droit civil. Faculté de droit d'Aix-Marseille
03/2021
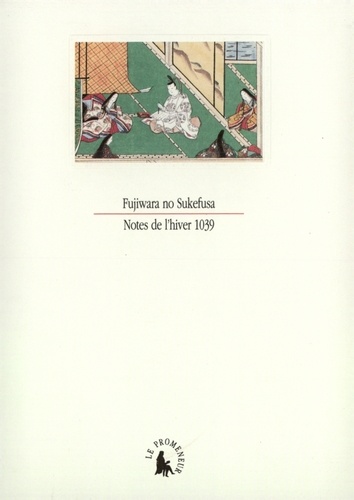
Littérature étrangère
Notes de l'hiver 1039
07/1994
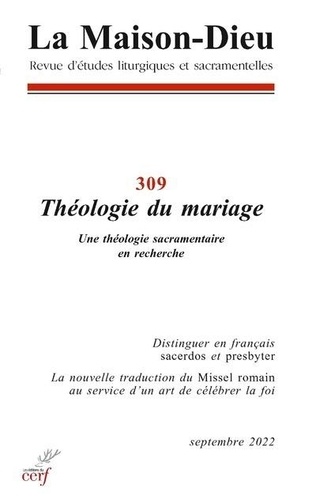
Théologie
La Maison Dieu N° 309
09/2022
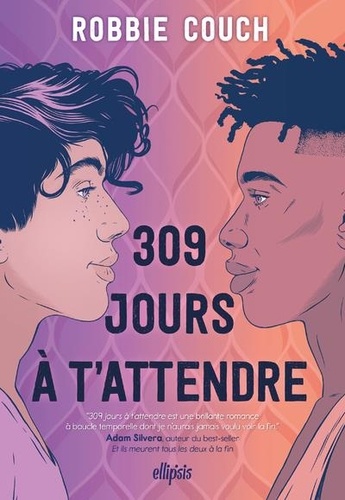
Romans, témoignages & Co
309 jours à t'attendre
04/2024
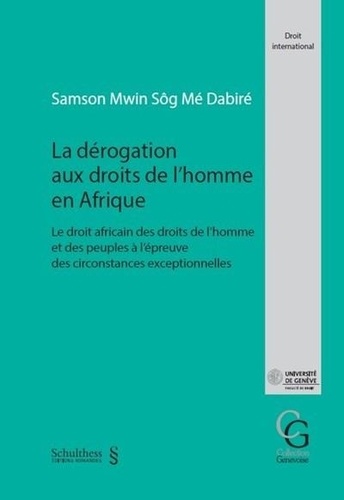
Droit international public
La dérogation aux droits de l'Homme en Afrique. Droit africain des droits de l'Homme et peuples à l'épreuve des circonstances
02/2022
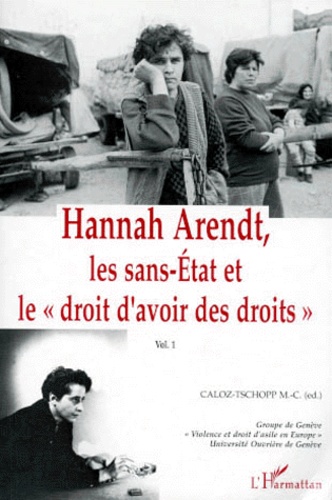
Philosophie
Hannah Arendt, les sans-Etats et le "droit d'avoir des droits". Volume 1, avec 1 CD audio
05/1998
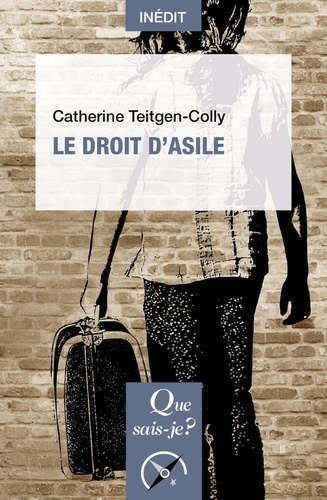
Encyclopédies de poche
Le droit d'asile
05/2019
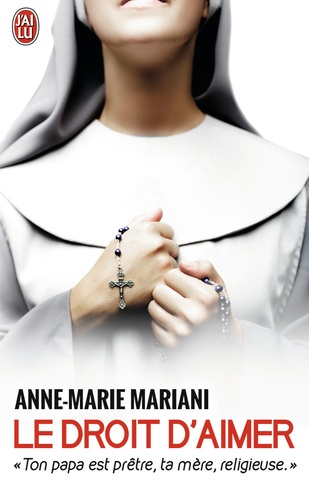
Religion
Le droit d'aimer
03/2015
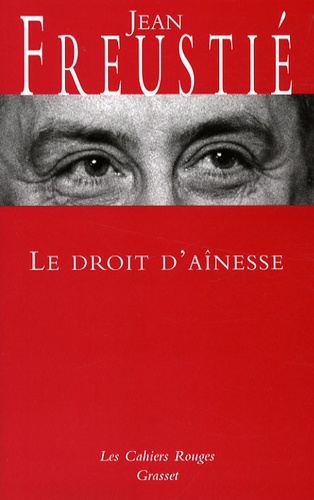
Littérature française (poches)
Le droit d'aînesse
03/2008
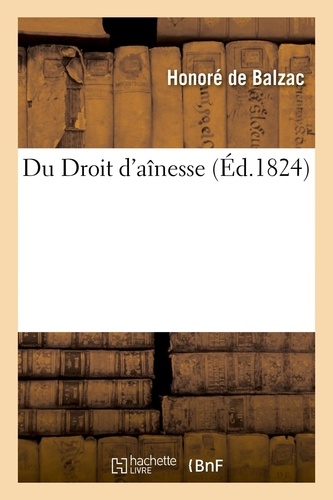
Littérature française
Du Droit d'aînesse
09/2021
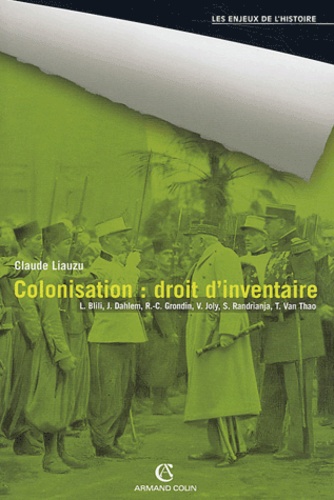
Histoire de France
Colonisation : droit d'inventaire
02/2004
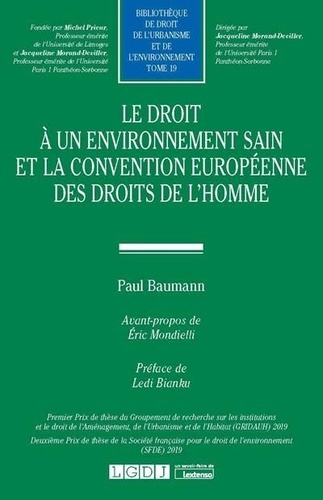
Droit
Le droit à un environnement sain et la Convention européenne des droits de l'homme
01/2021
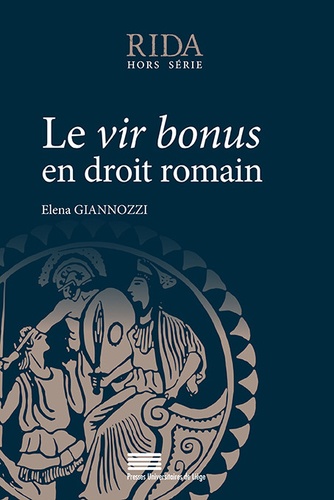
Revues de droit
Revue internationale des droits de l'Antiquité Hors-série : Le vir bonus en droit romain
06/2021
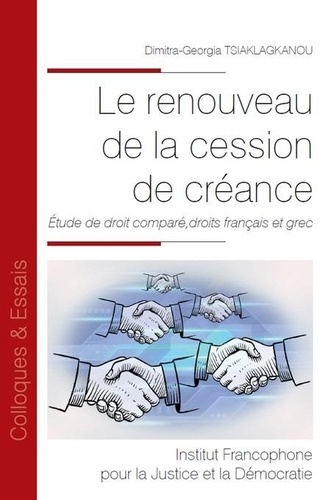
Droit comparé
Le renouveau de la cession de créance. Etude de droit comparé, droits français et grec
07/2021
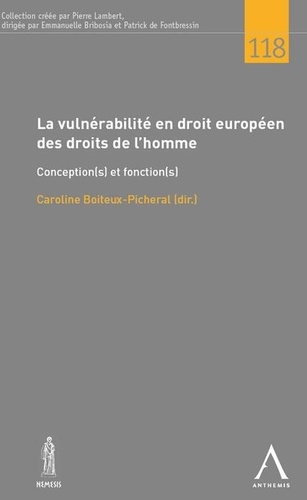
Droit
La vulnérabilité en droit européen des droits de l'homme. Conception(s) et fonction(s)
03/2019
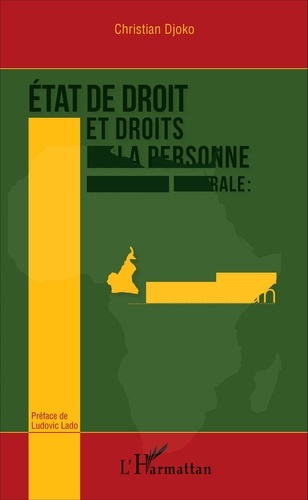
Droit
Etat de droit et droits de la personne en Afrique centrale : le cas du Cameroun
02/2016
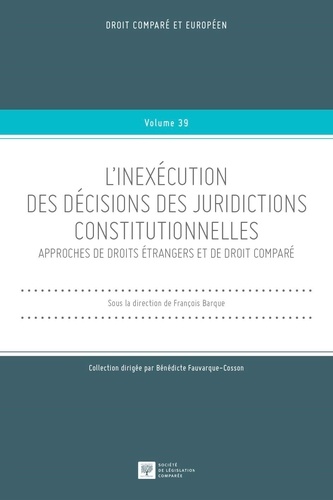
Droit constitutionnel
L'inexécution des décisions des juridictions constitutionnelles. Approches de droits étrangers et de droit comparé
12/2023
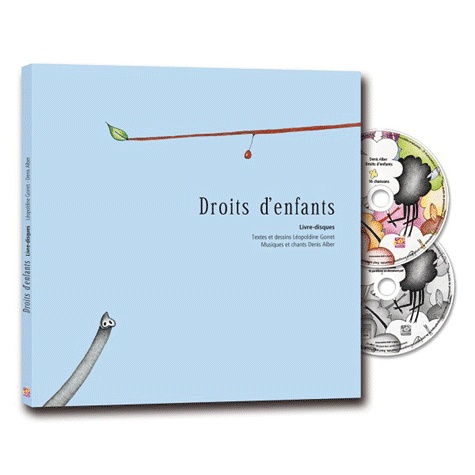
Documentaires jeunesse
Droits d'enfants. Avec 2 CD audio
10/2011
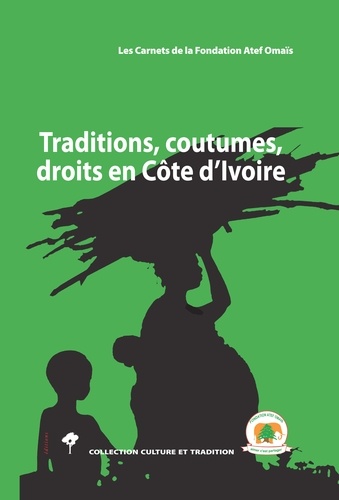
Ethnologie
Traditions, coutumes, droits en Côte d'Ivoire
07/2017
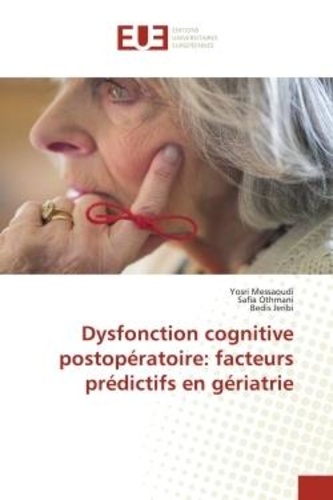
Littérature française
Dysfonction cognitive postopératoire: facteurs prédictifs en gériatrie
11/2022
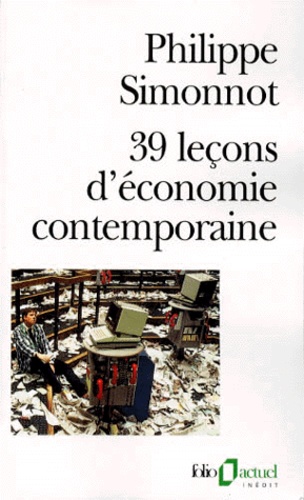
Economie
39 leçons d'économie contemporaine
09/1998
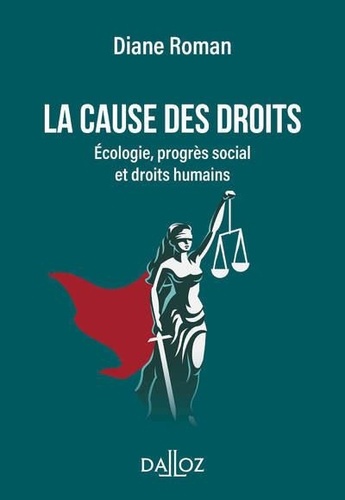
Philosophie du droit
La cause des droits. Ecologie, progrès social et droits humains
01/2022
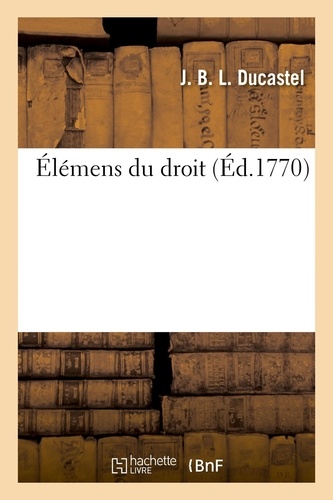
Histoire du droit
Élémens du droit. précédés d'une réponse aux opinions de M. G. sur les droits des femmes en Normandie
10/2021
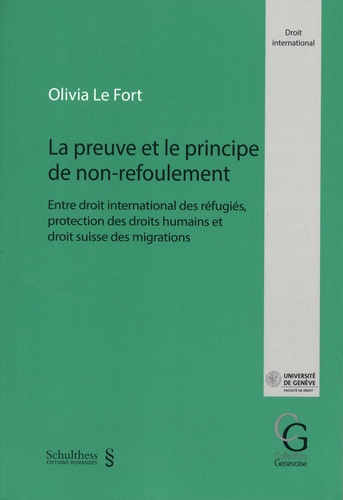
Droit
La preuve et le principe de non-refoulement. Entre le droit international des refugiés, protection des droits humains et droit suisse des migrations
01/2019
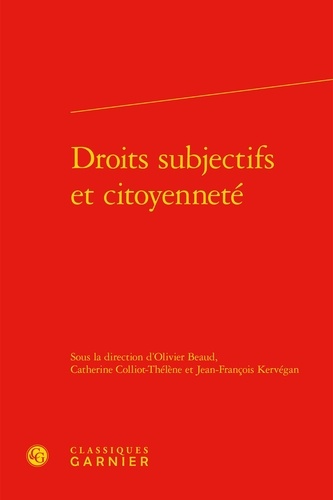
Droit
Droits subjectifs et citoyenneté
11/2019
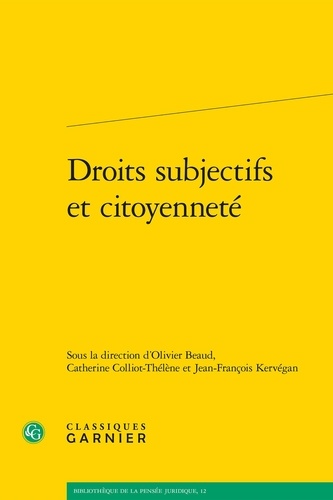
Droit
Droits subjectifs et citoyenneté
11/2019
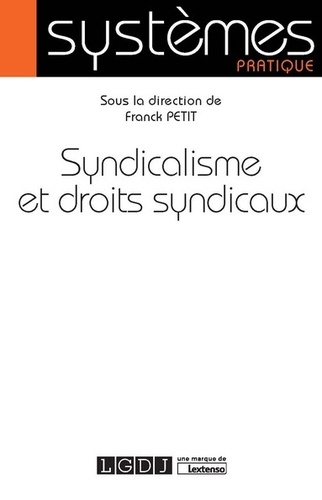
Droit
Syndicalisme et droits syndicaux
07/2019
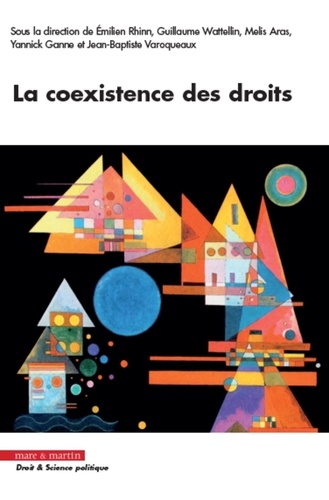
Droit
La coexistence des droits
05/2019
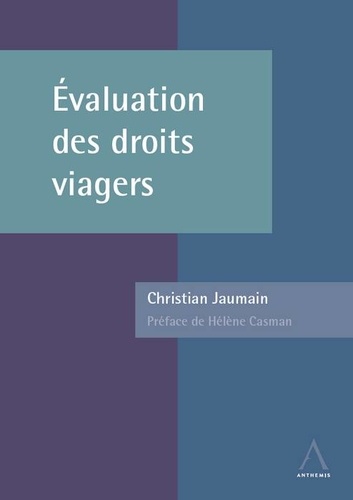
Droit
Evaluation des droits viagers
05/2019
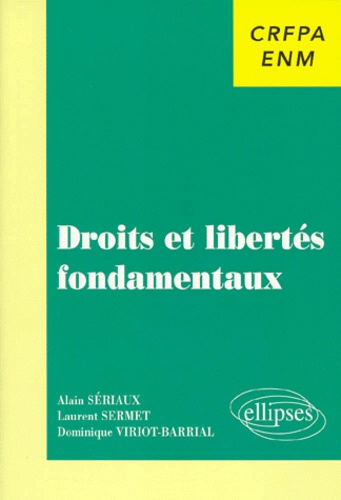
Droit
Droits et libertés fondamentaux
09/1998


