Caterina Bonvicini Gallimard
Extraits
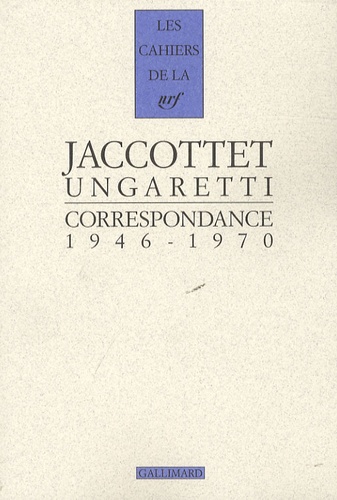
Critique littéraire
Jaccottet, traducteur d'Ungaretti. Correspondance 1946-1970
11/2008
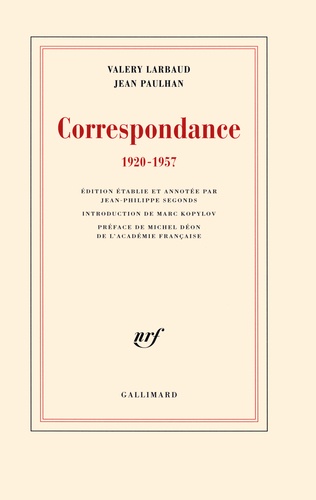
Critique littéraire
Correspondance 1920-1957
12/2010
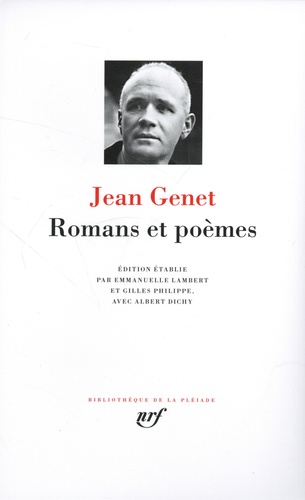
Littérature française
Romans et poèmes
04/2021
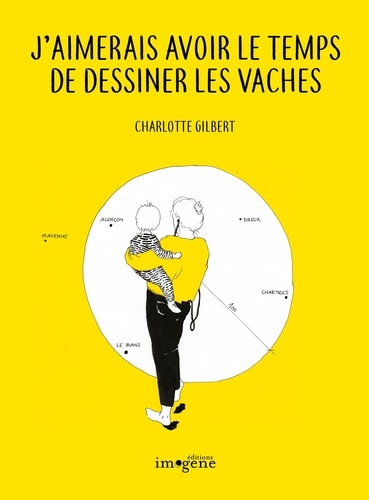
Divers
J'aimerais avoir le temps de dessiner les vaches
04/2021
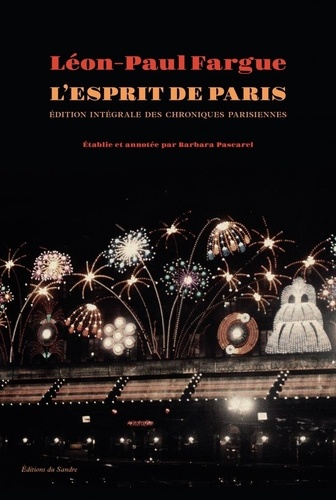
Littérature française
Oeuvres Complètes Tome 1 : L'esprit de Paris. Chroniques parisiennes 1934-1947
09/2020
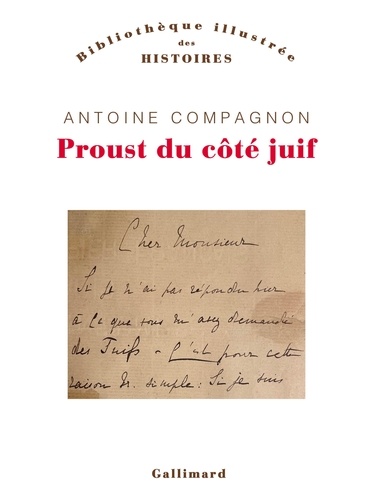
Biographies
Proust du côté juif
03/2022
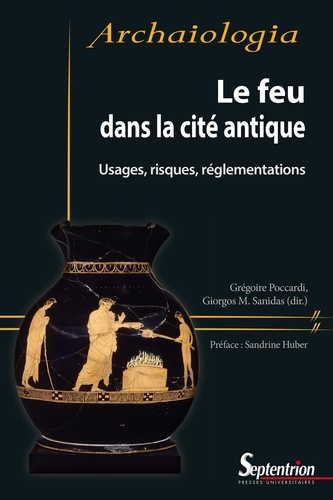
Histoire internationale
Le feu dans la cité antique. Usages, risques, réglementations
01/2022
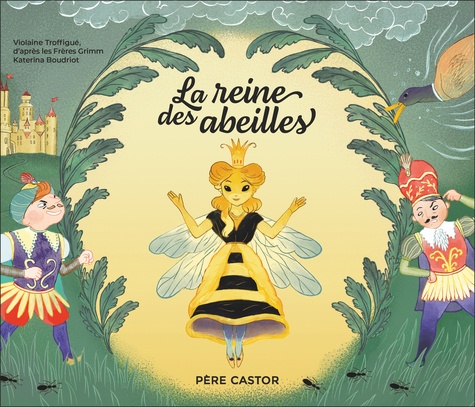
Contes des 4 coins du monde
La Reine des Abeilles
05/2023
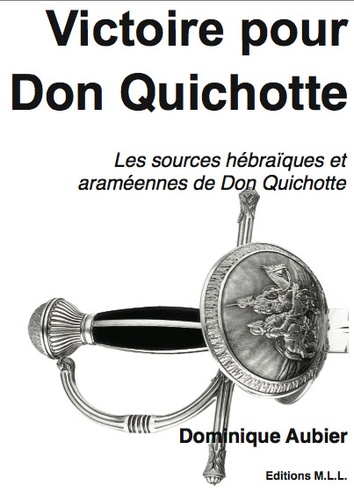
Critique littéraire
Victoire pour Don Quichotte !
10/2015
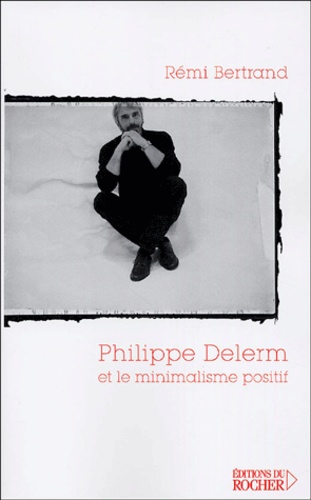
Critique littéraire
Philippe Delerm et le minimalisme positif
01/2005
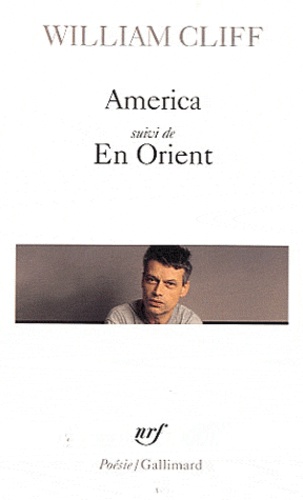
Poésie
America suivi de En Orient
02/2012
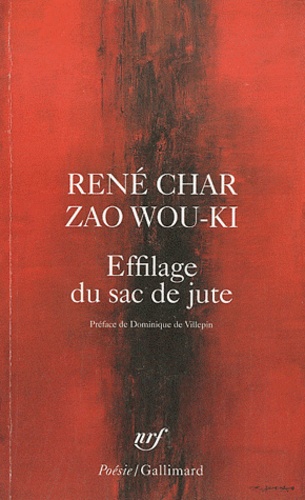
Poésie
Effilage du sac de jute
02/2011
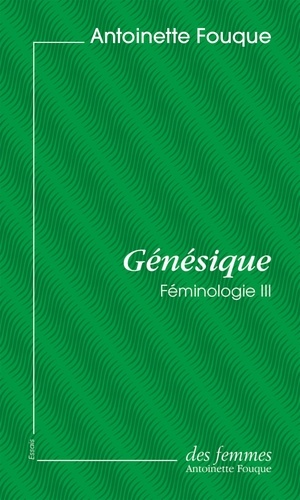
Psychologie, psychanalyse
Génésique. Féminologie III
01/2021
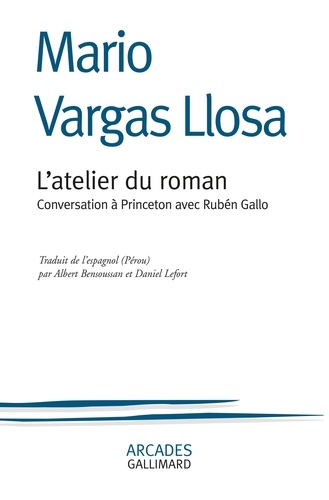
Critique littéraire
L’atelier du roman. Conversation à Princeton avec Rubén Gallo
02/2019
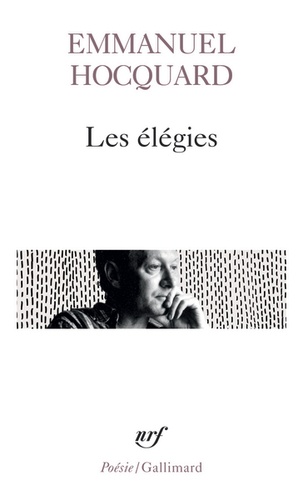
Poésie
Les élégies
02/2016
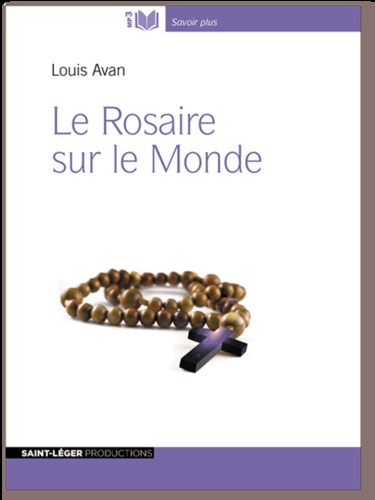
Religion
Le rosaire sur le monde
06/2020
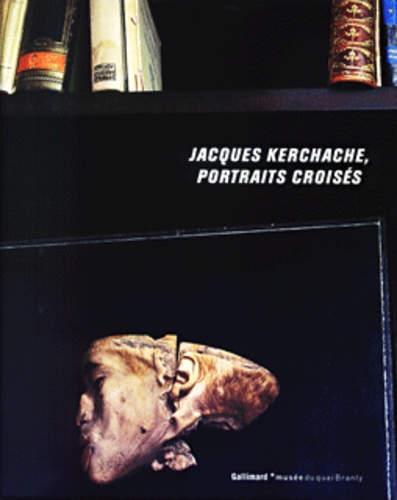
Beaux arts
Jacques Kerchache, portraits croisés
04/2003
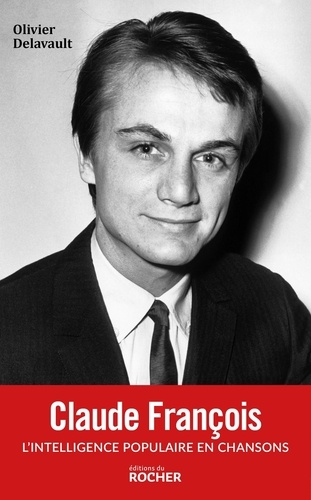
Chanson française
Claude François. L'intelligence populaire en chansons
Le chanteur Claude François est à l'origine d'un continent musical que d'aucuns pensent connaître or, il n'en est rien. En dehors de quelques énormes succès des années 60, du planétaire Comme d'habitude, quelques chansons très connues des années 70 ont eu la particularité de donner l'image réductrice d'un chanteur "léger" à "paillettes-festives" , la seule qui demeure dans les esprits.
Cette caractéristique a engendré contre lui des formes de discrédits permettant à diverses intelligentsias de congédier le chanteur de toute de respectabilité socio-artistique. Ultimement, au risque de choquer ou de faire ricaner, ce constat résonne comme un mauvais diagnostique sur l'état de notre société et de notre culture... C'est oublier un peu vite celui qui, dès 1962, dans le monde du pop / rock français, a été consacré idole aux côtés de Richard Anthony et Johnny Hallyday avant d'aborder ensuite, avec talent et maîtrise, les rivages la country, de la soul music et du funk.
Auscultant les fondations de son répertoire, cet ouvrage tente de pallier ces étranges lacunes. Depuis sa disparition le 11 mars 1978, l'écrasante majorité des ouvrages qui lui ont été consacrés ont totalement occulté la matière première qui a rendu son nom célèbre dans France entière : la chanson, la musique. Olivier Delavault a travaillé à la télévision de 1969 à 1988 dans les secteurs technique puis artistique. L'émission qu'il présenta à France-Inter en 1996 sur les chansons "françaises" issues d'une adaptation l'on poussé à écrire en 2003 le Dictionnaire des chansons de Claude François ; une collaboration en 2010 avec Richard Anthony pour sa dernière autobiographie, un essai sur Jacques Brel, Mots de Brel. Le dégoût essentiel en 2013. Olivier Delavault est également l'auteur, en 2007, d'une biographie de Geronimo chez Folio/Biographie, Gallimard.
01/2023
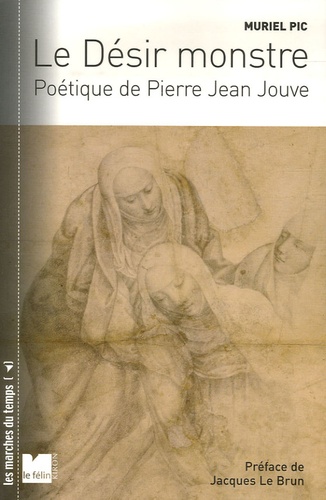
Critique littéraire
Le désir monstre. Poétique de Pierre Jean Jouve
11/2006
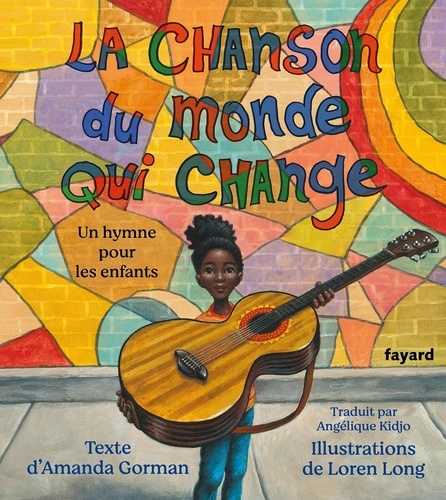
Autres éditeurs (F à J)
La chanson du monde qui change. Un hymne pour les enfants
09/2021
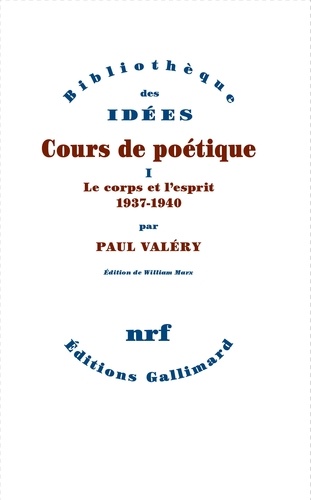
Critique
Cours de poétique. Tome 1, Le corps et l'esprit 1937-1940
01/2023
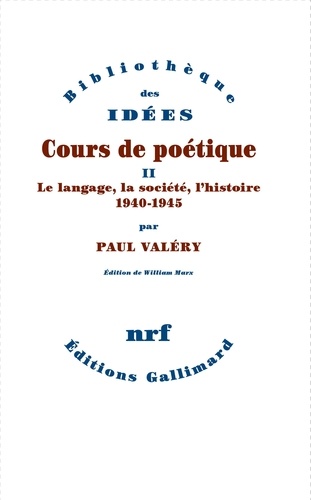
Critique
Cours de poétique. Tome 2, Le langage, la société, l'histoire (1940-1945)
01/2023
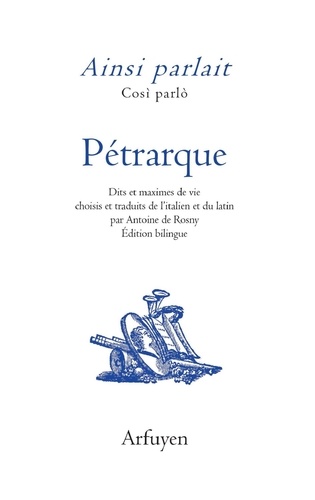
Latin - Littérature
Ainsi parlait Pétrarque. Dits et maximes de vie, Edition bilingue français-latin
10/2021
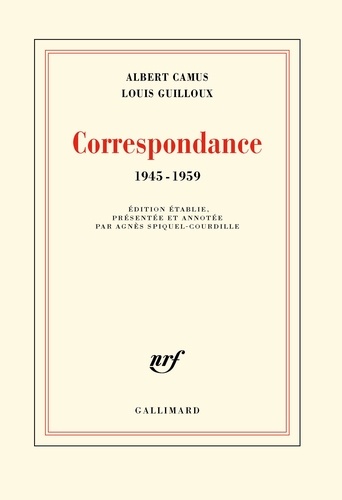
Critique littéraire
Correspondance. 1945-1959
09/2013
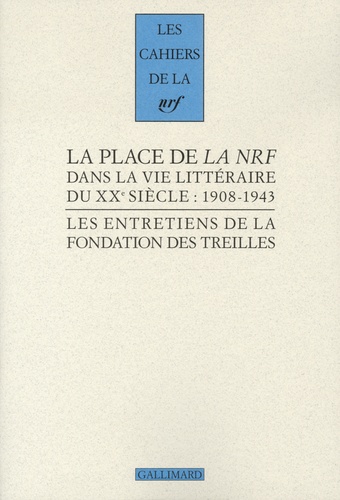
Critique littéraire
Les entretiens de la Fondation des Treilles Tome 3 : La place de la NRF dans la vie littéraire du XXe siècle : 1908-1943
10/2009
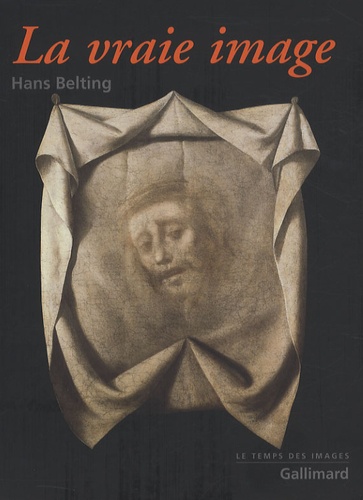
Beaux arts
La vraie image. Croire aux images ?
10/2007
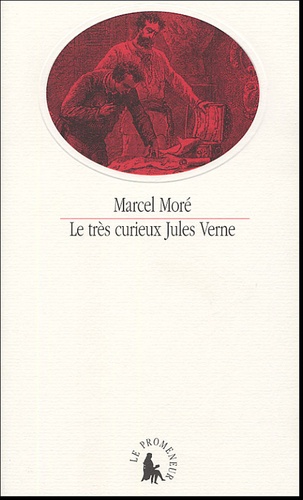
Critique littéraire
Le très curieux Jules Verne. Le problème du père dans les Voyages extraordinaires
03/2005
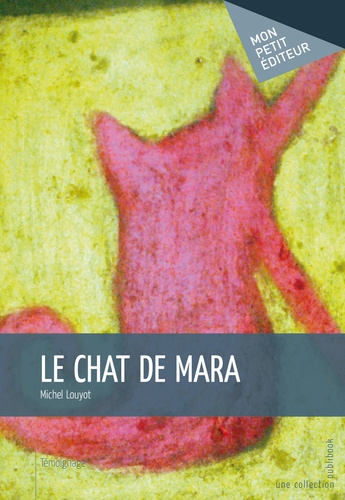
Littérature française
Le chat de Mara
09/2014
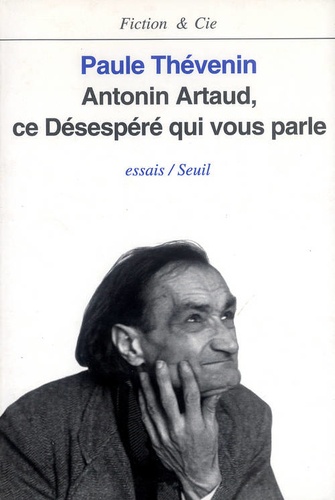
Critique littéraire
Antonin Artaud, ce désespéré qui vous parle. Essais
02/1993
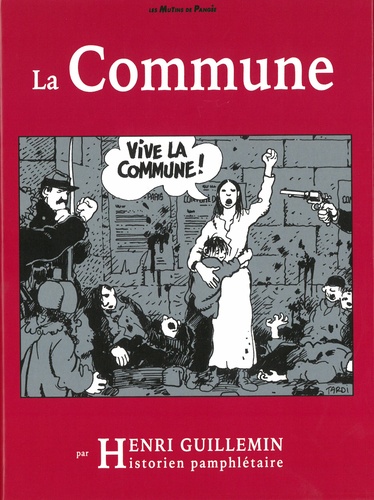
Histoire de France
La Commune. Réflexions sur la Commune, avec 3 DVD
11/2018

