L'Eglise et la société dans l'Occident médiéval
Extraits
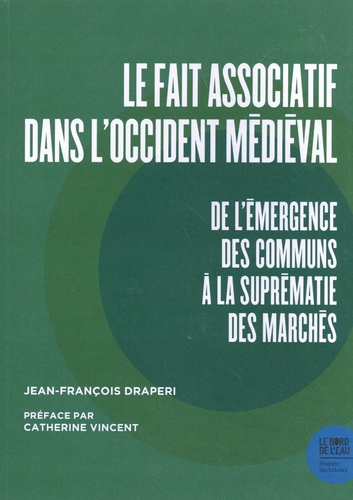
Ouvrages généraux et thématiqu
Le fait associatif dans l'Occident médiéval. De l'émergence des communs à la suprématie des marchés
12/2021
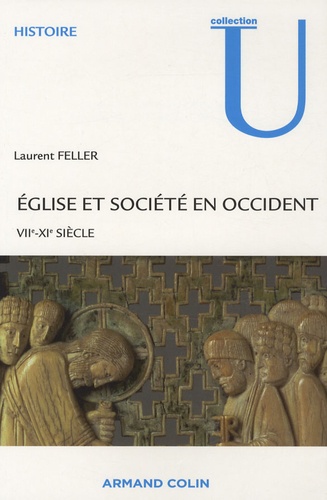
Religion
Eglise et société en Occident. Du début du VIIe au milieu du XIe siècle
03/2009
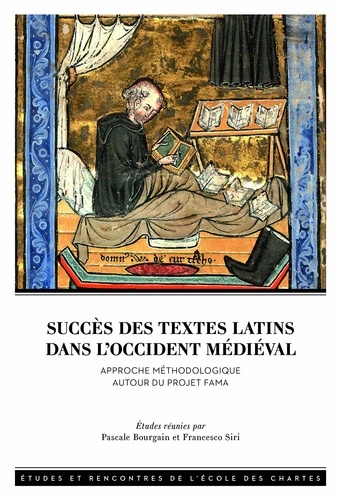
Moyen Age - Critique littérair
Succès des textes latins dans l'Occident médiéval. Approche méthodologique autour du projet FAMA
10/2020
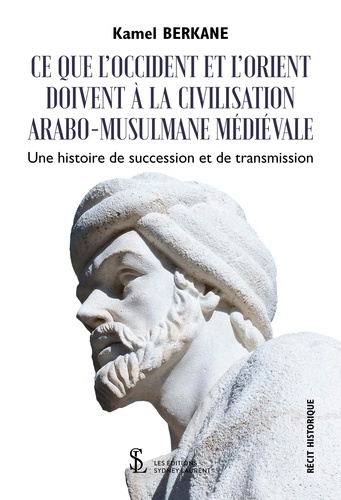
Ouvrages généraux et thématiqu
Ce que l'occident et l'orient doivent à la civilisation arabo-musulmane médiévale
01/2022
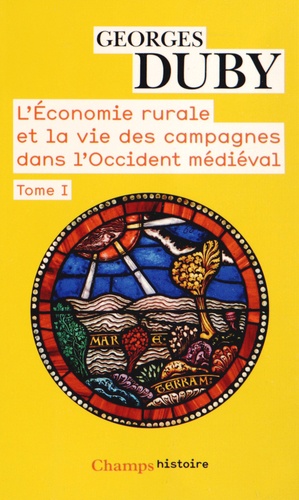
Histoire de France
L'économie rurale et la vie des campagnes dans l'Occident médiéval (France, Angleterre, Empire IXe-XVe siécles). Tome 1
02/2014
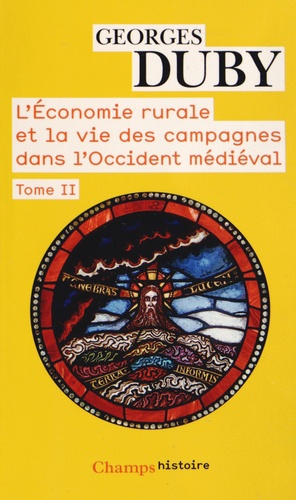
Histoire internationale
L'économie rurale et la vie des campagnes dans l'Occident médiéval (France, Angleterre, Empire, IXe-XVe siècles). Tome 2
02/2014
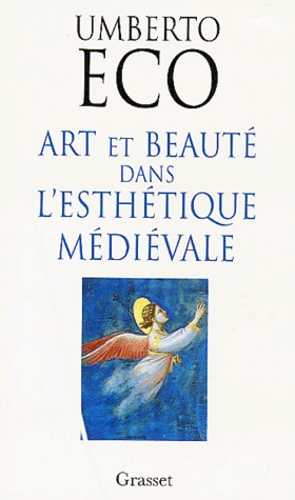
Beaux arts
Art et beauté dans l'esthétique médiévale
04/1997
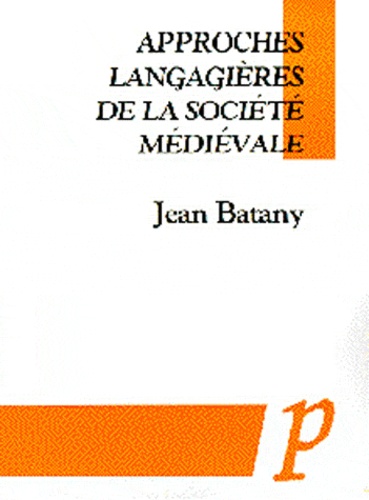
Critique littéraire
Approches langagières de la société médiévale
01/1992
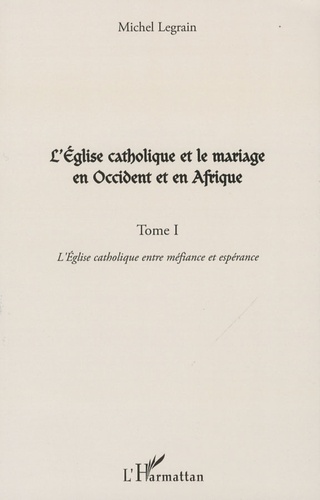
Religion
L'Eglise catholique et le mariage en Occident et en Afrique. Tome 1, L'Eglise catholique entre méfiance et espérance
10/2009
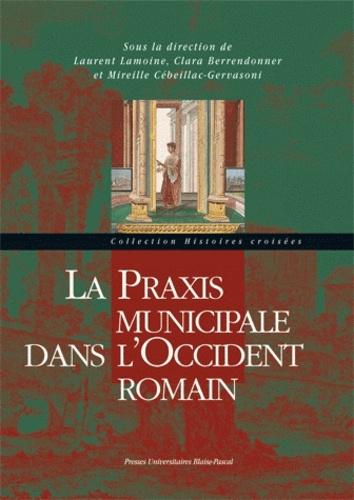
Histoire ancienne
La Praxis municipale dans l'Occident romain
02/2011
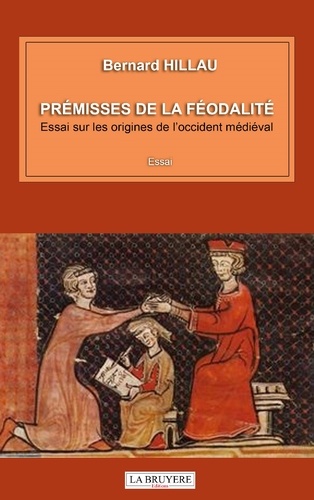
Ouvrages généraux et thématiqu
Les prémisses de la féodalité. Essai sur les origines de l'occident médiéval
03/2021
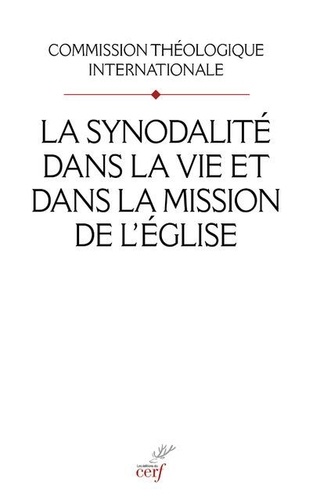
Religion
La synodalité dans la vie et dans la mission de l'Eglise
09/2019
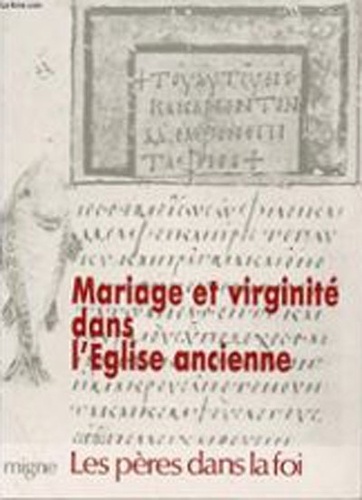
Religion
Mariage et virginité dans l'Eglise ancienne
07/1997
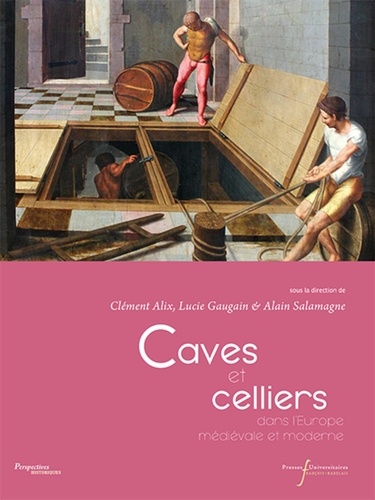
Histoire internationale
Caves et celliers dans l'Europe médiévale et moderne
10/2019
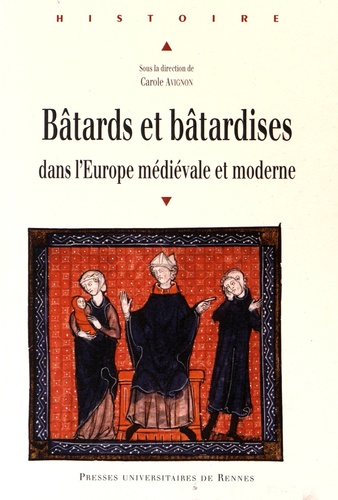
Sciences historiques
Bâtards et bâtardises dans l'Europe médiévale et moderne
08/2016
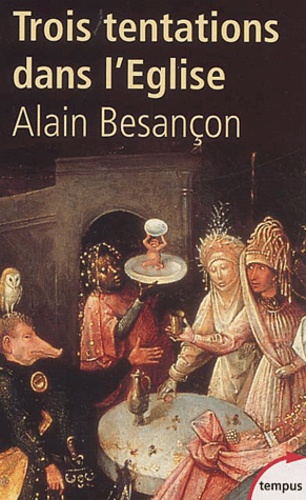
Religion
Trois tentations dans l'Eglise
09/2002
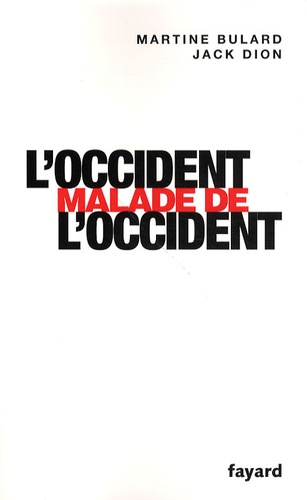
Sciences politiques
L'Occident malade de l'Occident
10/2009
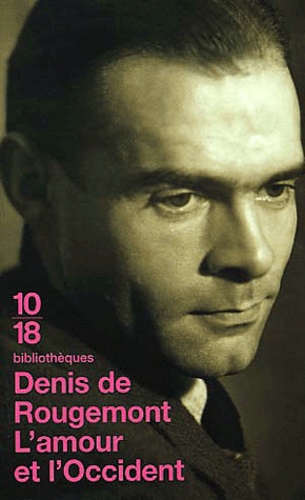
Critique littéraire
L'amour et l'Occident
06/2006
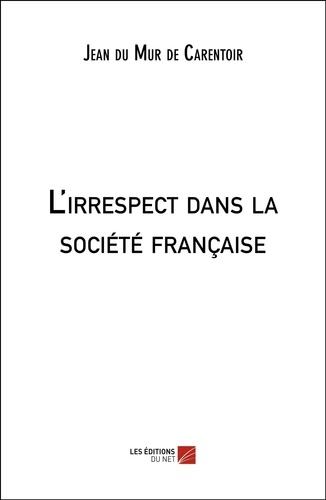
Littérature française
L'irrespect dans la société française
10/2020
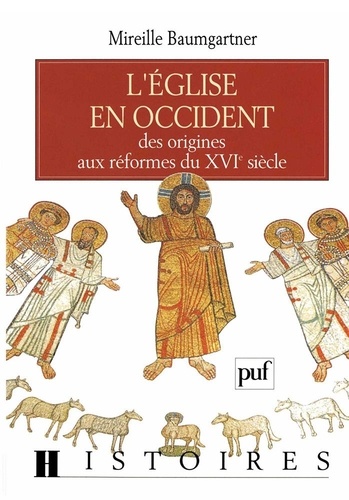
Religion
L'Église en Occident. Des origines aux réformes du XVIe siècle
02/1999
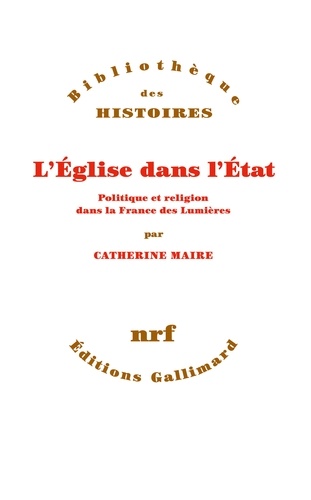
Religion
L'Eglise dans l'Etat. Politique et religion dans la France des Lumières
10/2019
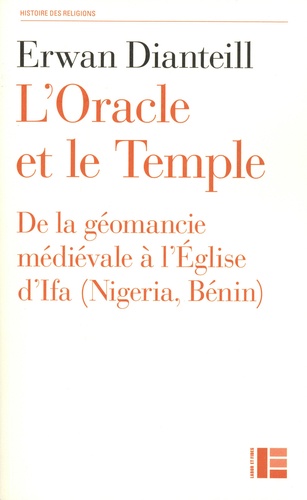
Esotérisme
L'oracle et le temple. De la géomancie médiévale à l'Eglise d'Ifa (Nigeria, Bénin)
01/2024
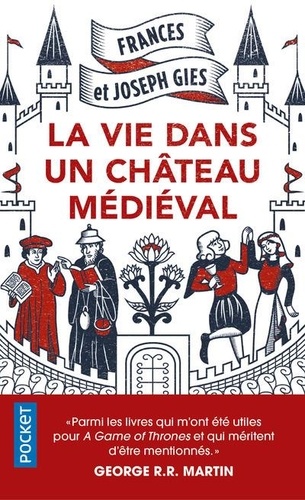
Ouvrages généraux et thématiqu
La vie dans un château médiéval
05/2021
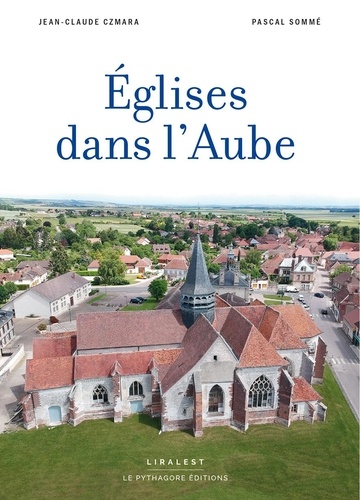
XIXe siècle
Églises dans l'Aube
11/2022
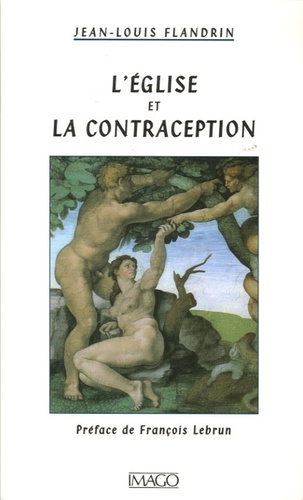
Religion
L'Eglise et la contraception
06/2006
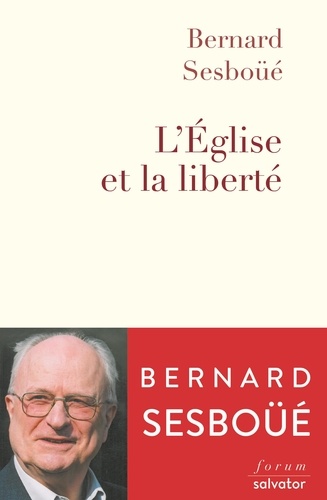
Religion
L'Eglise et la liberté
03/2019
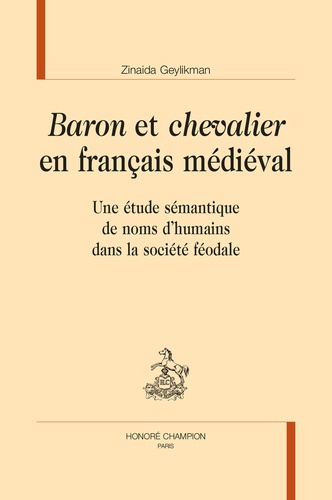
Linguistique médiévale
Baron et chevalier en français médiéval. Une étude sémantique de noms d'humains dans la société féodale
01/2022
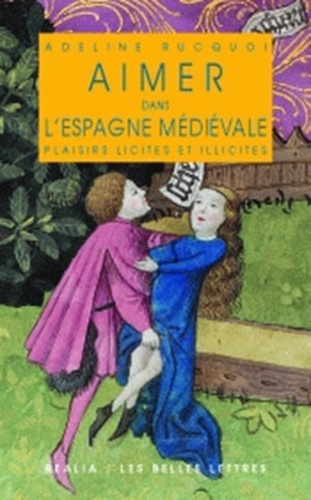
Histoire internationale
Aimer dans l'Espagne médiévale. Plaisirs licites et illicites
05/2008
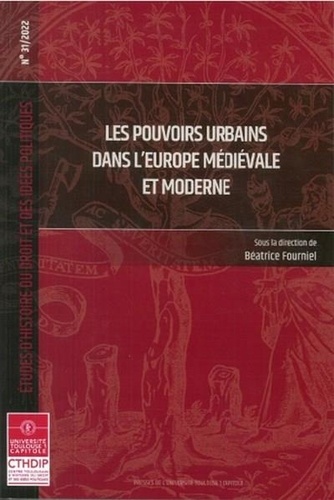
Histoire du droit
Les pouvoirs urbains dans l'Europe médiévale et moderne
01/2023
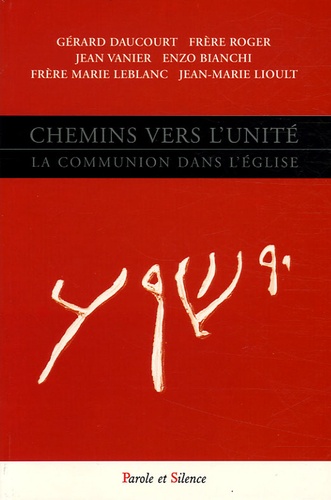
Religion
Chemins vers l'unité. La communion dans l'Eglise
12/2005

