Sakanyi henri Mova
Extraits
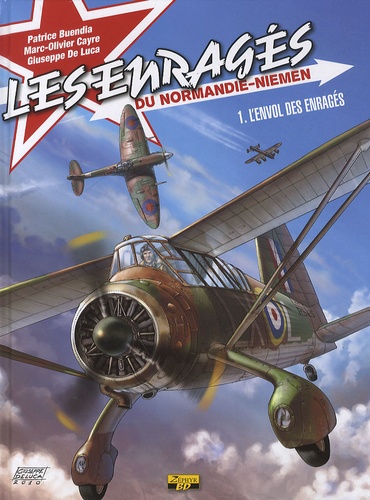
BD tout public
Les enragés du Nomandie-Niemen Tome 1 : L'envol des enragés
06/2010
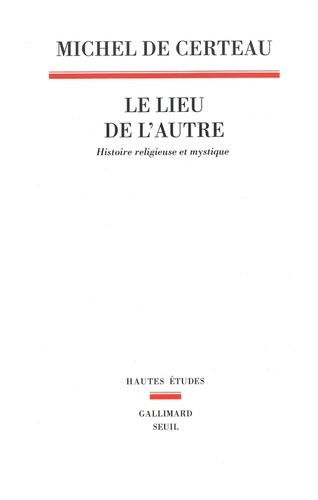
Sciences historiques
Le lieu de l'autre. Histoire religieuse et mystique
10/2005
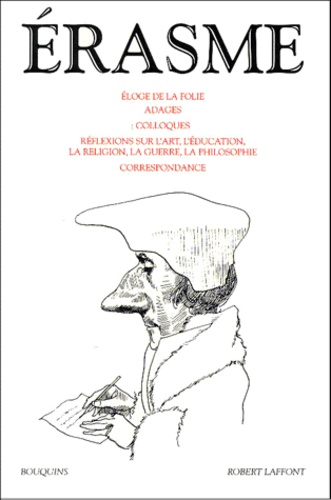
Philosophie
Éloge de la folie. Adages. Colloques...
02/2000
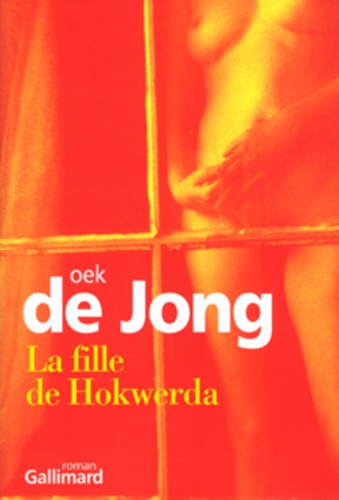
Littérature étrangère
La fille de Hokwerda
09/2004
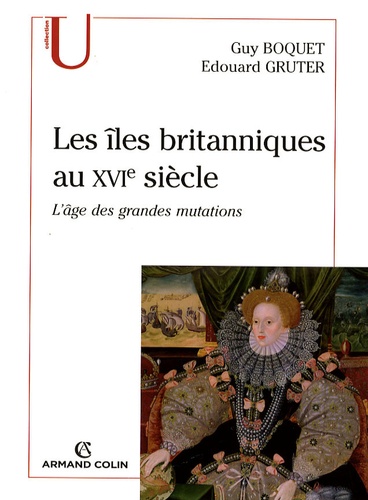
Histoire internationale
Les îles britanniques au XVIe siècle. L'âge des grandes mutations ?
07/2007
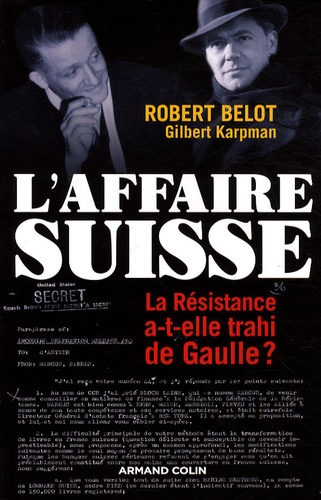
Histoire de France
L'affaire suisse. La Résistance a-t-elle trahi de Gaulle ? (1943-1944)
02/2009
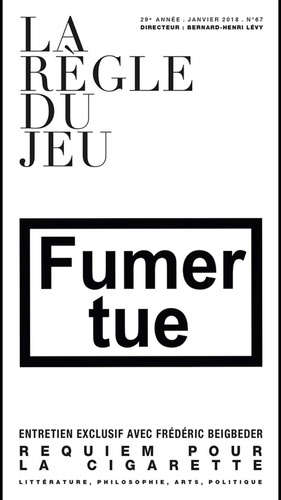
Actualité et médias
La Règle du jeu N° 67, janvier 2019 : Fumer tue
01/2019
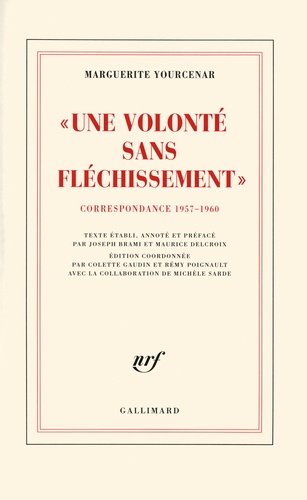
Critique littéraire
Une volonté sans fléchissement. Correspondance 1957-1960 (D'Hadrien à Zénon, II)
11/2007
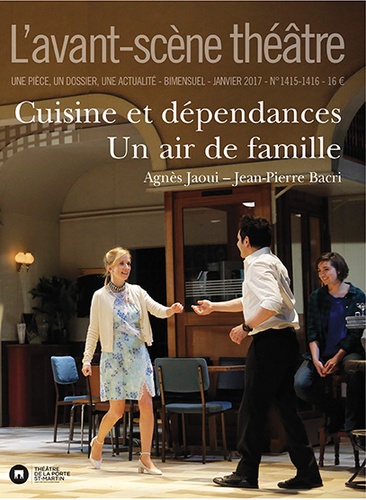
Théâtre
L'Avant-scène théâtre N° 1415-1416, janvier 2017 : Cuisine et dépendances ; Un air de famille
02/2017
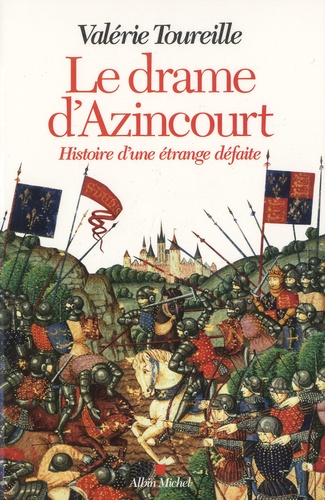
Histoire de France
Le drame d'Azincourt. Histoire d'une étrange défaite
09/2015
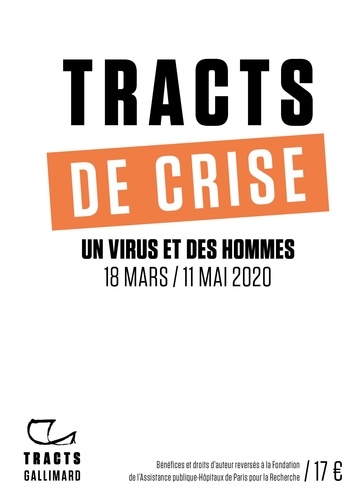
Actualité et médias
Tracts de crise. Un virus et des hommes 18 mars/11 mai 2020
06/2020
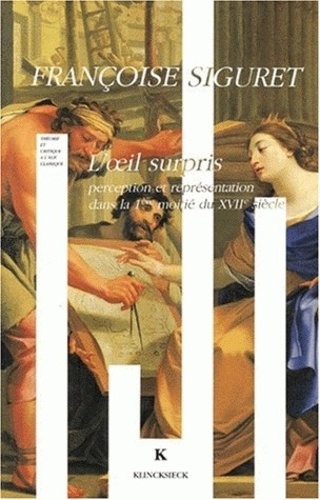
Critique littéraire
L'OEIL SURPRIS. Perception et représentation dans la première moitié du XVIIème siècle, édition 1993 entièrement revue et augmentée
06/1993
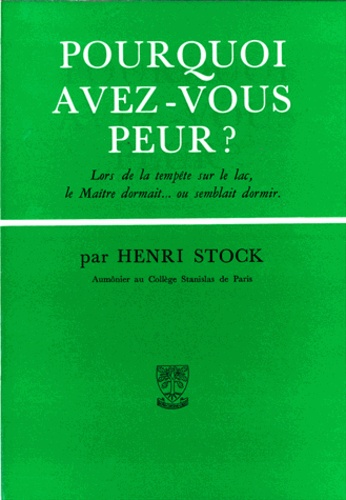
Religion
Pourquoi avez-vous peur ? lors de la tempete sur le lac, le maitre dormait... ou semblait dormir
04/1997
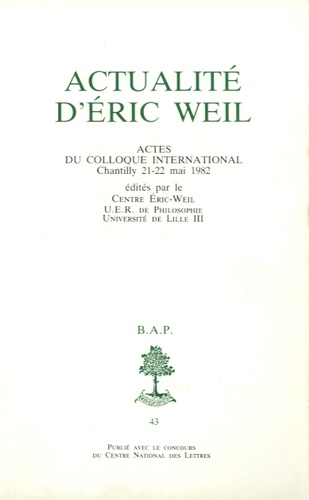
Philosophie
Actualité d'Eric Weil. Actes du colloque international, Chantilly 21-22 mai 1982
03/1984
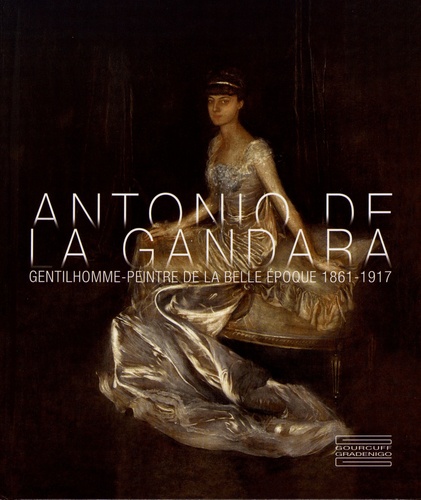
Beaux arts
Antonio de La Gandara. Gentilhomme-peintre de la Belle Epoque (1861-1917)
11/2018
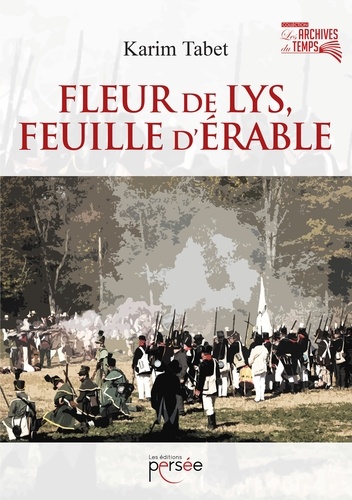
Romans historiques
Fleur de lys, feuille d'érable
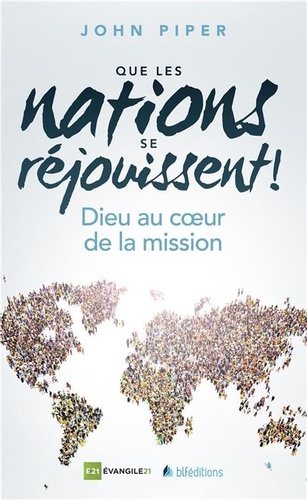
Religion
Que les nations se réjouissent ! Dieu au coeur de la mission
10/2015
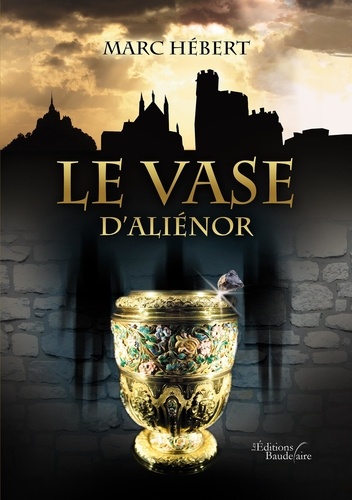
Littérature française
Le vase d'Aliénor
04/2021
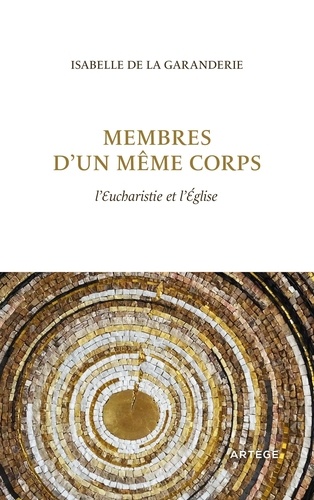
Prière et spiritualité
Membres d'un même corps. L'Eucharistie et l'Eglise
10/2022
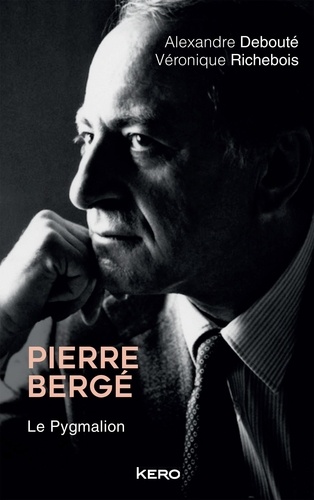
Décoration
Pierre Bergé. Le Pygmalion
01/2020
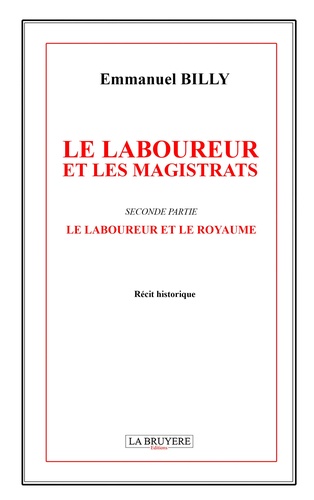
XVIIIe siècle
Le Laboureur et les Magistrats. Seconde partie : Le Laboureur et le Royaume
03/2023
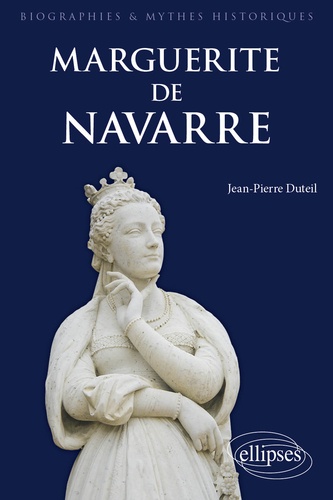
XVIe siècle
Marguerite de Navarre
05/2021
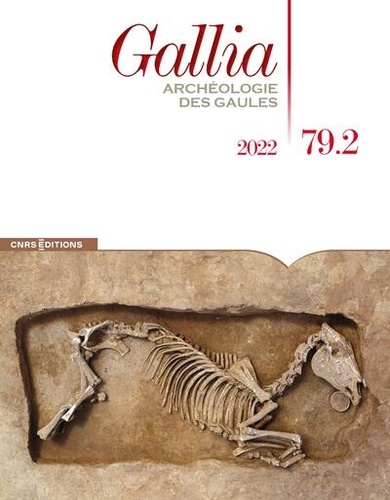
Archéologie
Gallia N° 79-2, 2022
04/2023
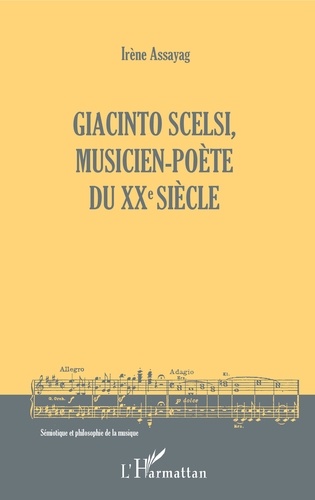
Musique, danse
Giacinto Scelsi, musicien-poète du XXe siècle
12/2017
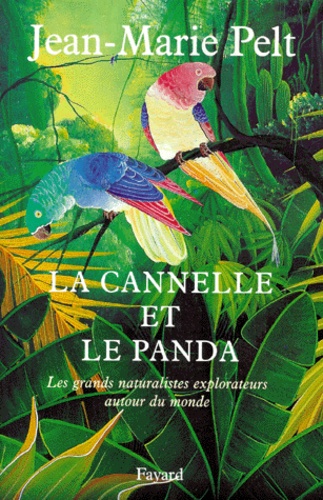
Développement durable-Ecologie
LA CANNELLE ET LE PANDA. Les grands naturalistes explorateurs autour du monde
10/1999
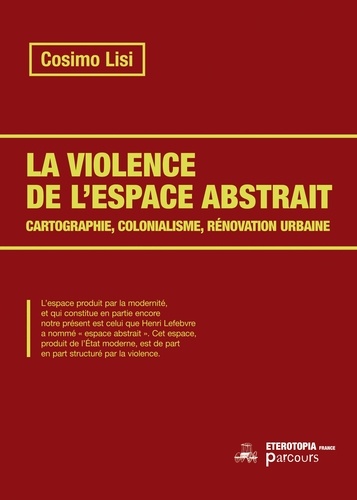
Géograhie urbaine
Paris capitale coloniale. Cartographie, colonialisme, rénovation urbaine
01/2024
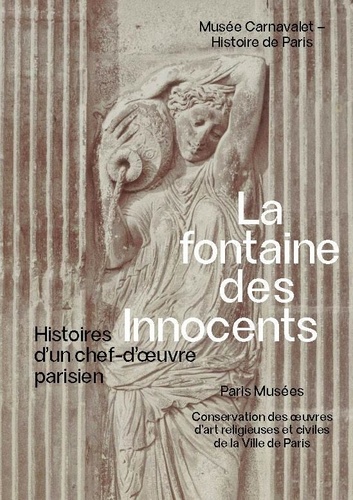
Musées français
Fontaine des Innocents. Histoire d'un chef-d'oeuvre parisien - Musée Carnavalet 2024
05/2024
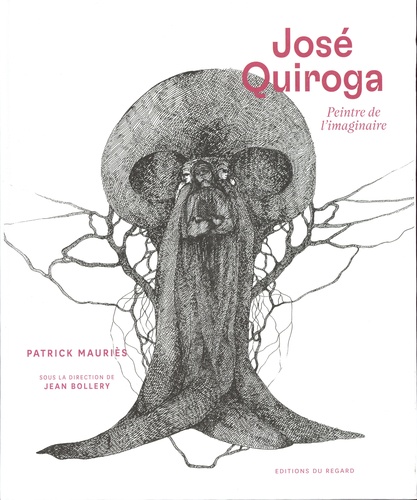
Monographies
José Quiroga. Peintre de l'imaginaire
05/2023
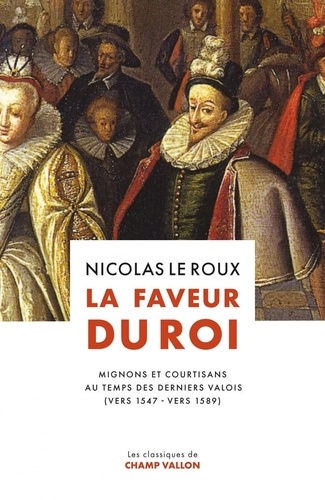
Renaissance
La faveur du roi. Mignons et courtisans au temps des derniers Valois, vers 1547- vers 1589)
02/2024
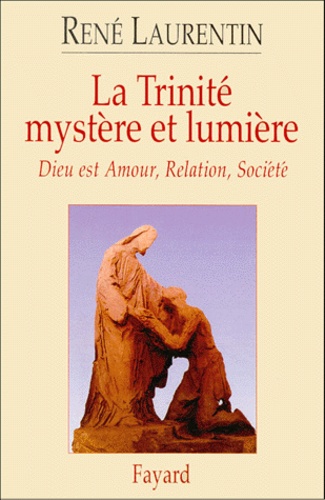
Religion
LA TRINITE, MYSTERE ET LUMIERE. Dieu est Amour, Relation, Société
11/1999

