Henri Haas
Extraits
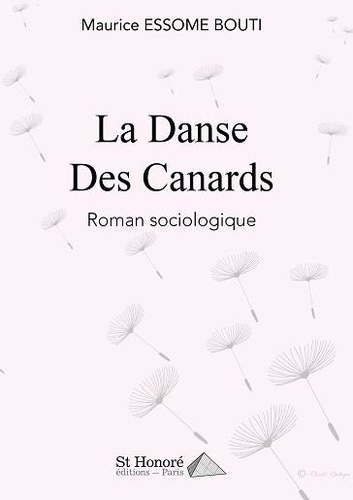
Littérature française
La Danse Des Canards
11/2019
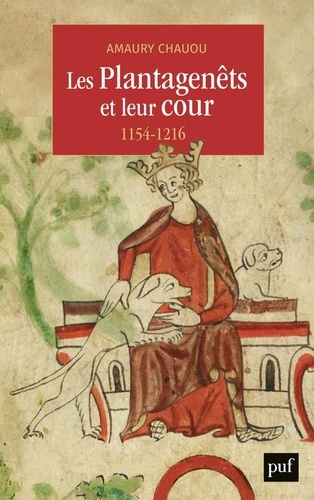
Histoire de France
Les Plantagenêts et leur cour (1154-1216)
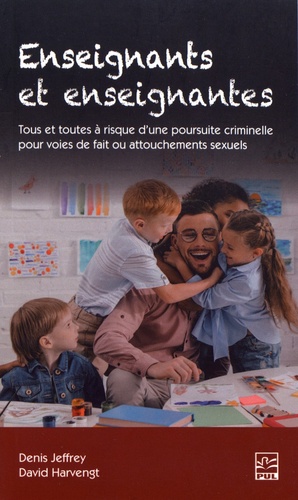
Pédagogie
Enseignants et enseignantes. Tous et toutes à risque d'une poursuite criminelle pour voies de fait ou attouchements sexuels
04/2020
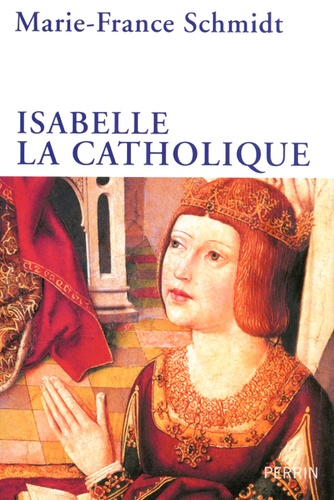
Histoire internationale
Isabelle la Catholique
10/2014
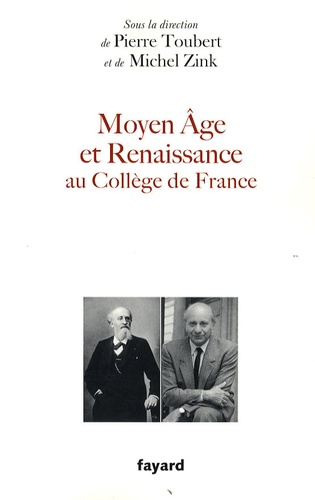
Sciences historiques
Moyen Age et Renaissance au Collège de France. Leçons inaugurales
06/2009
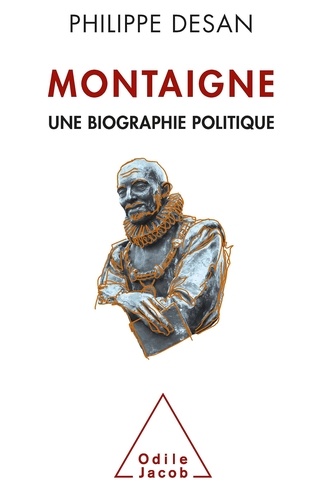
Philosophie
Montaigne. Une biographie politique
04/2014
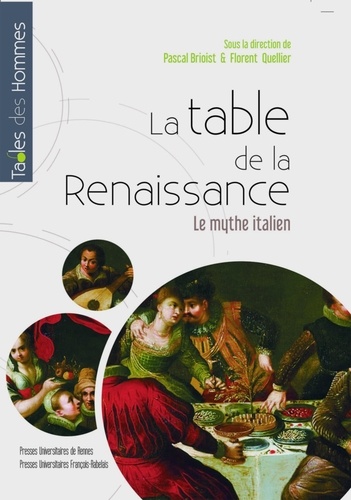
Sciences historiques
La table de la Renaissance. Le mythe italien
06/2018
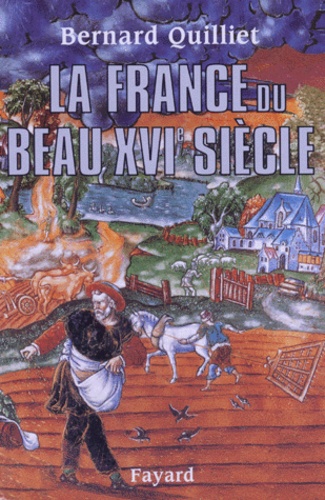
Histoire ancienne
La France du beau XVIème siècle. 1490-1560
11/1998
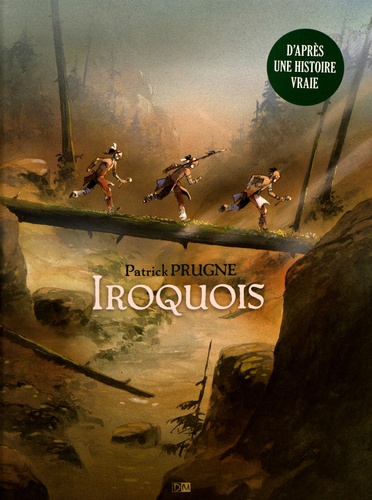
BD tout public
Iroquois
08/2016
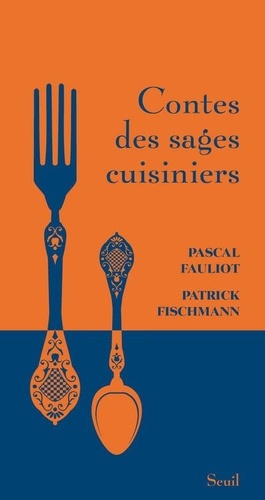
Littérature française
Contes des sages cuisiniers
03/2014
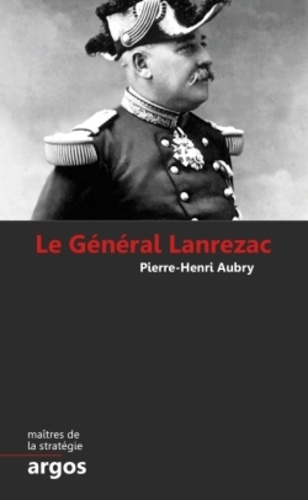
Sciences historiques
Le général Lanrezac
11/2015
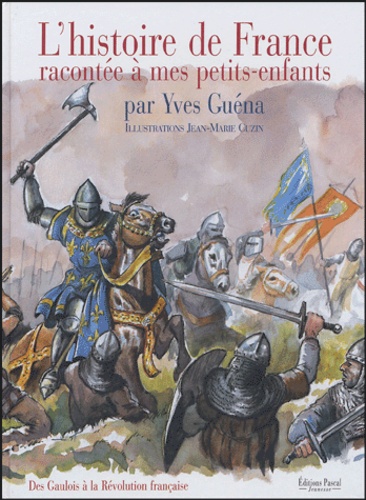
Documentaires jeunesse
L'histoire de France. Racontée à mes petits-enfants
11/2004
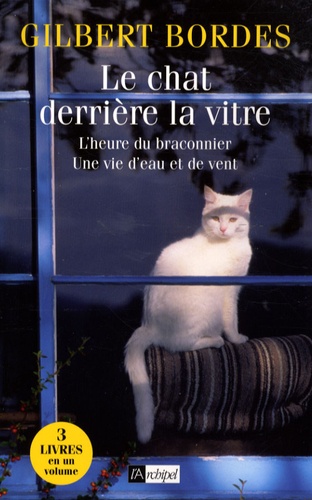
Littérature française
Le chat derrière la vitre ; L'heure du braconnier ; Une vie d'eau et de vent
08/2008
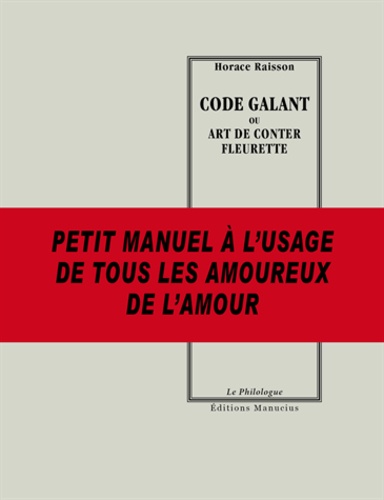
Littérature française
Code galant ou art de conter fleurette
02/2013
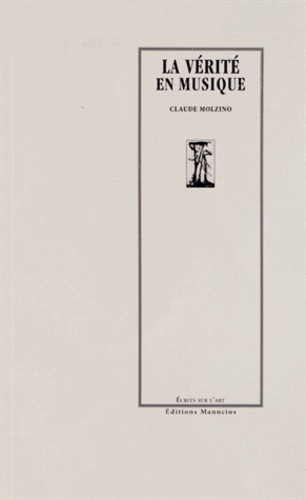
Musique, danse
La vérité en musique
01/2013
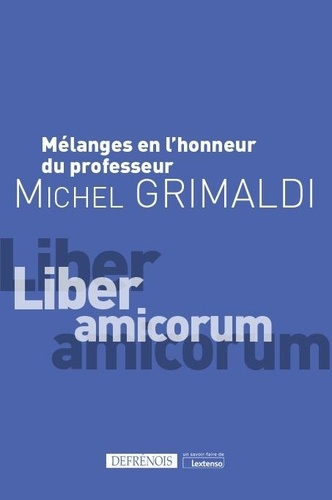
Droit
Mélanges en l'honneur du professeur Michel Grimaldi. Liber amicorum
10/2020
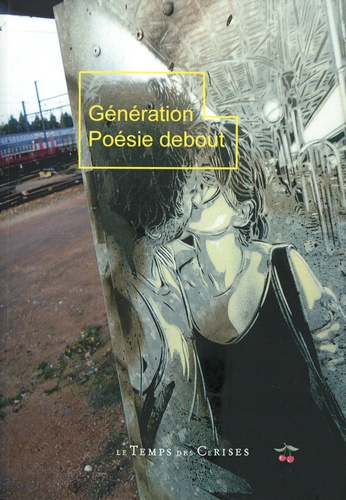
Poésie
Génération Poésie debout
06/2019
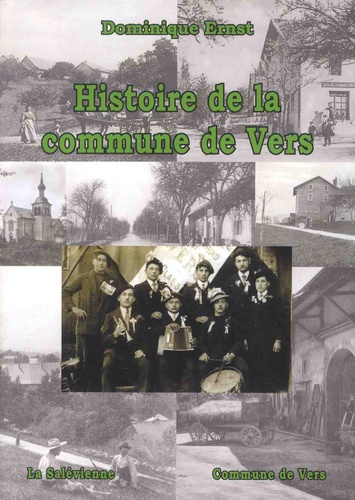
Régionalisme
Histoire de la commune de Vers
06/2012
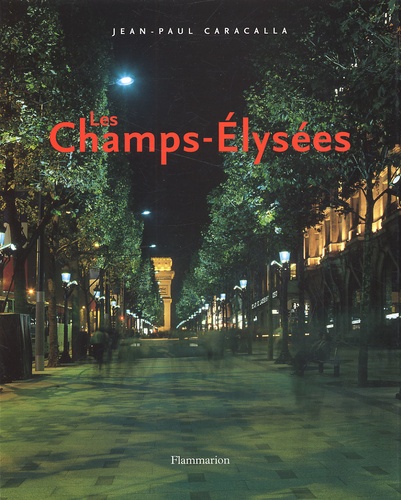
Sciences historiques
Les Champs-Elysées
07/2002
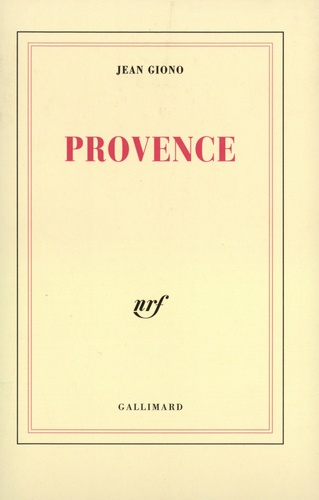
Littérature française
Provence
12/1993
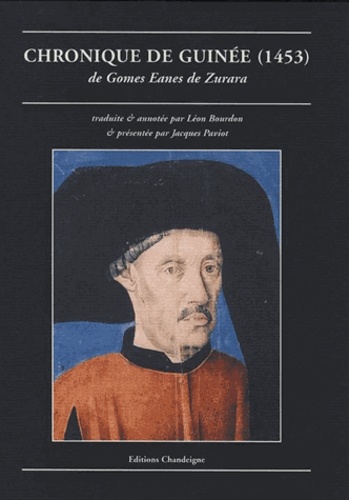
Récits de voyage
Chronique de Guinée (1453)
11/2011
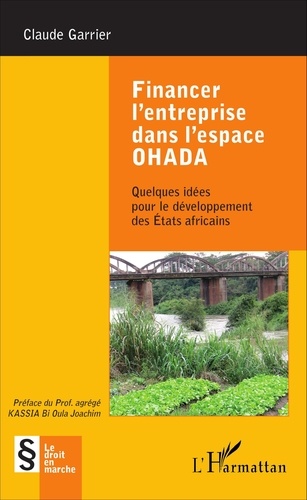
Droit
Financer l'entreprise dans l'espace OHADA. Quelques idées pour le développement des Etats africains
09/2016
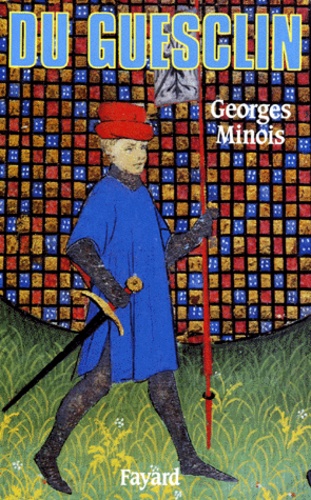
Histoire de France
Du Guesclin
11/1996
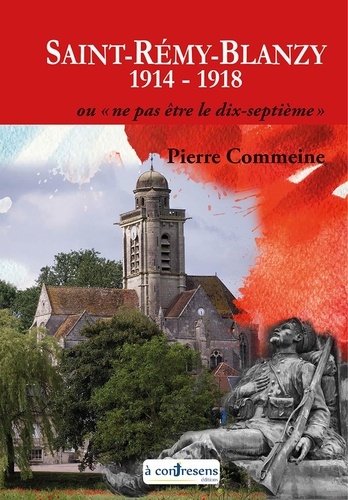
Non classé
Saint-remy-blanzy 1914 - 1918
07/2018
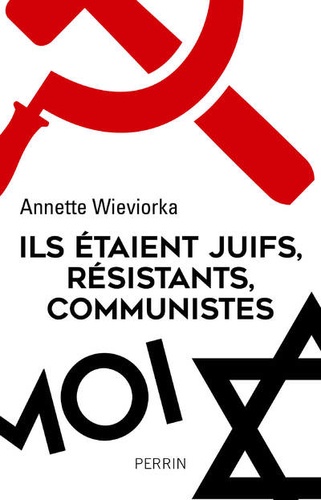
Histoire de France
Ils étaient juifs, résistants, communistes
08/2018
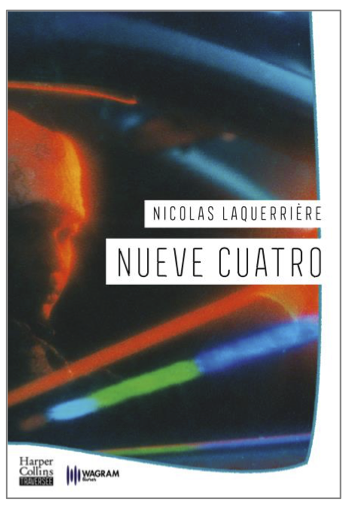
Littérature française
Nueve Cuatro
Qui connaît le 9-4 ? Qui connaît ceux qui y vivent et y survivent ? Et surtout, qui connaît son miroir inversé, le 9-4 dans le 9-4, le nueve cuatro ? Un pays des merveilles peuplé de paumés, de cramés, de caïds, de macs, d'animaux sauvages et de toutes les histoires extraordinaires qui vont avec.
Parmi eux, Henri, comptable à la retraite, qui a perdu sa moitié puis un orteil pour cause de diabète. Son quotidien ressemble à un long fleuve tranquille, jusqu'au jour où sa voisine Clara disparaît des radars. Soulaymane, recouvreur de dettes à la petite semaine, rêvait de devenir flic. Chercher cette fille, c'est ce qui lui manquait pour relancer son coeur au ralenti. Brahim, enfin, boss du nueve cuatro. Son règne semble éternel, mais il commence à perdre la tête. Mettre sa ville à feu et à sang sera son dernier coup d'éclat. Tous n'ont pas la démesure de vouloir imprimer l'histoire, pourtant, avec cette disparition, chacun va vivre sa grande épopée. Odyssée noire et conte urbain empreint d'une folle humanité, Nueve Cuatro offre une vision de la banlieue à nulle autre pareille. Une nouvelle voix explosive est née. A propos de l'auteur Passé par la Fémis, NICOLAS LAQUERRIERE, trente-deux ans, est le coscénariste de la série à succès Validé. Il vit depuis toujours à Choisy-le-Roi, au coeur de ce 94 dont il a fait la grande héroïne de son premier roman.
02/2022
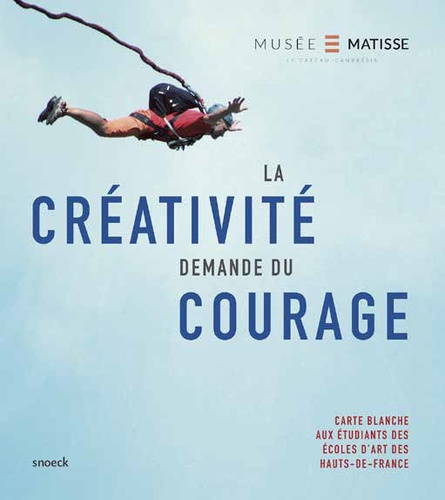
Beaux arts
La créativité demande du courage. Carte blanche aux étudiants des Ecoles d'art des Hauts-de-France
03/2019
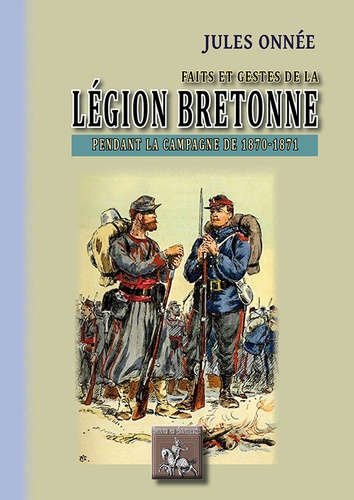
Sciences historiques
Faits et gestes de la légion bretonne pendant la campagne de 1870-1871
03/2019
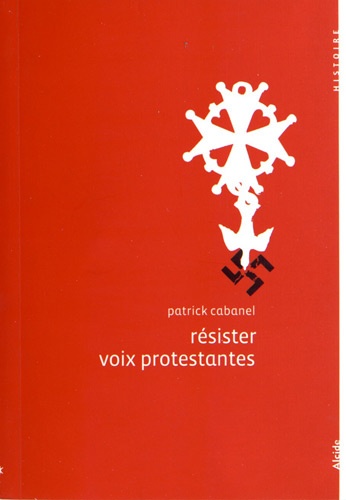
Religion
Résister, voix protestantes
06/2012
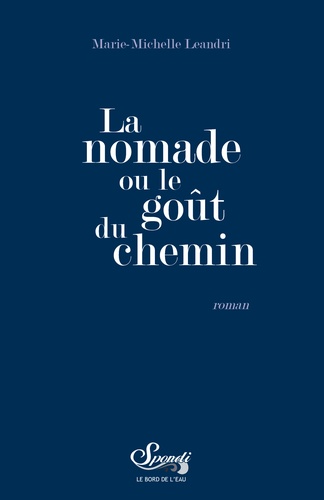
Littérature française
La nomade ou le goût du chemin
05/2015

