exemption impôts militaires
Extraits
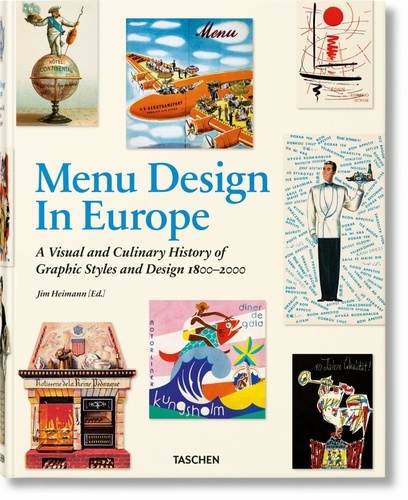
Graphisme
Menu Design in Europe
07/2022
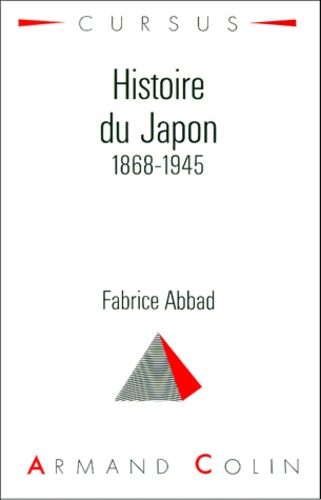
Histoire internationale
HISTOIRE DU JAPON 1868-1945
11/1999
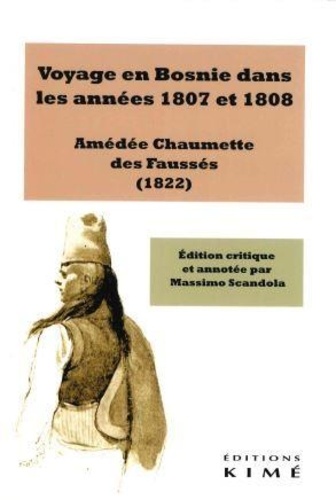
Récits de voyage
Voyage en Bosnie dans les années 1807 et 1808
05/2023
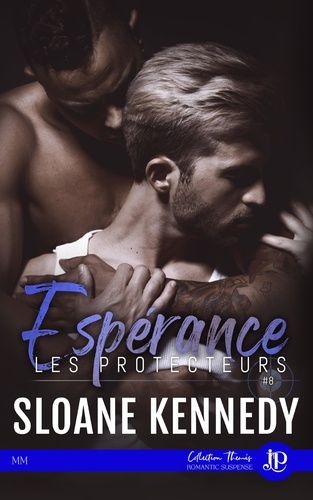
Romance et érotique LGBT
Les protecteurs Tome 8 : Espérance
11/2021
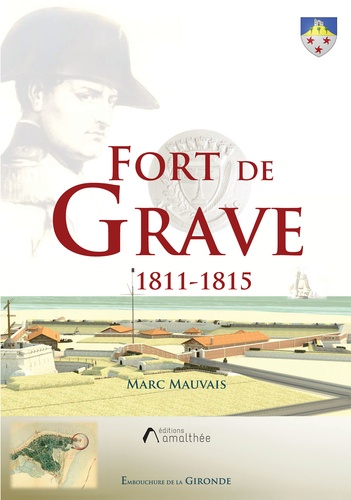
Histoire contemporaine
Fort de Grave
11/2021
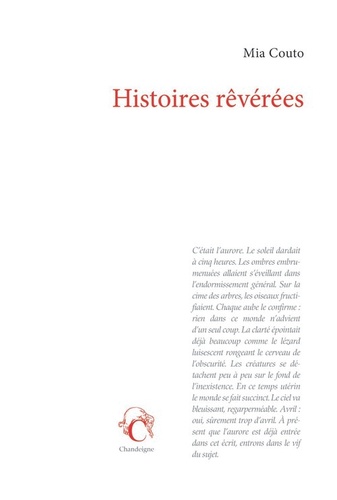
Littérature étrangère
Histoires rêvérées
09/2016
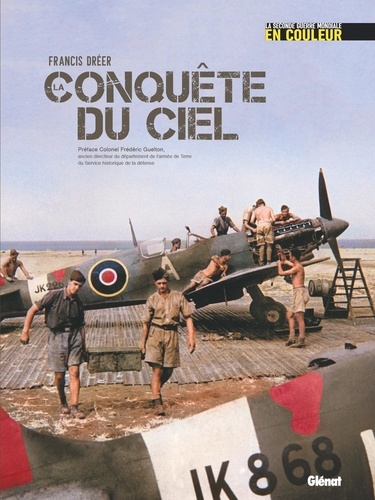
Histoire militaire
La conquête du ciel
10/2021
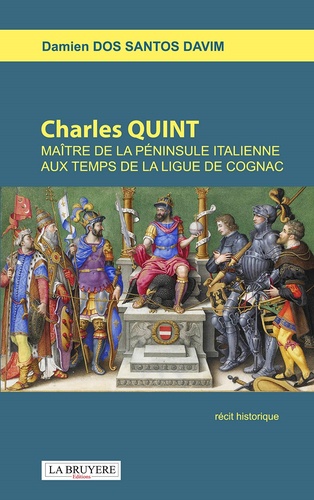
Italie
Charles Quint maître de la péninsule italienne aux temps de la ligue de Cognac
10/2021
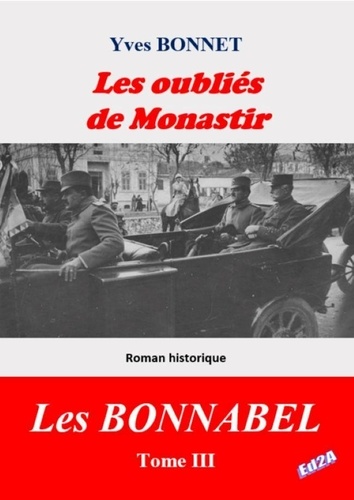
Littérature française
Les Bonnabel Tome 3 : Les oubliés de Monastir
05/2023
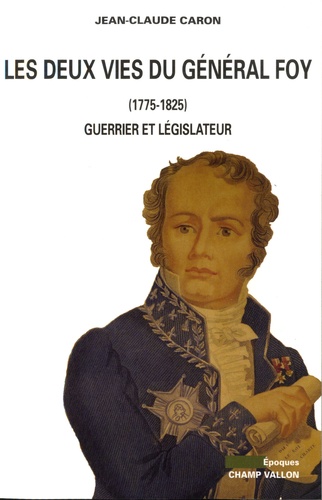
Histoire de France
Les deux vies du général Foy (1775-1825). Guerrier et législateur
08/2014
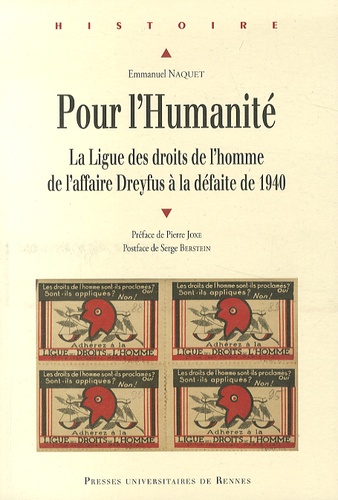
Sciences politiques
Pour l'Humanité. La ligue des Droits de l'homme, de l'affaire Dreyfus à la défaite de 1940
08/2014
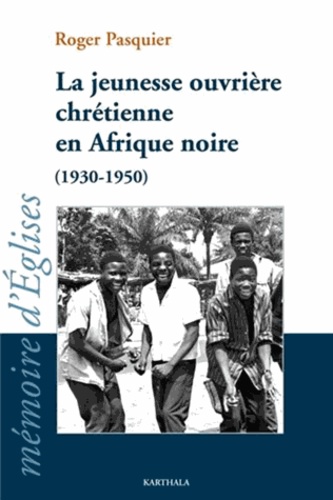
Religion
La jeunesse ouvrière chrétienne en Afrique noire (1930-1950)
12/2013
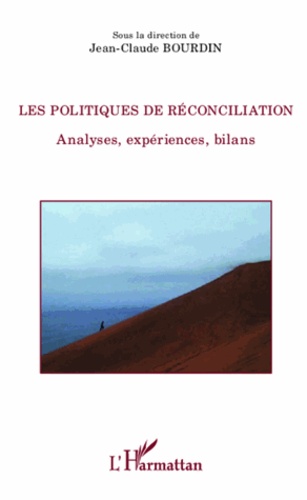
Philosophie
Les politiques de réconciliation. Analyses, expériences, bilans
12/2013
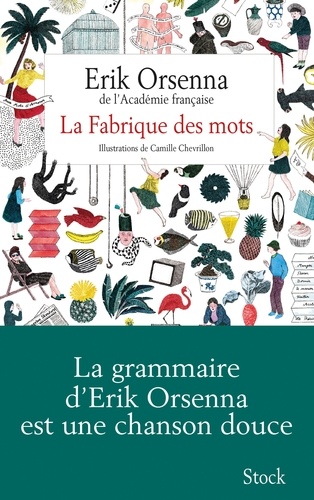
Littérature française
La fabrique des mots
04/2013
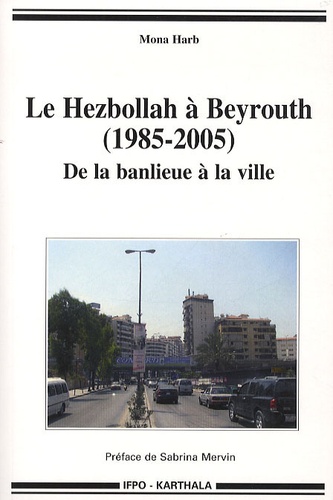
Histoire internationale
Le Hezbollah à Beyrouth (1985-2005). De la banlieue à la ville
10/2010
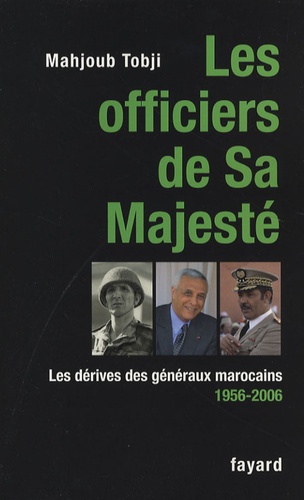
Histoire internationale
Les officiers de Sa Majesté. Les dérives des généraux marocains 1956-2006
09/2006
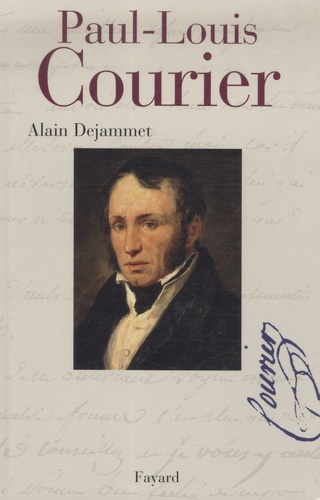
Critique littéraire
Paul-Louis Courier, vies...
03/2009
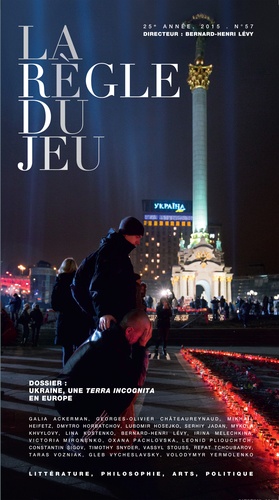
Actualité et médias
La Règle du jeu N° 57, mai 2015 : Ukraine, une terra incognita en Europe
05/2015
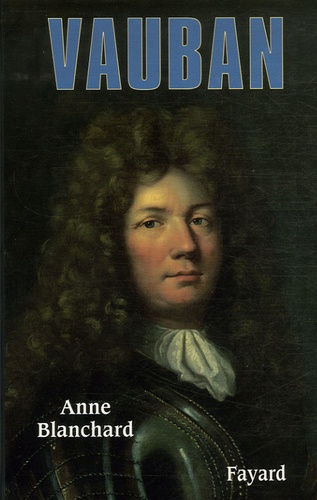
Histoire de France
Vauban. Edition revue et corrigée
05/2007
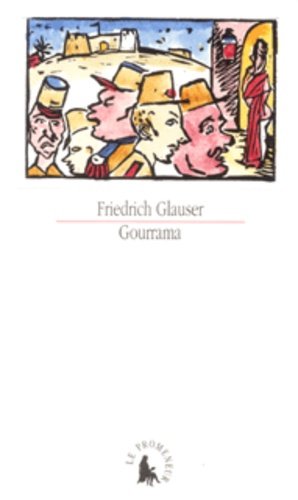
Littérature étrangère
Gourrama
04/2002
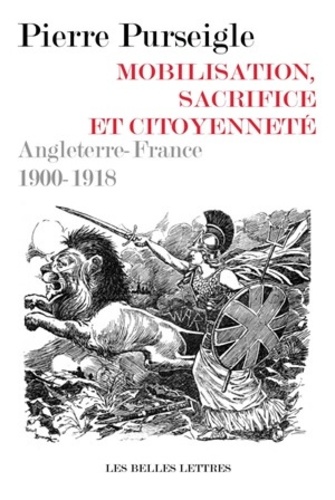
Histoire de France
Mobilisation, sacrifice et citoyenneté. Angleterre-France 1900-1918
09/2013
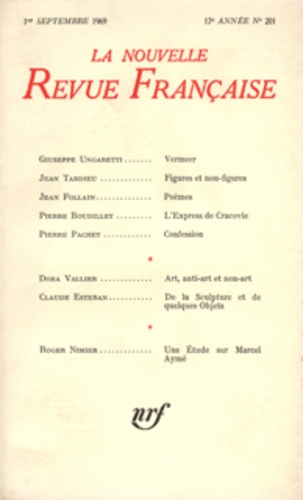
Critique littéraire
La Nouvelle Revue Française N° 201 sept 1969
09/1969
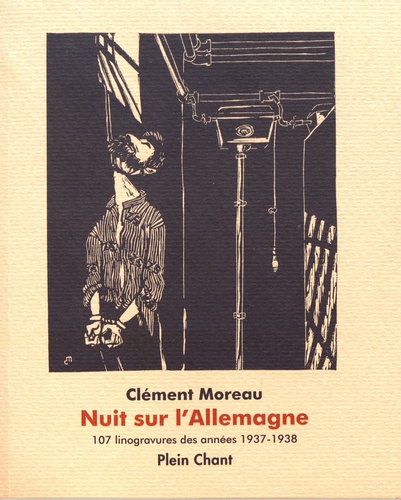
Décoration
Nuit sur l'Allemagne. 107 linogravures des années 1937-1938
01/2018
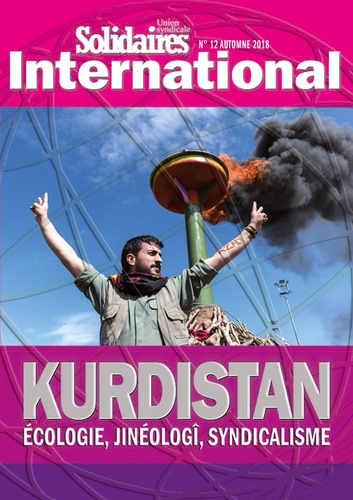
Histoire internationale
Kurdistan. Solidaires international
10/2018
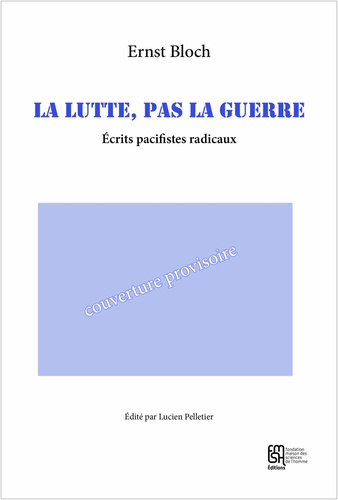
Philosophie
La lutte, pas la guerre. Ecrits pacifistes radicaux (1918)
11/2018
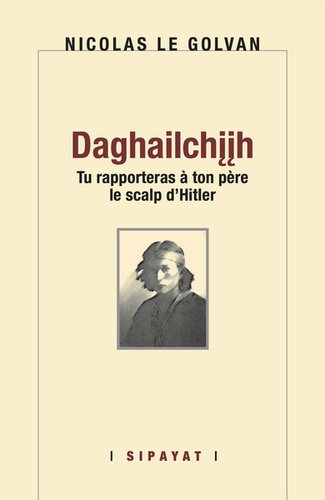
Littérature française
Daghailchiih. Tu rapporteras à ton père le scalp d'Hitler
02/2017
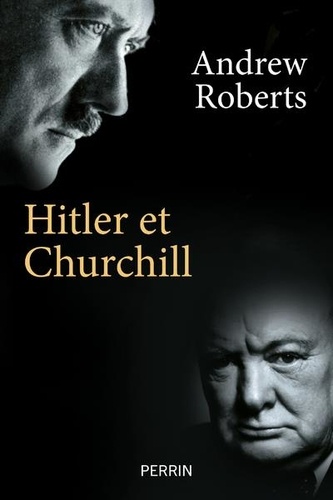
ouvrages généraux
Hitler et Churchill
10/2022
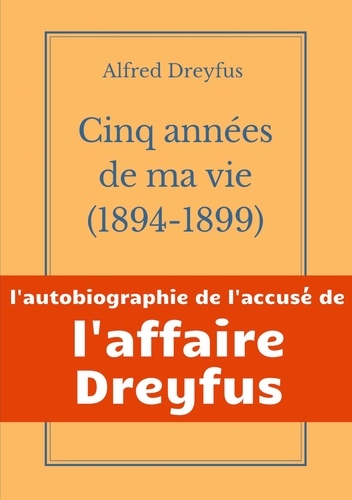
Troisième République
Cinq années de ma vie, 1894-1899. L'autobiographie de l'accusé de l'Affaire Dreyfus
04/2021
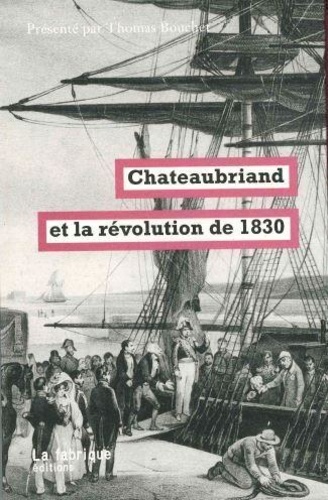
Histoire littéraire
Chateaubriand et la révolution de 1830
05/2022
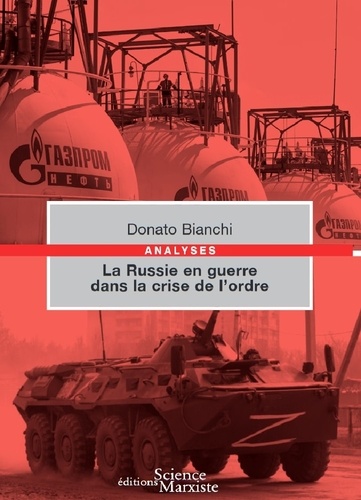
Actualité politique internatio
La Russie en guerre dans la crise de l'ordre
01/2023

