Nogent
Extraits
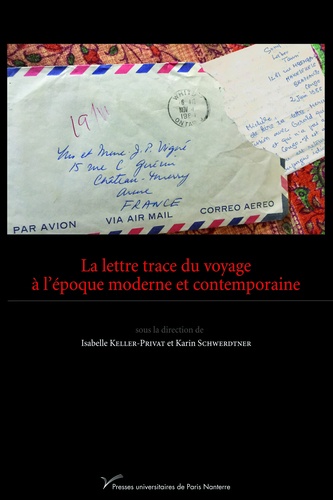
Critique littéraire
La lettre trace du voyage à l'époque moderne et contemporaine
05/2019
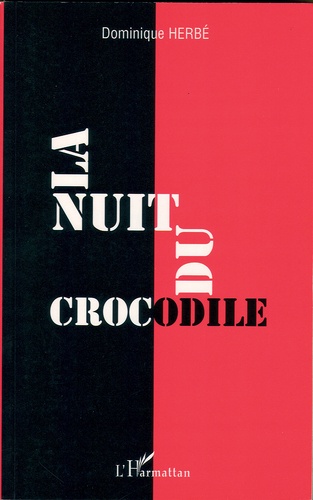
Littérature française
La nuit du crocodile
01/2005
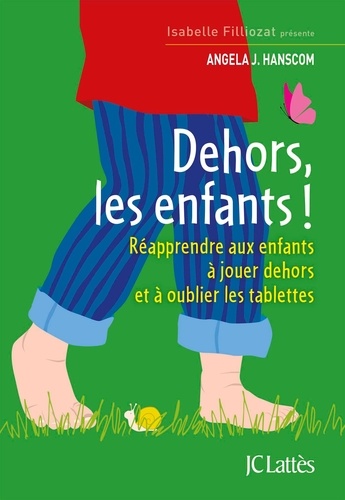
Couple, famille
Dehors les enfants ! Réapprendre aux enfants à jouer dehors et à oublier les tablettes
05/2018
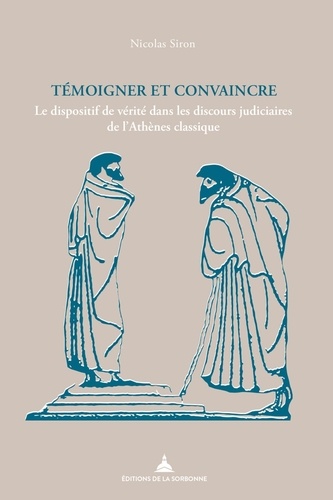
Histoire ancienne
Témoigner et convaincre. Le dispositif de vérité dans les discours judiciaires de l'Athènes classique
09/2019
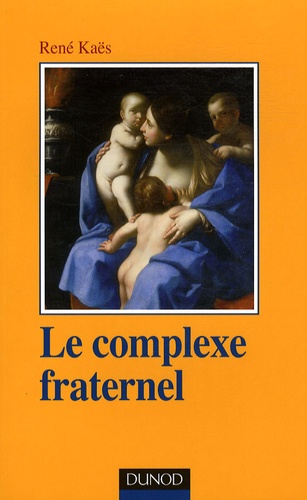
Psychologie, psychanalyse
Le complexe fraternel
04/2008
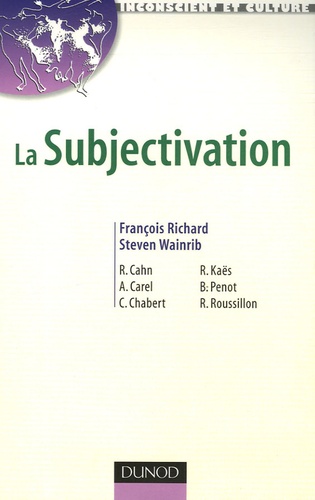
Psychologie, psychanalyse
La Subjectivation
05/2006
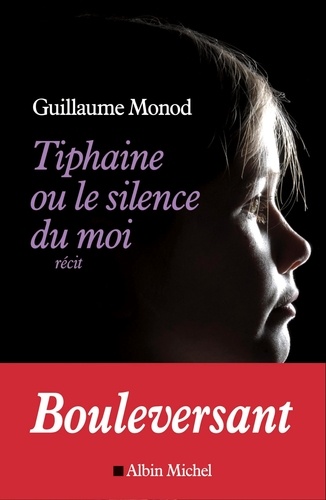
Littérature française
Tiphaine ou le silence du moi
10/2013
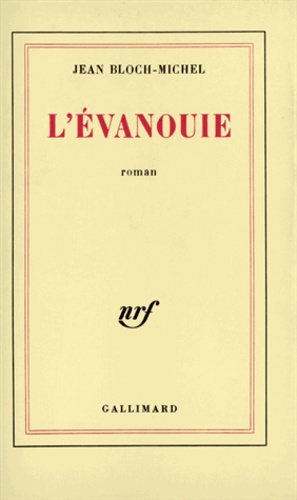
Littérature française
L'évanouie
10/1985
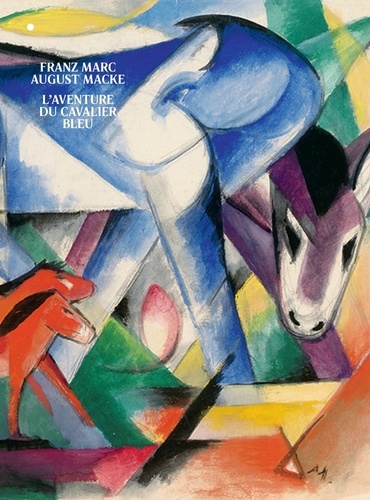
Beaux arts
Franz Marc August Macke. L'aventure du cavalier bleu
03/2019
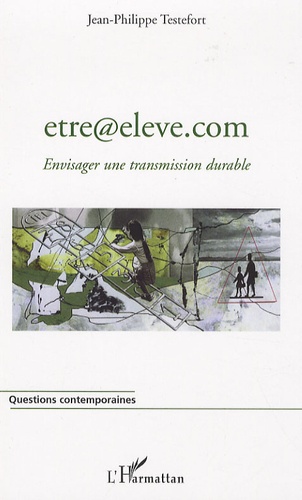
Pédagogie
etre@eleve.com. Envisager une transmission durable
02/2009
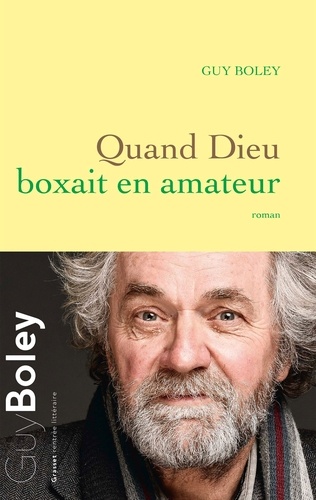
Littérature française
Quand Dieu boxait en amateur
08/2018
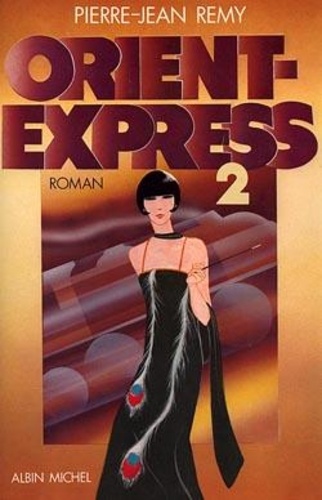
Littérature française
Orient-Express Tome 2
06/1984
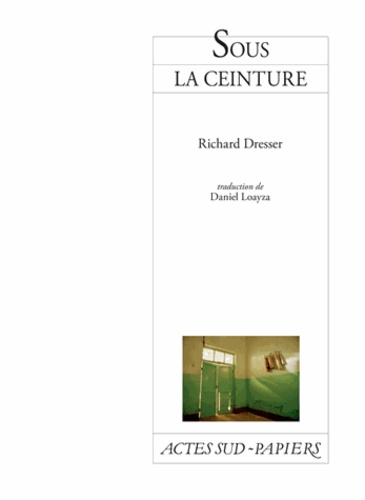
Théâtre
Sous la ceinture
01/2013
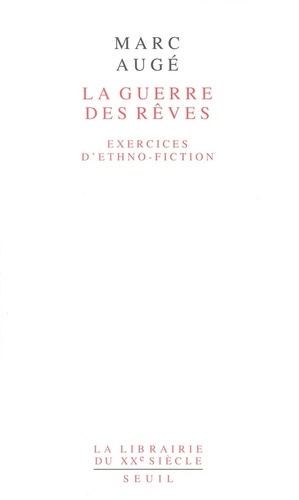
Ethnologie
LA GUERRE DES REVES. Exercices d'ethno-fiction
04/1997
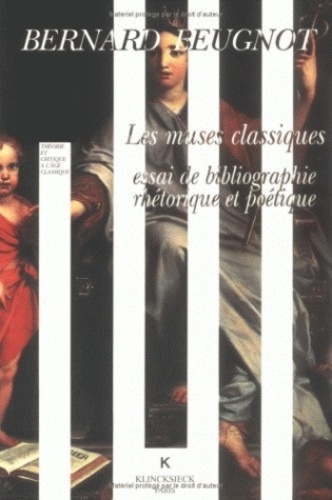
Critique littéraire
Les muses classiques. Essai de bibliographie rhétorique et poétique, 1610-1716
12/1996
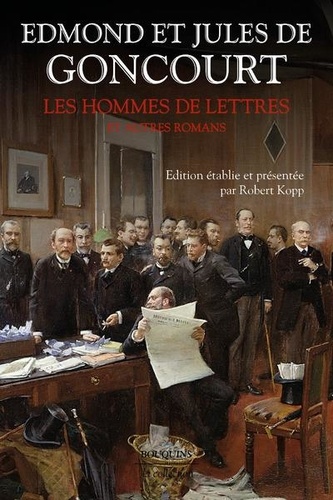
Littérature française
Les hommes de lettres et autres romans
09/2022
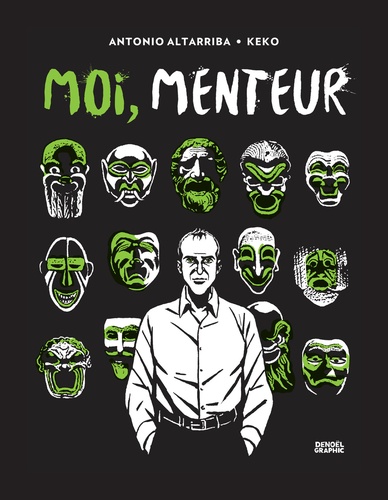
Romans graphiques
Moi, menteur
03/2021
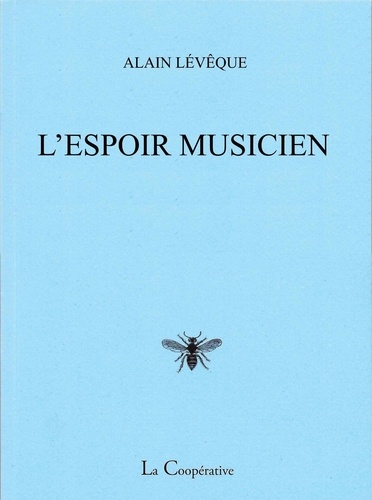
Poésie
L'espoir musicien. 1e édition
05/2021
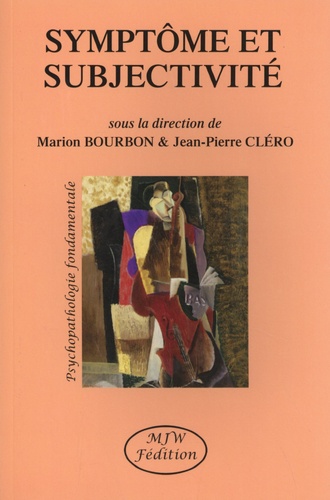
Autres troubles du comportemen
Symptôme et subjectivité
01/2022
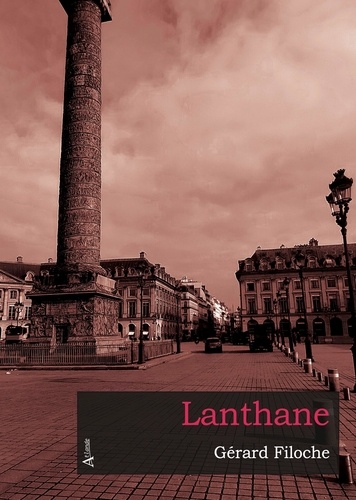
Romans policiers
Lanthane
03/2024

Divers
Baguenaudes
Après Guerre, récit très personnel ayant attrait à la mort et à l'amitié, Marion Jdanoff poursuit son travail de prospection personnelle. Cette fois, on reste sur le terrain relationnel mais personne ne va mourir. La question est plutôt "comment être proches ? " Baguenaudes est une tentative pour se sortir des fréquentes embûches qui ponctuent les relations intimes et la proximité des corps. Marion Jdanoff l'a avant tout fait pour elle, parce que son rapport aux interactions physiques lui semble compliqué. Il lui a paru soudain évident que le dessin et le récit en image serait le moyen idéal pour explorer ce terrain accidenté. Elle s'en sert comme de formidables outils d'invention, de matérialisations d'imaginaires, d'émotions. L'exercice est doublement passionnant : quelles images fabriquer et comment les fabriquer. Baguenaudes est une boîte à outils un peu bordélique qu'elle peut ouvrir pour raconter son rapport aux corps. Le sien, celui des autres. Un mode d'emploi et une boîte de jeux. Son profil Tinder en quelque sorte. Pourquoi publier une recherche aussi personnelle ? Bonne question. Parce qu'elle n'est pas un cas isolé. Nous sommes pris. e. s dans des maillages complexes de rapport de pouvoirs qui se logent jusqu'au fond de nos corps. Il n'est pas si étonnant que nous rencontrions des difficultés aux mêmes endroits. Comment inventer un truc à soi ? Comment et de quoi parler ? Se proposer des imaginaires, les construire, seul. e, à 2, à 3, à 18. Savoir les partager et les ajuster. Bref, d'abord baguenauder, l'alpinisme hyper technique viendra après . Et seulement si on en a envie. L'idée ici est de bricoler une série d'outils et les espérer ré-appropriables. D'où le pari de sortir Baguenaudes du tiroir.
11/2023
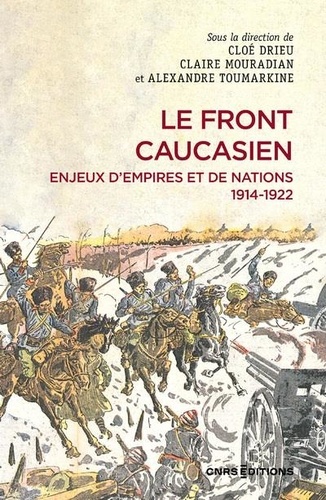
Première guerre mondiale
Le front caucasien. Enjeux d'empires et nations, 1914-1922
04/2024
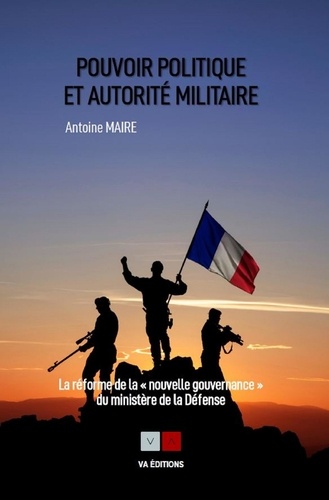
Sciences politiques
Pouvoir politique et autorité militaire. La réforme de la "nouvelle gouvernance" du ministère de la Défense
08/2022
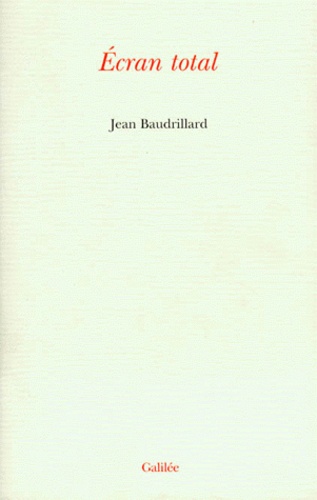
Philosophie
Écran total
09/1997
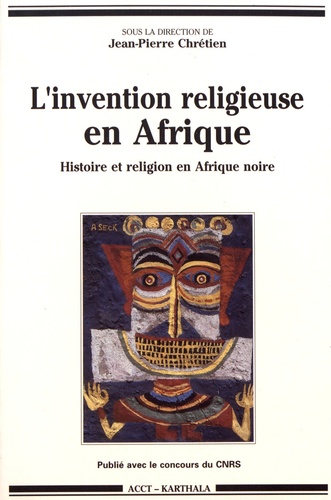
Ethnologie
L'invention religieuse en Afrique. Histoire et religion en Afrique noire
09/1993
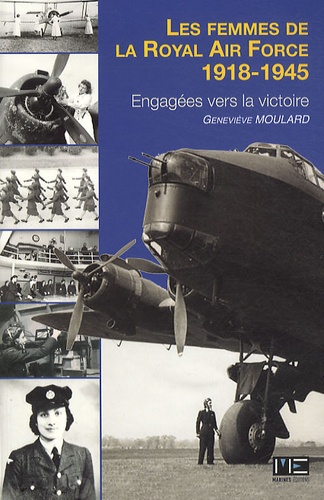
Sciences historiques
Les femmes de la royal Air Force. Engagées vers la victoire 1918-1945
02/2012
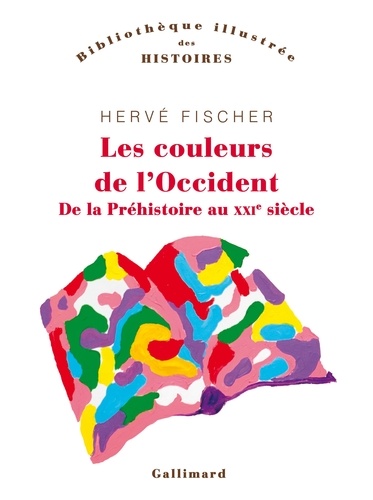
Beaux arts
Les couleurs de l'Occident. De la préhistoire au XXIe siècle
11/2019
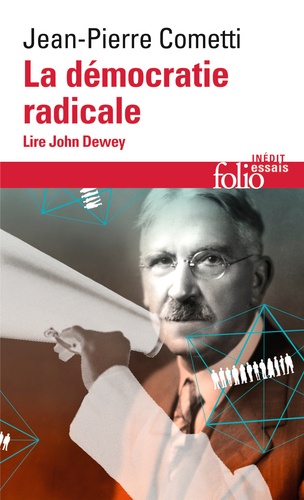
Philosophie
La démocratie radicale. Lire John Dewey
01/2016
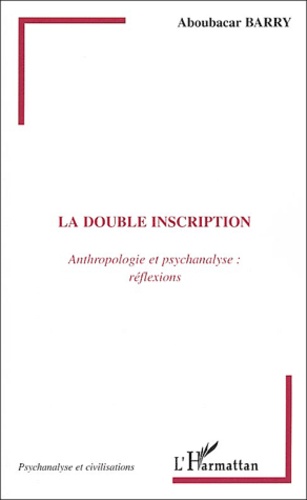
Psychologie, psychanalyse
La double inscription. Anthropologie et psychanalyse : réflexions
01/2004
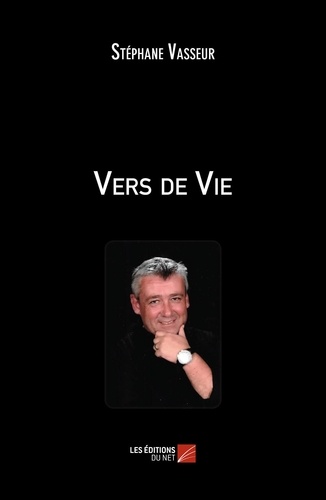
Poésie
Vers de Vie
10/2016

