Philipus Education
Extraits
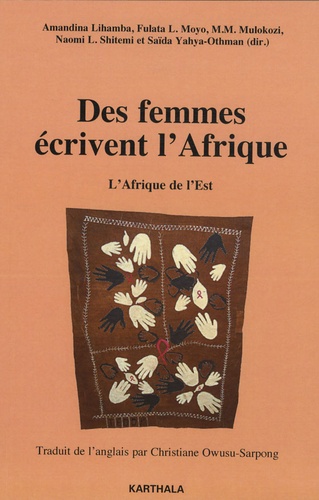
Critique littéraire
Des femmes écrivent l'Afrique. L'Afrique de l'Est
12/2010
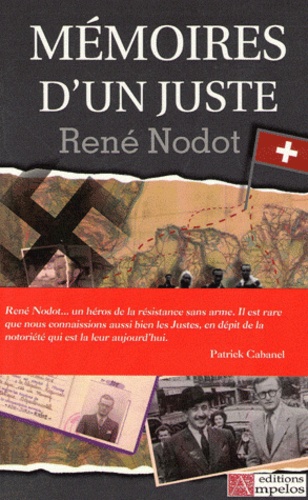
Histoire de France
Mémoire d'un juste
10/2011
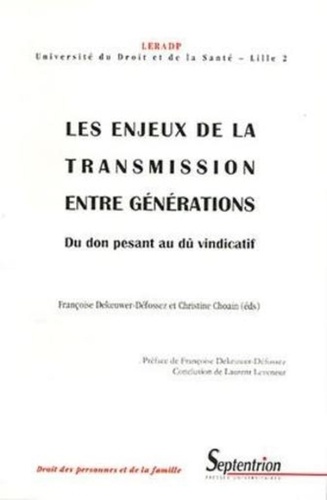
Droit
Les enjeux de la transmission entre générations. Du don pesant au dû vindicatif
07/2005
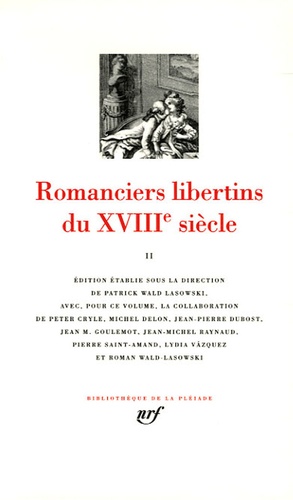
Pléiades
Romanciers libertins du XVIIIe siècle. Tome 2
11/2005
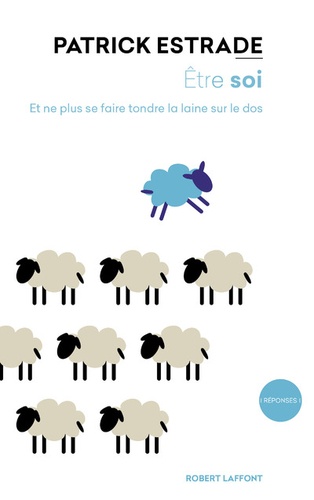
Développement personnel
Etre soi et ne plus se faire tondre la laine sur le dos
05/2017
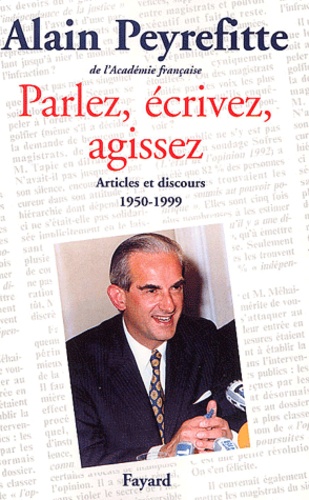
Droit
Parlez, écrivez, agissez. Articles et discours 1950-1999
09/2002
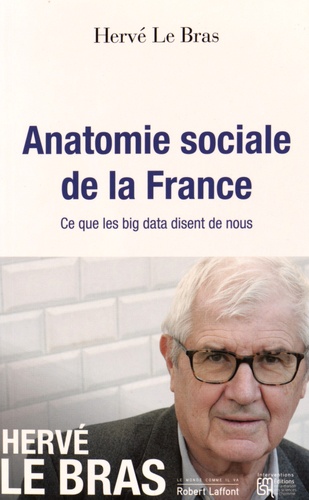
Sociologie
Anatomie sociale de la France. Ce que les big data disent de nous
03/2016
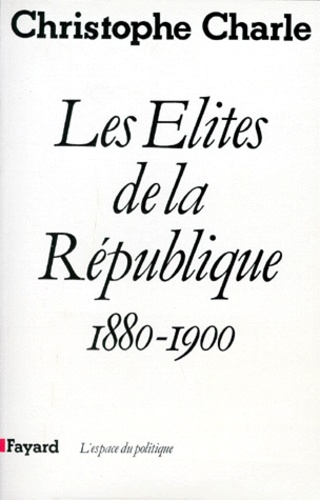
Histoire de France
Les Elites de la République (1880-1900)
09/1987
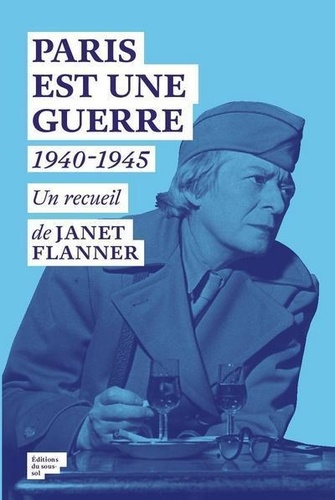
Histoire de France
Paris est une guerre 1940-1945. Un recueil de reportages
05/2020
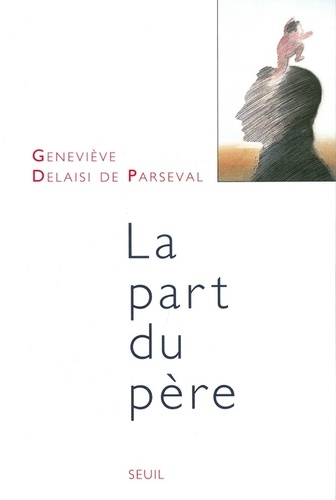
Psychologie, psychanalyse
LA PART DU PERE. Edition 1998 revue et augmentée
04/1998
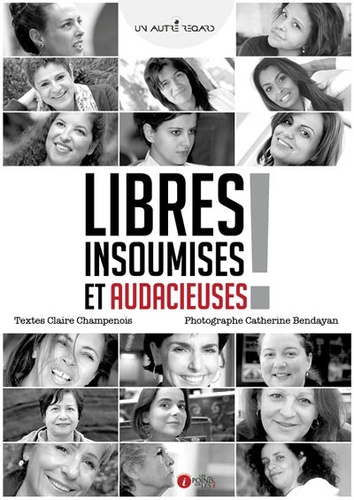
Sociologie
Libres, insoumises et audacieuses !
02/2015
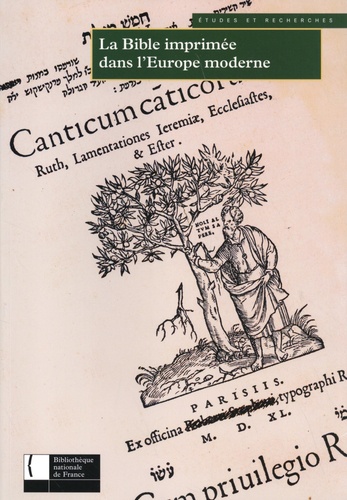
Critique littéraire
La Bible imprimée dans l'Europe moderne
12/1999
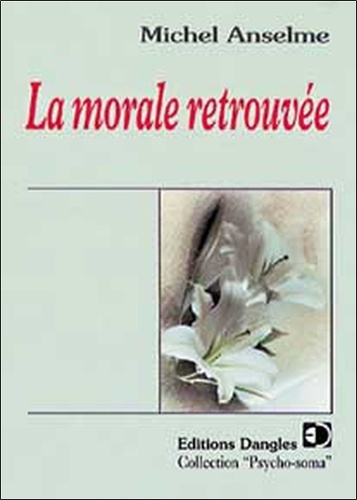
Couple, famille
La morale retrouvée
06/1998
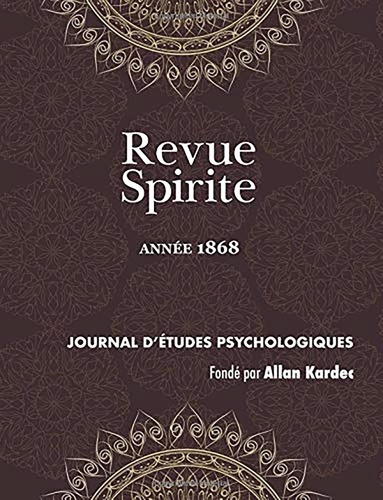
Esotérisme
Revue Spirite (Année 1868). le spiritisme devant l'histoire, les convulsionnaires de la rue Le Pelelier, instructions des Esprit
10/2017
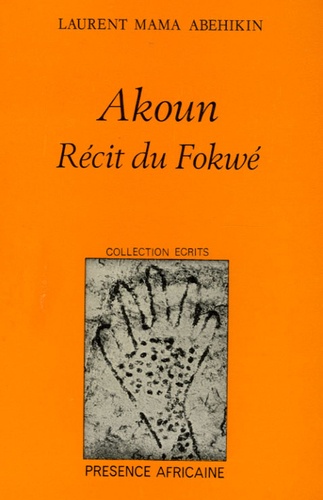
Littérature française
Akoun. Récit du Fokwé
03/1980
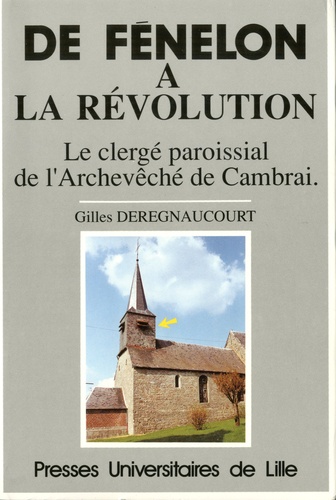
Sciences historiques
De Fénelon à la Révolution. Le clergé paroissial de l'archevêché de Cambrai
01/1991
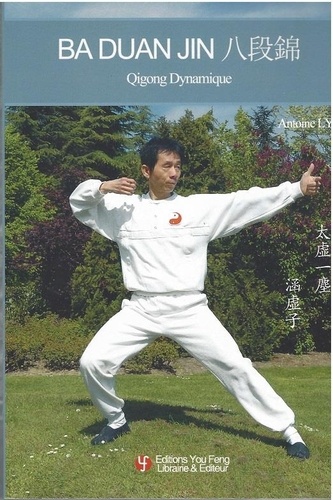
Développement personnel
Ba duan jin : qigong dynamique
10/2019
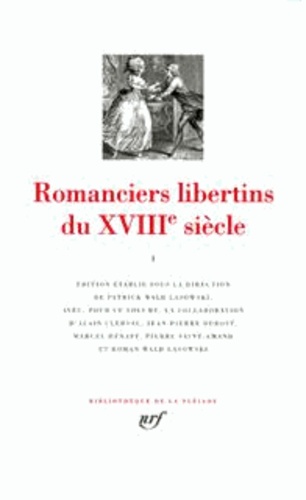
Pléiades
Romanciers libertins du XVIIIème siècle
11/2000

Théâtre
Les Noces du pape / Sauvés
06/2013
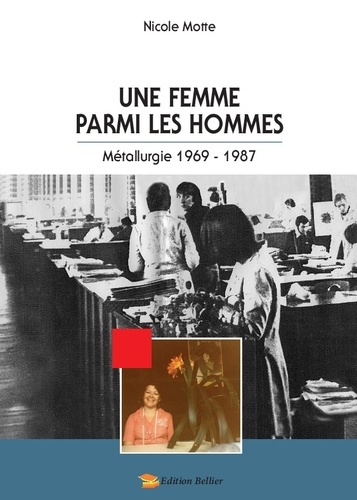
Littérature française
Une femme parmi les hommes. Métallurgie 1969-1987
03/2019
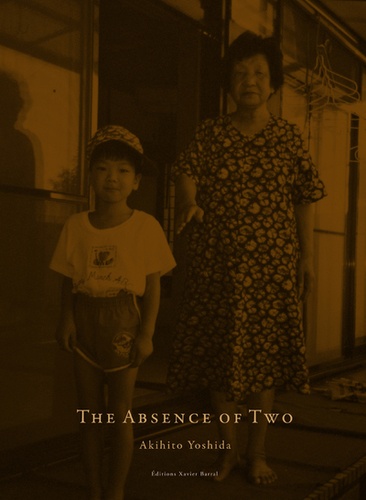
Photographie
Une double absence. Edition bilingue français-anglais
04/2019
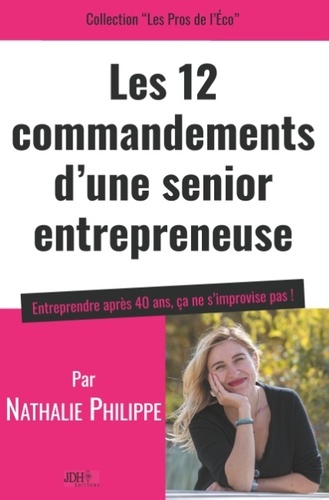
Droit
Les 12 commandements d'une senior entrepreneuse
02/2019
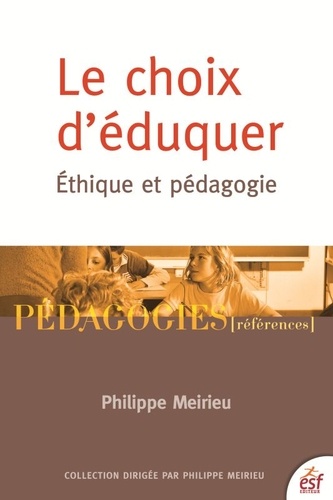
Pédagogie
Le choix d'éduquer. Ethique et pédagogie, Edition 2018
01/2018
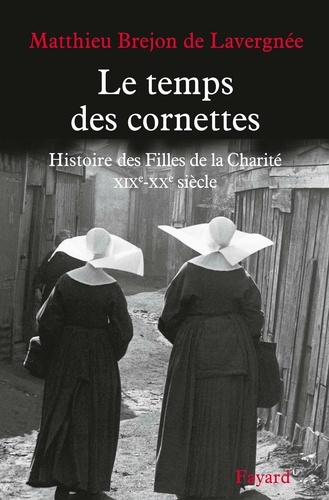
Religion
Le temps des cornettes. Histoire des Filles de la Charité. XIXe-XXe siècle
05/2018
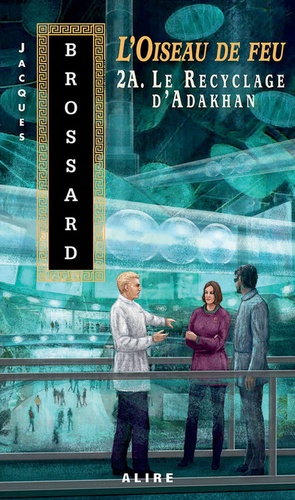
Science-fiction
L'oiseau de feu Tome 2A : Le recyclage d'Adakhan
05/2018
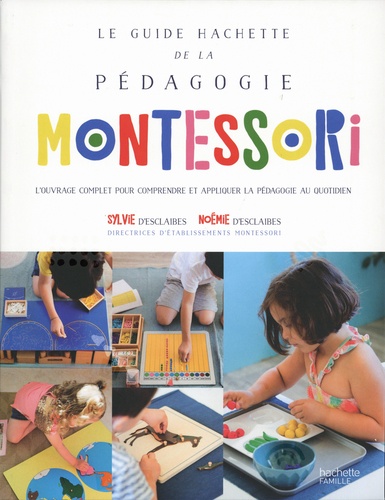
Couple, famille
Le guide Hachette de la pédagogie Montessori. L'ouvrage complet pour comprendre et appliquer la pédagogie au quotidien
10/2018
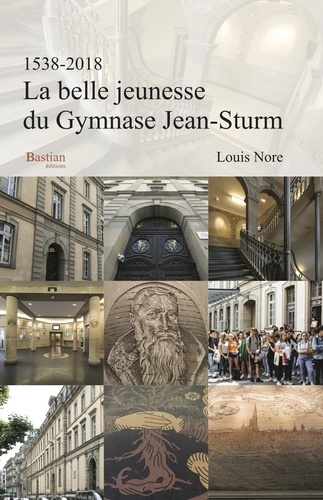
Sciences historiques
La belle jeunesse du gymnase Jean-Sturm. 1538-2018
10/2018
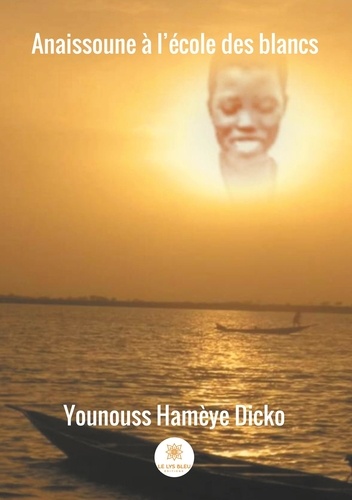
Littérature française
Anaissoune à l'école des blancs
06/2018
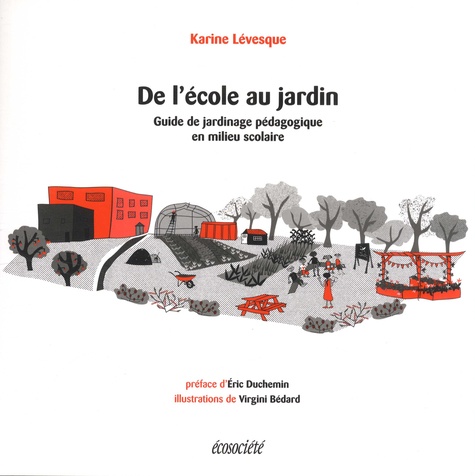
Développement durable-Ecologie
De l'école au jardin. Guide de jardinage pédagogique en milieu scolaire
01/2019
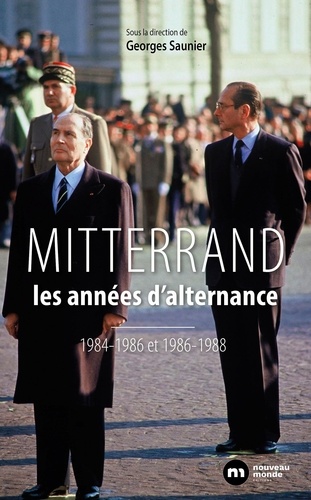
Histoire de France
François Mitterrand, les années d'alternance. 1984-1986 / 1986-1988
01/2019

