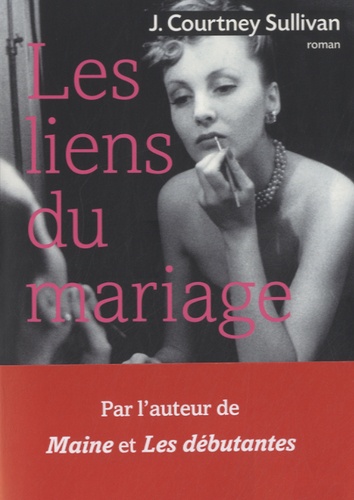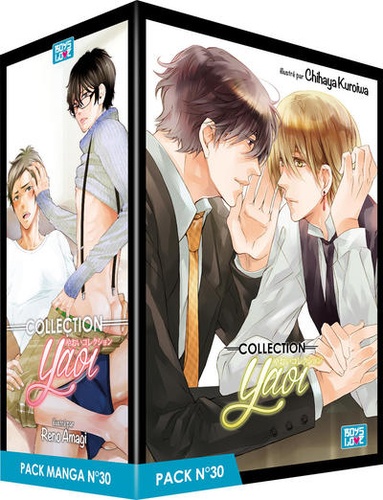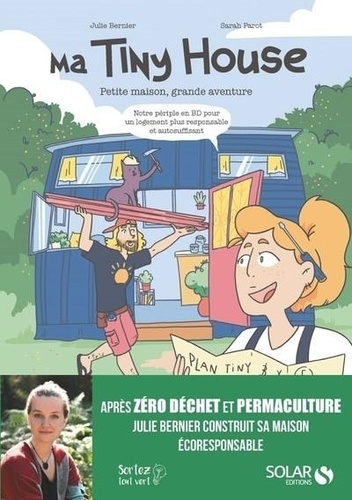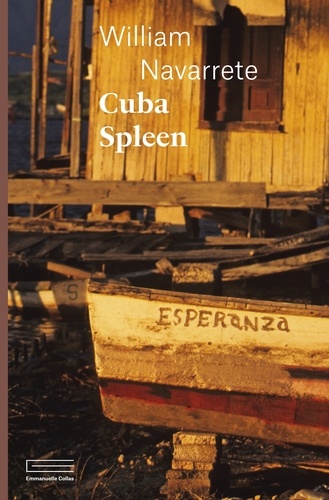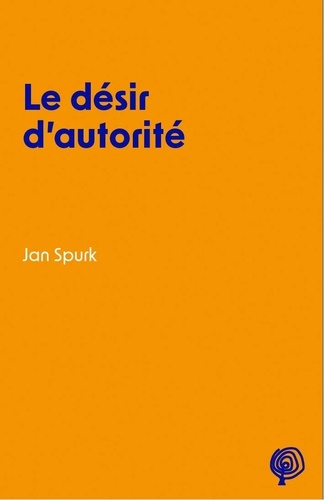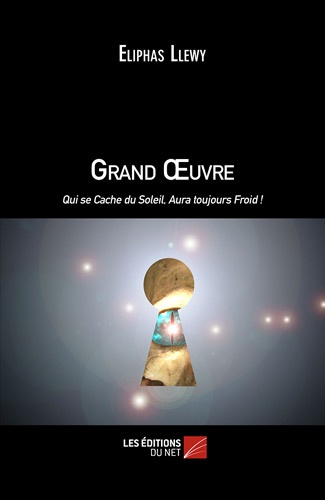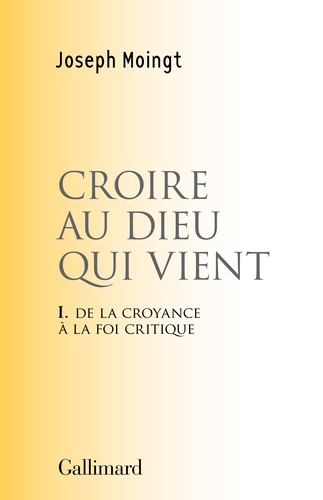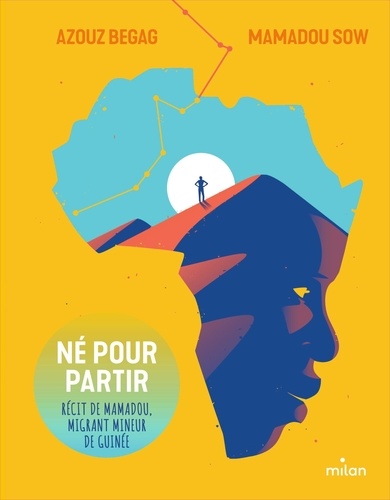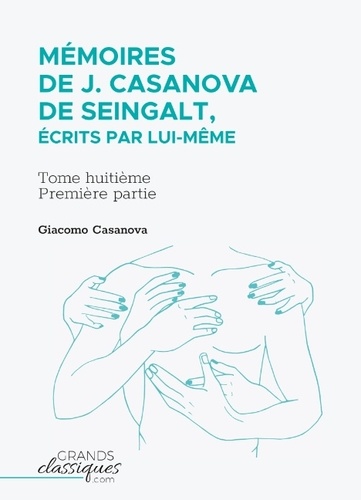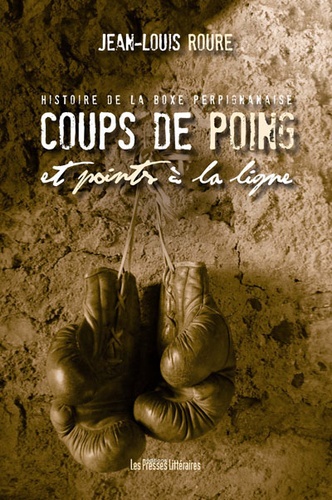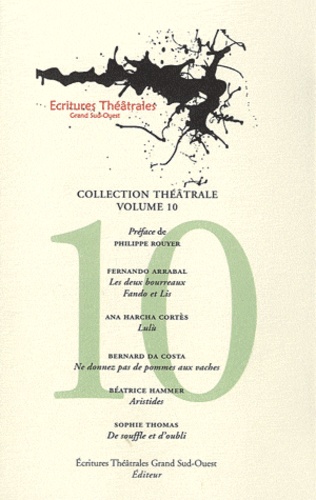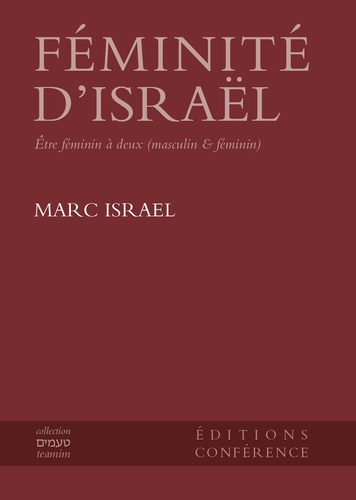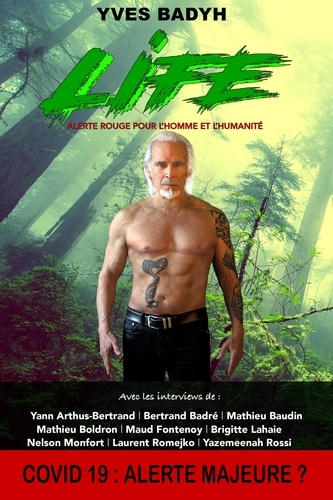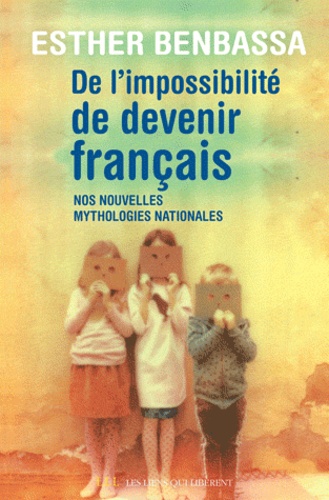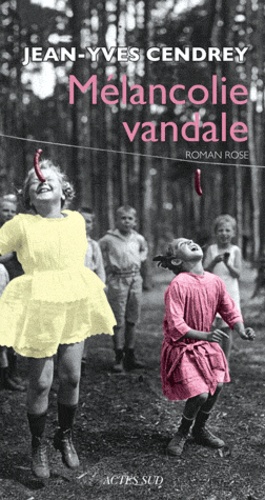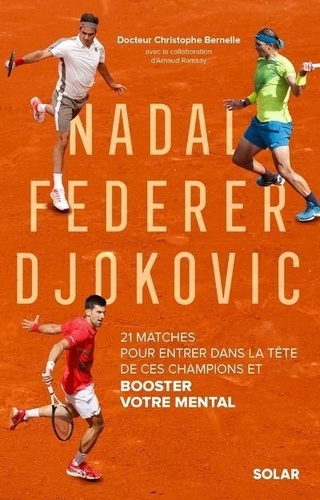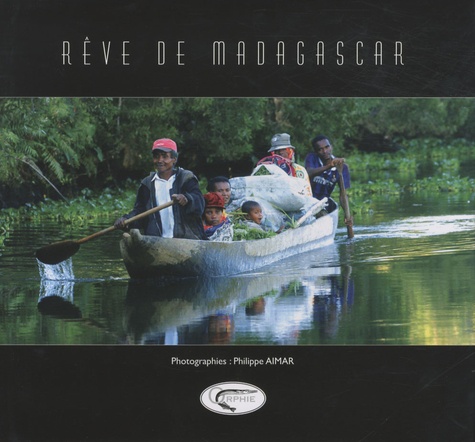Mélancolie vandale. Roman rose
Dans Berlin réunifiée, Kornelia Sumpf, cinquante-trois ans, (“fruit débile des amours d’une charogne et d’un fossoyeur”) condamnée à rester à jamais “une empotée de l’Est”, travaille comme interprète à la prison de Moabit où le détenu est souvent basané et insuffisamment germanophone. Elle est désormais la compagne, prétendument comblée, d’un homme plus jeune qu’elle, Ali, son ultime conquête, qui a été élevé, dans ce qui fut Berlin-Ouest, par une mère turque, richissime et foutraque, prénommée Utkügul, dont la fortune permet à son aboulique de fils de passer son temps en tête-à-tête avec l’écran de son ordinateur (et les vidéos pornos afférentes). Bien avant de rencontrer Ali, l’homme aux “lèvres-saucisses”, Kornelia a adopté la petite Viorica, d’origine roumaine (on dira “Rom”, sous peu), devenue une pré-adolescente paumée, d’humeur aussi maussade que le temps qui sévit à Berlin, en cet hiver 2010, et dont la fascination pour la société de consommation triomphante entraîne des échanges aussi fréquents qu’embarrassants avec la puissante caste que forment les vigiles de supermarchés. Afin d’échapper à la suffocante emprise de la dévoratrice Utkügul, restée “à l’Ouest”, le couple turco-germanique, fier de sa mixité, vit dans le modeste (et peu amène) pavillon familial de l’ancien Berlin-Est dans le quartier de Lichtenberg, où, cloué sur un fauteuil roulant, le père de Kornelia, dit “petit-papa”, achève son existence dans la hargne et ce mutisme aussi “réflexe” que tactique auquel l’a rompu sa longue expérience de communiste impénitent et de délateur professionnel aux temps “heureux” de la stasi. A son corps défendant, et comme à son insu, sa fille Kornelia, quand elle a terminé sa journée de “traductrice du malheur” à la prison de Moabit, semble passer son temps à traverser dans les deux sens un Mur qui n’existe plus, comme si ce dernier faisait défaut à l’ordre bénéfique naguère providentiellement assigné à l’univers. En proie à des nostalgies bancales et à des haines confuses, cette femme de devoir, au sourire (socialiste) inoxydable mais dont la jeunesse s’enfuit inexorablement, l’est en effet aussi à des désirs, désordonnés et violents, sur lesquels elle n’est pas en mesure de mettre un nom, sinon celui de sexe (par provocation, impuissance et manque d’imagination réunis) ou de consommation (activité enfin autorisée, sinon prescrite). Mais, dressée par la rda, une Kornelia Sumpf ne peut rêver de posséder une Audi que juchée sur la selle de son vélo, prolétaire symbole d’une liberté de circulation qui s’étend désormais jusqu’à la célèbre Alexanderplatz (oncques immortalisée par Döblin et à présent livrée aux promoteurs). Sur son vélo, Kornelia roule, dérape dans la neige, tombe, se blesse, rencontre le parcours d’un marathon en folie où des vieillards cacochymes repoussent leurs limites au risque de leur vie, fait des rencontres, assiste à des accidents, se trompe de chemin, se met en retard, nouvelle Alice déjantée au pays sans merveilles, se cherche un avenir, une histoire qui serait enfin à elle et comblerait le manque, souffrant, sans le comprendre, du temps qui passe, de l’inassouvissement, de la solitude harassante qui règne dans une ville qui, pour avoir fait de la notion de communauté retrouvée son nouvel étendard, fièrement brandi à la face du monde, n’a, à l’instar de l’Europe dite unie, réussi à se fonder en transmission d’aucune sorte. Aussi mal à l’aise vis-à-vis d’un passé familial caviardé que frustrée par le morne présent qui lui est dévolu, cette “femme gauchère” porte sur ce qui l’entoure un regard tour à tour exalté et agressif, qui, tout en “scannant” avec trop d’ironie une vie sans espoir et des destinées sans grandeur (vieillards en déshérence ou “actifs” aliénés s’entassant dans l’enfer du métro), lamine les mythologies de la défunte rda comme les illusions de l’Allemagne nouvelle. Dans le décor chaotique d’une modernité violente placée sous le signe du marché libéral qui a pris ses quartiers en des lieux où, hier encore, sévissaient de tout autres mœurs et pratiques, sous les cieux plombés d’une ville immense dont la division fut l’un des symboles majeurs du xxe siècle, se déploie, tel un plan crypté (et cruellement poétique), l’impitoyable cartographie d’un monde aussi interdit d’authentique mémoire qu’il est assujetti au “devoir” de célébrer sans trêve cette dernière, quitte à la soumettre à une marchandisation aussi décomplexée que florissante. Ecrit à “l’impersonnel” (au “on”), Mélancolie vandale (non sans dérision sous-titré : roman rose) propose avec cet hommage paradoxal et désabusé rendu à une ville emblématique, une vision de nos temps contemporains aussi désespérée que lucide. Tant il est vrai que, avec ce roman puissamment baroque, aussi tragique que farcesque, Jean-Yves Cendrey, en avatar de Jérôme Bosch (ou en passager sidéré embarqué sur quelque nef des fous), semble ici sonner l’alerte sur la renaissance possible de la “bête immonde”, ce monstre familier aux multiples visages si prompt à prospérer, en temps de paix, sur tous les territoires abandonnés à sa férocité vorace.
01/2012