Milton Friedman
Extraits
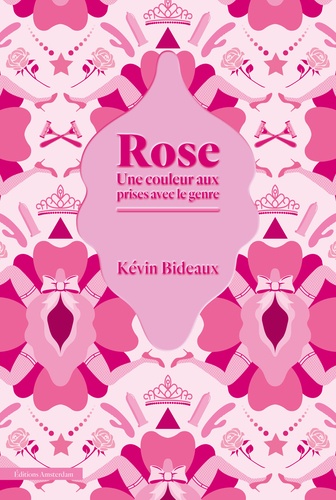
Iconographie
Rose. Une couleur aux prises avec le genre
11/2023
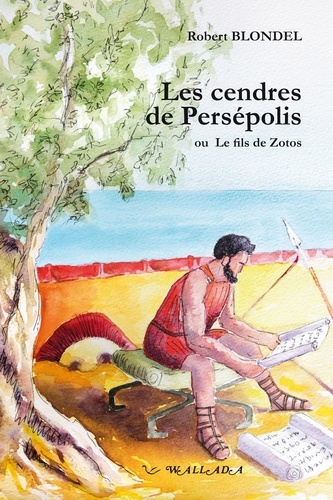
Romans historiques
Les cendres de Persépolis. Ou Le fils de Zotos
03/2011
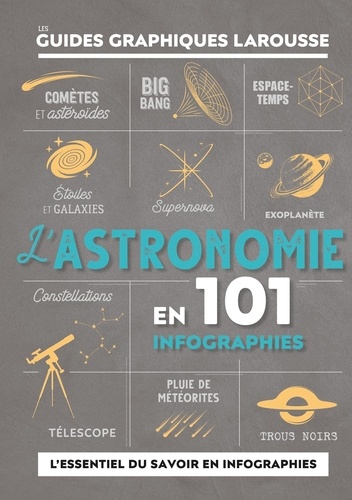
Astronomie - Initiation
L'Astronomie en 101 infographies
06/2022
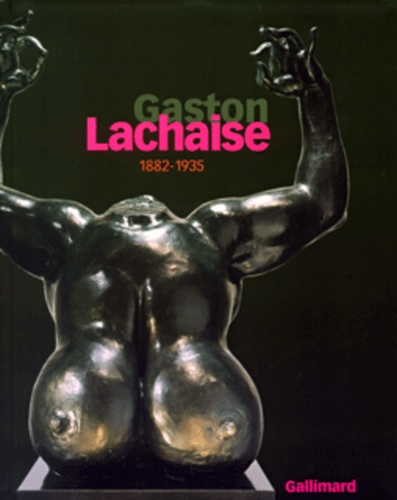
Beaux arts
Gaston Lachaise, 1882-1935
06/2003
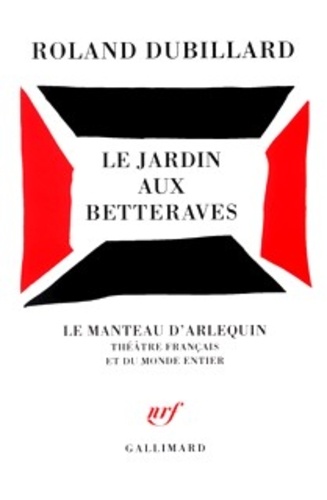
Théâtre
Le jardin aux betteraves
10/2002
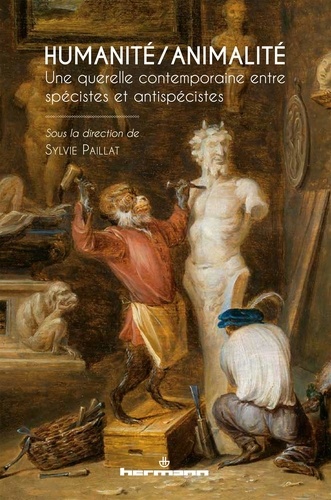
Notions
Humanité/Animalité. Une querelle contemporaine entre spécistes et antispécistes
10/2023
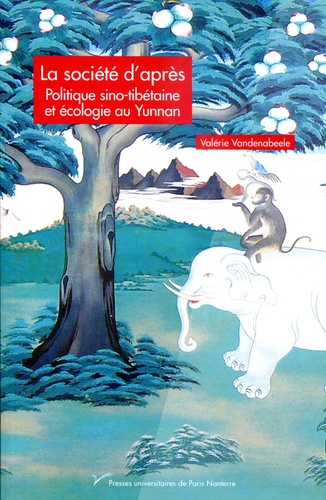
Ethnologie
La société d'après. Politique sino-tibétaine et écologie au Yunnan
02/2019
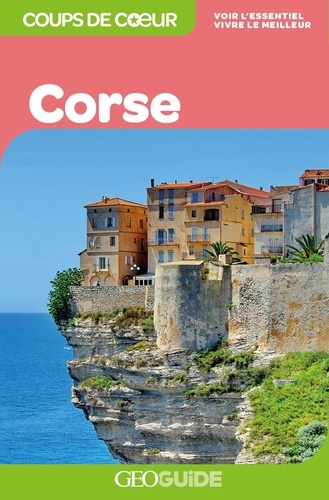
Corse
Corse
04/2022
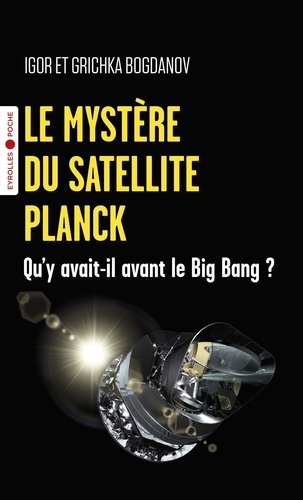
Cosmologie - Histoire
Le mystère du satellite Planck. Qu'y avait-il avant le Big Bang ?
02/2022
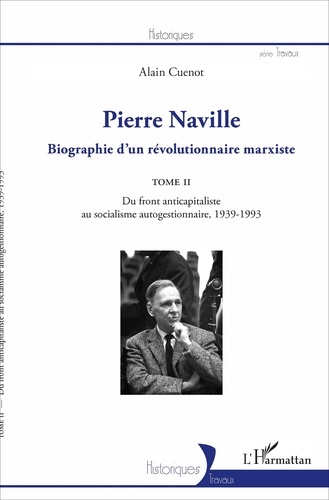
Sciences politiques
Pierre Naville. Biographie d'un révolutionnaire marxiste Tome 2, Du front anticapitaliste au socialisme autogestionnaire, 1939-1993
05/2017
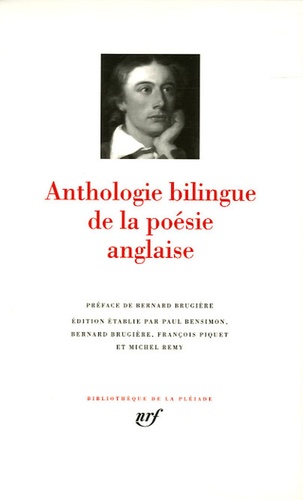
Pléiades
Anthologie bilingue de la poésie anglaise. Edition bilingue français-anglais
10/2005
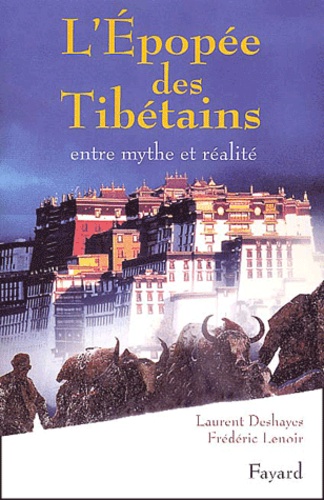
Histoire internationale
L'épopée des Tibétains. Entre mythe et réalité
04/2002
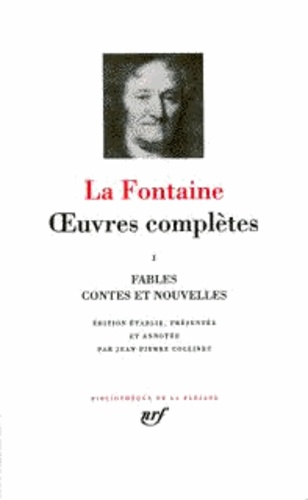
Pléiades
Oeuvres Complètes. Tome 2, Oeuvres diverses
07/1943
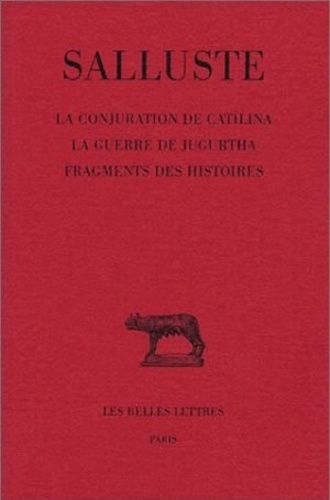
Critique littéraire
La conjuration de Catilina ; La guerre de Jugurtha. Fragments des histoires
01/1999

Loisirs et jeux
100 % excellent ! 40 nouvelles recettes gourmandes, Edition de luxe
10/2020
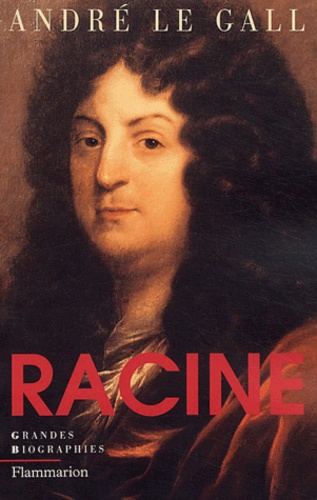
Critique littéraire
Racine
01/2004
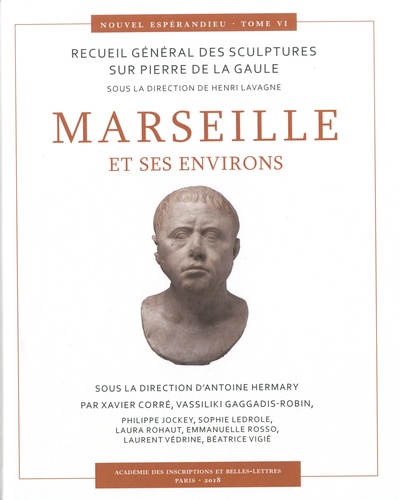
Beaux arts
Marseille et ses environs. Recueil général des culptures sur Pierre de la Gaule
04/2019
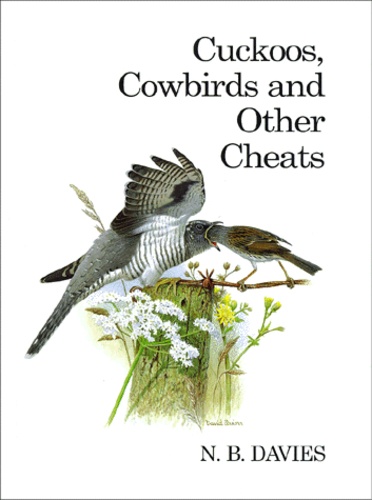
Sciences de la terre et de la
Cuckoos, Cowbirds and Other Cheats
04/2000
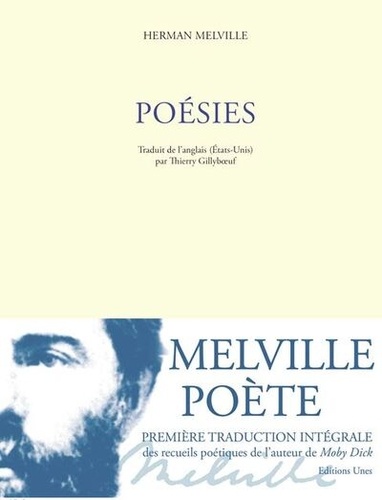
Poésie
Poésies
11/2022
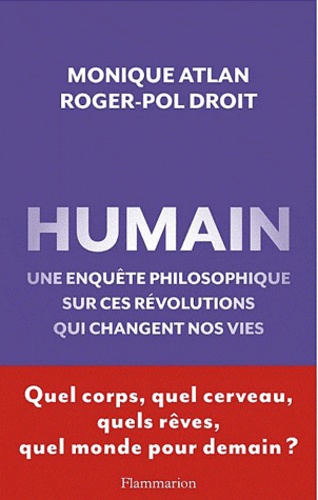
Philosophie
Humain. Une enquête philosophique sur ces révolutions qui changent nos vies
01/2012
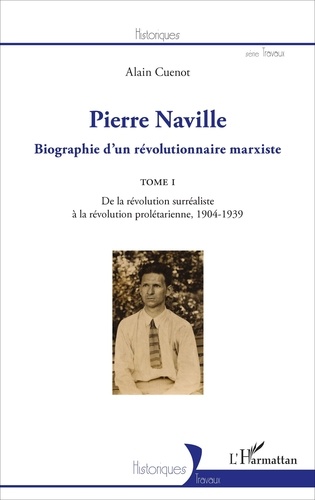
Sciences politiques
Pierre Naville. Biographie d'un révolutionnaire marxiste Tome 1, De la révolution surréaliste à la révolution prolétarienne, 1904-1939
05/2017
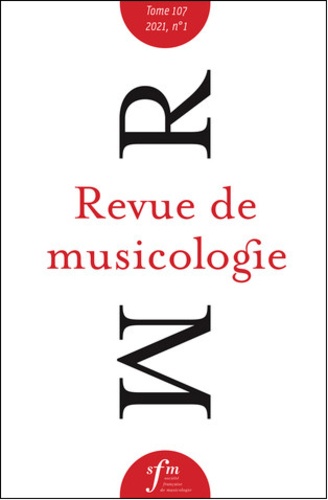
Musicologie
Revue de musicologie Tome 107 N° 1 (2021)
04/2021
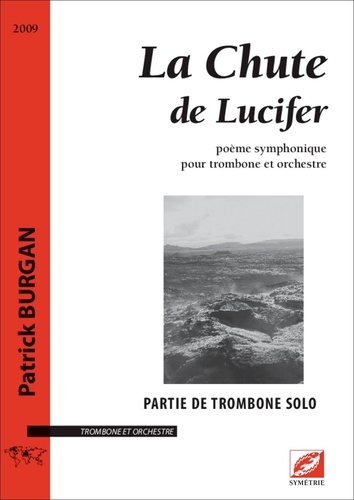
Musique, danse
La Chute de Lucifer (partie de trombone solo). poème symphonique pour trombone et orchestre
10/2014
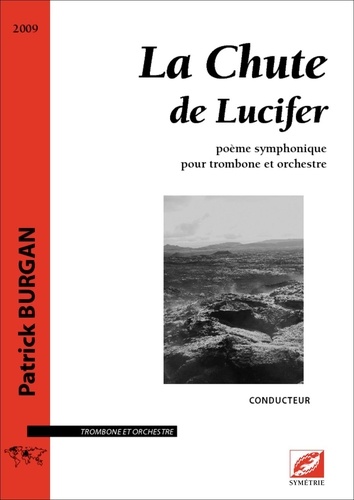
Musique, danse
La Chute de Lucifer (conducteur). poème symphonique pour trombone et orchestre
12/2013
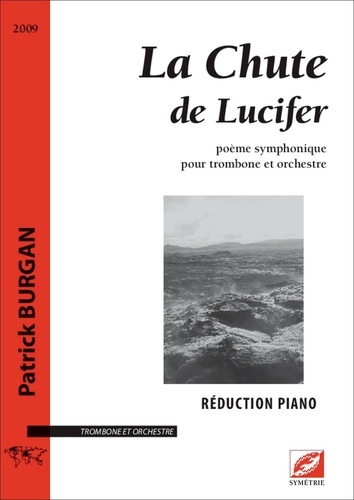
Musique, danse
La Chute de Lucifer (réduction piano). poème symphonique pour trombone et orchestre
07/2020
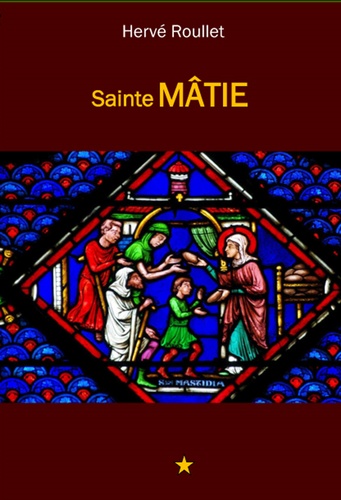
Religion
Sainte Mâtie
01/2019
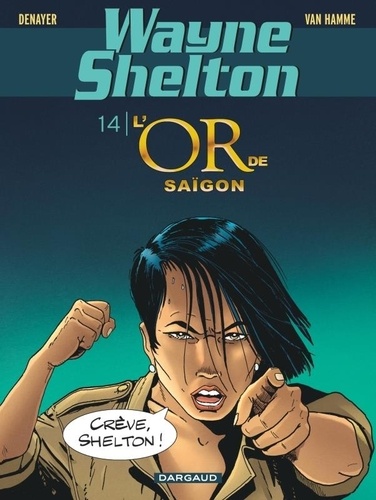
Policier-Espionnage
Wayne Shelton Tome 14 : L'or de Saïgon
06/2024
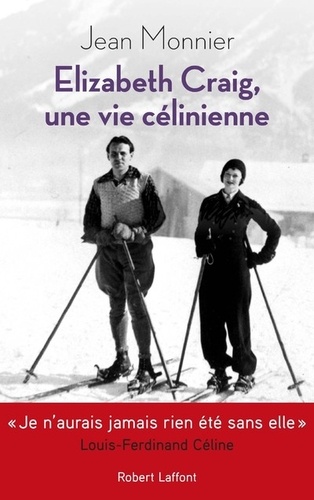
Critique littéraire
Elizabeth Craig, une vie célinienne
02/2018
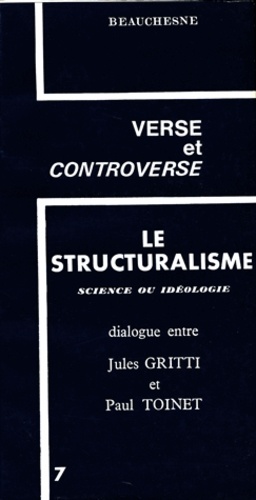
Sociologie
Le structuralisme
01/1968
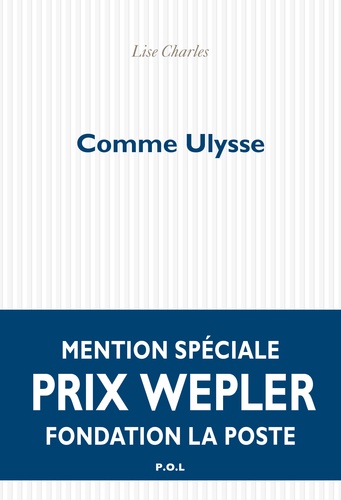
Littérature française
Comme Ulysse
08/2015

