Morten Hesseldahl
Extraits
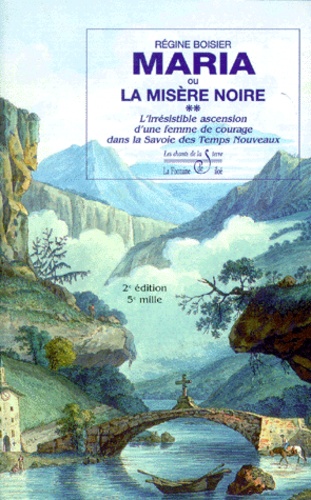
Romans historiques
La belle du Lac-Bénit, la ballade d'une dame des temps jadis en Savoie
06/1997
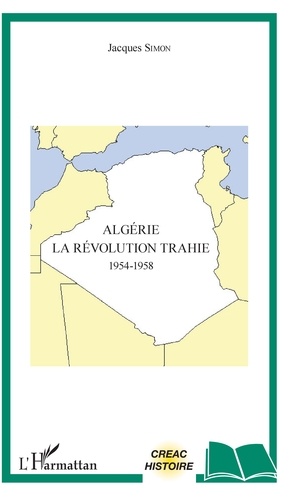
Histoire internationale
Algérie, la révolution trahie (1954-1958)
12/2018
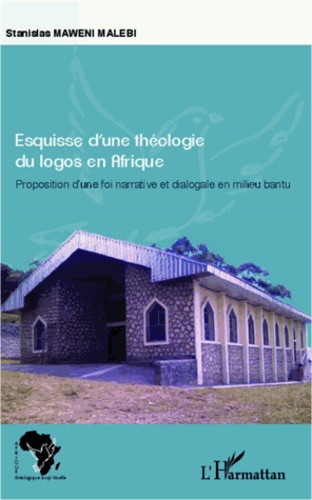
Religion
Esquisse d'une théologie du logos en Afrique. Proposition d'une foi narrative et dialogale en milieu bantu
02/2013
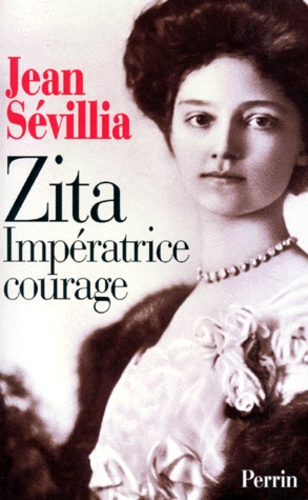
Histoire internationale
Zita, impératrice courage. 1892-1989
04/1997
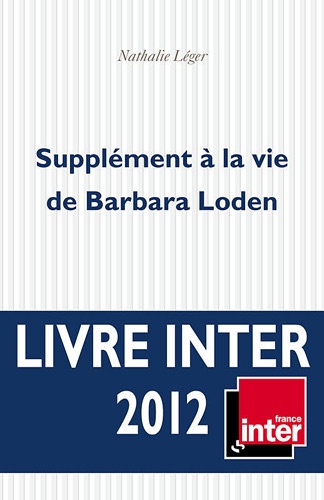
Littérature française
Supplément à la vie de Barbara Loden
01/2012
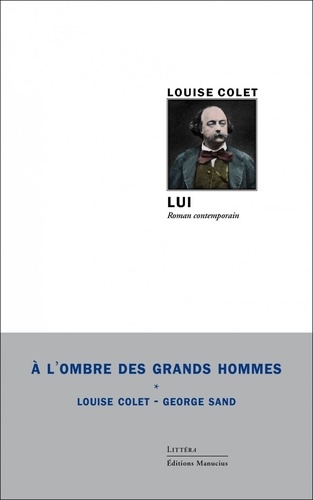
Littérature française
Lui - Roman contemporain
11/2022
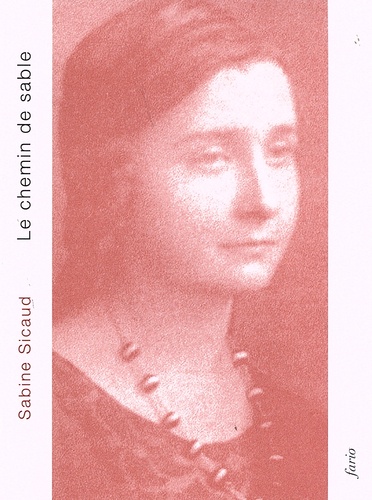
Poésie
Le chemin de sable
01/2023
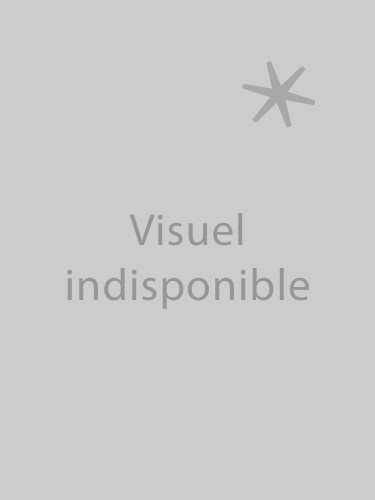
Littérature française
L'affaire Myriam Sakhri
07/2022
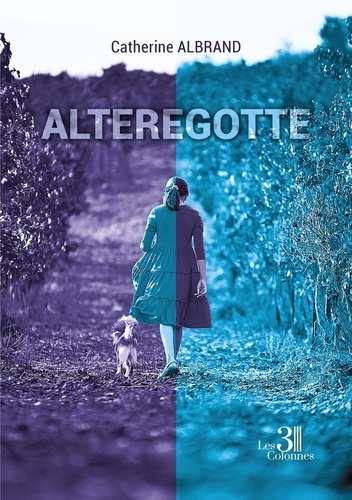
Littérature française
Alteregotte
11/2021
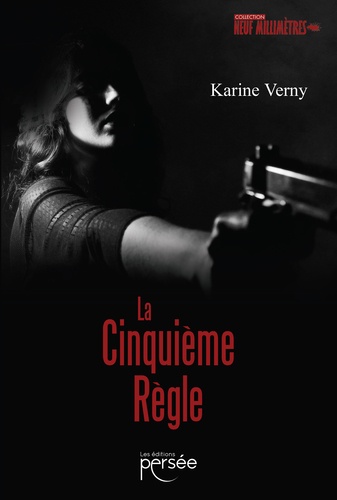
Thrillers
La cinquième règle
11/2021
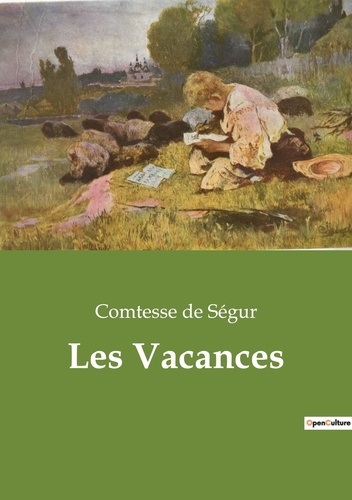
Romans historiques
Les Vacances
10/2022
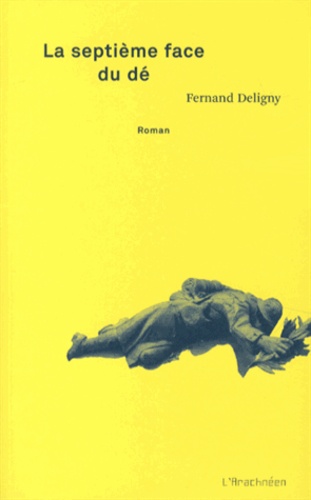
Policiers
La septième face du dé
11/2013
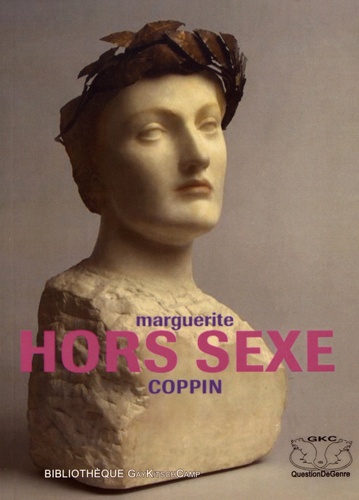
Littérature érotique et sentim
Hors sexe
04/2012
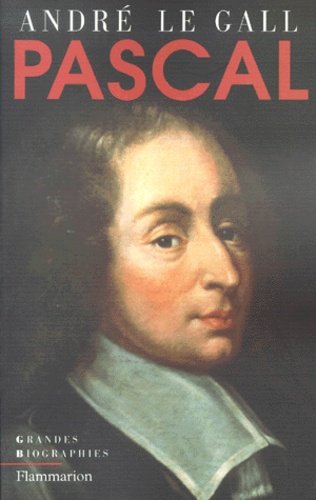
Philosophie
Pascal
11/2000
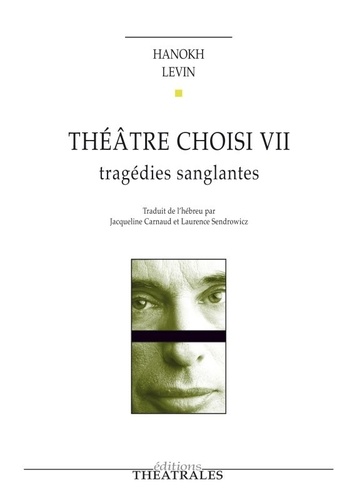
Théâtre
Théâtre choisi. Tome 7, Tragédies sanglantes
06/2018
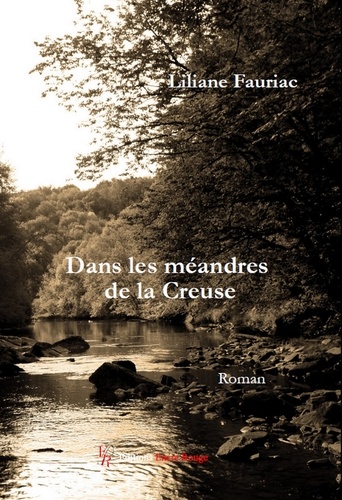
Littérature française
Dans les méandres de la Creuse
01/2019
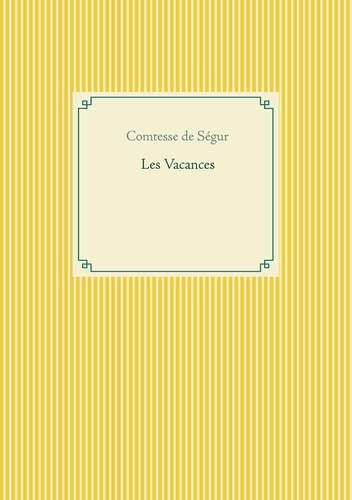
Autres collections (6 à 9 ans)
Les Vacances
04/2021
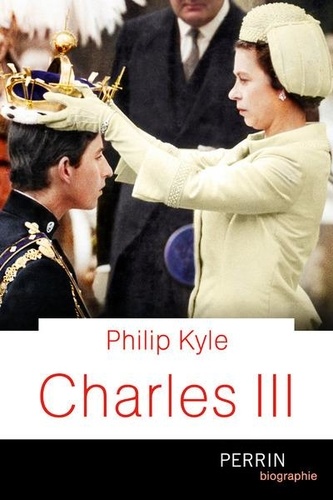
Royaume-Uni
Charles III
10/2022
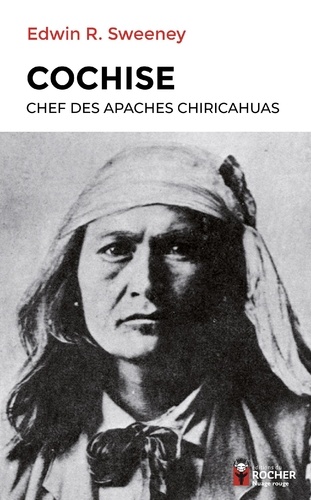
Indiens
Cochise, chef des Apaches chiricahuas
04/2023
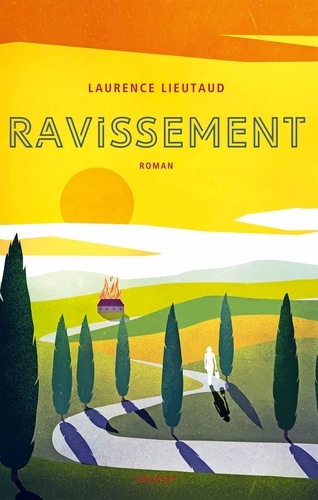
Littérature française
Ravissement
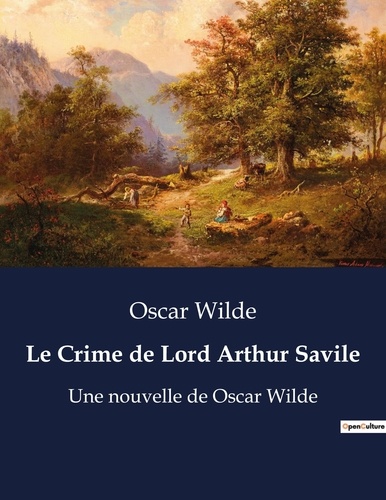
Littérature française
Le Crime de Lord Arthur Savile. Une nouvelle de Oscar Wilde
02/2023
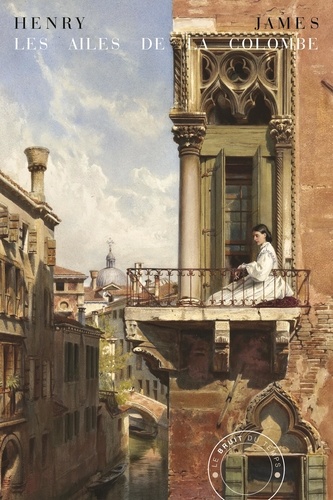
Littérature anglo-saxonne
Les Ailes de la colombe
11/2020
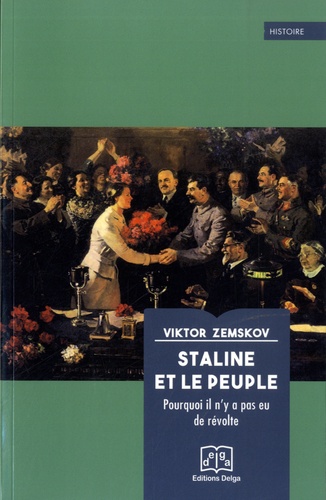
Russie
Staline et le peuple. Pourquoi il n'y a pas eu de révolte
02/2022
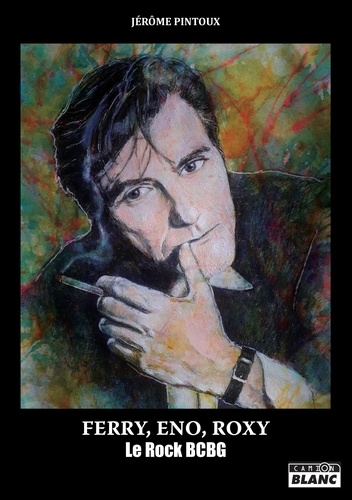
Rock
Ferry, Eno, Roxy. Le Rock BCBG
01/2023
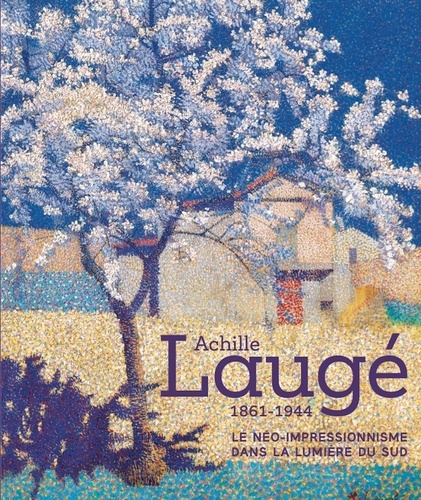
Impressionnisme
Achille Laugé. Le néo-impressionnisme dans la lumière du Sud
06/2022
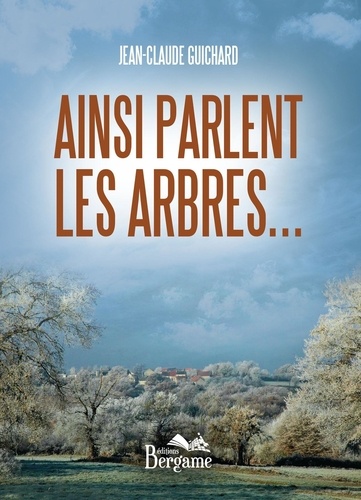
Limousin
Ainsi parlent les arbres...
08/2021
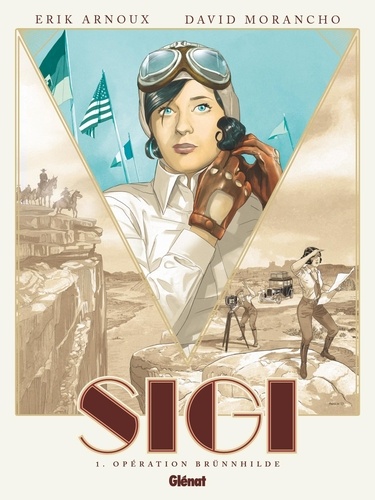
Historique
Sigi. Tome 1
08/2023
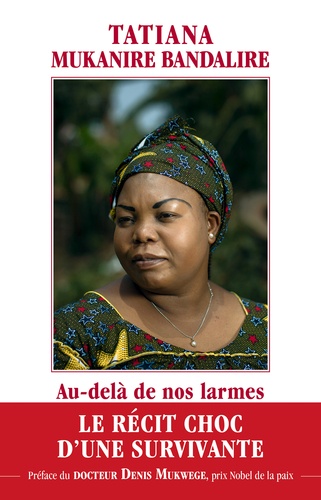
Violence
Au-delà de nos larmes
11/2021
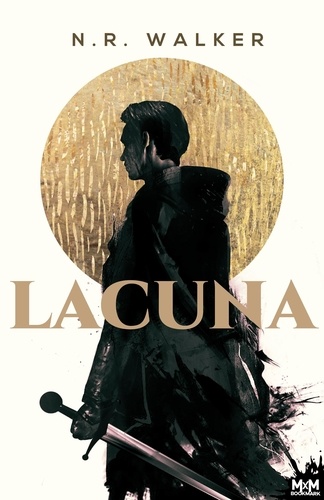
Romance et érotique LGBT
Lacuna
12/2023
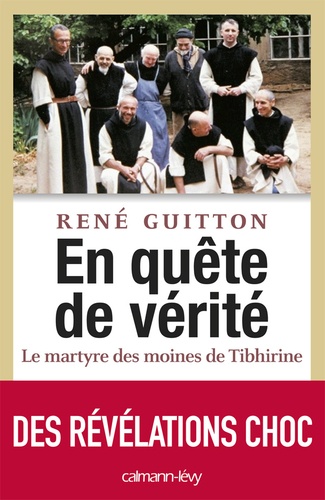
Religion
En quête de vérité. Le martyre des moines de Tibhirine
03/2011

