Mamadou Lamine Niang
Extraits
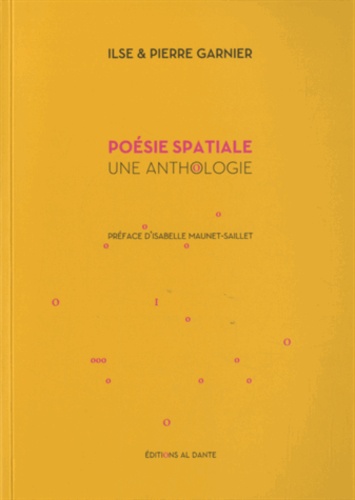
Poésie
Poésie spatiale. Une anthologie
11/2012
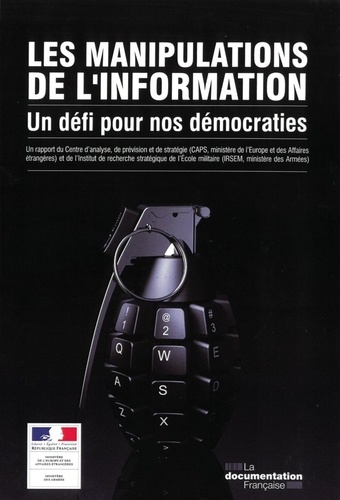
Sciences politiques
Les manipulations de l'information. Un défi pour nos démocraties
08/2019
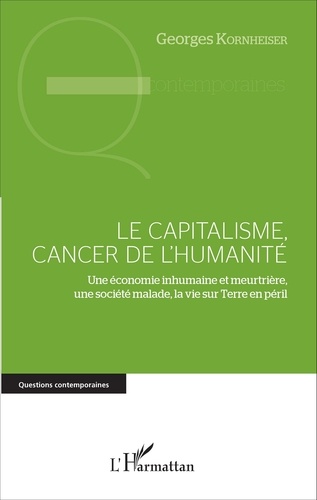
Sciences politiques
Le capitalisme, cancer de l'humanité. Une économie inhumaine et meurtrière, une société malade, la vie sur Terre en péril
11/2015
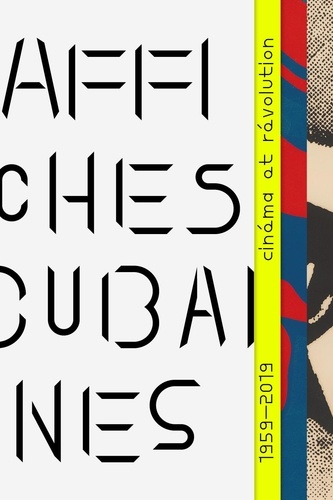
Art mural, graffitis, tags
Affiches cubaines. Révolution et cinéma, 1959-2019
03/2023
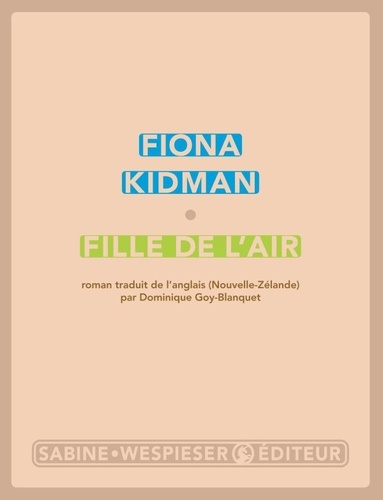
Littérature étrangère
Fille de l'air
04/2017
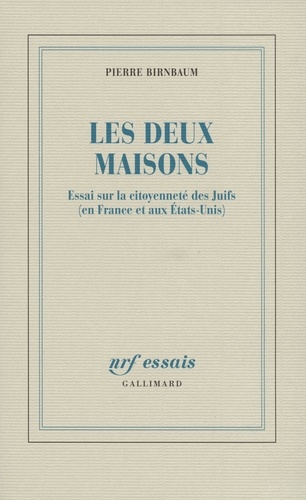
Religion
Les deux maisons. Essai sur la citoyenneté des Juifs (en France et aux Etats-Unis)
09/2012
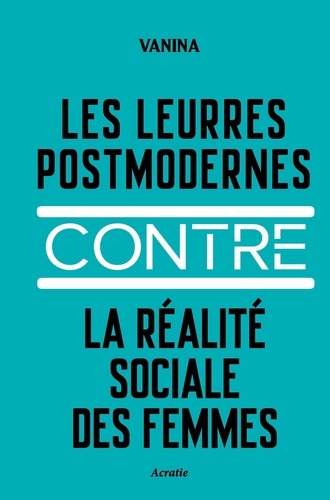
sociologie du genre
Les leurres postmodernes contre la réalité sociale des femmes
10/2023
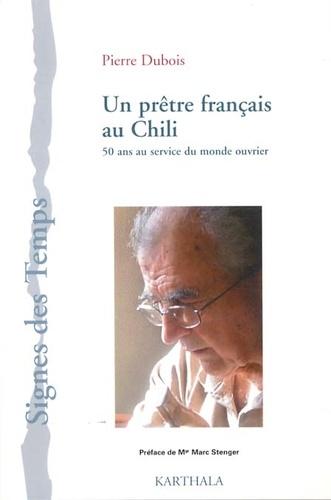
Religion
Un prêtre français au Chili. 50 ans au service du monde ouvrier
10/2012
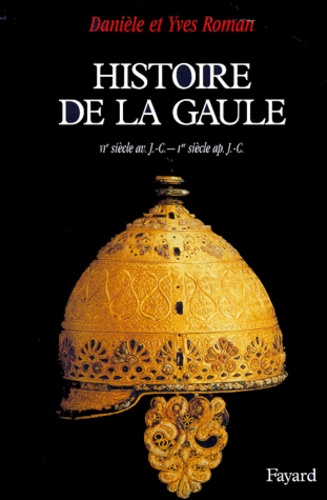
Histoire ancienne
Histoire de la Gaule. Une confrontation culturelle, VIème siècle avant J.-C. - Ier siècle après J.-C.
04/1997
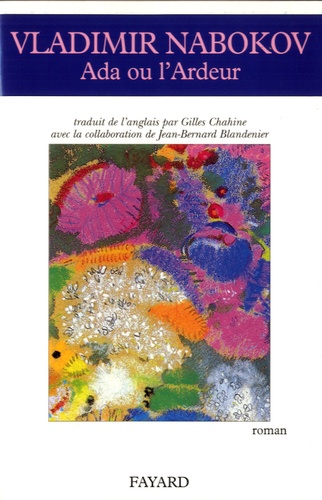
Littérature étrangère
Ada ou l'Ardeur. Chronique familiale
12/1991
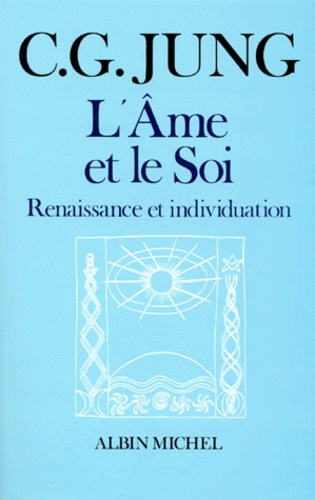
Psychologie, psychanalyse
L'AME ET LE SOI. Renaissance et individuation
05/1990
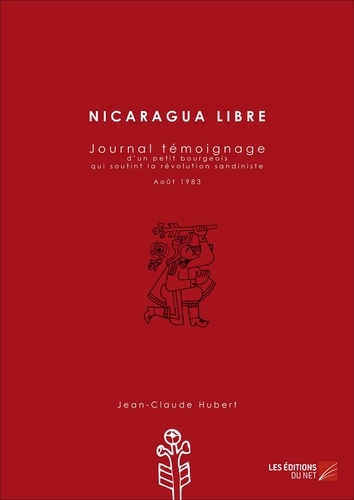
Critique littéraire
Nicaragua libre - Journal témoignage
02/2014
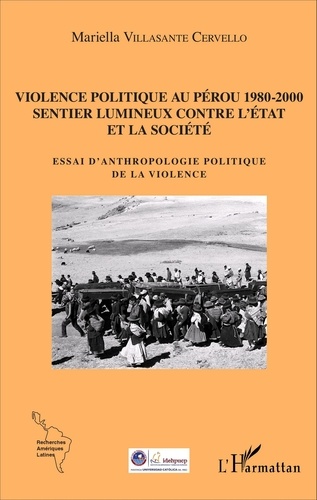
Sciences politiques
Violence politique au Pérou 1980-2000, Sentier lumineux contre l'Etat et la société. Essai d'anthropologie politique de la violence
04/2016
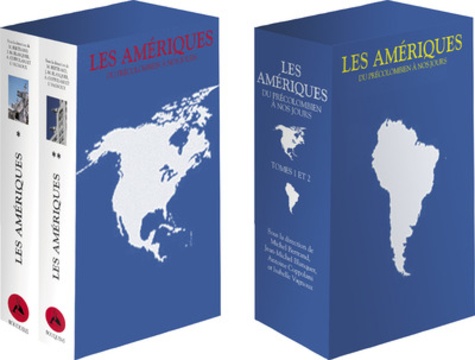
Histoire internationale
Les Amériques. Du Précolombien à nos jours. Coffret en 2 volumes
11/2016
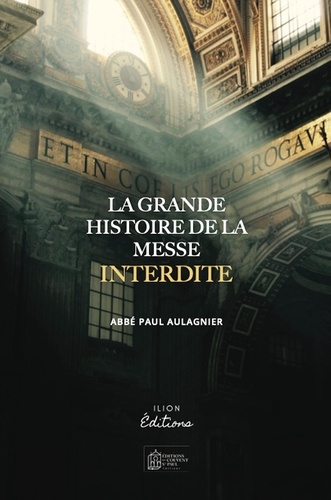
Histoire de l'Eglise
La grande histoire de la messe interdite. Réflexion sur La Messe de nos jours
02/2021
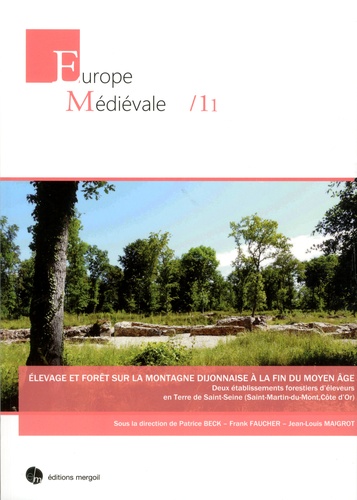
Histoire ancienne
Elevage et forêt sur la montagne dijonnaise à la fin du Moyen Age. Deux établissements forestiers d'éleveurs en Terre de Saint-Seine (Saint-Martin-du-Mont, Côte d'Or)
01/2018
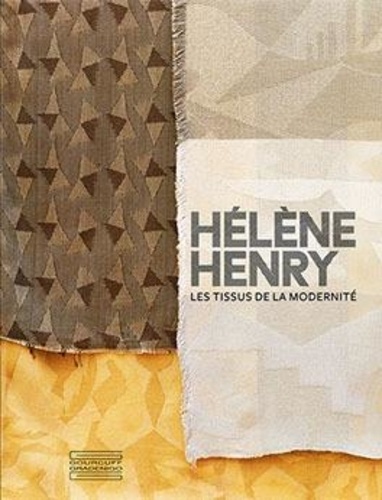
Art textile
Hélène Henry. Les tissus de la modernité, Edition bilingue français-anglais
08/2021
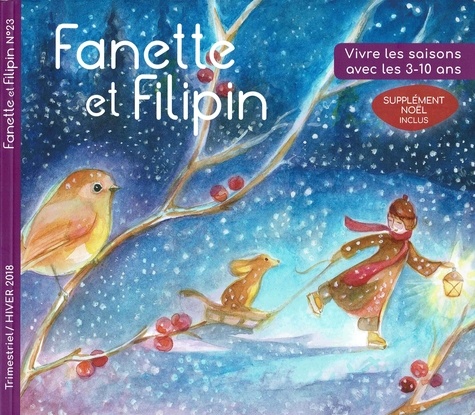
Livres 3 ans et +
Fanette et Filipin N°23 Hiver
12/2018

Littérature française
Chère brigande. Lettre à Marion du Faouët
02/2017
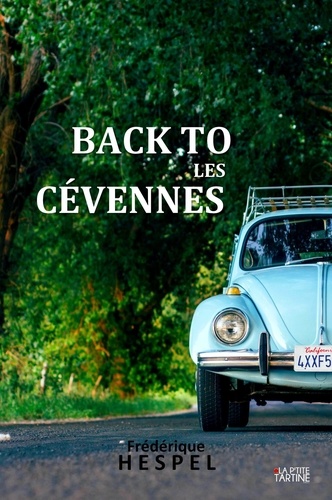
Littérature francophone
Back to les cévennes
09/2021
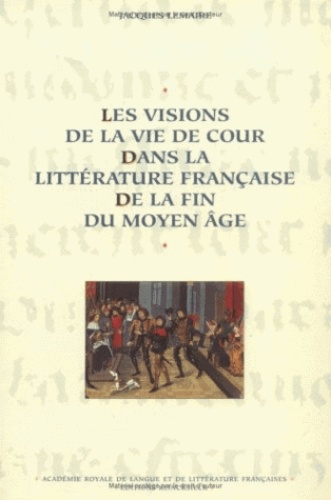
Histoire de France
Les visions de la vie de cour dans la littérature française du Moyen Age
04/1994
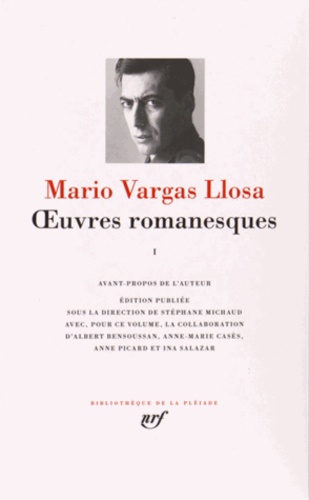
Pléiades
Oeuvres romanesques. Tome 1
03/2016
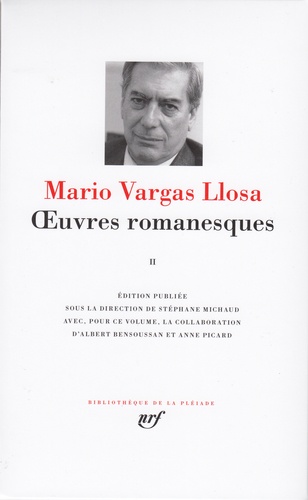
Pléiades
Oeuvres romanesques. Tome 2
03/2016
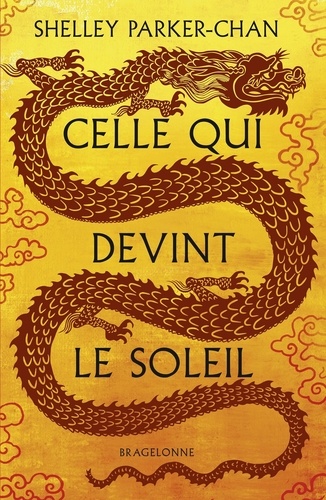
Fantasy
Celle qui devint le soleil
05/2022
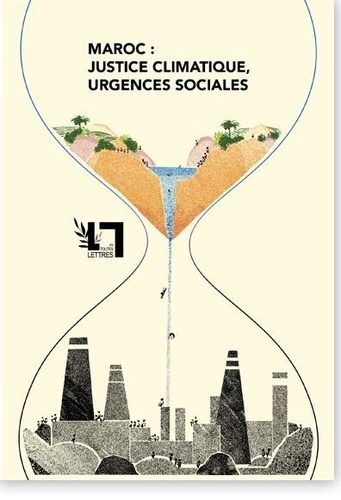
discriminations, exclusion, ra
Maroc : justice climatique, urgences sociales
09/2021
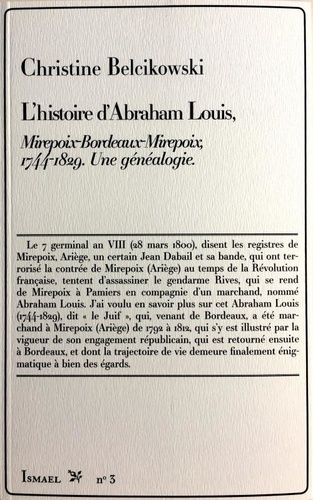
Histoire de France
L’histoire d’Abraham Louis, Mirepoix-Bordeaux-Mirepoix, 1744-1829. Une généalogie.
07/2017
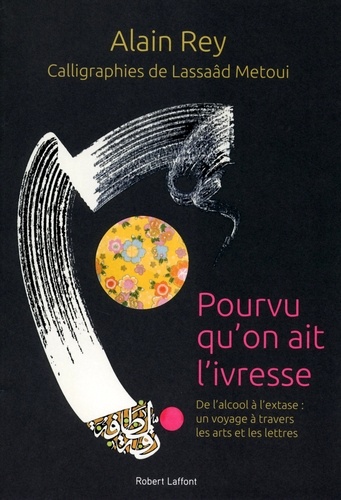
Décoration
Pourvu qu'on ait l'ivresse. De l'alcool à l'extase : un voyage mondial à travers les arts et les lettres
11/2015
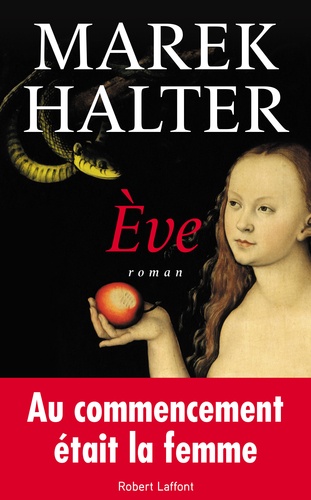
Romans historiques
Eve
10/2016
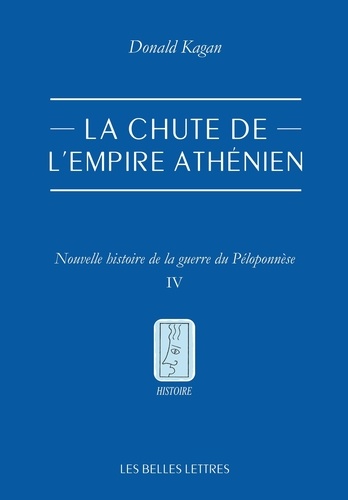
Grèce
La chute de l'empire athénien. Tome 4, Nouvelle histoire de la guerre du Péloponnèse
04/2024
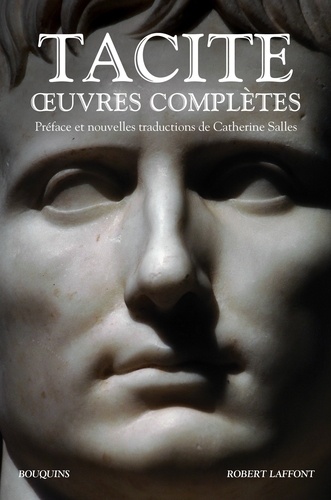
Critique littéraire
Oeuvres complètes. Livre sur la vie de Julius Agricola ; De la Germanie ; Dialogue des orateurs ; Les Histoires ; Les Annales
02/2014

