sirene racisme
Extraits
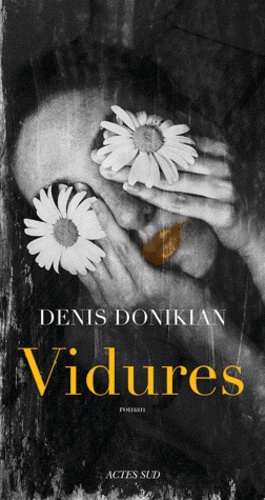
Littérature française
Vidures
C’est une journée dans la vie de Gam’, une journée qui contient toute une vie. Unité de temps, unité de lieu, unité d’action, matière première de tragédie classique que Denis Donikian sculpte en roman-monde. On est au pied du mont Ararat, sous le bleu du ciel et le rire des mouettes moqueuses, les pieds dans la boue, entre la grande décharge et le cimetière, peut-être le chemin le plus court pour raconter la vie sur terre. Et tout est vrai. Poète contrarié, journaliste-pamphlétaire clandestin, vagabond magnifique, fils en fugue, orphelin inconsolable, chiffonnier de fortune dans une Arménie en ruine qui ressemble diablement à sa décharge - cette “apocalypse en sursis”, Gam’ conduit cette danse folle, dangereuse et salvatrice, épique et dérisoire : la traversée d’un jour parmi les sans-riens qui fouillent les entrailles de la ville pour en faire leur festin. Et Gam’ nous prête ses yeux, ses oreilles et ses sens pour appréhender une réalité de fable ou de mauvaise blague historique aussi invraisemblable que réaliste, aussi anachronique qu’actuelle. On est à la marge - dans l’ombre toujours vaguement menaçante d’un régime qui pour être indépendant n’en est pas moins autoritaire, mafieux, expéditif ; où la police envoie au feu ses voyous en costards à la gâchette facile, où tous les cadavres doivent disparaître. Voici Dro, le “bouseux sensuel”, le patron de la décharge, qui a baptisé son chien et ses porcs préférés des surnoms des trois caricatures de présidents qui se sont succédés aux commandes de la petite république - et qui manie le tractopelle en scénographe de la pourriture. Voici Roubo, le gardien du cimetière, son voisin-frère-ennemi, collé toute la sainte journée à son tabouret, qui biberonne sa gnôle et surveille les entrées et sorties, aussi attaché à “ses” morts que l’autre l’est à ses porcs. Et voici les chiffonniers, hommes, femmes, enfants, dont le désespoir et les épreuves n’ont jamais entamé la fierté. L’humanité en deuil d’elle-même que nous présente Denis Donikian nous colle au cœur : elle est à part égale effrayante et attachante pour ce qu’elle ravive de souvenirs autant que pour ce qu’elle promet - parce qu’elle nous pend au nez. Le regard qu’elle pose sur son absence d’horizon (de la décharge, on voit le cimetière et vice-versa) est chargé d’une lucidité acérée, d’un humour de dépossédés et d’un sens de la fête proche de l’instinct de survie. C’est un pays, un peuple, qui a tout subi, injustice des hommes et de la nature, génocide et tremblement de terre, un pays qui s’est tout juste assez relevé, construit, pour céder aux fausses sirènes d’une comédie d’Indépendance conquise de haute lutte et aussitôt gangrénée par toutes les corruptions. Dans ce contexte sans merci, Denis Donikian échappe au folklore et aux lamentations légitimes pour mieux mener la ronde des affaiblis, explorer la hiérarchie sophistiquée de la misère et sonner l’heure du réveil. Aux confins d’un pays en charpie, dans l’urgence reçue en héritage, parce que quand “on n’a plus d’avenir à offrir, on patauge dans la fatalité”, comme un chant contestataire improvisé pendant qu’il est trop tard, Vidures est un hymne à la résistance humaine (à la survivance de l’humain), fort d’un constat paradoxal qui vaut pour tout un peuple : Vivre était encore possible après qu’on avait touché le fond. Vidures est une allégorie de l’Arménie dans un miroir tendu à toute la planète. Un hymne et un appel, un hymne et un coup de tonnerre pour rallumer les âmes, secouer les corps et rendre aux esprits le seul pouvoir qui vaille : celui des mots choisis, celui des histoires transmises, pour nourrir la mémoire qui est le meilleur moyen de transport vers l’avenir. Il y a dans ce texte une puissance rare et fondamentale - et fondamentalement singulière, qui évoque des grandes voix à la pelle (on pense à Beckett, à Shakespeare, à Céline, à Hrabal…) et/mais qui ne ressemble à rien. Il y a, au-delà du souffle narratif, un texte qui fonce vent debout contre les pseudo-fatalités de l’histoire, une révolte qui creuse et qui jaillit, une rage pleine d’amour contre ses semblables si aisément vaincus, si vite démissionnaires. Il y a, enlacés, la colère et la joie de vivre, l’ordure et la poésie, le rire et l’impossible. Le “vin fou des légendes” et la honte bus d’un même trait. Il y a les messies narcissiques et les révoltés désarmés, des hommes qui font les morts et des morts qui ne lâchent rien. Der Vorghomia ! crie au petit matin Gam’, perché sur sa colline qui domine la ville. Ce sont les premiers mots de Vidures. Ils signifient : Seigneur, prends pitié ! Pourtant, après avoir résonné tout au long du roman, ils sonnent à nos oreilles comme un toast et comme un cri de guerre. Comme une improbable promesse. Comme une prière active.
11/2011
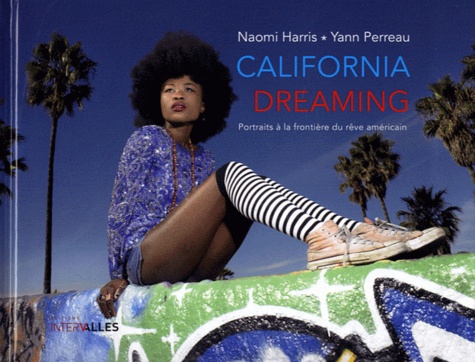
Sociologie
California dreaming. Portraits à la frontière du rêve américain
La société américaine est plus que jamais en mutation. Au début étaient les White Anglo-Saxons Protestants, sur la côte Nord-Est. Puis les vagues d’immigration se sont succédées, toujours plus diverses : l’Europe du Sud, l’Europe de l’Est, le Proche et le Moyen-Orient et maintenant, en masse, l’Asie et l’Amérique latine. Dans moins d’une génération, la majorité blanche sera passée... dans la minorité. Plus de 50% des Américains seront alors issus de minorités : Latinos, Noirs, Asiatiques, etc. Ils seront nés Américains, car sur le sol des Etats-Unis. Mais leurs parents sont ceux qui, aujourd’hui même, s’installent. Malgré Guantanamo Bay, le « Terrorism Act » ou encore ses lois liberticides en matière d’immigration, ce pays s’appelle toujours, et probablement plus que jamais depuis l’élection d’un Président dont le père était kenyan, « The Land of Freedom ». Dans la
Déclaration d’indépendance américaine de 1776, la « poursuite du bonheur » figure parmi les droits inaliénables de l’Homme, à côté de la liberté et de l’égalité. Ainsi est né l’American dream, l’idée selon laquelle « n’importe quelle personne vivant aux Etats-Unis, par son travail, son courage et sa détermination, peut devenir prospère ». Ce concept a été, et demeure encore, l’un des principaux moteurs du courant migratoire vers les Etats-Unis, le plus important phénomène d’immigration de l’histoire contemporaine. Le rêve américain, c’est donc la possibilité pour toute personne, quelle
que soit la couleur de sa peau, sa classe sociale, ses origines ou son éducation, de « réussir ». Le rêve californien... c’est le bout du rêve américain. « Des Etats d’Amérique, la Californie est, peut-être, le plus ‘américain’ de tous », explique l’historien Kevin Strarr dans son dernier livre, California. Au-delà de ses richesses naturelles, de ses grandes villes ou de son industrie (qui en fait la huitième puissance économique mondiale), la Californie est surtout l’Etat le plus multiculturel
du pays. « L’ADN de l’État, c’est sa diversité ethnique », résume Starr. Plus de 90 langues sont recensées par la Los Angeles Unified School District. La Californie, cependant, a été forgée sur la discrimination raciale : racisme envers les Mexicains, envers les Japonais, envers les Noirs (l’exemple de Rodney King, dont le tabassage par des policiers est à l’origine des émeutes de 1992, en est symptomatique). Et il faut attendre les années 1960 pour que les choses s’améliorent. « L’affirmative action » ou discrimination positive, sera abandonnée par la suite, par référendum, dans les années 1990. Mais elle aura porté ses fruits. Aujourd’hui, la Californie s’enorgueillit d’être l’Etat le moins discriminatif, le moins inégalitaire et le plus multiculturel du pays. Malgré le 11 septembre, le Patriotic Act et les mesures répressives entreprises chez ses voisins, notamment le Texas, l’Etat du gouverneur autrichien Schwarzenegger continue de croire en son utopie de terre bénie, à l’image de ses deux grandes villes, Los Angeles, la cité des anges et San Francisco, la ville de la contestation et de la matière grise. Invaincu, donc, malgré huit ans d’administration Bush, ce rêve californien, mélange d’utopie hippie, d’Hollywood et d’horizon sans limites, est aujourd’hui inévitablement menacé par la crise économique. L’Etat vit sa plus grave crise depuis la Grande Dépression. Des dizaines de milliers de Californiens ont perdu leur maison ou leur emploi. Parfois les deux. L’Etat est, officiellement, reconnu comme celui qui souffre le plus de la récession de tout
le pays. La classe moyenne inférieure lutte et tombe dans la précarité, pour ne pas dire, parfois, la pauvreté. Les immigrés sont en première ligne. Et les mailles du filet de l’Etat Providence sont trop larges. Le retour au pays est parfois la seule solution. Plus de 50 000 immigrés, en 2008, sont ainsi repartis de la Californie vers le Mexique. Et à la frontière, le rêve vire souvent au cauchemar, les narcotrafiquants mexicains, renfloués par la crise, déplaçant leur guerre sur le territoire californien.
Et pourtant, aujourd’hui, peut-être plus que jamais, les Etats-Unis redécouvrent ce rêve qui fait leur fierté autant que leur identité : ils viennent d’élire leur premier président issu d’une minorité, dans un élan d’espoir et de soif de changement rarement vu depuis les frères Kennedy, John en 1960 et peut-être plus encore Bobby en 1968. L’effet miroir fonctionne-t-il ? Les Africains Américains,
les Latinos, ont largement voté pour Barack Obama : à plus de 75%... mais aussi une majorité de Blancs. Ce rêve, le nouveau Président Obama l’invoque souvent. « Si nous n’agissons pas vite pour remédier à la crise, le rêve américain risque d’être menacé », martèle-t-il sans relâche. Il y croit, à ce rêve : il l’a ressuscité chez ses compatriotes, lui le fils d’immigré kenyan, qui rappelle au pays ce qu’est sa raison d’être : l’American dream. Au jour le jour, comment devient-on Américain ? Y a-t-il des critères à remplir ? Des codes à s’approprier ? Qu’abandonne-t-on de sa culture d’origine, de ses traditions ? Que conserve-t-on ? Comment aborde-t-on le monde du travail ? Finalement, c’est quoi être américain ?
04/2011
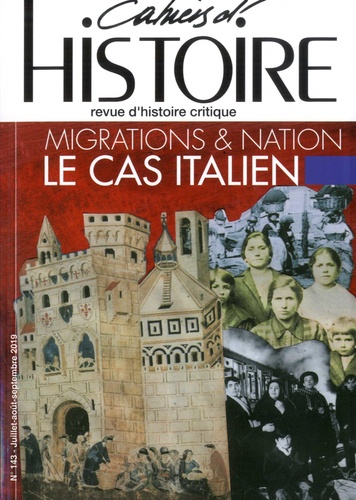
Sciences historiques
Cahiers d'Histoire N° 143, juillet-août-septembre 2019 : Migrations & nation : le cas italien
Revenir sur les migrations, encore et toujours. Travail crucial en temps dinstrumentalisation criminelle des craintes suscitées par ces "autres" qui arrivent. Temps où, en Italie, ce mois de septembre 2019, les défenseurs de Matteo Salvini se mobilisent contre un nouveau gouvernement qui acceptera "linvasion" et préparent une "grande journée de la fierté italienne" le 19 octobre. Temps des incessants bégaiements du même, temps des oublis aussi. Oublis des constants déplacements des humains à la surface du globe, des micro-déplacements de villages à villages aux longues migrations transatlantiques. Oublis des conditions de construction des cadres nationaux et des rejeux des formes des appartenances et des identités. Les travaux des sociologues, des géographes, des historiens ont beau se multiplier depuis plusieurs décennies, le développement des savoirs vient buter sur un contexte de luttes économiques tues sur un socle de passions identitaires, qui conduit à faire à nouveau du rejet des immigrants un moteur des politiques de nombreux Etats, en Europe et au-delà. Cela est connu, trop connu. La Méditerranée, grand cimetière africain, le plus grand cimetière de migrants au monde, 30 000 morts depuis 1990 selon lONG United against racism, nous nous devons de tristement répéter ces réalités monstrueuses en ouvrant ce numéro des Cahiers dhistoire qui nous parle dItalie, de cette "botte" immergée en Méditerranée1. Nous devons le répéter en cette année qui célèbre la gloire dun grand migrant de la Péninsule, savant, peintre, dont lhumanité tout entière sapproprie aujourdhui les oeuvres, devenues "patrimoine" pour lhumanité. Né à Vinci, en Toscane, mort à Amboise, dans le royaume de France en 1519, Léonard nous ramène à un temps où lItalie nétait pas une et où le grand savant pouvait vendre son talent dinventeur aux princes qui y menaient avec constance des guerres pour lhégémonie sur de micro territoires. Pascal Brioist a rappelé cela, qui déconstruit à sa façon les mythologies nationalistes2. Les Cahiers dhistoire se sont donc saisis du choix des "Rendez-vous dhistoire" de Blois de faire penser à propos de l "Italie" pour construire ce dossier. LItalie, beau cas décole que ce petit espace intensément divisé par la dense présence humaine, par une exceptionnelle ouverture maritime, si propice à létude de la réalité des migrations et de la diversité de leurs visées comme de leurs formes. Les historiens de lItalie mais aussi des migrations, Mathieu Grenet et Stéphane Mourlane, ont fait le choix de décentrer nos regards par rapport au drame contemporain comme aux flux spectaculaires bien connus de lémigration italienne des 19e et 20e siècles pour évoquer les circulations internes à la Botte et interroger le rôle de ces déplacements de femmes et dhommes dans la construction dune nation unifiable, de fait politiquement unifiée depuis la fin du 19e siècle3. Les contributions rassemblées dans ce dossier des Cahiers dhistoire étudient ces faits migratoires sur un temps long allant du Moyen Age au 20e siècle. Elles rappellent donc de façon salutaire la diversité des configurations sociales des migrations. La migration nest pas le plus souvent un passage de frontière, elle nest pas non plus toujours définitive. Elle est souvent saisonnière, associée à une recherche de travail qui conduit à partir avec le projet de revenir et lorganisation de retours. Elle saccompagne de multiples allers-retours, visant à entretenir des liens que la migration met à mal, notamment entre parents et enfants, comme lévoque ici en particulier Anna Badino à propos du grand mouvement migratoire du sud vers le nord de laprès Seconde Guerre mondiale. Mais les migrations ont souvent été plus courtes : Eleonora Canepari évoque une circulation permanente entre les campagnes et la ville de Rome à lépoque moderne, reprenant les mots évocateurs de lun de ces migrants : "Je vais et viens de Rome selon les occasions" . Toutes les contributions disent la complexité des faits migratoires, entre circulations traditionnelles transfrontalières et refus de la conscription napoléonienne dans les populations rurales des Apennins étudiés par Francesco Saggiorato, situations socialement contrastées des migrants ruraux vers la Florence médiévale évoquée par Cédric Quertier, croisements de multiples mouvements dans le temps, dans lespace, au gré des opportunités politiques comme économiques, des contraintes étatiques, religieuses, tels quévoqués par Matteo Sanfilippo dans le moyen terme des 18e et 19e siècles. Ces études rappellent que les migrations sont de toutes les sociétés et de tous les temps, mais aussi que ce sont les interdictions de circuler qui les transforment en exils quasi définitifs, amplifiant à la fois leur dimension de déracinement et la marginalisation des migrant-es dans les sociétés darrivée.
10/2019
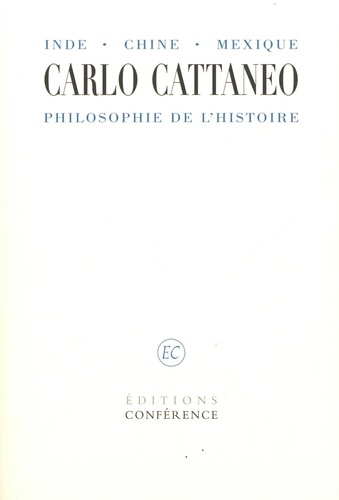
Ethnologie et anthropologie
Inde - Chine - Mexique. Philosophie de l'histoire
L'ouvrage présente des textes majeurs de Carlo Cattaneo (1801-1969) : six articles diversement monographiques, sous deux guises essentielles - l'étude monographique proprement dite, aux accents totalement inédits, de trois pays lointains d'une part, envisagés dans la perception conjointe de leur histoire, de leur culture, de leur économie et de leur droit ; et d'autre part, la conception de la philosophie de l'histoire et de l'homme lui-même qui soutient une telle étude. En 1993, dans l'une de ses dernières leçons devant ses étudiants en architecture, Giancarlo De Carlo leur conseillait vivement de faire quelques lectures décisives s'ils voulaient apprendre à connaître le paysage et le territoire, les questions à leur poser, les enseignements à tirer de leur histoire ; parmi elles, essentielle à ses yeux, celle de Cattaneo, India Messico Cina, " un très beau livre, peut-être un peu difficile à trouver [G. De Carlo songeait à la seule édition indépendante de ces trois textes, celle de Bompiani en 1942], où il parle précisément de la formation du paysage et du rapport entre le paysage et les économies des différents pays " (G. De Carlo, La città e il territorio, Macerata, Quodlibet, 2019, p. 43). C'est bien cela en effet qu'apprendront les étudiants en parcourant cette histoire incarnée de trois pays, reconstituée dans un dessein d'ensemble qu'il importe de méditer aujourd'hui ; et ce n'est pas sans raison que G. De Carlo se tournait vers Cattaneo : soucieux d'ouvrir les étudiants à une approche pluridisciplinaire de l'architecture, il était naturel qu'il retrouvât le rédacteur du Politecnico, à l'inlassable curiosité s'impatientant de frontières trop étroites. " Notre culture ", écrivait-il, " et pas seulement la culture architecturale, a été mutilée par le phénomène de la spécialisation : pour aller plus vite, pour résoudre des problèmes quantitatifs, pour accroître l'efficacité, on se concentre à chaque fois sur une petite partie du monde, en croyant qu'on retrouvera dans un second temps une vision d'ensemble. Mais cela s'est rarement produit, parce que la distorsion congénitale de la spécialisation fait qu'en se concentrant sur un point, elle perd le sens de la raison pour laquelle ce point existe " (ibid.). Cattaneo fournira l'antidote parfait aux risques qui inquiétaient l'architecte. En ce sens, Il Politecnico, la revue qu'il fonda en 1839, et en laquelle on a vu " le plus beau périodique de culture et de sciences que l'Europe ait eu à cette époque " (Elio Vittorini), sera, en certains domaines, le laboratoire le plus vivant de la pensée du XIXe siècle, et en d'autres, la chambre d'enregistrement la plus fidèle des innovations et des avancées qui s'y produisirent. C'est à cette revue que sont empruntés la majorité des textes que présente ce volume. Il y a cependant une grande cohérence dans la diversité même des intérêts de Cattaneo. Elle se retrouve jusque dans ses pages les moins liées en apparence à la philosophie de l'histoire qu'il développe, et dont ce recueil voudrait être la manifestation à la fois théorique (les Considérations ou les pages sur Vico) et appliquée (les monographies sur l'Inde, la Chine, le Mexique, et pour joindre pour ainsi dire les deux approches, celle sur les " types humains ", admirable leçon disqualifiant à la fois le racisme et, à l'avance, l'" antiracisme ", comme autant de manquement et à la pensée et à la réalité mêmes). Une diversité, donc, mais exigeante et orientée, aimantée par l'idée d'une commune dignité du genre humain ayant à méditer sur sa propre histoire et à se demander à lui-même le développement le plus harmonieux. On trouvera ici des formules décisives de cet humanisme scientifique, tout ensemble rêveur et curieux de tout, inventif et fervent ; partout règne la même attention à l'unité du genre humain, une unité incarnée, diverse, étrange parfois, mais toujours féconde et pour la pensée, et pour le projet politique, caressé en sous-main, d'un fédéralisme des nations gouverné par la foi dans le développement harmonieux des sciences, des cultures, des civilisations. Ainsi dans son De bello nelle arti ornamentali, " Du beau dans les arts décoratifs ", si éloigné que paraisse un tel texte des études à la fois historiques, géographiques, économiques, culturelles, juridiques, que parvient à mener Cattaneo dans les monographies de pays ou les études plus proprement philosophiques réunies ici, on retrouve, en peu de mots, le fond essentiel de ses convictions, qui peuvent emprunter toutes les voies - philosophique, " sociologique " avant la lettre, esthétique, etc. - pour se dire : " Il n'y a pas de raison qu'un pont de fer, dans sa gracilité apparente, ne puisse devenir aussi élégant qu'un arc massif en marbre. Il n'y a pas de raison qu'une pesante locomotive ne puisse recevoir de telles proportions formelles que les spectateurs ajoutent l'admiration pour sa beauté sévère à l'étonnement que leur inspire sa redoutable efficacité " ; il faut " accepter les cadeaux de tous les siècles et de toutes les nations, en faisant, comme disait, non sans grâce, Annibal Caro, non gerbe de toute herbe, mais guirlande de toutes fleurs [... ] De même, quand on a appris la grammaire d'une langue, on peut rencontrer le même assemblage de formes mentales dans celle d'une autre ; et à la fin, dans la contrariété babélienne des paroles humaines, on voit paraître un même tronc revêtu d'un feuillage différent " (Scritti letterari, artistici, linguistici e vari, a ura di A. Bertani, Florence, Le Monnier, vol. I, pp. 135-137). C'est à cet ouverture admirative et raisonnée sur la diversité du monde que Cattaneo nous convie. Les pages que nous réunissons donnent un premier aperçu de cet art du regard, de l'attention et de la pensée.
11/2021

Histoire internationale
Impérialisme, guerre et lutte de classes en Allemagne 1914-1918
Paul Frölich avait conçu ce livre comme la première partie d'une oeuvre plus importante (10 Jahre Krieg und Bürgerkrieg.I. Der Krieg, " Dix ans de guerre et de guerre civile. I. La guerre "), qui aurait dû s'occuper des événements intervenus en Allemagne pendant et après la Première Guerre mondiale. Toutefois, il ne réussit à terminer que le premier volume (Der Krieg, " La guerre ") que nous présentons ici dans sa première édition française. Le livre s'ouvre sur les événements d'août 1914, qui représentent un tournant. Le capitalisme entre dans le XXe siècle ayant épuisé la phase de développement progressif des forces productives et ayant atteint le stade de l'impérialisme. Le déclenchement de la Première Guerre mondiale transforme les rythmes insouciants de la Belle Epoque en détonations meurtrières. Comme l'écrit Erich Maria Remarque (A l'Ouest, rien de nouveau), " une génération a été détruite par la guerre, même si elle a réussi à échapper aux obus ". Cette guerre représente le commencement dramatique de ce que Lénine appela " l'époque des guerres e des révolutions ". Il ne s'agit plus de guerres bourgeoises pour la formation de marchés, mais de guerres impérialistes pour le partage de marchés et du monde tout entier en sphères d'influence. La lutte de la Bosnie pour son indépendance de l'Autriche, qui constitue le casus belli, ne change pas le caractère essentiellement impérialiste de la guerre. L'impuissance de la bourgeoisie à résoudre les causes de l'instabilité et les conflits de l'époque impérialiste est démontrée par le fait que l'effondrement des deux Empires – l'Ottoman, et l'Austro-hongrois – a ouvert, au carrefour entre Europe, Asie, Afrique, un arc de crise encore existant, allant des Balkans jusqu'au Moyen-Orient. Remarque avait raison : la destruction n'a pas été exclusivement physique. Le conflit emporte comme un ouragan les classes exploitées. D'autant plus que, en quelques jours à peine, l'édifice politique que les travailleurs avaient construit avec leurs luttes, grâce aux efforts et aux sacrifices de beaucoup – l'Internationale socialiste – a fondu comme neige au soleil. Après les grands discours, les affirmations solennelles et les ordres du jour, la plupart des partis socialistes se rangent du côté de leurs bourgeoisies respectives, allant jusqu'à théoriser que l'Internationale doit être considérée comme un instrument pour les périodes de paix, et " suspendue " en temps de guerre. C'est la plus flagrante trahison des aspirations de la classe ouvrière. Selon certaines sources, Lénine lui-même, à l'annonce du vote en faveur des crédits de guerre par la social-démocratie allemande – jusque là point de repère de l'ensemble du prolétariat européen – aurait exprimé son étonnement et son incrédulité. Un grand rendez-vous historique est manqué. Le désarroi des masses est énorme. Les courants internationalistes restent isolés et dans l'impossibilité de renverser la situation. A l'exception de la Russie. En effet, " quelque chose de nouveau " entre en scène " à l'est ". La Révolution d'octobre et les épisodes de fraternisation entre les troupes sur le front oriental deviennent l'exemple à suivre. Ce n'est pas un hasard. L'exception russe était due à la rupture précoce de Lénine et des bolcheviks d'avec les réformistes. Son analyse de l'impérialisme, du social-impérialisme et ses bases sociales dans l'aristocratie ouvrière – corrompue par les miettes de superprofits – explique la dynamique objective de la trahison social-démocrate. Le retard de la rupture avec les réformistes empêche les internationalistes allemands et de l'Europe de l'ouest de suivre l'exemple russe. La révolution reste isolée. Sur le côté oriental, elle accélère objectivement le développement de l'Asie, en amorçant les luttes de libération nationale dans les pays arriérés. Sur le côté occidental, elle ne trouve pas l'alliance naturelle avec le prolétariat le plus important et le plus avancé politiquement du monde : le prolétariat allemand. Pour cette raison, en Occident, la révolution doit reculer devant une contre-révolution interne qui, malheureusement, en vole traîtreusement le langage, les symboles et les drapeaux : le stalinisme. Pendant des décennies, le capitalisme d'Etat oriental se présente comme socialisme voire comme communisme. Mais finalement l'histoire a réclamé des comptes. La " rupture du maillon le plus faible de la chaîne impérialiste " se réfère à l'immense " crise de déséquilibre " représentée par une super-structure encore tsariste du développement capitaliste en Russie. En effet, la social-démocratie n'a même pas essayé de limer le maillon le plus fort, le maillon allemand ; au contraire, elle l'a renforcé, en déployant le prolétariat aux côtés de sa propre bourgeoisie. C'est là l'échec historique du réformisme, un échec qui n'admet pas d'appel. La question historique et politique centrale demeure la trahison de la social-démocratie en 1914. Comment cela a pu se produire ? Quelles en ont été les conditions ? Quelle la dynamique ? Comment peut-elle justifier sa trahison devant les masses ? C'est en répondant à ces questions que le travail de Paul Frölich prend toute son épaisseur. Internationaliste, connu pour sa superbe biographie de Rosa Luxemburg, Frölich nous offre une chronique politique autant sévère que documentée de ces événements. Depuis les causes de la guerre (l'impérialisme, le colonialisme, le militarisme) et les positions internationalistes et antimilitaristes de la IIe Internationale, jusqu'au " triomphe de la folie " déclenché le 28 juin 1914, à Sarajevo, par l'assassinat de l'archiduc François-Ferdinand, héritier du trône autrichien, par les nationalistes bosniaques. De la social-démocratie impériale du 4 août (date du premier vote au Reichstag sur les crédits de guerre), à la paix sociale imposée grâce aux syndicats et à la suspension des lois de protection des travailleurs. Sur ce terrain, les dirigeants sociaux-démocrates vont même au-delà des requêtes du patronat, allant jusqu'à abolir les célébrations du Premier mai. Depuis les luttes de classe qui ont eu lieu en dépit de tout cela, au courage de Karl Liebknecht qui, lors du procès politique contre lui, s'érige en juge du gouvernement et de la bourgeoisie allemands. Liebknecht est condamné à quatre ans et un mois de prison et à six ans de privation des droits politiques. Une condamnation qui contribue à faire pousser des ailes aux radicaux de gauche et au groupe Spartakus, malgré l'emprisonnement à plusieurs reprises d'autres dirigeants du calibre de Rosa Luxemburg et Franz Mehring. On en arrive ainsi à la crise finale et aux révoltes de masse, à savoir à la débâcle politique et militaire de l'impérialisme allemand. Dans son travail, l'auteur ne saisit pas toujours entièrement les limites de l'action politique de la gauche social-démocrate (voir chapitre 3, l'allusion à " la grève générale politique de masse ", une thèse chère à Rosa Luxemburg). Dans le même chapitre, Frölich fait référence à la " thèse erronée d'Engels " contre l'insurrection et en faveur d'une action respectueuse des lois. De toute évidence, il ne savait pas que l'introduction de 1895 d'Engels aux Luttes de classe en France de 1848 à 1850, de Marx, avait été grossièrement falsifiée par l'élimination de plusieurs morceaux, et qu'elle avait été publiée à l'époque sous cette forme domestiquée dans le Vorwärts. C'est Karl Kautsky qui avait refusé à Engels la publication du texte complet. Mais, dans l'ensemble, le texte de Frölich est très valable. C'est une fresque fascinante du grand drame historique dans lequel les masses anonymes, trahies et trompées, sont envoyées à l'abattoir. Un massacre que l'auteur estime à hauteur d'environ 35 millions de victimes, en comptant, dans les différents pays, la chute de la natalité, les morts au front et les victimes des famines et des difficultés de toutes sortes à l'intérieur. Nous sommes certains que, en parcourant ces pages, aujourd'hui encore, même le lecteur politiquement engagé et non dépourvu de culture historique sera pris d'étonnement, d'indignation et, peut-être, de colère. C'est bien qu'il en soit ainsi. La force que la social-démocratie allemande aurait pu déployer contre la guerre et contre sa propre bourgeoisie est impressionnante : des centaines de milliers de membres du Parti, quatre millions d'électeurs, 110 représentants au Parlement ainsi que de nombreux journaux ayant une large diffusion parmi le prolétariat, ce à quoi il faut encore ajouter les organisations syndicales et les coopératives. Mais Frölich documente la progressive diffusion – dès avant le déclenchement du conflit – de positions opportunistes, social-impérialistes et colonialistes au sein du Parti et parmi ses cadres syndicaux. Il en analyse aussi ponctuellement les formulations et les prétentions théoriques, souvent basées sur la " défense des intérêts nationaux ". A une époque telle que la nôtre, caractérisées par des processus de renationalisation, par le localisme et le racisme, il s'agit là d'une leçon précieuse. Le bruit de la campagne en faveur de la guerre est assourdissant. Les journaux surchauffent les esprits. La chasse à l'étranger est lancée. Les chants de guerre accompagnent le départ des troupes : " A chaque balle, un Russe / A chaque coup de baïonnette, un Français / A chaque coup de pied, un Britannique ! " Parmi ceux qui vocifèrent, il y a aussi de nombreux travailleurs socialistes, entraînés dans le tourbillon. Une autre leçon à retenir. Le chapitre sur la guerre en tant qu'" affaire " est instructif. " Business as usual ", écrit Frölich au tout début du chapitre. Il explique les diverses méthodes par lesquelles " l'or était distillé à partir du sang humain ". Il documente aussi l'extraordinaire multiplication généralisée des profits, la grande arnaque financière de Daimler Motoren Werke à Stuttgart, les menaces de sabotage de cette même Daimler, les dons intéressés à la Croix-Rouge, les sociétés par actions de la bienfaisance. Parmi les autres exemples, le libéralisme commercial paradoxal et effronté de Thyssen qui, en pleine guerre, vend des boucliers à l'armée allemande à 117 reichsmarks la pièce, et à 68 reichsmarks au gouvernement néerlandais. Les hommes de confiance des grands industriels deviennent les conseillers des bureaux gouvernementaux. Les épisodes d'escroquerie que relate Frölich sont nombreux. Les impôts de guerre se répercutent principalement sur la consommation de masse. Le livre contient beaucoup d'affirmations qui font réfléchir. Rappelons-en deux. " Regardez le monde tel qu'il était avant la guerre, et vous verrez que c'était un monde qui était fait pour la guerre ", écrit Frölich au début du texte. Il parle d'économie mondiale, de concentration du capital, de blocs de puissances, d'armements, de partage des marchés... Si l'on fait une comparaison, comment le monde d'aujourd'hui se présente-t-il ? " Pour nous, aujourd'hui, il est clair que les deux questions que constituaient le maintien de la paix et la révolution, n'en faisaient qu'une. Lutte contre la guerre voulait dire lutte de pouvoir contre la bourgeoisie dans tous les pays, autrement dit lutte révolutionnaire. Aujourd'hui, il est tout aussi clair pour nous que la lutte révolutionnaire présuppose certaines conditions spirituelles, morales et organisationnelles. " Et encore : " Le désarmement était une utopie. A tout moment, il était possible d'en contourner les effets en créant de nouveaux moyens de guerre. " La critique de Frölich à l'égard des positions de Karl Kautsky est ponctuelle. Ce dernier imaginait un capitalisme sans l'impérialisme et sans politique de puissance. Une lutte véritable pour la paix et contre le militarisme n'est possible qu'à la condition d'être une lutte contre le capitalisme. En conclusion de son livre, Frölich affirme qu'il ne voit pas la paix dans l'avenir de l'Europe : " Certains Etats se sont effondrés. Sous les ruines de la guerre mondiale gisent les cendres des vieilles monarchies. Le monde a été partagé de manière différente. La France se considère comme la première puissance du continent européen, les Etats-Unis comme la première puissance du monde. Certains Etats impérialistes ont été détrônés. Les colonies ont fait un grand pas en avant sur la voie de leur libération. L'Allemagne et l'Autriche sont devenues elles-mêmes des colonies. ... Les peuples se sont laissés entraîner au massacre de masse dans le but de renverser le militarisme allemand qui menaçait tout le monde. Ce but "élevé" est atteint, et le monde, plus sinistre que jamais, regorge d'armements. Avant la guerre, les armées comptaient sept millions d'hommes ; elles en comptent onze millions après la guerre. ... On dit que ce sera la dernière guerre. La Société des Nations existe désormais. Les tribunaux d'arbitrage sont mis à contribution. Les peuples sont unis sur le papier par de sacro-saints traités qui n'engagent à rien. En vue de la prochaine guerre, les techniciens et les chimistes se mettent au travail et les Etats s'arment. ... Et pourtant ! La bourgeoisie s'est elle-même porté le coup le plus terrible en déclarant cette guerre. Dans l'immense empire de l'Est, la classe de l'avenir a déjà triomphé. Les vieilles puissances capitalistes sont grosses de la révolution. Et si aujourd'hui la bourgeoisie, dix ans après ce maudit 4 août, cherche encore une fois à prêcher la conciliation des classes en vue de l'extermination des peuples, alors retentira le cri de Karl Liebknecht, répété par des millions de voix : Contre la guerre, révolution ! " Les choses ne sont pas allées comme Frölich l'espérait. L'erreur de 1914-1918, sous d'autres formes, a déjà été répétée en 1939-1945. Elle ne doit plus se répéter. Voilà pourquoi elle doit être connue.
05/2014

