Le guépard
Giuseppe Tomasi di Lampedusa
Mai 1860
"Nunc et in hora mortis nostrœ. Amen."
La récitation quotidienne du Rosaire était finie. Pendant une demi-heure la voix paisible du Prince avait rappelé les Mystères Douloureux ; pendant une demi-heure d'autres voix, entremêlées, avaient tissé un bruissement ondoyant d'où s'étaient détachées les fleurs d'or de mots inaccoutumés : amour, virginité, mort ; et pendant que durait ce bruissement le salon rococo semblait avoir changé d'aspect ; même les perroquets qui déployaient leurs ailes irisées sur la soie de la tenture avaient paru intimidés ; même la Marie Madeleine, entre les deux fenêtres, ressemblait davantage à une pénitente qu'à une belle grande blonde, perdue dans on ne sait quels rêves, comme on la voyait toujours.
À présent, la voix s'était tue, tout rentrait dans l'ordre, dans le désordre, habituel. Par la porte qu'avaient passée les domestiques pour sortir, le danois Bendico, attristé de son exclusion, entra et remua la queue. Les femmes se levaient lentement, et les oscillations de leurs jupes en se retirant laissaient peu à peu découvertes les nudités mythologiques qui se dessinaient sur le fond laiteux du carrelage. Seule une Andromède resta cachée par la soutane du Père Pirrone, qui s'était attardé dans ses oraisons supplémentaires ; elle l'empêcha un bon moment de revoir le Persée argenté qui, survolant les flots, se hâtait à son secours et vers le baiser.
Sur la fresque du plafond, les divinités se réveillèrent. Les cortèges de Tritons et de Dryades s'élançant depuis montagnes et mers dans des nuages framboise et cyclamen vers une Conque d'Or transfigurée, pour exalter la gloire de la maison Salina, étaient apparus comblés d'une si grande allégresse qu'ils en négligeaient les règles les plus élémentaires de la perspective ; et les plus grands Dieux, les Princes parmi les Dieux, Jupiter foudroyant, Mars sévère, Vénus langoureuse, qui avaient précédé les foules de divinités mineures, soutenaient de bon gré le blason azur au Guépard. Ils savaient que, pendant vingt-trois heures et demie, ils allaient maintenant reprendre leur empire sur la villa. Les singes, sur les murs, recommencèrent à faire des grimaces aux cacatoès.
Au-dessous de cet Olympe palermitain, les mortels de la maison Salina descendaient à la hâte, eux aussi, des sphères mystiques. Les jeunes filles arrangeaient les plis de leurs robes, échangeaient des coups d'œil azurés et des bavardages de pensionnaires ; depuis plus d'un mois, depuis le jour des « mouvements » du Quatre Avril, on les avait fait revenir, par prudence, du couvent, et elles regrettaient les dortoirs à baldaquin et l'intimité collective du Saint-Sauveur. Les garçons se querellaient pour la possession d'une image de saint François de Paule ; l'aîné, l'héritier, le duc Paolo, avait déjà envie de fumer et, craignant de le faire en présence de ses parents, il palpait à travers sa poche la paille tressée de son porte-cigares ; une mélancolie métaphysique se montrait sur son visage émacié : la journée avait été mauvaise : Guiscardo, l'alezan irlandais, ne lui avait pas paru très en forme, et Fanny n'avait pas trouvé le moyen (ou l'envie ?) de lui faire parvenir l'habituel petit billet couleur parme. À quoi servait alors que le Rédempteur se soit incarné ? L'orgueil anxieux de la Princesse laissa tomber sèchement le chapelet dans son sac brodé de jais, tandis que ses beaux yeux inquiets regardaient du coin de l'œil ses enfants esclaves et son mari tyran vers lequel son corps minuscule s'élançait dans une impatience vaine de possession amoureuse.
Lui, le Prince, pendant ce temps, se levait : le heurt de son poids de géant faisait trembler le plancher et dans ses yeux très clairs se refléta, un instant, l'orgueil de la confirmation éphémère de sa domination sur les hommes et les édifices. Il posait à présent l'énorme Missel rouge sur la chaise qui se trouvait devant lui pendant la récitation du Rosaire, rangeait le mouchoir sur lequel il avait posé son genou, et un peu de mauvaise humeur brouilla son regard quand il revit la petite tache de café qui depuis le matin avait eu l'impertinence de rompre l'étendue blanche de son gilet.
Non qu'il fût gros : il n'était qu'immense et très fort ; sa tête effleurait (dans les maisons habitées par le commun des mortels) les lustres ; ses doigts pouvaient froisser comme du papier vélin les pièces d'un ducat ; et entre la villa Salina et l'atelier d'un orfèvre le va-et-vient était fréquent pour la réparation de fourchettes et de cuillères que ses colères contenues, à table, lui faisaient souvent tordre en cercle. Ces doigts, cependant, savaient aussi avoir un toucher très délicat quand ils tâtaient et caressaient, et Maria Stella, sa femme, en avait des souvenirs à ses dépens ; de même les vis, les manchons, les boutons dépolis des télescopes et des lunettes astronomiques, et autres « chercheurs de comètes » qui là-haut, au faîte de la villa, encombraient son observatoire privé, demeuraient intacts sous ses effleurements légers. Les rayons du soleil couchant de cet après-midi de Mai illuminaient le teint rosé, les poils couleur de miel du Prince; ils dénonçaient l'origine allemande de sa mère, cette princesse Caroline dont l'orgueil hautain avait glacé, trente ans auparavant, la cour négligée des Deux-Siciles. Mais dans son sang d'autres essences germaniques fermentaient, bien plus fâcheuses pour cet aristocrate sicilien en cette année 1860, que l'attrait de la peau très blanche et des cheveux blonds au milieu de gens olivâtres et aux cheveux de jais : un tempérament autoritaire, une certaine rigidité morale, une propension aux idées abstraites qui dans la mollesse de l'habitat de la société palermitaine s'étaient transformés en arrogance capricieuse, en scrupules moraux perpétuels et en mépris pour ses parents et ses amis qui lui semblaient aller à la dérive dans les lenteurs pragmatiques du fleuve sicilien.
Premier (et dernier) d'une lignée qui au cours des siècles n'avait jamais su faire l'addition de ses dépenses ni la soustraction de ses dettes, il avait de réelles et fortes inclinations pour les mathématiques ; il les avait appliquées à l'astronomie et en avait tiré des reconnaissances publiques suffisantes et des joies personnelles très savoureuses. Il suffit de dire que chez lui l'orgueil et l'analyse mathématique s'étaient à tel point associés qu'ils pouvaient lui donner l'illusion que les astres obéissaient à ses calculs (comme, de fait, ils semblaient le faire) et que les deux petites planètes qu'il avait découvertes (il les avait appelées Salina et Svelto, comme son fief et un de ses chiens de chasse, un braque qu'il n'avait pas oublié) propageaient la renommée de sa maison au milieu des espaces stériles entre Mars et Jupiter et que les fresques de la villa avaient été, par conséquent, plutôt une prophétie qu'une adulation.
Sollicité d'un côté par l'orgueil et l'intellectualisme maternel, de l'autre par la sensualité et le laisser-aller de son père, le pauvre Prince Fabrizio vivait dans un mécontentement perpétuel, malgré son regard jupitérien courroucé, et il contemplait la ruine de sa classe et de son patrimoine sans rien faire pour y porter remède ni en avoir la moindre envie.
Cette demi-heure entre le Rosaire et le dîner était un des moments les moins irritants de la journée, et il en savourait des heures à l'avance le calme pourtant douteux.
Précédé d'un Bendico très excité, il descendit le court escalier qui menait au jardin. Enfermé entre trois murs et un côté de la villa, sa réclusion lui conférait un aspect sépulcral accentué par les monticules parallèles qui délimitaient les petits canaux d'irrigation et qui ressemblaient à des tumulus de géants élancés. Sur le sol rougeâtre, les plantes croissaient dans un désordre touffu, les fleurs poussaient où Dieu voulait et les haies de myrte semblaient avoir été placées pour entraver plus que pour diriger les pas. Au fond, une Flore marbrée de lichen jaune et noir exhibait avec résignation ses charmes plus que séculaires ; à ses côtés, deux bancs soutenaient des coussins roulés et brodés, eux aussi en marbre gris, et dans un coin l'or d'un cassier interposait son allégresse intempestive. De chaque motte de terre émanait la sensation d'un désir de beauté vite brisé par la paresse.
Mais le jardin, resserré et macérant entre ses clôtures, exhalait des parfums onctueux, charnels et légèrement putrides comme les liquides de décomposition aromatiques distillés par les reliques de certaines saintes ; les petits œillets superposaient leur odeur poivrée à celle, protocolaire, des roses et, huileuse, des magnolias qui s'alourdissaient dans les coins ; tout en dessous, on percevait aussi le parfum de la menthe mêlé à celui, enfantin, du cassier et à celui, confit, du myrte et, par-delà le mur, la senteur d'alcôve des premières fleurs d'oranger débordait de la plantation d'agrumes.
C'était un jardin pour aveugles : la vue était constamment offensée mais l'odorat pouvait en tirer un fort plaisir quoique sans délicatesse. Les roses Paul Neyron dont il avait lui-même acheté les plants à Paris avaient dégénéré : stimulées d'abord, puis ramollies par les sèves vigoureuses et indolentes de la terre sicilienne, brûlées par des juillets d'apocalypse, elles s'étaient transformées en une sorte de choux couleur chair, obscènes, mais distillant un arôme dense et presque ignoble qu'aucun horticulteur français n'eût osé espérer. Le Prince en porta une à son nez et il lui sembla sentir la cuisse d'une danseuse de l'Opéra. Bendico, à qui la fleur fut aussi offerte, s'écarta écœuré et s'empressa de chercher des sensations plus salubres parmi le fumier et quelques petits lézards morts.
Pour le Prince, pourtant, le jardin parfumé fut la cause de sombres associations d'idées. « Aujourd'hui ça sent bon, mais il y a un mois... »
Il se souvenait du dégoût que les relents douceâtres avaient diffusé dans toute la villa avant que la cause en fût éloignée : le cadavre d'un jeune soldat du 5e bataillon de Chasseurs qui, blessé dans la mêlée de San Lorenzo contre les escouades des rebelles, était venu mourir, seul, sous un citronnier. On l'avait trouvé la face contre le sol dans le trèfle épais, le visage enfoncé dans le sang et les vomissures, les ongles plantés dans la terre, couvert de grosses fourmis ; et, en dessous des bandoulières, les intestins violacés avaient formé une flaque. C'était Russo, le surintendant, qui avait trouvé cette chose brisée, qui l'avait retournée, avait caché le visage de son grand mouchoir rouge, avait renfoncé les viscères avec une petite branche dans la déchirure du ventre, et avait recouvert ensuite la blessure avec les pans verts de la capote ; en crachant sans arrêt de dégoût, pas vraiment sur la dépouille, mais assez près. Le tout avec une inquiétante habileté. « La puanteur de ces charognes ne cesse pas, même quand ils sont morts », disait-il. C'était tout ce qui avait commémoré cette mort abandonnée. Ensuite, quand ses compagnons d'armes, émus, l'eurent emporté (et, oui, ils l'avaient traîné par les épaules jusqu'à la charrette si bien que l'étoupe du pantin était ressortie de nouveau) on ajouta au Rosaire du soir un De Profundis pour l'âme de l'inconnu ; et on n'en parla plus, la conscience des femmes de la maison s'étant déclarée satisfaite.
Don Labrizio alla gratter un peu de lichen sur les pieds de la statue de Llore et commença à se promener en long et en large. Le soleil bas projetait son ombre immense sur les plates-bandes funèbres. On n'avait plus parlé du mort, en effet ; au bout du compte, les soldats sont des soldats justement pour mourir en défendant le Roi. Mais l'image de ce corps éventré réapparaissait souvent dans ses souvenirs comme si elle demandait qu'on lui donne la paix de la seule manière possible pour le Prince : en dépassant et en justifiant son extrême souffrance par une nécessité générale. Parce que mourir pour quelqu'un ou pour quelque chose, d'accord, c'est dans l'ordre des choses ; il faut pourtant savoir ou, du moins, être certain que quelqu'un sache pour qui ou pour quoi on est mort ; c'est cela que demandait ce visage abîmé ; et c'est là que, justement, commençait le brouillard.
« Mais il est mort pour le Roi, mon cher Labrizio, c'est clair », lui aurait répondu son beau-frère Màlvica si Don Labrizio l'eût interrogé, ce même Màlvica toujours choisi comme porte-parole de la foule de ses amis. « Pour le Roi, qui représente l'ordre, la continuité, la décence, le droit, l'honneur ; pour le Roi qui, seul, défend l'Église, qui, seul, empêche l'écroulement de la propriété, but ultime de la "secte". »
C'étaient de très belles paroles, qui indiquaient tout ce qui était cher au Prince, jusqu'aux racines de son cœur. Quelque chose, pourtant, grinçait encore. Le Roi, d'accord. Le Roi, il le connaissait bien, du moins celui qui était mort depuis peu ; le Roi actuel n'était qu'un séminariste habillé en général. Et, à vrai dire, il ne valait pas grand-chose. « Mais ce n'est pas un raisonnement, Fabrizio », répliquait Màlvica, « un souverain pris individuellement peut ne pas être à la hauteur, mais l'idée monarchique reste ce qu'elle est; elle est détachée des personnes. » « Cela aussi est vrai ; mais les Rois qui incarnent une idée ne peuvent pas, ne doivent pas descendre d'une génération à l'autre au-dessous d'un certain niveau; sinon, mon cher beau-frère, l'idée elle-même en pâtit. »
Assis sur un banc, il restait inerte à contempler les dévastations que Bendico opérait dans les plates-bandes ; de temps à autre, le chien tournait vers lui ses yeux innocents comme pour être loué du travail accompli : quatorze œillets brisés, la moitié d'une haie arrachée, un petit canal obstrué. On aurait vraiment dit un humain. « C'est bon, Bendico, viens là. » Et la bête accourait, posait son museau terreux sur la main, anxieuse de lui montrer que la grossière interruption d'un travail si bien accompli lui était pardonnée.
Les audiences, les nombreuses audiences que le Roi Ferdinand lui avait accordées à Caserte, à Naples, à Capodimonte, à Portici, au diable vauvert...
À côté du chambellan de service qui le guidait en bavardant, son bicorne sous le bras et les dernières grossièretés napolitaines à la bouche, on parcourait les salles interminables d'une architecture magnifique et au mobilier écœurant (exactement comme la monarchie bourbonienne), on enfilait des corridors malpropres et des petits escaliers mal tenus et on débouchait dans une antichambre où beaucoup de gens attendaient : des visages fermés de sbires, des visages avides de quémandeurs recommandés. Le chambellan s'excusait, permettait de dépasser l'obstacle de cette canaille, et vous pilotait vers une autre antichambre, celle réservée aux gens de Cour : une petite pièce azur et argent ; au bout d'une courte attente, un domestique grattait à la porte et on était admis devant la Présence Auguste.
Le cabinet privé était petit et artificiellement simple : sur les murs blanchis un portrait du Roi François Ier et celui de la Reine actuelle, l'air aigri ; au-dessus de la cheminée une Madone d'Andréa del Sarto semblait étonnée de se trouver entourée de lithographies colorées représentant des saints de troisième ordre et des sanctuaires napolitains ; sur une console, un Enfant Jésus de cire et devant lui une veilleuse allumée ; et sur l'immense bureau, des papiers blancs, des papiers jaunes, des papiers bleus: toute l'administration du Royaume parvenue à sa phase finale, celle de la signature de Sa Majesté (D. G.).
Derrière ce barrage de paperasses, le Roi. Déjà debout pour ne pas être obligé de montrer qu'il se levait : le Roi avec sa grande face blême entre des favoris blondasses, et sa veste militaire de drap grossier d'où jaillissait la cataracte violacée des pantalons tombants. Il faisait un pas en avant avec la main droite déjà tendue pour le baisemain qu'il allait refuser. « Oh, Salina ! Heureux les yeux qui te voient ! » Son accent napolitain dépassait de loin en saveur celui du chambellan. « Je prie Sa Majesté le Roi de bien vouloir m'excuser si je ne porte pas la tenue de Cour ; je ne suis que de passage à Naples et je ne voulais pas omettre de présenter mes respects à Votre Personne. » « Salina, tu es fou ; tu sais bien qu'à Caserte tu es comme chez toi. Comme chez toi, évidemment », répétait-il en s'asseyant derrière son bureau et tardant un instant à faire asseoir son hôte.
« Et les petites, que font-elles ? » Le Prince comprenait qu'à cet instant il fallait placer l'équivoque en même temps salace et bigote. «Les petites, Majesté ? à mon âge et dans les liens sacrés du mariage ? » La bouche du Roi riait tandis que ses mains mettaient rageusement de l'ordre dans les papiers. « Je ne me serais jamais permis, Salina. Je parlais de tes petiotes, des petites Princesses. Concetta, notre chère filleule, doit se faire grande maintenant, une demoiselle. »
De la famille on passa à la science. « Toi, Salina, tu fais honneur non seulement à toi-même, mais à tout le Royaume ! La science est une bien belle chose quand elle ne se met pas en tête d'attaquer la religion ! » Ensuite, cependant, le masque de l'amitié était mis de côté pour assumer celui du Souverain Sévère. « Et dis-moi, Salina, que dit-on en Sicile de Castelcicala ? » Don Labrizio se défendait : il avait entendu pis que pendre tant du côté royaliste que du côté libéral, mais il ne voulait pas trahir son ami, il restait dans les généralités. « Un grand seigneur, une blessure glorieuse, peut-être un peu âgé pour les fatigues de la Lieutenance. » Le Roi s'assombrissait : Salina ne voulait pas faire le mouchard, Salina ne valait donc rien pour lui. Appuyant ses mains sur le bureau, il se préparait à le congédier. « J'ai tant de travail ; tout le Royaume repose sur ces épaules. » Il était temps de dorer la pilule ; le masque de l'amitié ressortit du tiroir : « Quand tu repasses par Naples, Salina, viens montrer Concetta à la Reine. Je sais, elle est trop jeune pour être présentée à la Cour, mais personne ne peut empêcher un petit déjeuner privé. Macaronis et belles filles, comme on dit. Au revoir, Salina, porte-toi bien. »
Une fois, pourtant, le congé avait été méchant. Don Fabrizio avait déjà fait sa seconde révérence à reculons lorsque le Roi le rappela : « Salina, écoute-moi bien. On m'a dit qu'à Païenne tu as de mauvaises fréquentations. Ce neveu à toi, Falconeri... pourquoi ne le refais-tu pas marcher droit ? » « Majesté, mais Tancredi ne s'occupe que de femmes et de jeux. » Le Roi perdit patience. « Salina, Salina, tu deviens fou. Le responsable, c'est toi, son tuteur. Dis-lui de surveiller son cou. Porte-toi bien. »
En parcourant de nouveau l'itinéraire fastueusement médiocre pour aller signer le registre de la Reine, il se sentait envahi par le découragement. La cordialité plébéienne l'avait déprimé autant que le rictus policier. Heureux tous ses amis qui voulaient interpréter la familiarité comme de l'amitié, la menace comme de la puissance royale. Lui, il ne pouvait pas. Et tandis qu'il échangeait des commérages avec l'impeccable chambellan, il se demandait qui était destiné à succéder à cette monarchie qui portait les signes de la mort sur son visage. Le Piémontais, celui qu'on appelait le « Galant-uomo », l'« Honnête Homme » qui faisait tant de vacarme dans sa petite capitale perdue ? Ne serait-ce pas la même chose ? Le dialecte turinois à la place du napolitain; rien d'autre.
On était arrivé au registre. Il signait : Labrizio Corbera, Prince de Salina.
Ou bien la République de don Peppino Mazzini ? « Merci bien. Je deviendrais monsieur Corbera. »
Et le long trajet du retour ne le calma pas. Même le rendez-vous déjà pris avec Cora Danolo ne put le consoler.
Les choses étant ce qu'elles étaient, que restait-il à faire ? S'accrocher à ce qui est là sans faire de sauts dans le vide? Il y fallait alors les coups de feu secs des tirs, comme il en avait retenti quelque temps plus tôt sur une place désolée de Païenne ; mais les coups de fusil, eux aussi, à quoi servaient-ils ? « On n'aboutit à rien avec les "poum poum" ! N'est-ce pas, Bendico ? »
«Ding, ding, ding ! » sonnait alors de son côté la cloche qui annonçait le dîner. Bendicô courait l'eau à la bouche, savourant à l'avance son repas. «Un vrai Piémontais ! », pensait Salina en remontant l'escalier.
Le dîner à la villa Salina était servi avec le faste ébréché qui était alors le style du Royaume des Deux-Siciles. Le nombre des convives (ils étaient quatorze, entre maîtres de maison, enfants, gouvernantes et précepteurs) suffisait à lui seul à conférer un caractère imposant à la table. Recouverte d'une nappe très fine, reprisée, elle resplendissait sous la lumière d'une puissante lampe carcel suspendue de façon précaire sous la «nymphe», sous le lustre de Murano. Par les fenêtres la lumière entrait encore mais les silhouettes blanches sur le fond sombre des cimaises au-dessus des portes, imitant des bas-reliefs, se perdaient déjà dans l'ombre. L'argenterie était massive et les magnifiques verres bosselés de Bohême portaient sur un médaillon lisse le chiffre F.D. (Ferdinandus dédit) en souvenir d'une largesse royale, mais les assiettes, marquées chacune d'un monogramme illustre, n'étaient que les survivantes des hécatombes accomplies par les garçons de cuisine et provenaient de services disparates. Celles de plus grande taille, un très beau capodimonte à large bordure vert amande décorée de petites ancres dorées, étaient réservées au Prince qui aimait avoir autour de lui toute chose à son échelle, hormis sa femme. Quand il entra dans la salle à manger ils étaient déjà tous réunis, seule la Princesse était assise, les autres debout derrière leur chaise. Devant sa place, à côté d'une pile d'assiettes, s'élargissaient les rondeurs argentées d'une soupière énorme au couvercle surmonté du Guépard dansant. Le Prince versait lui-même la soupe, une tâche agréable, symbole des fonctions nourricières du paterfamilias. Ce soir-là, toutefois, et cela n'était pas arrivé depuis longtemps, on entendit le tintement menaçant de la louche contre les bords de la soupière: signe d'une grande colère encore contenue, l'un des bruits les plus épouvantables qui pouvaient exister, comme le disait encore quarante ans plus tard un des fils survivants ; le Prince s'était rendu compte que Francesco Paolo, son fils de seize ans, n'était pas à sa place. Le jeune garçon entra en se hâtant (« pardonnez-moi, papa ») et s'assit. Il ne subit pas de reproches, mais le Père Pirrone, qui avait plus ou moins les fonctions d'un chien de berger, inclina la tête et se recommanda à Dieu. La bombe n'avait pas explosé mais le vent de son passage avait glacé la table et le dîner était quand même gâché. Tandis que l'on mangeait en silence, les yeux bleus du Prince, un peu rétrécis entre ses paupières mi-closes, fixaient ses enfants les uns après les autres et les rendaient muets de crainte.
En fait il pensait : « C'est une belle famille ! » Les filles rondelettes, à la santé florissante, avec leurs fossettes malicieuses et, entre le front et le nez, ce froncement sévère particulier, cette marque atavique des Salina. Les garçons minces mais vigoureux maniaient les couverts avec une violence mesurée. L'un d'eux, Giovanni, le deuxième, le plus aimé, le plus boudeur, était absent depuis deux ans. Un beau jour il avait disparu de la maison et on n'avait plus eu de ses nouvelles pendant deux mois. Jusqu'au moment où arriva de Londres une lettre respectueuse et froide dans laquelle il présentait ses excuses pour les inquiétudes qu'il avait causées, il rassurait sur sa santé et affirmait, étrangement, qu'il préférait la modeste vie de commis dans une maison de commerce de charbon à l'existence « trop choyée » (lire : enchaînée) au milieu de l'aisance palermitaine. Le souvenir, l'anxiété pour le jeune homme errant dans le brouillard enfumé de cette ville hérétique, pincèrent cruellement le cœur du Prince qui souffrit beaucoup. Il s'assombrit encore davantage.
Il s'assombrit tant que la Princesse, assise près de lui, tendit sa main enfantine et caressa la puissante grosse patte qui reposait sur la nappe. Geste imprudent qui déchaîna une série de sensations: l'irritation d'être plaint, la sensualité réveillée mais qui ne se dirigeait plus vers celle qui l'avait ranimée. En un éclair apparut au Prince l'image de Mariannina, la tête enfoncée dans l'oreiller. Il éleva sèchement la voix : « Domenico », dit-il à un serviteur, « va dire à don Antonino d'atteler les bais au coupé ; je descends à Palerme aussitôt après dîner. » En voyant les yeux de sa femme qui étaient devenus vitreux il se repentit de ce qu'il avait ordonné, mais puisqu'il était impensable de revenir sur une disposition désormais prise, il insista, ajoutant même la raillerie à la cruauté: « Père Pirrone, venez avec moi, nous serons de retour à onze heures ; vous pourrez passer deux heures à la Maison Professe avec vos amis. »
Aller à Palerme le soir, et par ces temps de désordres, apparaissait manifestement sans raison, hormis celle d'une aventure galante de bas étage: prendre ensuite comme compagnon l'ecclésiastique de la maison était d'une arrogance offensante. C'est ainsi du moins que le ressentit le Père Pirrone, et il en fut offensé ; mais, naturellement, il céda.
La dernière nèfle venait juste d'être avalée qu'on entendait déjà rouler la voiture sous le porche ; pendant que dans la salle un domestique tendait son haut-de-forme à Don Labrizio et son tricorne au Jésuite, la Princesse, qui avait maintenant les larmes aux yeux, fit une dernière tentative, tout aussi vaine : « Mais Labrizio, par les temps qui courent... avec les rues pleines de soldats, pleines de malandrins... un accident peut arriver.» Il ricana. « Sottises, Stella, sottises; que veux-tu qu'il arrive ? Tout le monde me connaît : des hommes de ma taille, il y en a peu à Palerme. Adieu. » Et il embrassa hâtivement le front encore lisse qui lui arrivait à hauteur du menton. Pourtant, soit que l'odeur de la peau de la Princesse eût évoqué de tendres souvenirs, soit que derrière lui l'allure de pénitent du Père Pirrone eût éveillé quelque pieuse admonition, quand il arriva devant le coupé il se trouva de nouveau sur le point de décommander cette sortie. À ce moment-là, tandis qu'il ouvrait la bouche pour dire de regagner les écuries, un cri imprévu « Labrizio, mon Labrizio ! » parvint de la fenêtre au-dessus, suivi de cris très aigus. La Princesse avait une de ses crises d'hystérie. « En avant ! », dit-il au cocher, qui se tenait sur le siège avec le fouet en diagonale sur le ventre. « En avant, allons à Palerme laisser le Révérend à la Maison Professe. » Et il claqua la portière avant que le domestique eût pu la refermer.
Il ne faisait pas encore complètement nuit et la route s'allongeait très blanche, encaissée entre les hauts murs. Dès que l'on était sorti de la propriété Salina, on apercevait à gauche la villa à moitié en ruine des Lalconeri, qui appartenait à Tancredi, son neveu et pupille. Un père prodigue, mari de la sœur du Prince, avait dissipé tout son patrimoine, puis il était mort. Cela avait été une de ces ruines totales au cours desquelles on fait fondre jusqu'aux fils en argent des galons des livrées ; et, à la mort de sa mère, le Roi avait confié la tutelle de l'orphelin, alors âgé de quatorze ans, à son oncle Salina. L'enfant, d'abord presque ignoré, était vite devenu très cher au Prince irascible qui remarquait en lui une gaieté querelleuse, un tempérament frivole parfois contredit par de soudaines crises de sérieux. Sans se l'avouer, il eût préféré l'avoir comme fils aîné, plutôt que ce bon nigaud de Paolo. À présent, Tancredi, à l'âge de vingt ans, se donnait du bon temps avec l'argent que son tuteur ne lui faisait pas manquer, en allant jusqu'à y mettre de sa poche. « Qui sait ce qu'il est en train de trafiquer en ce moment, ce garnement », pensait le Prince tandis qu'ils rasaient la villa Falconeri à laquelle l'énorme bougainvillier qui laissait déborder au-delà de la grille ses cascades de soie épiscopale conférait dans l'obscurité un aspect abusif de faste.
« Qui sait ce qu'il est encore en train de trafiquer. » Car le Roi Ferdinand, lorsqu'il avait parlé des mauvaises fréquentations du jeune homme, avait eu tort de le dire mais, dans les faits, avait eu raison. Pris dans un réseau d'amis joueurs, d'amies, comme on disait, « à la mauvaise conduite » dominées par son charme frêle, Tancredi en était arrivé à avoir des sympathies pour les « sectes », des relations avec le Comité national secret ; peut-être prenait-il aussi de l'argent de là, comme il en prenait, par ailleurs, de la Cassette Royale. Et il avait fallu la croix et la bannière, il avait fallu des visites chez un Castelcicala sceptique et un Maniscalco trop courtois pour éviter au garçon de sérieux ennuis après le Quatre Avril. Tout cela n'était pas bien ; d'autre part, Tancredi, pour son oncle, ne pouvait jamais avoir tort, et donc la véritable faute était due à l'époque, à cette époque incohérente au cours de laquelle un jeune homme de bonne famille n'était pas libre de jouer une partie de «pharaon» sans tomber dans des amitiés compromettantes. Triste époque.
« Triste époque, Excellence ! » La voix du Père Pirrone résonna comme un écho de ses pensées. Écrasé dans un coin du coupé, comprimé par la masse du Prince, pliant sous l'orgueil hautain du Prince, le Jésuite souffrait dans son corps et dans sa conscience et, en homme sans médiocrité, il transférait aussitôt ses propres peines éphémères dans le monde durable de l'histoire. « Regardez, Excellence », et il indiquait les montagnes abruptes de la Conque d'Or, encore claires dans cette fin de crépuscule. Sur leurs pentes et à leurs sommets brûlaient des dizaines de feux, les feux que les « escouades » rebelles allumaient chaque nuit, menace silencieuse pour la ville royale et conventuelle. Ils ressemblaient à ces lampes que Ton voit brûler dans les chambres des grands malades pendant les ultimes nuits.
« Je vois, mon père, je vois », et il pensait que Tancredi était peut-être autour d'un de ces méchants feux en train d'attiser de ses mains d'aristocrate les braises qui brûlaient justement pour discréditer de telles mains. « Je fais vraiment un beau tuteur, avec un pupille qui fait toutes les bêtises qui lui passent par la tête. »
La route était maintenant légèrement en pente et on voyait Païenne très proche dans l'obscurité la plus complète. Ses maisons basses et serrées étaient accablées par la masse démesurée des couvents ; de ceux-là, il y en avait des dizaines, tous immenses, souvent associés par groupes de deux ou trois, couvents d'hommes et de femmes, couvents riches et couvents pauvres, couvents nobles et couvents plébéiens, couvents de Jésuites, de Bénédictins, de Franciscains, de Capucins, de Carmes, de Rédemptoristes, d'Augustiniens... Des coupoles émaciées, aux courbes incertaines, pareilles à des seins vidés de leur lait, se dressaient encore plus haut, mais c'étaient ces couvents qui conféraient à la ville son air sombre et son caractère, son décorum joint au sentiment de mort que même la frénétique lumière sicilienne ne parvenait jamais à dissiper. À cette heure-là, en outre, la nuit presque tombée, ils devenaient les despotes du panorama. Et c'était contre eux, en réalité, que les feux sur les montagnes étaient allumés, attisés d'ailleurs par des hommes entièrement semblables à ceux qui vivaient dans les couvents, tout aussi fanatiques, tout aussi fermés, tout aussi avides de pouvoir, c'est-à-dire, comme de coutume, d'oisiveté.
Voilà ce que pensait le Prince, tandis que les chevaux bais avançaient au pas dans la descente ; des pensées en désaccord avec sa véritable nature, engendrées par l'anxiété sur le sort de Tancredi et par l'impulsion sensuelle qui l'amenait à se révolter contre les rigueurs que les couvents incarnaient.
À présent, en effet, la route traversait les orangeraies fleuries et l'arôme nuptial des fleurs d'oranger annulait toute chose comme la pleine lune annule un paysage : l'odeur de transpiration des chevaux, l'odeur de cuir des capitonnages, l'odeur du Prince et l'odeur du Jésuite, tout était effacé par cette odeur islamique évoquant hou-ris et outre-tombe charnels.
Le Père Pirrone en fut touché lui aussi. « Quel beau pays ce serait, Excellence, si... » « S'il n'y avait pas tant de Jésuites », pensa le Prince dont les plus doux présages avaient été interrompus par la voix du prêtre. Il se repentit aussitôt de la goujaterie qu'il n'avait pas achevée, et de sa grosse main il assena une tape sur le tricorne de son vieil ami.
Extraits

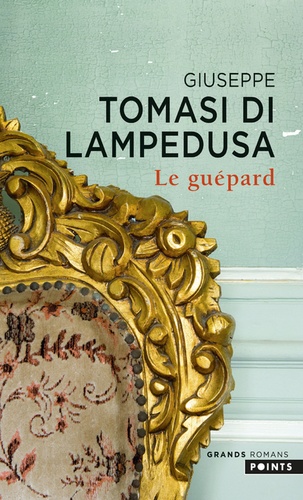


























Commenter ce livre