Traversée
Francis Tabouret
Je suis convoyeur de chevaux : je voyage avec des chevaux dans les soutes d’avions de marchandises. Une sorte de steward équin, ou de livreur, soigneur de bêtes à dix mille mètres d’altitude. Les avions, la vitesse et les réacteurs, mais les oreilles qui se pointent quand on s’approche au fond des carlingues, les sabots qui grattent le sol de fer et d’air, le bruit des mâchoires, le poil qui colle à la main et dit la peur, les naseaux, les yeux inquiets ou joueurs, les crins. Le ciel et les nuages, mais du foin et de l’eau.
Métier aussi de l’étrangeté des kilomètres avalés, lundi Amsterdam, mardi Tokyo, mercredi Abu Dhabi. Métier du monde par sauts de puces. Puces volantes, envolées. Soigneur de bêtes volantes. Métier de tarmacs et de tampons sur les passeports, de frontières passées, de langues mélangées. Heures d’aéroports, d’avions, de soutes d’avions. Et, au bout des heures de vol, la pincée, le tout petit, l’instant, ce qui est vu par la fenêtre, d’un jour ou de quelques heures avant de rentrer, l’image volée d’une ville, d’un pays ou d’un continent : ramener dans ses yeux une ville d’immeubles au milieu des montagnes ou une autre toute de verre, une terre rouge, un casque de faucon ou un homme fuyant dans un bus, un air bon, un autre si chaud, quelques chèvres ou une vache, une nuit, la lumière de minarets, une étendue d’Argentine. Une image ici, une autre là. Métier de notes éparses, de petites impressions, du monde picoré.
*
Un jour de ce métier, un homme m’a dit : « Aux Antilles, tu ne peux pas aller en avion. » Il m’a dit que les lignes avaient été fermées, qu’il n’y avait plus de ces avions de marchandises qu’on appelle cargos, que le fret était maintenant chargé sous les passagers et que les chevaux, qui ne rentrent pas là-dessous, avaient dû reprendre la mer pour traverser l’Atlantique. Il m’a dit : « Les chevaux embarquent et traversent sur des porte-containers. »
Trois mois plus tard, j’étais sur un bateau avec douze chevaux : on naviguait sur l’océan et vers la Guadeloupe. J’avais embarqué pour le très grand large et pour le temps long. Pour l’Atlantique, les vagues, les terres lointaines, parce que l’immensité des océans sur les cartes du monde. Treize jours d’eau. J’étais au Havre, je me suis retrouvé à Pointe-à-Pitre. Mes souvenirs de traversée sont assez flous : la ligne d’horizon, le tain des vitres de la passerelle, la chaleur et le bruit des machines, le vent, le lent roulis du bateau qui si souvent est torpeur, l’envie parfois furieuse de tempêtes, le regard des bêtes… mais d’événements, d’un lendemain qui serait différent d’une veille, je ne me rappelle pas. Je crois que j’étais hébété, d’eau et d’horizon. Le bateau va de jour comme de nuit et il pourrait continuer de naviguer pendant des semaines sans qu’à bord on s’étonne de ne jamais rien rencontrer. En mer, le seul qui se noie vraiment c’est le temps. J’ai débarqué ne sachant plus combien de jours j’avais été en mer.
Extraits

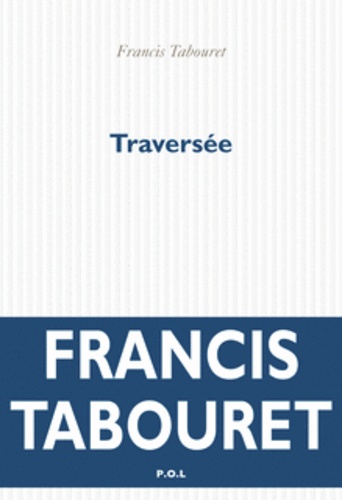


























Commenter ce livre