La démocratie comme violence
Luciano Canfora
Editeur
Genre
Littérature étrangère
LA DÉMOCRATIE COMME VIOLENCE
AVANT-PROPOS
PAR
LUCIANO CANFORA
Il n’est pas possible de rendre compte de façon sommaire et satisfaisante des hypothèses suscitées par cet opuscule, parvenu jusqu’à nous parmi les œuvres de Xénophon sous le titre d’Athenaiôn Politeia, mais qui n’a certainement pas été écrit par lui. Il s’agit en réalité de la plus ancienne prose attique subsistante : la première voix à s’être exprimée dans la langue de Thucydide et de Platon est une critique sévère et lucide du système politique — la démocratie directe — qui fut caractéristique d’Athènes.
Alors que, dans les trente dernières années, la propension à donner un nom à cet auteur semble définitivement éteinte (la dernière tentative pour attribuer l’opuscule à Thucydide fut celle de Nestle en 1943), la question de la chronologie a été souvent reposée. On est passé d’un consensus général pour une datation correspondant aux premières années de la guerre du Péloponnèse (avec une préférence pour la période qui va de la mort de Périclès, 429 avant J.-C., à la représentation des Cavaliers d’Aristophane, 424) à des hypothèses plus archaïsantes, avec une préférence pour les années 40 du Ve siècle (Mazzarino) ; la tendance qui voudrait rapprocher l’époque de composition de cet opuscule de 411, l’année du sanglant coup d’état oligarchique à Athènes, reste isolée. La date la plus probable me semble être la période 429-424 avant J.-C. pour les raisons suivantes : 1) le tableau du personnel politique typique de la démocratie athénienne tracé par l’auteur paraît impliquer clairement que Périclès, figure imposante de dominateur de l’État « au-dessus » des partis, est mort ; 2) toute la partie de l’opuscule qui décrit comment les Athéniens se comportent en cas de guerre, montre justement qu’Athènes est en guerre lorsque l’auteur écrit, et qu’elle est aux prises avec une guerre qui a toutes les caractéristiques de la phase initiale de la guerre du Péloponnèse (dévastation de la campagne attique par les Spartiates, gêne des paysans, indifférence des marins).
Que l’opuscule soit en réalité un dialogue dont la subdivision des répliques s’était perdue dans la tradition (comme cela fut le cas, du reste, pour tant de textes scéniques athéniens), est une hypothèse formulée il y a plus d’un siècle par le philologue hollandais Carel Gabriel Cobet, qui signala les points du texte qui ne deviennent compréhensibles que si l’on pense à un dialogue. Cette hypothèse du dialogue a été reprise dernièrement par un savant américain, William Forrest, qui a observé que, tout au long de l’opuscule, chaque opinion est précédée de l’avis contraire, et qui en a déduit que nous sommes donc en face d’un débat entre un Athénien et un Spartiate, ou — comme le pensait Cobet — entre deux Athéniens d’opinions différentes. Dans cette traduction, on a tenté pour la première fois de reconstruire le dialogue de façon complète. La méconnaissance de la nature dialoguée de cet opuscule a aussi eu des répercussions sur sa présentation éditoriale. On a préféré en général conjecturer, tailler généreusement, bouleverser l’ordre habituel du texte, parce que celui-ci, tel qu’il était, semblait difficile, décousu, contradictoire : en réalité, tout s’éclaire si l’on admet qu’il y a deux locuteurs et que l’un contredit l’autre. J’ai désigné les interlocuteurs par les sigles A et B.
Extraits




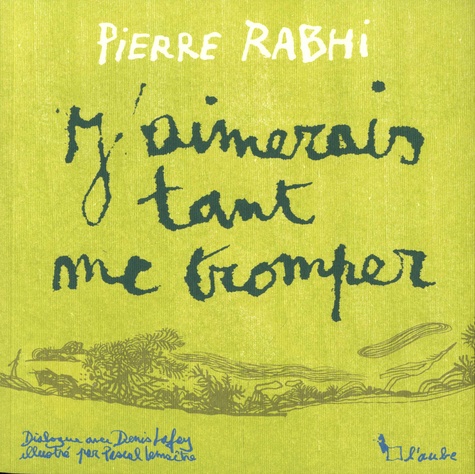
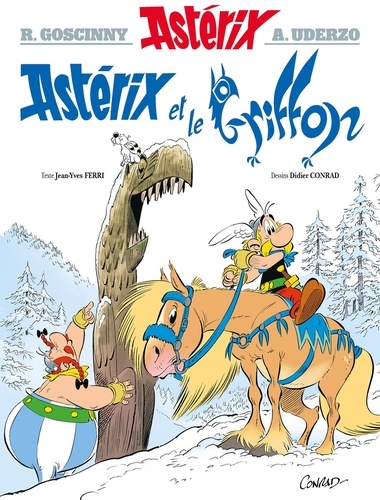
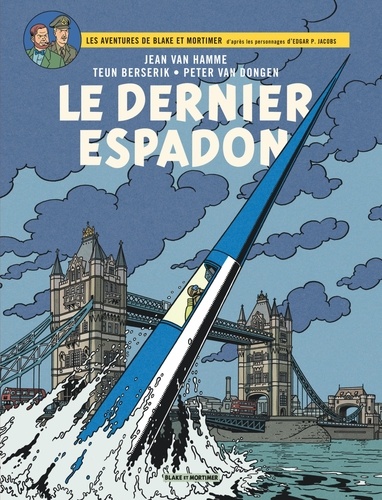
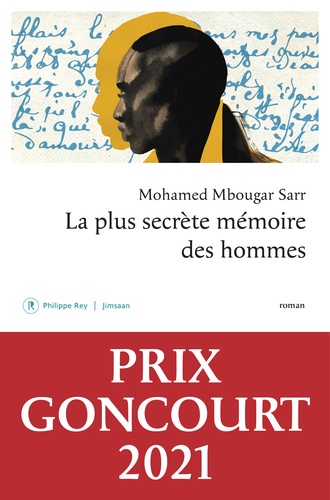
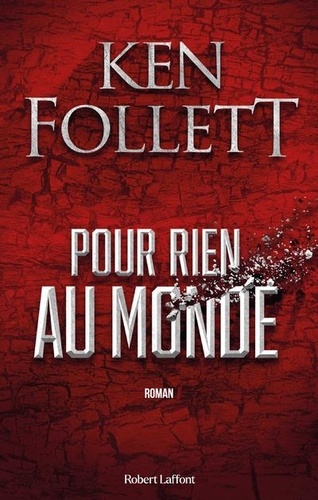
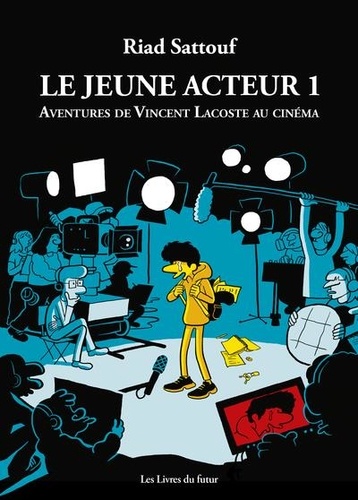
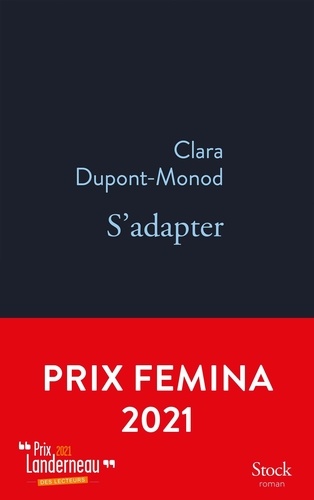
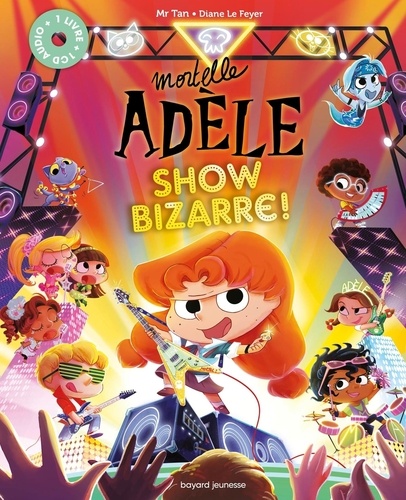
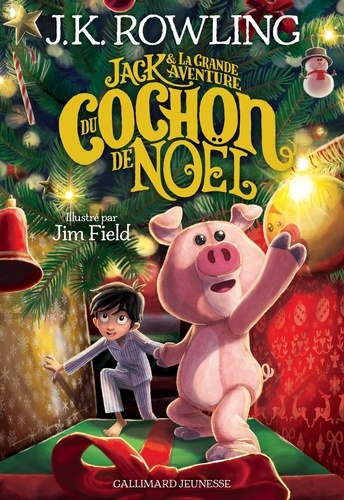
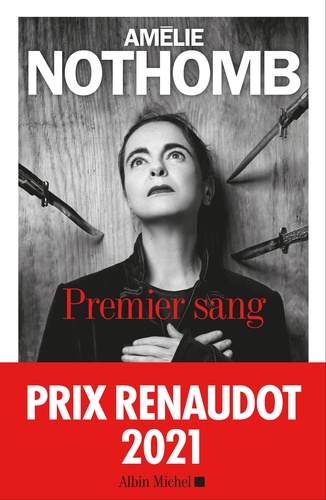
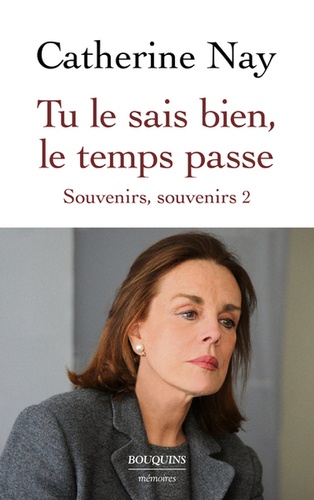
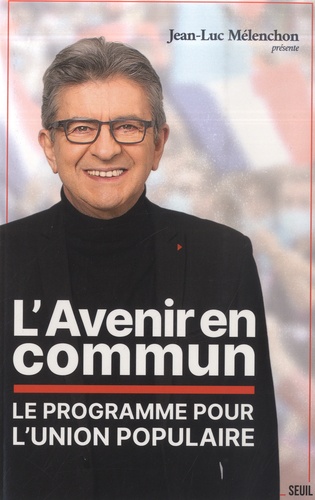

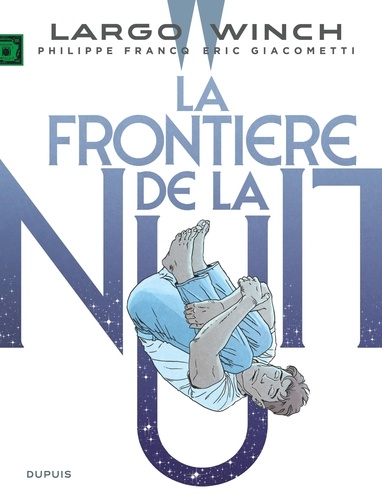
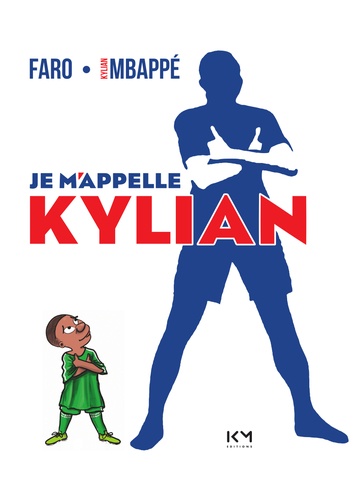
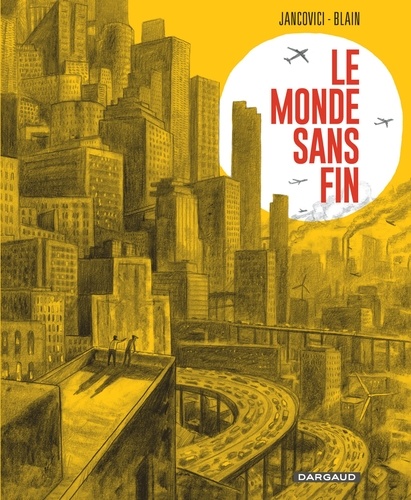
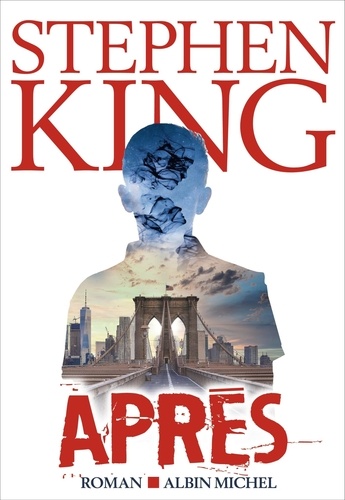
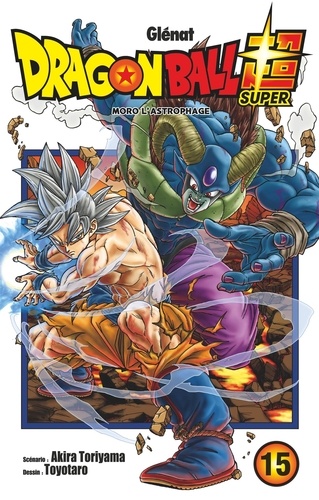
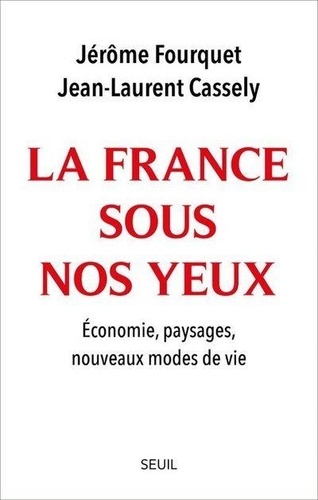
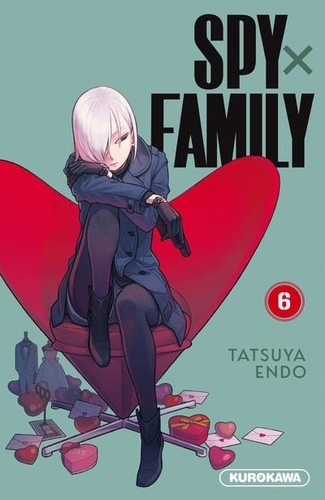
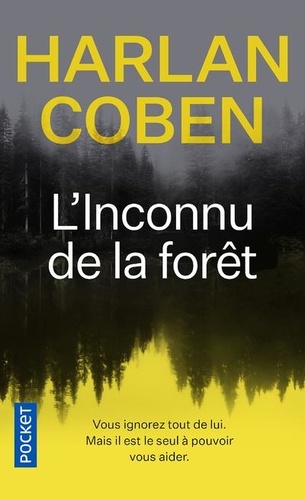
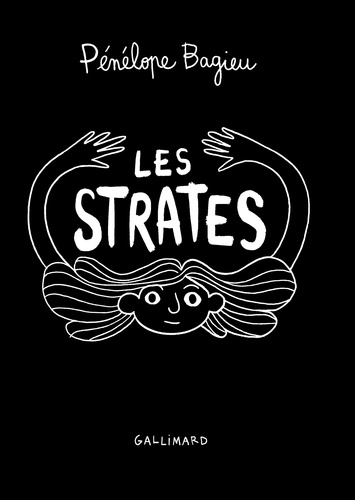
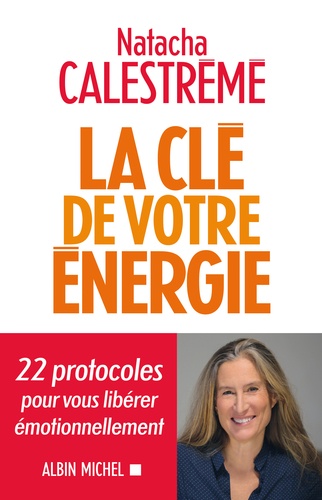
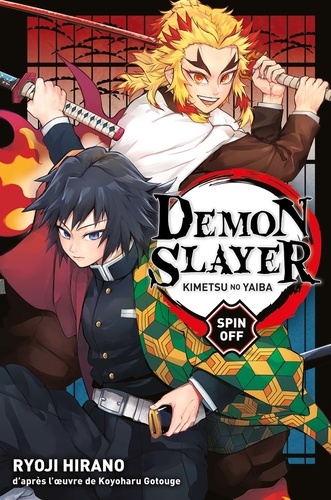
Commenter ce livre