Villa triste
Patrick Modiano
Pour Rudy
Pour Dominique
Pour Zina
Qui es-tu, toi, voyeur d'ombres ?
Dylan Thomas.
Une petite ville de la province française, au bord d'un lac et à proximité de la Suisse.
C'est dans cette station thermale qu'à dix-huit ans le narrateur, un apatride, est venu se réfugier pour échapper à une menace qu'il sentait planer autour de lui et pour combattre un sentiment d'insécurité et de peur panique. Peur d'une guerre, d'une catastrophe imminente ? Peur du monde extérieur ? En tout cas la proximité de la Suisse, où il comptait fuir à la moindre « alerte », lui apportait un réconfort illusoire.
Il se cachait, au début de ce mois de juillet, dans la foule des estivants, quand il fit la rencontre de deux êtres d'apparence mystérieuse qui allaient l'entraîner à leur suite...
Le narrateur évoque cet été d'il y a presque quinze ans et les figures d'Yvonne Jacquet et de René Meinthe, autour desquelles passent, comme des lucioles, Daniel Hendrickx, Pulli, Fossorié, Rolf Madéja et beaucoup d'autres... Il tente de faire revivre les visages, la fragilité des instants, les atmosphères de cette saison déjà lointaine. Mais tout défile et se dérobe comme à travers la vitre d'un train, de sorte qu'il ne reste plus que le souvenir d'un mirage et d'un décor de carton-pâte.
Et une musique où s'entrecroisent plusieurs thèmes : le déraciné qui cherche vainement des attaches, le temps qui passe et la jeunesse perdue.
Patrick Modiano est né en 1945 à Boulogne-Billancourt Il a fait ses études à Annecy et à Paris. Il a publié son premier roman, La place de l'étoile, en 1968, puis La ronde de nuit en 1969, Les boulevards de ceinture en 1972 et Villa triste en 1975. En 1996, il a reçu le Grand Prix national des Lettres pour l'ensemble de son œuvre. Patrick Modiano a écrit avec Louis Malle le scénario de Lacombe Lucien.
I
Ils ont détruit l'hôtel de Verdun. C'était un curieux bâtiment, en face de la gare, bordé d'une véranda dont le bois pourrissait. Des voyageurs de commerce y venaient dormir entre deux trains. Il avait la réputation d'un hôtel de passe. Le café voisin, en forme de rotonde, a disparu lui aussi. S'appelait-il café des Cadrans ou de l'Avenir ? Entre la gare et les pelouses de la place Albert-Ier, il y a un grand vide, maintenant.
La rue Royale, elle, n'a pas changé, mais à cause de l'hiver et de l'heure tardive, on a l'impression, en la suivant, de traverser une ville morte. Vitrines de la librairie Chez Clément Marot, d'Horowitz le bijoutier, Deauville, Genève, Le Touquet, et de la pâtisserie anglaise Fidel-Berger... Plus loin, le salon de coiffure René Pigault. Vitrines d'Henry à la Pensée. La plupart de ces magasins de luxe sont fermés en dehors de la saison. Quand commencent les arcades, on voit briller, au bout, à gauche, le néon rouge et vert du Cintra. Sur le trottoir opposé, au coin de la rue Royale et de la place du Pâquier, la Taverne, que fréquentait la jeunesse pendant l'été. Est-ce toujours la même clientèle aujourd'hui ?
Plus rien ne reste du grand café, de ses lustres, de ses glaces, et des tables à parasols qui débordaient sur la chaussée. Vers huit heures du soir, des allées et venues se faisaient de table à table, des groupes se formaient. Éclats de rire. Cheveux blonds. Tintements des verres. Chapeaux de paille. De temps en temps un peignoir de plage ajoutait sa note bariolée. On se préparait pour les festivités de la nuit.
A droite, là-bas, le Casino, une construction blanche et massive, n'ouvre que de juin à septembre. L'hiver, la bourgeoisie locale bridge deux fois par semaine dans la salle de baccara et le grill-room sert de lieu de réunion au Rotary Club du département. Derrière, le parc d'Albigny descend en pente très douce jusqu'au lac avec ses saules pleureurs, son kiosque à musique et l'embarcadère d'où l'on prend le bateau vétuste qui fait la navette entre les petites localités du bord de l'eau : Veyrier, Chavoires, Saint-Jorioz, Éden-Roc, Port-Lusatz... Trop d'énumérations. Mais il faut chantonner certains mots, inlassablement, sur un air de berceuse.
On suit l'avenue d'Albigny, bordée de platanes. Elle longe le lac et au moment où elle s'incurve vers la droite, on distingue un portail en bois blanc : l'entrée du Sporting. De chaque côté d'une allée de gravier, plusieurs courts de tennis. Ensuite, il suffit de fermer les yeux pour se rappeler la longue rangée de cabines et la plage de sable qui s'étend sur près de trois cents mètres. A l'arrière-plan, un jardin anglais entourant le bar et le restaurant du Sporting, installés dans une ancienne orangerie. Tout cela forme une presqu'île qui appartenait vers 1900 au constructeur d'automobiles Gordon-Gramme.
A la hauteur du Sporting, de l'autre côté de l'avenue d'Albigny, commence le boulevard Carabacel. Il monte en lacet jusqu'aux hôtels Hermitage, Windsor et Alhambra, mais on peut également emprunter le funiculaire. L'été il fonctionne jusqu'à minuit et on l'attend dans une petite gare qui a l'aspect extérieur d'un chalet. Ici la végétation est composite, et on ne sait plus si l'on se trouve dans les Alpes, au bord de la Méditerranée ou même sous les Tropiques. Pins parasols. Mimosas. Sapins. Palmiers. En suivant le boulevard à flanc de colline, on découvre le panorama : le lac tout entier, la chaîne des Aravis, et de l'autre côté de l'eau, ce pays fuyant qu'on appelle la Suisse.
L'Hermitage et le Windsor n'abritent plus que des appartements meublés. Pourtant on a négligé de détruire la porte-tambour du Windsor et la verrière qui prolongeait le hall de l'Hermitage. Souvenez-vous : elle était envahie par les bougainvillées. Le Windsor datait des années 1910 et sa façade blanche avait le même aspect de meringue que celles du Ruhl et du Négresco à Nice. L'Hermitage de couleur ocre était plus sobre et plus majestueux. Il ressemblait à l'hôtel Royal de Deauville. Oui, comme un frère jumeau. Ont-ils vraiment été convertis en appartements ? Pas une lumière aux fenêtres. Il faudrait avoir le courage de traverser les halls obscurs et de gravir les escaliers. Alors peut-être s'apercevrait-on que personne n'habite ici.
L'Alhambra, lui, a été rasé. Plus aucune trace des jardins qui l'entouraient. Ils vont certainement construire un hôtel moderne sur son emplacement. Un tout petit effort de mémoire : en été, les jardins de l'Hermitage, du Windsor et de l'Alhambra étaient très proches de l'image que l'on peut se faire de l'Eden perdu ou de la Terre promise. Mais dans lequel des trois y avait-il cet immense parterre de dahlias et cette balustrade où l'on s'accoudait pour regarder le lac, tout en bas ? Peu importe. Nous aurons été les derniers témoins d'un monde.
Il est très tard, en hiver. On distingue à peine, de l'autre côté du lac, les lumières mouillées de la Suisse. De la végétation luxuriante de Carabacel, il ne reste que quelques arbres morts et des massifs rabougris. Les façades du Windsor et de l'Hermitage sont noires et comme calcinées. La ville a perdu son vernis cosmopolite et estival. Elle s'est rétrécie aux dimensions d'un chef-lieu de département. Une petite ville tapie au fond de la province française. Le notaire et le sous-préfet bridgent dans le Casino désaffecté. Mme Pigault également, la directrice du salon de coiffure, quarantaine blonde et parfumée au « Shocking ». A côté d'elle, le fils Fournier, dont la famille possède trois usines de textiles à Faverges ; Servoz, des laboratoires pharmaceutiques de Chambéry, excellent joueur de golf. Il paraît que Mme Servoz, brune comme Mme Pigault est blonde, circule toujours au volant d'une B.M.W. entre Genève et sa villa de Chavoires, et aime beaucoup les jeunes gens. On la voit souvent avec Pimpin Lavorel. Et nous pourrions donner mille autres détails aussi insipides, aussi consternants sur la vie quotidienne de cette petite ville, parce que les choses et les gens n'ont certainement pas changé, en douze ans.
Les cafés sont fermés. Une lumière rose filtre à travers la porte du Cintra. Voulez-vous que nous entrions pour vérifier si les boiseries d'acajou n'ont pas changé, si la lampe à l'abat-jour écossais est à sa place : du côté gauche du bar ? Ils n'ont pas enlevé les photographies d'Émile Allais, prises à Engelberg quand il remporta le Championnat du monde. Ni celles de James Couttet. Ni la photo de Daniel Hendrickx. Elles sont alignées au-dessus des rangées d'apéritifs. Elles ont jauni, bien sûr. Et dans la demi-pénombre, le seul client, un homme congestionné portant une veste à carreaux, pelote distraitement la barmaid. Elle avait une beauté acide au début des années soixante mais depuis elle s'est alourdie.
On entend le bruit de ses propres pas, dans la rue Sommeiller déserte. A gauche, le cinéma le Régent est identique à lui-même : toujours ce crépi orange et les lettres le Régent en caractères anglais de couleur grenat. Ils ont dû quand même moderniser la salle, changer les fauteuils de bois et les portraits Harcourt des vedettes qui décoraient l'entrée. La place de la Gare est le seul endroit de la ville où brillent quelques lumières et où règne encore un peu d'animation. L'express pour Paris passe à minuit six. Les permissionnaires de la caserne Berthollet arrivent par petits groupes bruyants, leur valise de métal ou de carton à la main. Quelques-uns chantent Mon beau sapin : l'approche de Noël, sans doute. Sur le quai no 2, ils s'agglutinent les uns aux autres, se donnent des bourrades dans le dos. On dirait qu'ils partent au front. Parmi toutes ces capotes militaires, un costume civil de couleur beige. L'homme qui le porte ne semble pas souffrir du froid ; il a autour du cou une écharpe de soie verte qu'il serre d'une main nerveuse. Il va de groupe en groupe, tourne la tête de gauche à droite avec une expression hagarde, comme s'il cherchait un visage au milieu de cette cohue. Il vient même d'interroger un militaire, mais celui-ci et ses deux compagnons l'inspectent des pieds à la tête, narquois. D'autres permissionnaires se sont retournés et sifflent sur son passage. Il feint de n'y prêter aucune attention et mordille un fume-cigarette. Maintenant il se trouve à l'écart, en compagnie d'un jeune chasseur alpin tout blond. Celui-ci paraît gêné et jette de temps en temps des yeux furtifs vers ses camarades. L'autre s'appuie sur son épaule et lui chuchote quelque chose à l'oreille. Le jeune chasseur alpin essaie de se dégager. Alors il lui glisse une enveloppe dans la poche de son manteau, le regarde sans rien dire et, comme il commence à neiger, relève le col de sa veste.
Cet homme s'appelle René Meinthe. Il porte brusquement sa main gauche à son front, et la laisse là, en visière, geste qui lui était familier, il y a douze ans. Comme il a vieilli...
Le train est arrivé en gare. Ils montent à l'assaut, se bousculent dans les couloirs, baissent les vitres, se passent les valises. Certains chantent : Ce n'est qu'un au revoir... mais la plupart préfèrent hurler : Mon beau sapin... Il neige plus fort. Meinthe se tient debout, immobile, sa main en visière. Le jeune blondinet, derrière la vitre, le considère, un sourire un peu méchant au coin des lèvres. Il tripote son béret de chasseur alpin. Meinthe lui fait un signe. Les wagons défilent emportant leurs grappes de militaires qui chantent et agitent les bras.
Il a enfoncé ses mains dans les poches de sa veste et se dirige vers le buffet de la gare. Les deux garçons rangent les tables et balayent autour d'eux à grands gestes mous. Au bar, un homme en imperméable range les derniers verres. Meinthe commande un cognac. L'homme lui répond d'un ton sec qu'on ne sert plus. Meinthe demande à nouveau un cognac.
– Ici, répond l'homme en traînant sur les syllabes, ici, on ne sert pas les tantes.
Et les deux autres, derrière, ont éclaté de rire. Meinthe ne bouge pas, il fixe un point devant lui, l'air épuisé. L'un des garçons a éteint les appliques du mur gauche. Il ne reste plus qu'une zone de lumière jaunâtre, autour du bar. Ils attendent, les bras croisés. Lui casseront-ils la figure ? Mais qui sait ? Peut-être Meinthe va-t-il frapper de la paume de sa main le comptoir crasseux et leur lancer : « Je suis la reine Astrid, la REINE DES BELGES ! », avec sa cambrure et son rire insolent d'autrefois.
II
Que faisais-je à dix-huit ans au bord de ce lac, dans cette station thermale réputée ? Rien. J'habitais une pension de famille, les Tilleuls, boulevard Carabacel. J'aurais pu choisir une chambre en ville, mais je préférais me trouver sur les hauteurs, à deux pas du Windsor, de l'Hermitage et de l'Alhambra, dont le luxe et les jardins touffus me rassuraient.
Car je crevais de peur, un sentiment qui depuis ne m'a jamais quitté : il était beaucoup plus vivace et plus irraisonné, en ce temps-là. J'avais fui Paris avec l'idée que cette ville devenait dangereuse pour des gens comme moi. Il y régnait une ambiance policière déplaisante. Beaucoup trop de rafles à mon goût. Des bombes éclataient. Je voudrais donner une précision chronologique, et puisque les meilleurs repères, ce sont les guerres, de quelle guerre, au fait, s'agissait-il ? De celle qui s'appelait d'Algérie, au tout début des années soixante, époque où l'on roulait en Floride décapotable et où les femmes s'habillaient mal. Les hommes aussi. Moi, j'avais peur, encore plus qu'aujourd'hui et j'avais choisi ce lieu de refuge parce qu'il était situé à cinq kilomètres de la Suisse. Il suffisait de traverser le lac, à la moindre alerte. Dans ma naïveté, je croyais que plus on se rapproche de la Suisse, plus on a de chances de s'en sortir. Je ne savais pas encore que la Suisse n'existe pas.
La « saison » avait commencé depuis le 15 juin. Les galas et les festivités allaient se succéder. Dîner des « Ambassadeurs » au Casino. Tour de chant de Georges Ulmer. Trois représentations d'Écoutez bien Messieurs. Feu d'artifice tiré le 14 Juillet du golf de Chavoires, Ballets du marquis de Cuevas et d'autres choses encore qui me reviendraient en mémoire si j'avais sous la main le programme édité par le syndicat d'initiative. Je l'ai conservé et je suis sûr de le retrouver entre les pages d'un des livres que je lisais cette année-là. Lequel ? Il faisait un temps « superbe » et les habitués prévoyaient du soleil jusqu'en octobre.
Je n'allais que très rarement me baigner. En général, je passais mes journées dans le hall et les jardins du Windsor et finissais par me persuader que là, au moins, je ne risquais rien. Quand la panique me gagnait – une fleur qui ouvrait lentement ses pétales, un peu plus haut que le nombril – je regardais en face de moi, de l'autre côté du lac. Des jardins du Windsor, on apercevait un village. A peine cinq kilomètres, en ligne droite. On pouvait franchir cette distance à la nage. De nuit, avec une petite barque à moteur, cela prendrait une vingtaine de minutes. Mais oui. J'essayais de me calmer. Je chuchotais en articulant les syllabes : « De nuit, avec une petite barque à moteur... » Tout allait mieux, je reprenais la lecture de mon roman ou d'un magazine inoffensif (je m'étais interdit de lire les journaux et d'écouter les bulletins d'information à la radio. Chaque fois que j'allais au cinéma, je prenais soin d'arriver après les Actualités). Non, surtout, ne rien savoir du sort du monde. Ne pas aggraver cette peur, ce sentiment de catastrophe imminente. Ne s'intéresser qu'aux choses anodines : la mode, la littérature, le cinéma, le music-hall. S'allonger sur les grands « transats », fermer les yeux, se détendre, surtout se détendre. Oublier. Hein ?
Vers la fin de l'après-midi, je descendais en ville. Avenue d'Albigny, je m'asseyais sur un banc et suivais l'agitation du bord du lac, le trafic des petits voiliers et des pédalos. C'était réconfortant. Au-dessus, les feuillages des platanes me protégeaient. Je poursuivais mon chemin à pas lents et précautionneux. Place du Pâquier, je choisissais toujours une table en retrait à la terrasse de la Taverne et commandais toujours un Camparisoda. Et je contemplais toute cette jeunesse autour de moi, à laquelle, d'ailleurs, j'appartenais. Ils étaient de plus en plus nombreux à mesure que l'heure passait. J'entends encore leurs rires, je me souviens de leurs mèches rabattues sur l'œil. Les filles portaient des pantalons corsaires et des shorts en vichy. Les garçons ne dédaignaient pas le blazer à écusson et le col de chemise ouvert sur un foulard. Ils avaient les cheveux courts, ce qu'on appelait la coupe « Rond-Point ». Ils préparaient leurs surboums. Les filles y viendraient avec des robes serrées à la taille, très amples, et des ballerines. Sage et romantique jeunesse qu'on expédierait en Algérie. Pas moi.
A huit heures, je revenais dîner aux Tilleuls. Cette pension de famille, dont l'extérieur évoquait à mon avis un pavillon de chasse, recevait chaque été une dizaine d'habitués. Ils avaient tous dépassé la soixantaine, et ma présence, au début, les agaçait. Mais je respirais de façon très discrète. Par une grande économie de gestes, un regard volontairement terne, un visage figé – battre le moins possible des paupières – je m'efforçais de ne pas aggraver une situation déjà précaire. Ils se sont rendu compte de ma bonne volonté, et je pense qu'ils ont fini par me considérer sous un jour plus favorable.
Nous prenions les repas dans une salle à manger de style savoyard. J'aurais pu engager la conversation avec mes plus proches voisins, un vieux couple soigné qui venait de Paris, mais à certaines allusions, j'avais cru comprendre que l'homme était un ancien inspecteur de police. Les autres dînaient par couples, également, sauf un monsieur à moustaches fines et tête d'épagneul qui donnait l'impression d'avoir été abandonné là. A travers le brouhaha des conversations, je l'entendais pousser par instants des hoquets brefs qui ressemblaient à des aboiements. Les pensionnaires passaient au salon et s'asseyaient en soupirant sur les fauteuils recouverts de cretonne. Mme Buffaz, la propriétaire des Tilleuls, leur servait une infusion ou quelque digestif. Les femmes parlaient entre elles. Les hommes entamaient une partie de canasta. Le monsieur à tête de chien suivait la partie, assis en retrait, après avoir tristement allumé un havane.
Et moi, je serais volontiers resté parmi eux, dans la lumière douce et apaisante des lampes à abat-jour de soie rose saumon, mais il aurait fallu leur parler ou jouer à la canasta. Peut-être auraient-ils accepté que je sois là, sans rien dire, à les regarder ? Je descendais de nouveau en ville. A neuf heures quinze minutes précises – juste après les Actualités – j'entrais dans la salle du cinéma le Régent ou bien je choisissais le cinéma du Casino, plus élégant et plus confortable. J'ai retrouvé un programme du Régent qui date de cet été-là.
CINÉMA LE RÉGENT
Du 15 au 23 juin :
Tendre et violente Elisabeth de H. Decoin.
Du 24 au 30 juin :
L'Année dernière à Marienbad de A. Resnais.
Du 1er au 8 juil. :
R.P.Z. appelle Berlin de R. Habib.
Du 9 au 16 juil. :
Le Testament d'Orphée de J. Cocteau.
Du 17 au 24 juil. :
Le Capitaine Fracasse de P. Gaspard-Huit.
Du 25 juil. au 2 août :
Qui êtes-vous, M. Sorge ? de Y. Ciampi.
Du 3 au 10 août :
La Nuit de M. Antonioni.
Du 11 au 18 août :
Le Monde de Suzie Wong.
Du 19 au 26 août :
Le Cercle vicieux de M. Pecas.
Du 27 août au 3 sept. :
Le Bois des amants de C. Autant-Lara.
Je reverrais volontiers quelques images de ces vieux films.
Après le cinéma, j'allais de nouveau boire un Campari à la Taverne. Elle était désertée par les jeunes gens. Minuit. Ils devaient danser quelque part. J'observais toutes ces chaises, ces tables vides, et les garçons qui rentraient les parasols. Je fixais le grand jet d'eau lumineux de l'autre côté de la place, devant l'entrée du Casino. Il changeait sans cesse de couleur. Je m'amusais à compter combien de fois il virait au vert. Un passe-temps, comme un autre, n'est-ce pas ? Une fois, deux fois, trois fois. Quand j'avais atteint le chiffre 53, je me levais, mais, le plus souvent, je ne me donnais même pas la peine de jouer à ce jeu-là. Je rêvassais, en buvant à petites gorgées mécaniques. Vous rappelez-vous Lisbonne pendant la guerre ? Tous ces types affalés dans les bars et le hall de l'hôtel Aviz, avec leurs valises et leurs malles-cabines, attendant un paquebot qui ne viendrait pas ? Eh bien, j'avais l'impression, vingt ans après, d'être un de ces types-là.
Les rares fois où je portais mon costume de flanelle et mon unique cravate (cravate bleu nuit semée de fleurs de lys qu'un Américain m'avait offerte et au revers de laquelle étaient cousus les mots : « International Bar Fly ». J'ai appris plus tard qu'il s'agissait d'une société secrète d'alcooliques. Grâce à cette cravate ils pouvaient se reconnaître les uns les autres et se rendre de menus services), il m'arrivait d'entrer au Casino et de rester quelques minutes au seuil du Brummel pour regarder les gens danser. Ils avaient entre trente et soixante ans, et l'on remarquait parfois une fille plus jeune en compagnie d'un quinquagénaire élancé. Clientèle internationale, assez « chic » et qui ondulait sur des succès italiens ou des airs de calypso, cette danse de la Jamaïque. Ensuite, je montais jusqu'aux salles de jeux. On assistait souvent à de gros bancos. Les joueurs les plus fastueux venaient de la Suisse toute proche. Je me souviens d'un Égyptien très raide, aux cheveux roux lustrés et aux yeux de gazelle, qui caressait pensivement de l'index sa moustache de major anglais. Il jouait par plaques de cinq millions et on le disait cousin du roi Farouk.
J'étais soulagé de me retrouver à l'air libre. Je revenais lentement vers Carabacel par l'avenue d'Albigny. Je n'ai jamais connu de nuits aussi belles, aussi limpides qu'en ce temps-là. Les lumières des villas du bord du lac avaient un scintillement qui éblouissait les yeux et dans lequel je discernais quelque chose de musical, un solo de saxophone ou de trompette. Je percevais aussi, très léger, immatériel, le bruissement des platanes de l'avenue. J'attendais le dernier funiculaire, assis sur le banc de fer du chalet. La salle n'était éclairée que par une veilleuse et je me laissais glisser, avec un sentiment de totale confiance, dans cette pénombre violacée. Que pouvais-je craindre ? Le bruit des guerres, le fracas du monde pour parvenir jusqu'à cette oasis de vacances devraient traverser un mur d'ouate. Et qui aurait l'idée de venir me chercher parmi les estivants distingués ?
Je descendais à la première station : Saint-Charles-Carabacel et le funiculaire continuait de monter, vide. Il ressemblait à un gros ver luisant.
Je traversais le couloir des Tilleuls sur la pointe des pieds, après avoir enlevé mes mocassins car les vieillards ont le sommeil léger.
III
Elle était assise dans le hall de l'Hermitage, sur l'un des grands canapés du fond et ne quittait pas des yeux la porte-tambour, comme si elle attendait quelqu'un. J'occupais un fauteuil à deux ou trois mètres d'elle et je la voyais de profil.
Cheveux auburn. Robe de chantoung vert. Et les chaussures à talons aiguilles que les femmes portaient. Blanches.
Un chien était allongé à ses pieds. Il bâillait et s'étirait de temps en temps. Un dogue allemand, immense et lymphatique avec des taches noires et blanches. Vert, roux, blanc, noir. Cette combinaison de couleurs me causait une sorte d'engourdissement. Comment ai-je fait pour me retrouver à côté d'elle, sur le canapé ? Peut-être le dogue allemand a-t-il servi d'entremetteur, en venant, de sa démarche paresseuse, .ne flairer ?
J'ai remarqué qu'elle avait les yeux verts, de très légères taches de rousseur et qu'elle était un peu plus âgée que moi.
Nous nous sommes promenés, ce matin-là, dans les jardins de l'hôtel. Le chien ouvrait la marche. Nous suivions une allée recouverte d'une voûte de clématites à grandes fleurs mauves et bleues. J'écartais les feuillages en grappes des cytises ; nous longions des pelouses et des buissons de troènes. Il y avait – si j'ai bonne mémoire – des plantes de rocaille aux teintes givrées, des aubépines roses, un escalier bordé de vasques vides. Et l'immense parterre de dahlias jaunes, rouges et blancs. Nous nous sommes penchés sur la balustrade et nous avons regardé le lac, en bas.
Je n'ai jamais pu savoir exactement ce qu'elle avait pensé de moi au cours de cette première rencontre. Peut-être m'avait-elle pris pour un fils de famille milliardaire qui s'ennuyait. Ce qui l'avait amusée, en tout cas, c'était le monocle que je portais à l'œil droit pour lire, non par dandysme ou affectation, mais parce que je voyais beaucoup moins bien de cet œil que de l'autre.
Nous ne parlons pas. J'entends le murmure d'un jet d'eau qui tourne, au milieu de la plus proche pelouse. Quelqu'un descend l'escalier à notre rencontre, un homme dont j'ai distingué de loin le costume jaune pâle. Il nous fait un geste de la main. Il porte des lunettes de soleil et s'éponge le front.
Extraits

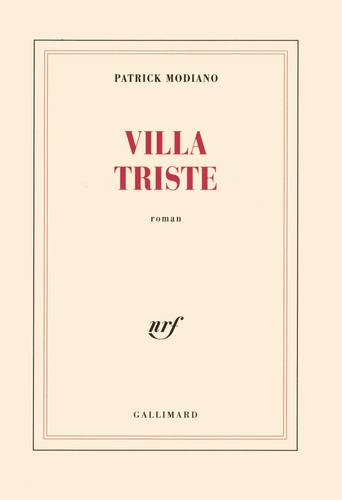


























Commenter ce livre