L'atelier des miracles
Valérie Tong Cuong
Editeur
Genre
Littérature française
L'odeur acre, violente, s'insinuait dans chaque espace libre de mon corps, me piquait le nez et la gorge, assaillait mon cerveau englué de sommeil de ses rafales hargneuses.
Je refusais de me réveiller. Je voulais dormir jusqu'au bout de la nuit et, tant qu'à faire, jusqu'au bout du week-end. Passer directement du vendredi soir au lundi matin, sans respirer, sans rêver, sans penser, d'une seule traite, d'une seule lutte.
Comme un enfant maladroit traverse la piscine sous l'eau, poussé par le maître nageur et les huées de ses camarades, épuisant ses ultimes réserves d'air pour atteindre le bord opposé, caressant la mort, l'admettant déjà. Puis soudain, agrippant de ses doigts tendus la pierre poreuse, regonfle ses poumons et surgit en s'ébrouant, à la fois étourdi et reconnaissant d'avoir survécu.
La toux brûlante m'arrachait à la nuit. J'ai entrouvert les yeux. Face à moi, une longue langue de fumée sombre se mouvait en silence à travers la fenêtre entrebâillée, léchant le papier peint jauni jusqu'au plafond.
Le feu ! Mon corps s'est soulevé dans un spasme, je n'étais plus sûre d'être éveillée, j'avais l'esprit scindé en deux, une moitié criant, Eh bien voilà, Millie, c'est l'heure des comptes, l'heure de vérité, celle de payer et de les rejoindre car après tout il faut bien que quelqu'un expie ! L'autre moitié se rebellant, refusant, Ne pas faire de lien hâtif, fuir les signes, les concordances, la psychologie de comptoir, cet incendie est le fruit du hasard, forcément, un accident, une pure coïncidence, alors se concentrer et agir, puisque le feu tue.
Je m'étais écroulée quelques heures plus tôt sur le canapé-lit, titubante, toute habillée, pas démaquillée, même pas les dents brossées. Incapable de faire un geste supplémentaire, à bout de forces.
J'étais pourtant intransigeante sur les règles de soin et d'hygiène. Je me lavais les mains cent fois par jour et les cheveux à chaque douche. Je me frottais à la pierre ponce, vérifiais mes ongles à tout instant, traquais la poussière matin et soir, lessivais entièrement le sol une fois par semaine. Au bureau - lorsque j'avais un emploi -, armée de lingettes désinfectantes commandées par cartons, je nettoyais tout ce qui se trouvait à ma portée. Rédigeais des check-lists : vider les pots à crayons des éclats de mine, ranger les tiroirs, vérifier les agrafeuses après chaque usage, débrancher les imprimantes en fin de journée. Il m'était même arrivé de faire les vitres, un jour où j'avais terminé mon travail en avance. Une initiative peu appréciée par la directrice de l'agence d'intérim qui m'avait sèchement mise en garde : si je tenais à demeurer dans ses fichiers, il faudrait m'en tenir aux tâches de secrétariat décrites dans mon contrat. Des laveurs de carreaux et des femmes de ménage, l'agence en avait plein ses registres.
Cette société me fournissait les deux tiers de mes missions : je m'étais donc excusée platement et avais réservé mes pulsions purificatrices à une sphère strictement privée.
Ce soir-là cependant, justement ce soir-là, l'alcool avait eu raison de mes principes. Jambes molles, regard voilé, à peine le seuil franchi, je n'aspirais plus qu'à dormir.
Et puis quoi, avais-je pensé : il n'y avait personne pour me voir, encore moins pour m'embrasser, se coucher à mes côtés. Personne à décevoir, en somme. C'était bien le seul intérêt à être celle que j'étais. Alors, pour une fois !
J'avais posé mon sac à main derrière les coussins et m'étais endormie aussitôt allongée, sans même ôter mes chaussures.
Je me suis précipitée vers la fenêtre. Dans l'aube grisâtre, un attroupement s'était formé au pied de l'immeuble. Des gens arboraient des mines effrayées et s'agitaient en indiquant la façade. Mon cœur s'est soulevé, agglomérant les images, les bruits, les odeurs, les mots, les douleurs. Morsure du feu, compression des poumons, décès par asphyxie.
Peut-être avais-je voulu cet incendie ? Peut-être l'avais-je espéré, tout au fond, là où se tapit l'inconscient ? Peut-être l'avais-je provoqué ? Ça ne pouvait pas être le hasard, non. C'était statistiquement impossible.
Quoique.
Tu y es Millie. Au pied du mur. Alors décide, maintenant.
La fumée provenait de l'étage inférieur. Ce vieil ours de Kanarek avait dû oublier son bortsch sur sa cuisinière à gaz. Il perdait la tête. Ces derniers temps, je l'avais trouvé plus d'une fois devant le porche de l'immeuble, haranguant les passants, déclamant avec fièvre des passages de son auteur favori, qu'il nommait pompeusement « le grand M. Dostoïevski ». Il mâchonnait ses mots dans une bouillie verbale rageuse dont surgissaient pauvres gens, mépris, amours déçues, compromis et amitiés trahies. Les voisins et les commerçants du quartier le jugeaient fou et le tenaient à distance. Il se murmurait qu'il pourrait bien, un beau matin, s'emparer d'un couteau de boucher et faire un carnage. Ou mettre le feu à l'immeuble.
Pauvre Kanarek. S'il s'en sortait, il ferait un beau coupable. Et si je m'en sortais - mais pourquoi m'en sortirais-je ? - mon avis ne pèserait pas lourd face à la coalition des propriétaires.
J'ai jeté un coup d'œil circulaire pour tenter d'évaluer la situation, reprendre le contrôle, analyser. Ne pas céder à la panique.
C'est le hasard, Millie, c'est comme ça, c'est tombé sur toi, Kanarek est un pauvre diable que tu n'as pas choisi pour voisin. Le voilà lui aussi dans de beaux draps. Allons, ne perds plus une minute, réfléchis, vite, que prend-on lorsque l'on fuit les flammes, qu'est-ce qui compte, à quoi l'on tient, ce dont on ne pourrait se séparer sous aucun prétexte ? Tout le monde s'est déjà posé cette question ! Tout le monde sait ce qui lui est indispensable !
Même toi, forcément.
Pour certains, ce sont les souvenirs, les albums photos, des lettres rangées dans une boîte à chaussures, un bibelot rapporté de vacances, un violoncelle stocké depuis l'enfance au fond d'un placard. Pour d'autres, ce sont le livret de famille et le contrat de mariage, le courrier de la caisse de retraite ou des objets de valeur, bijoux, tableaux, montres : tout ce qui définit, encadre, démontre une existence, tout ce qui garantit un avenir. Alors Millie ? Alors ?
Je ne possédais rien de tout cela. Mon dossier administratif se résumait aux courriers de Pôle emploi et à une poignée de contrats d'intérim. Mes souvenirs des dix dernières années, à trois ou quatre cartes postales de mes parents, au dos desquelles était invariablement écrit « bons baisers », une formule qui en disait long sur leur manière de m'aimer.
Je ne détenais aucun objet de valeur et tout ce qui meublait ce studio appartenait à la jeune ethnologue qui me l'avait sous-loué quelques mois plus tôt en toute illégalité avant de s'envoler pour une mission de trois ans en Corée du Sud.
Mon bien le plus précieux, je l'avais aux pieds : une paire de chaussures achetée une fortune le week-end précédent, non qu'elle soit particulièrement belle ou confortable, mais parce que je n'avais, une fois de plus, pas su dire non à un vendeur tenace.
La fumée s'épaississait. Pourquoi avait-il fallu que l'incendie se déclare précisément cette nuit, alors que j'étais ivre pour la première fois de ma vie ?
C'est qu'à ces gens-là non plus, la veille, je n'avais pas su dire non. C'était mon dernier jour dans l'entreprise, une journée particulièrement ennuyeuse employée à servir des cafés et distribuer le courrier : sachant que je quittais mon poste, et malgré deux mois de bons et loyaux services exécutés avec rigueur, personne ne me confiait plus la moindre responsabilité depuis le début de la semaine.
Je m'étais éclipsée vers dix-neuf heures, après avoir serré la main molle de la directrice des ressources humaines, qui m'avait félicitée pour mon travail mais s'était trompée sur mon prénom.
Devant l'ascenseur, un groupe de jeunes commerciaux s'apprêtait à passer la soirée ensemble. L'un d'eux m'avait soudain proposé de les accompagner. Nous nous connaissions à peine et n'avions rien en commun. Ils étaient pleins d'énergie, de projets, de promesses d'avenir, portaient des vêtements chics, employaient à tout bout de champ les adverbes « excessivement » ou « extraordinairement » et possédaient tous le même smartphone - un modèle qui coûtait la moitié de mon salaire.
J'étais une intérimaire de passage, habillée en sol-derie et dotée d'un diplôme flou dont ils ignoraient même qu'il existât. Je ne connaissais pas grand-chose à la hi-tech ni à toutes ces inventions qui, paraît-il, avaient accéléré l'ère de la communication - il faut dire que je ne communiquais pas beaucoup.
Bref, n'importe qui à ma place aurait refusé cette invitation saugrenue mais moi, sans bien savoir pourquoi, j'avais répliqué : pourquoi pas.
Bien plus tard, après avoir passé la soirée à avaler des bières et des mojitos en quantités astronomiques pour me donner une contenance, j'ai compris qu'il s'agissait d'un malentendu. L'invitation lancée devant l'ascenseur ne s'adressait pas à moi, mais à la directrice juridique qui attendait derrière mon épaule. J'avais répondu avec tant de promptitude que personne n'avait eu le courage de me détromper.
Si, ce soir-là, je m'étais contentée de ce qui était prévu (rentrer chez moi, manger une assiette de pâtes en regardant un programme quelconque à la télévision, me coucher vers vingt-deux heures, puis avaler un de ces comprimés qui vous assomment avec obstination), ce matin, sans doute, j'aurais eu les bons réflexes ; le corps défatigué et l'esprit alerte, je me serais souvenue de ce qu'on lit dans les journaux à longueur d'année - et que j'avais tant de fois étudié -, les précautions à prendre, la conduite à tenir, le linge mouillé au pied des portes, attendre les secours en s'allongeant au sol pour mieux respirer, surtout ne pas chercher à échapper aux flammes à tout prix.
Si je ne m'étais pas saoulée la veille comme une adolescente, j'aurais entendu la sirène des pompiers traverser la ville et j'aurais su que bientôt des hommes casqués et bottés à l'allure de héros déploieraient une immense échelle et viendraient me cueillir avec précaution sous les vivats des badauds pour me mettre en lieu sûr. J'aurais résisté à la terreur qui me gagnait, je me serais raisonnée, après tout, la fatalité n'était rien d'autre qu'un argument justifiant la lâcheté, le pessimisme d'humeur et l'absence de volonté.
Avec un peu de chance, les héros casqués auraient stoppé le feu avant qu'il ne ravage mon appartement. J'en aurais été quitte pour quelques heures de lessivage et j'aurais poursuivi ma route, à peine troublée, une route rectiligne, sans promesse et sans débat, qui dessinait chaque nouveau jour à l'identique du précédent.
Au lieu de ça, je me suis précipitée sur la porte d'entrée sans même prendre de quoi me protéger. Une masse noire et puissante m'a aussitôt repoussée vers l'intérieur, un nuage brûlant, étouffant qui attaquait ma peau et mes cheveux, chauffait l'air et le sol jusqu'à l'incandescence, cisaillait mes poumons. J'ai compris qu'il n'y avait plus aucune chance de sortir de cette pièce, et tout ce que j'enfouissais en moi avec application depuis plus de onze ans a jailli avec férocité.
Je me suis approchée de la fenêtre, retenant ma respiration pour ne pas nourrir le brasier qui me dévorait déjà de l'intérieur, et j'ai enjambé l'allège en hurlant.
Le tracé de ma route venait de former une épingle à cheveux.
Extraits

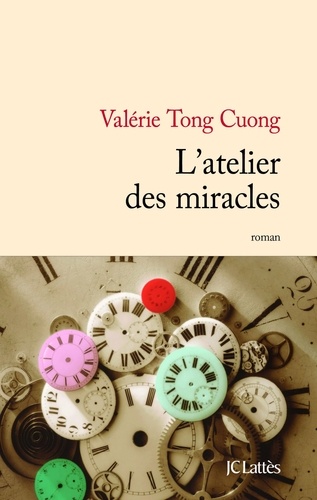


























Commenter ce livre