La terreur et l'empire. Tome 2, La violence et la paix
Extraits
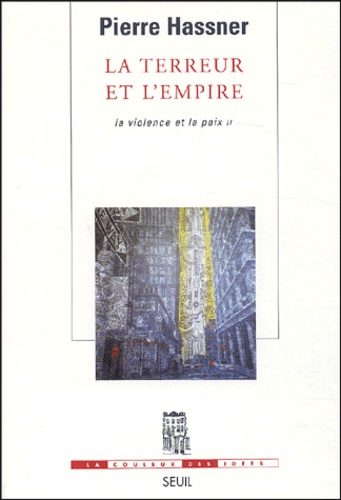
Sciences politiques
La terreur et l'empire. Tome 2, La violence et la paix
08/2003
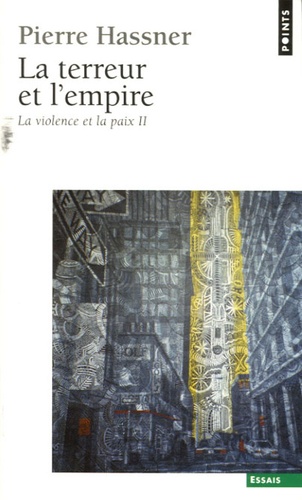
Sciences politiques
La violence et la paix. Tome 2, La Terreur et l'Empire
05/2006
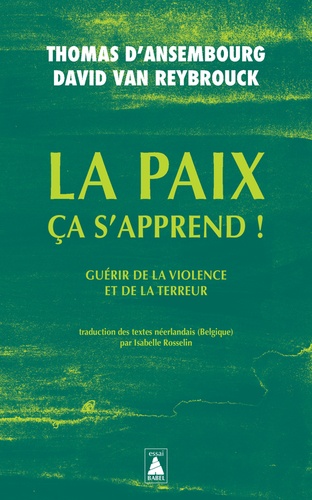
Violence
La paix ça s'apprend ! Guérir de la violence et de la terreur
10/2021
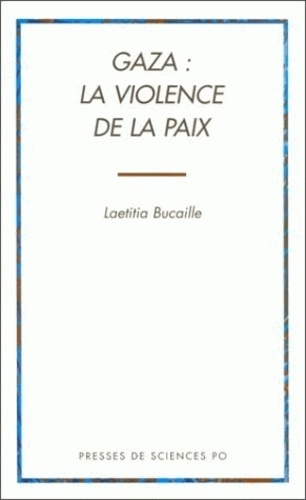
Histoire internationale
Gaza : la violence de la paix
11/1998
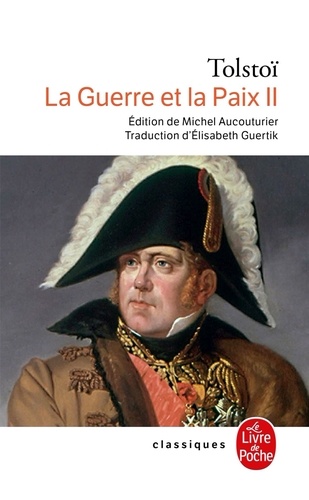
Poches Littérature internation
La Guerre et la Paix. Tome 2
08/2010
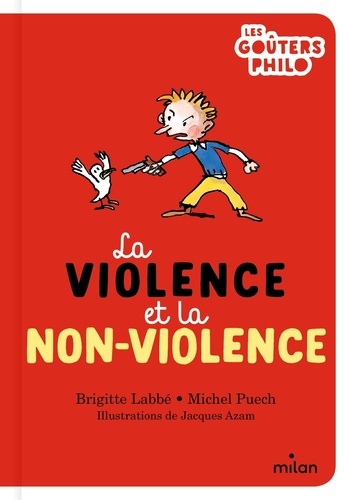
Philosophie
La violence et la non-violence
09/2021
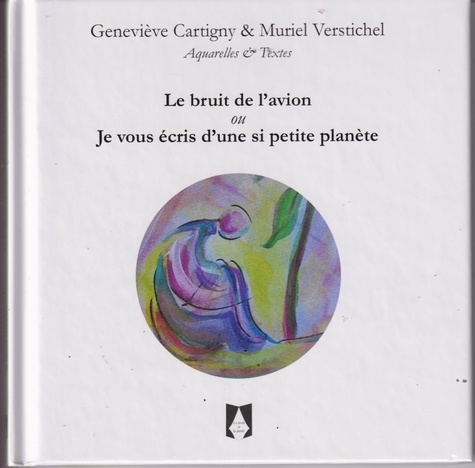
Poésie
Le bruit de l'avion
06/2022
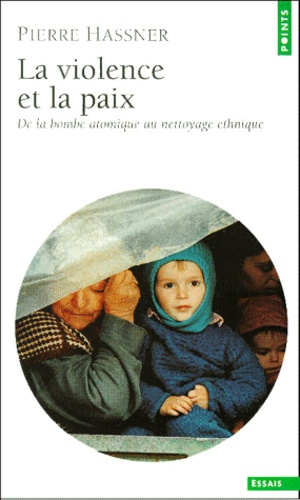
Sciences politiques
La violence et la paix. De la bombe atomique au nettoyage ethnique
03/2000
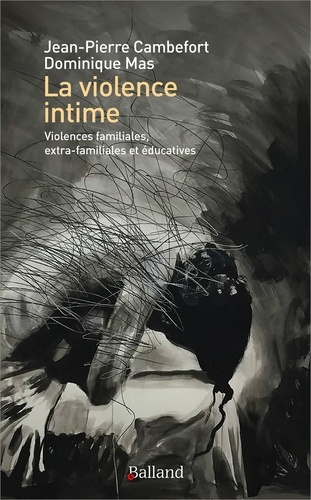
Psychologie, psychanalyse
La violence intime. Violences familiales, extra-familiales et éducatives
01/2020
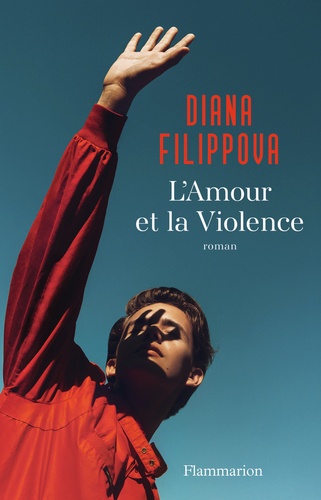
Littérature française
L'Amour et la Violence
08/2021
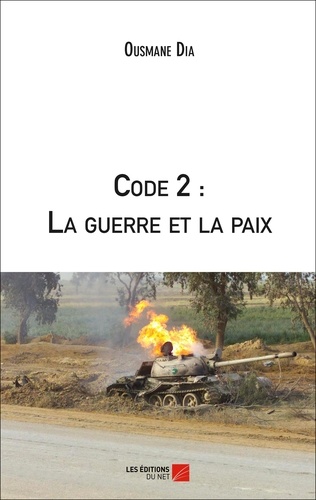
Sciences politiques
Code 2 : La guerre et la paix
06/2015
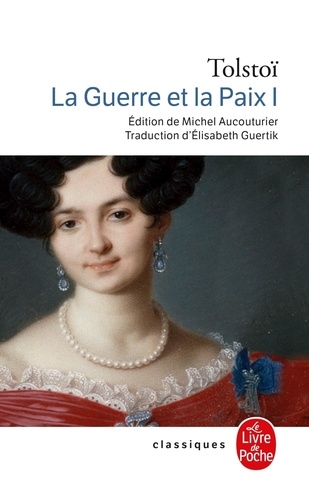
Poches Littérature internation
La Guerre et la Paix. Tome 1
08/2010
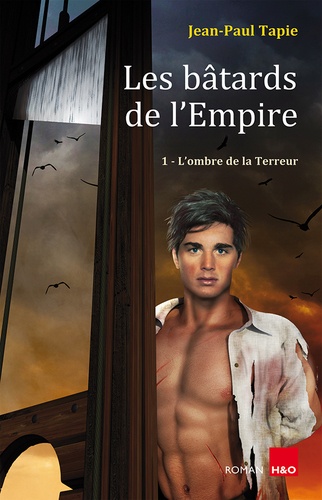
Littérature érotique et sentim
Les bâtards de l'Empire Tome 1 : L'ombre de la terreur
11/2015
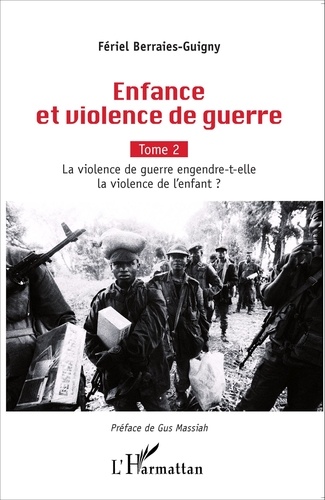
Psychologie, psychanalyse
Enfance et violence de guerre. Tome 2, La violence de guerre engendre-t-elle la violence de l'enfant ?
07/2015
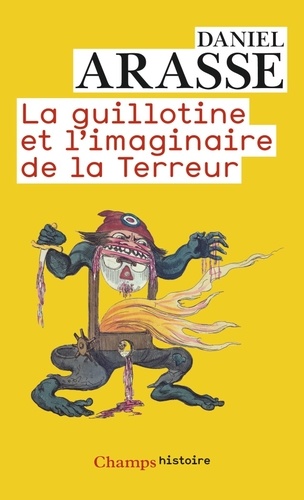
Histoire de France
La guillotine et l'imaginaire de la Terreur
11/2010
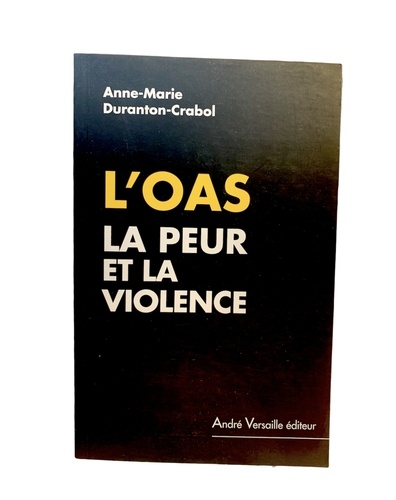
Histoire de France
L'OAS. La peur et la violence
02/2012
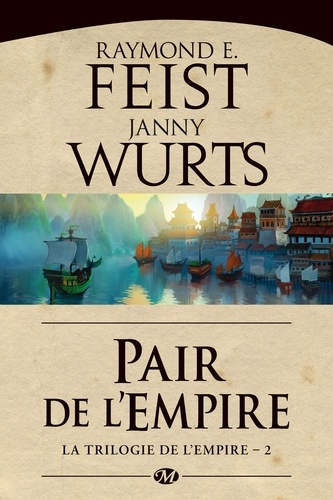
Science-fiction
Trilogie de l'Empire Tome 2 : Pair de l'empire
04/2013
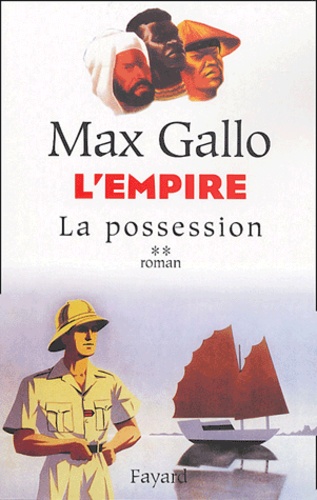
Romans historiques
L'Empire Tome 2 : La Possession
06/2004
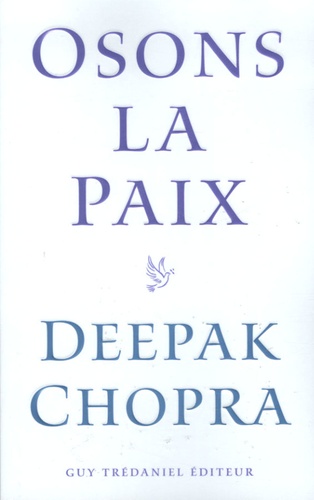
Religion
Osons la paix. Comment mettre fin à la violence
05/2006
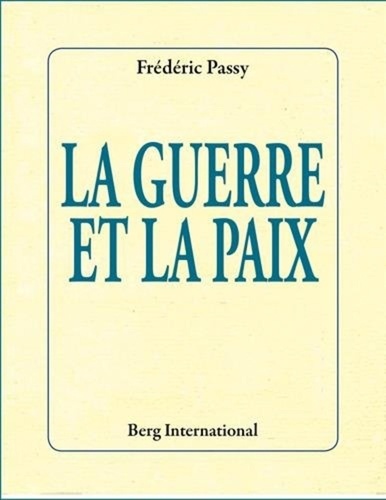
Sociologie
La guerre et la paix
06/2014
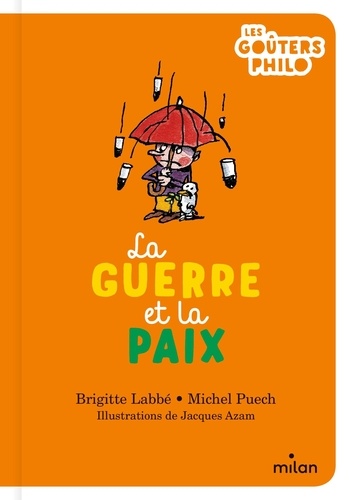
Autres encyclopédies (6 à 10 a
La guerre et la paix
02/2022
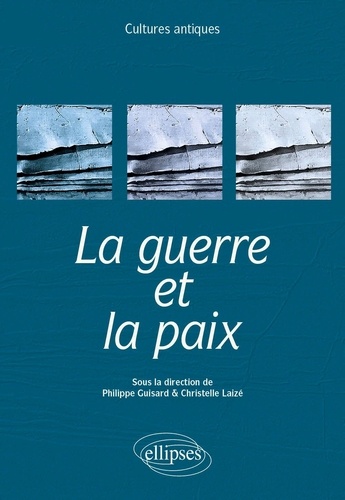
Grec, Latin - Traduction
La guerre et la paix
06/2022
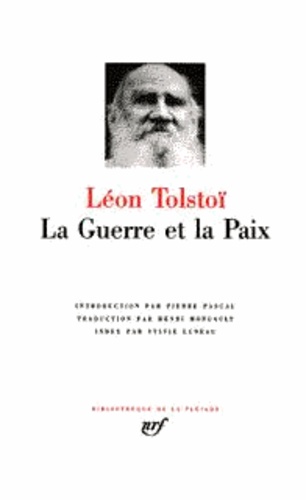
Pléiades
La Guerre et la paix
11/2000
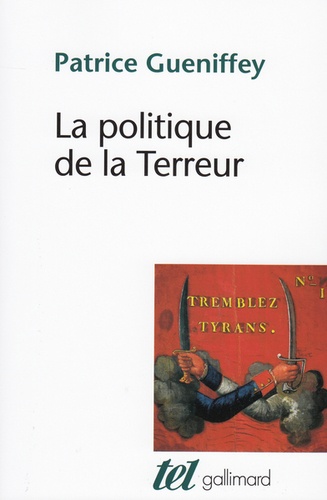
Histoire de France
La politique de la Terreur. Essai sur la violence révolutionnaire, 1789-1794
10/2003
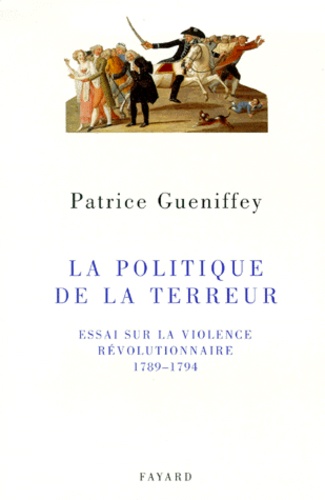
Histoire de France
La Politique de la Terreur. Essai sur la violence révolutionnaire, 1789-1794
01/2000
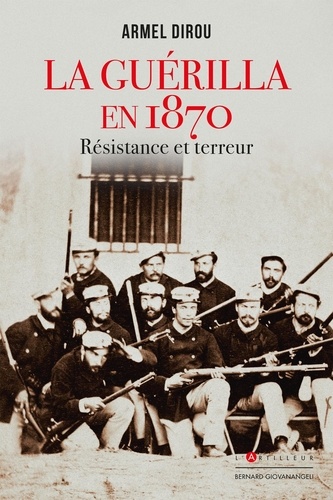
Troisième République
La Guérilla en 1870. Résistance et terreur
07/2021
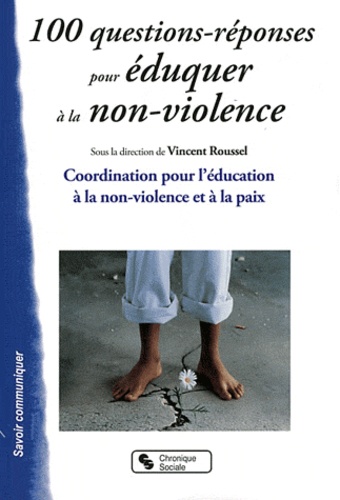
Pédagogie
100 questions-réponses pour éduquer à la non-violence. Coordination pour l'éducation à la non-violence et à la paix
09/2011
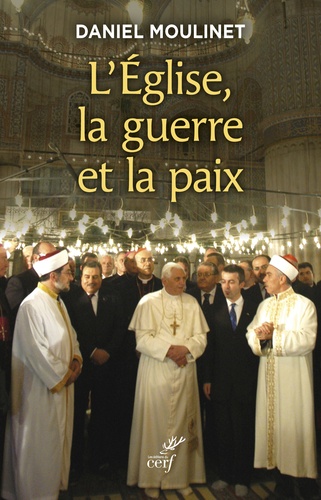
Religion
L'Eglise, la guerre et la paix
02/2016
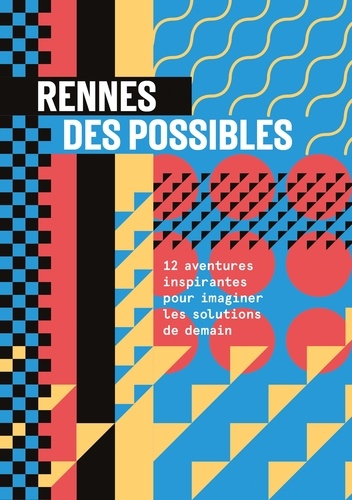
Aide humanitaire
Rennes des possibles. 12 aventures inspirantes pour imaginer les solutions de demain
09/2021
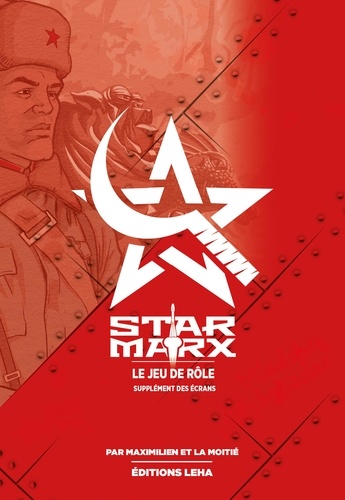
Jeux
Star Marx, jeu de rôle. Supplément écran
05/2021

