L'Histoire est une littérature contemporaine. Manifeste pour les sciences sociales
Extraits
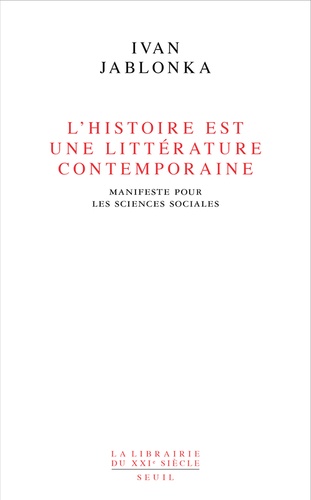
Sciences historiques
L'Histoire est une littérature contemporaine. Manifeste pour les sciences sociales
09/2014

Sociologie
Matière sociale. Esquisse d'une ontologie pour les sciences sociales
04/2022
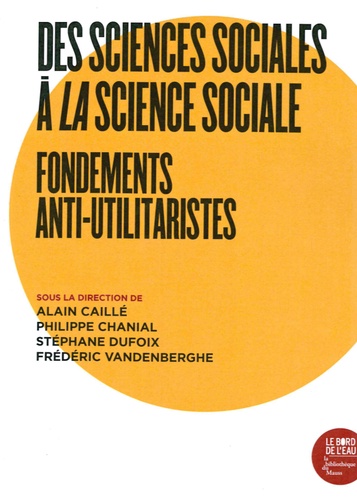
Sociologie
Des sciences sociales à la science sociale. Fondements anti-utilitaristes
04/2018
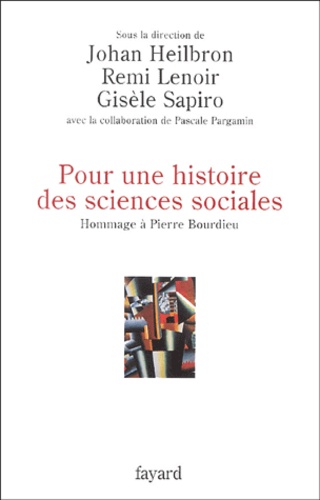
Sociologie
Pour une histoire des sciences sociales. Hommage à Pierre Bourdieu
10/2004
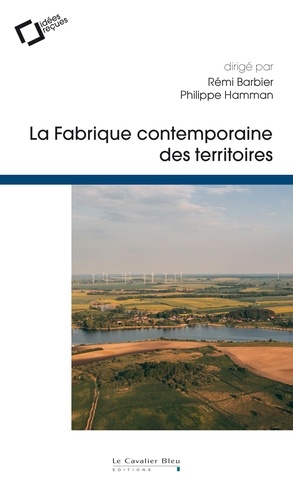
Aménagement du territoire
La Fabrique contemporaine des territoires. Regards en sciences sociales
10/2021
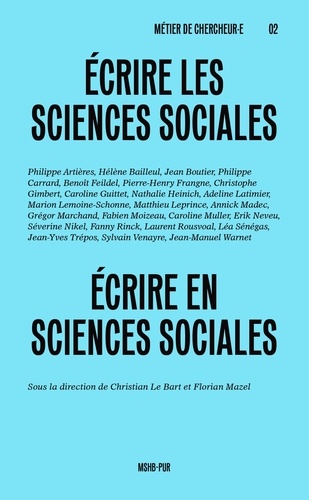
Sociologie
Ecrire les sciences sociales, écrire en sciences sociales
12/2021
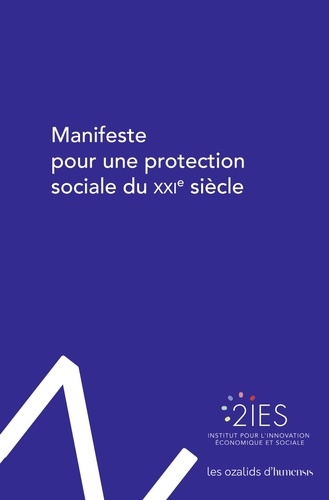
Sécurité sociale
Manifeste pour une protection sociale du XXIe siècle
11/2021
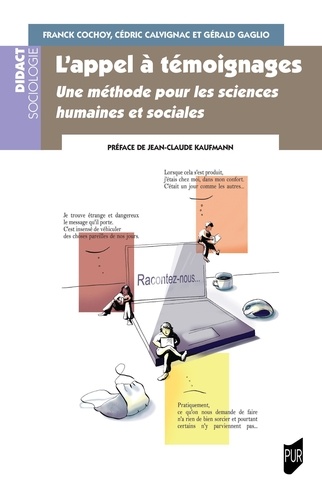
Sociologie
L'appel à témoignages. Une méthodologie pour les sciences humaines et sociales
07/2022
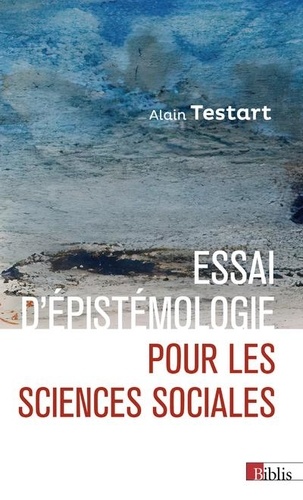
Ethnologie et anthropologie
Essai d'épistémologie pour les sciences sociales
09/2021
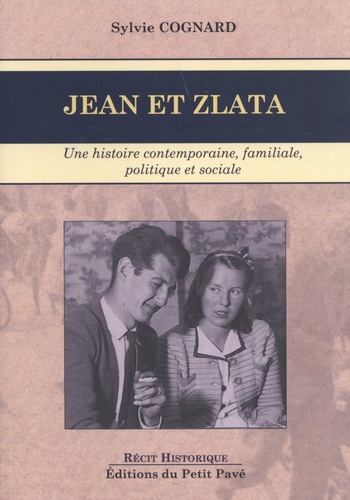
Romans historiques
Jean et Zlata. Une histoire contemporaine, familiale, politique et sociale
09/2019
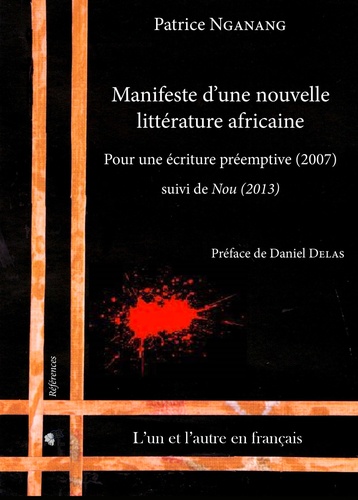
Littérature étrangère
Manifeste d'une nouvelle littérature africaine
02/2017
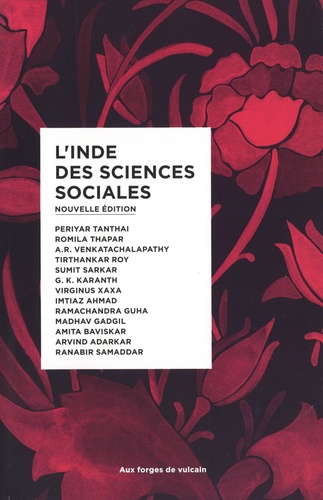
Sociologie
L'Inde des sciences sociales
05/2023
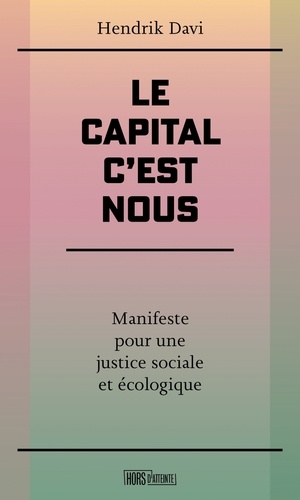
Sociologie
Le capital c'est nous. Manifeste pour une justice sociale et écologique
10/2023
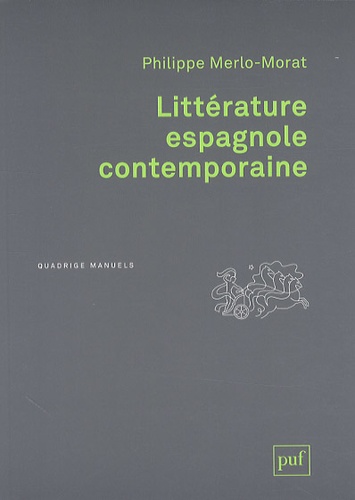
Espagnol apprentissage
Littérature espagnole contemporaine
08/2013
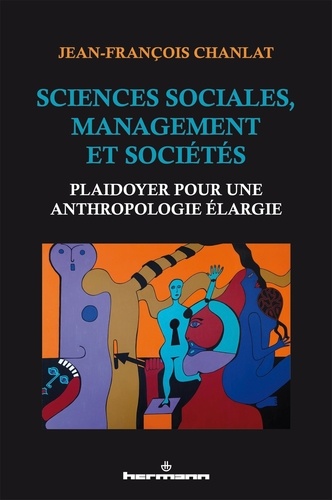
sociologie des organisations
Sciences sociales, management et sociétés. Plaidoyer pour une anthropologie élargie
10/2022
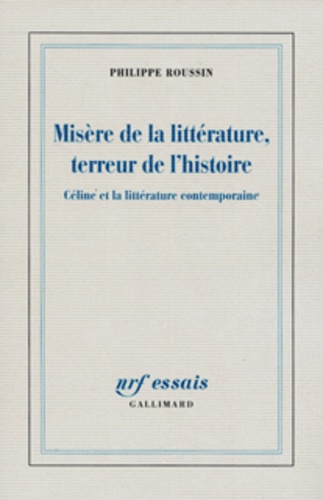
Critique littéraire
Misère de la littérature, terreur de l'histoire. Céline et la littérature contemporaine
02/2005
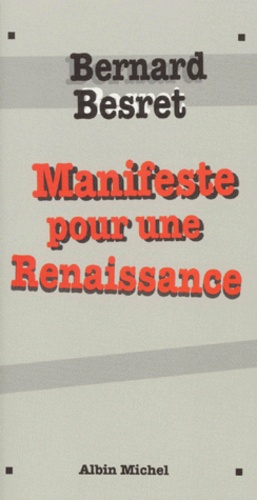
Religion
Manifeste pour une Renaissance
09/1997

sociologie des organisations
Innovations sociales. leviers pour une transition sociale, economique et environnementale
06/2023
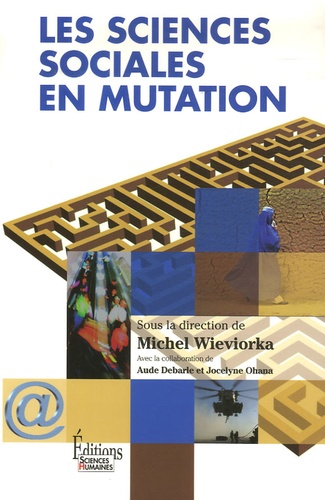
Sociologie
Les sciences sociales en mutation
03/2007
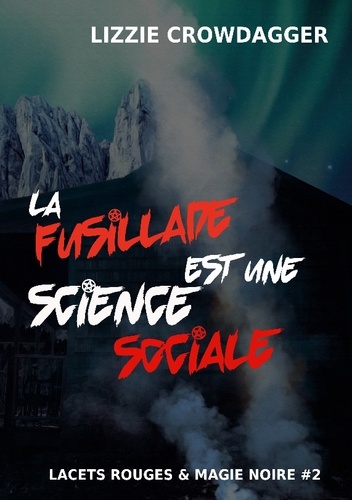
Fantasy
La fusillade est une science sociale
03/2024
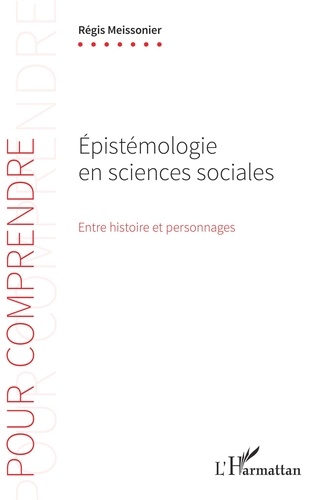
Epistémologie
Epistémologie en sciences sociales. Entre histoire et personnages
07/2021
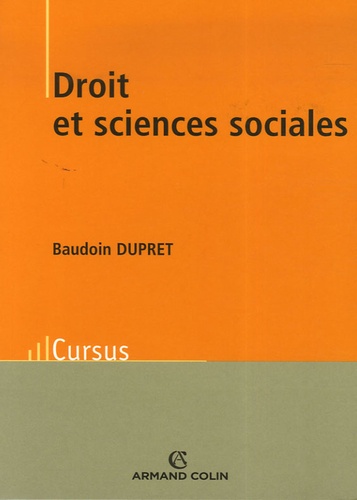
Sociologie
Droit et sciences sociales
11/2006
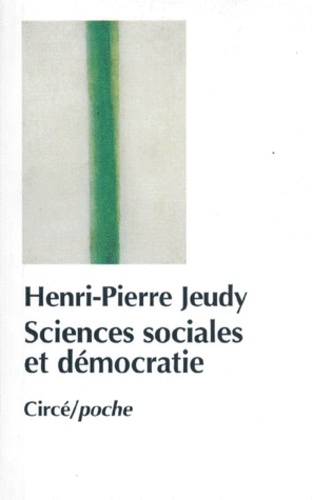
Sociologie
Sciences sociales et démocratie
09/1997
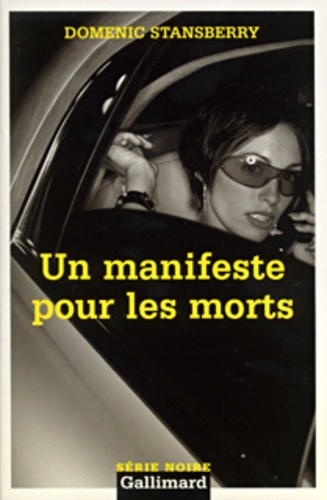
Policiers
Un manifeste pour les morts
11/2003

Critique littéraire
Station métropolis, direction Corsucant. Ville, science-fiction et sciences sociales
10/2019
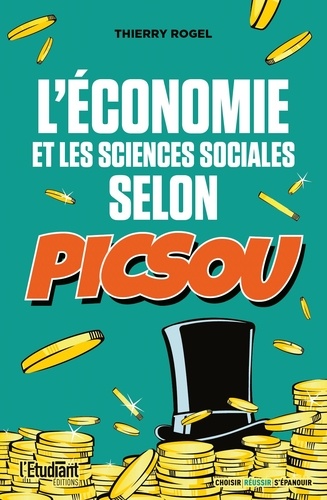
Economie (essai)
L'économie et les sciences sociales selon Picsou
09/2022
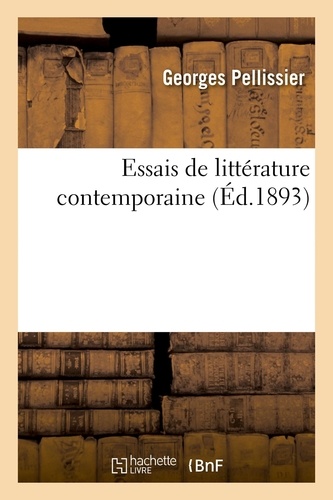
Littérature française
Essais de littérature contemporaine
02/2021
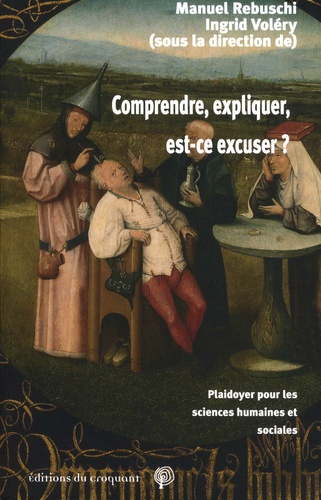
Sociologie
Comprendre, expliquer, est-ce excuser ? Plaidoyer pour les sciences humaines et sociales
10/2019
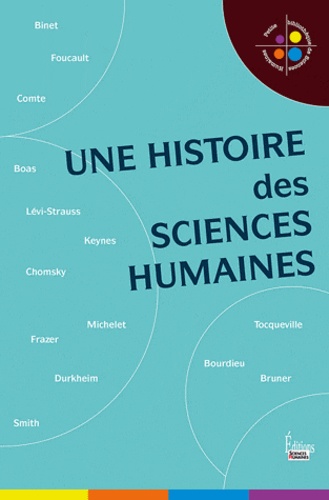
Histoire et Philosophiesophie
Une histoire des sciences humaines
10/2012
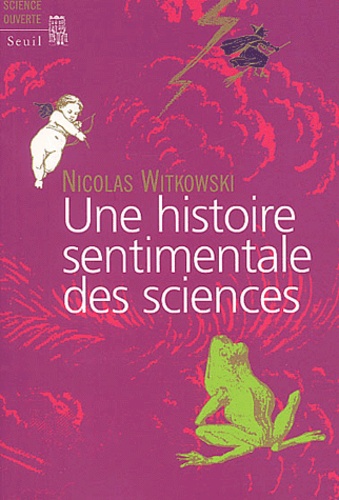
Histoire et Philosophiesophie
Une histoire sentimentale des sciences
03/2003

