Histoire romaine. Livres 50 et 51, Edition bilingue français-grec ancien
Extraits
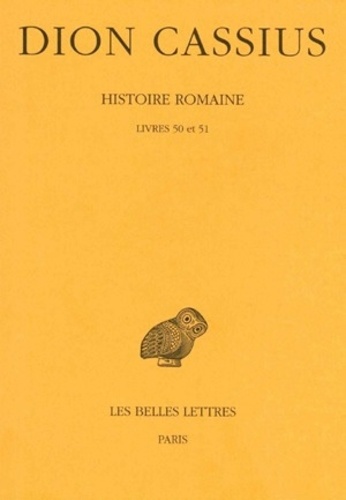
Critique littéraire
Histoire romaine. Livres 50 et 51, Edition bilingue français-grec ancien
01/1991
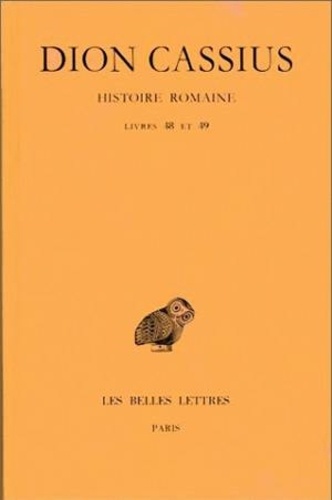
Critique littéraire
Histoire romaine. Livres 48 et 49, Edition bilingue français-grec ancien
07/1994
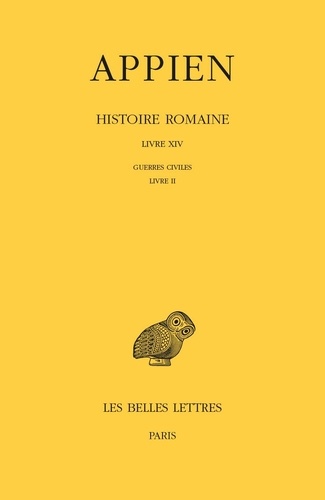
Collection Budé
Histoire romaine. Tome 11, Livre XIV : Guerres civiles, Livre II, Edition bilingue français-grec ancien
02/2021
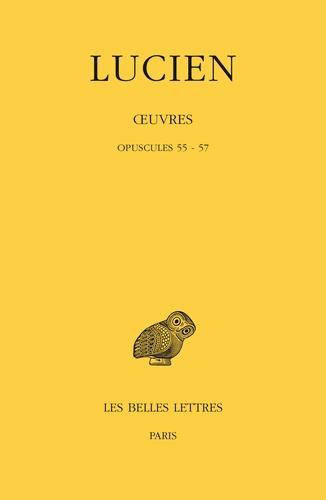
Critique littéraire
Oeuvres. Tome 12, Opuscules 55-57, Edition bilingue français-grec ancien
05/2017
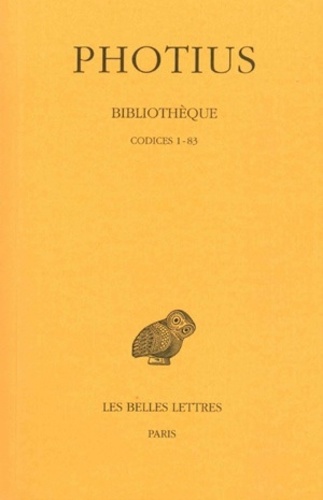
Critique littéraire
Bibliothèque. Tome 1, Codices 1-83, Edition bilingue français-grec ancien
01/1959
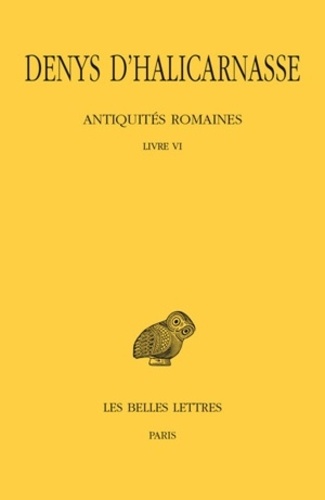
Critique littéraire
Antiquités romaines. Tome 6 Livre VI, Edition bilingue français-grec ancien
05/2016

Critique littéraire
Antiquités romaines. Tome 3, Livre III, Edition bilingue français-grec ancien
01/1999
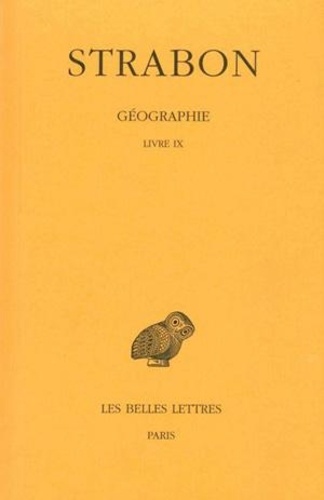
Critique littéraire
Géographie. Tome 6, Livre IX (Grèce), Edition bilingue français-grec ancien
11/1996
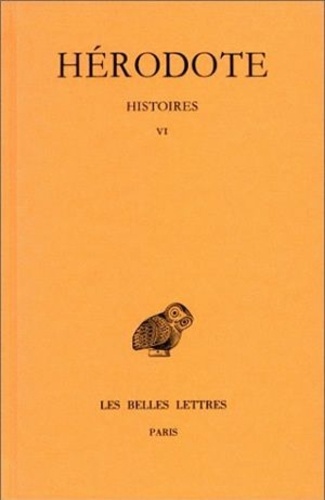
Critique littéraire
Histoires. Tome 6, Edition bilingue français-grec ancien
01/1963
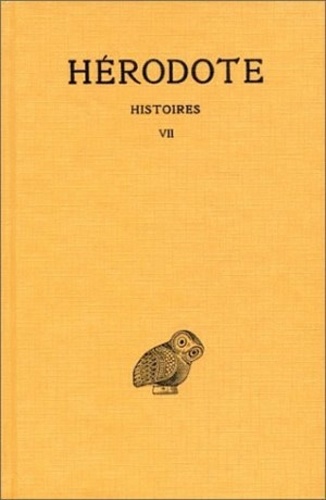
Critique littéraire
Histoires. Tome 7, Edition bilingue français-grec ancien
01/1986
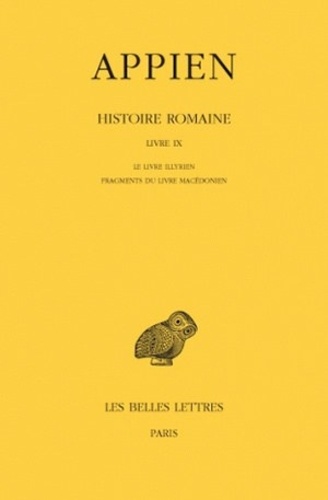
Critique littéraire
Histoire romaine. Tome 5, Livre IX, Le livre illyrien ; Fragments du livre macédonien, Edition bilingue français-grec ancien
11/2011
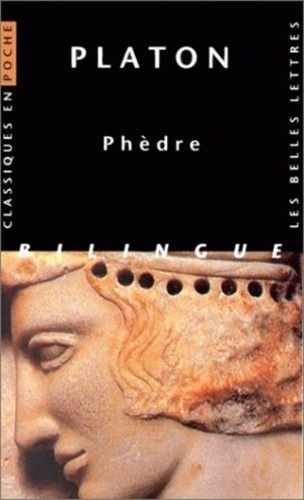
Critique littéraire
PHEDRE. Edition bilingue français-grec ancien
10/1998
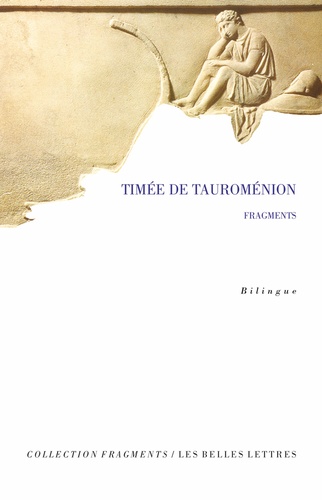
Critique littéraire
Fragments. Edition bilingue français-grec ancien
11/2017
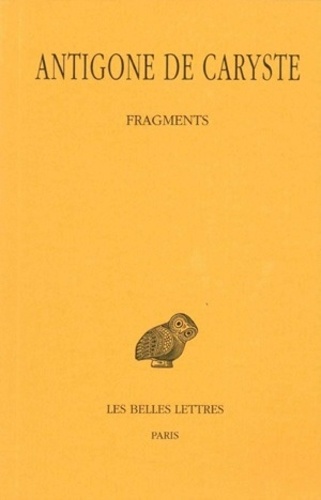
Critique littéraire
Fragments. Edition bilingue français-grec ancien
05/1990
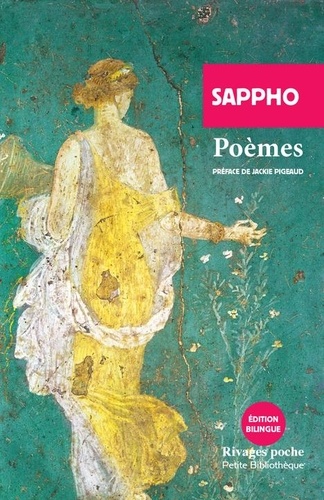
Critique littéraire
Poèmes. Edition bilingue français-grec ancien
05/2020
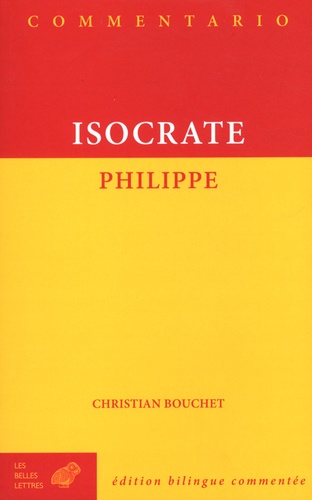
Critique littéraire
Philippe. Edition bilingue français-grec ancien
06/2019
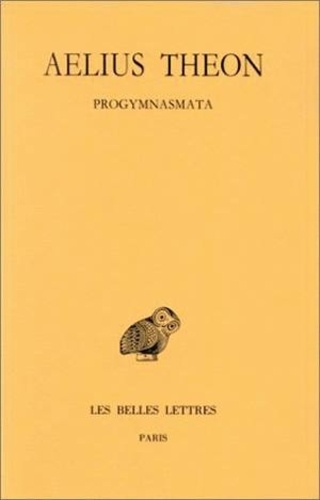
Critique littéraire
Progymnasmata. Edition bilingue français-grec ancien
01/1997
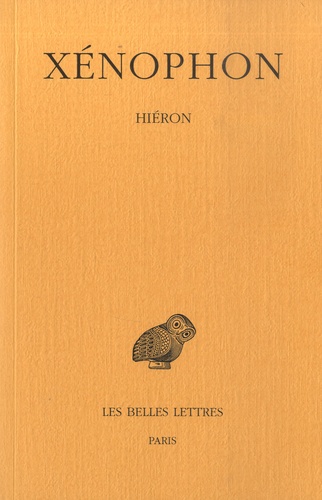
Collection Budé
Hiéron. Edition bilingue français-grec ancien
11/2021
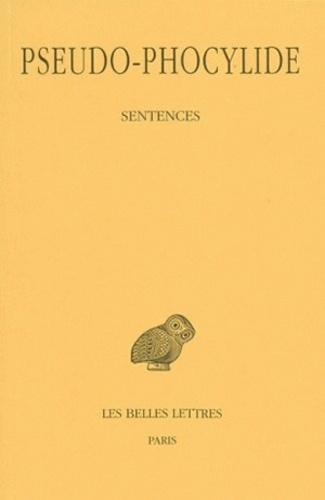
Critique littéraire
Sentences. Edition bilingue français-grec ancien
01/2003
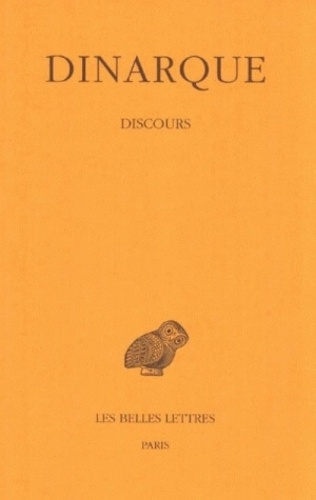
Critique littéraire
Discours. Edition bilingue français-grec ancien
01/1990
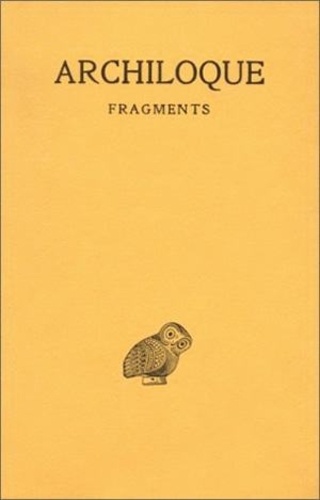
Critique littéraire
Fragments. Edition bilingue français-grec ancien
01/1968
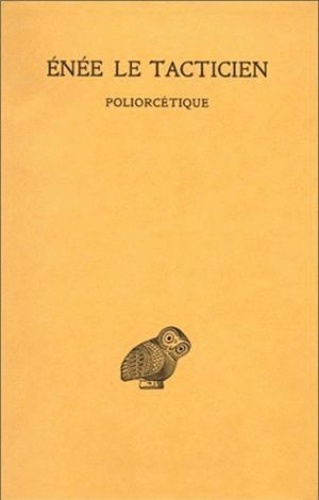
Critique littéraire
Poliorcétique. Edition bilingue français-grec ancien
01/1967
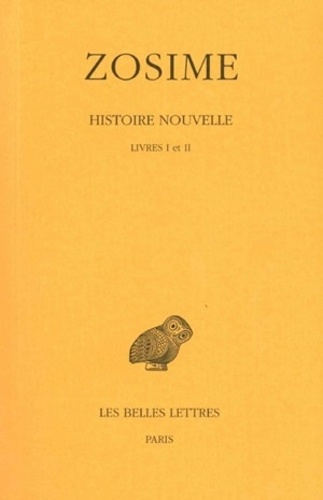
Critique littéraire
Histoire nouvelle. Tome 1, Livres I et II, Edition bilingue français-grec ancien
01/2000
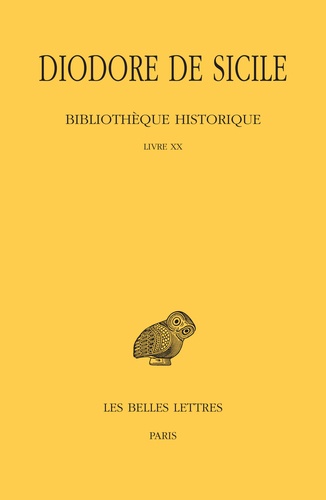
Critique littéraire
Bibliothèque historique. Tome 15 Livre XX, Edition bilingue français-grec ancien
05/2018
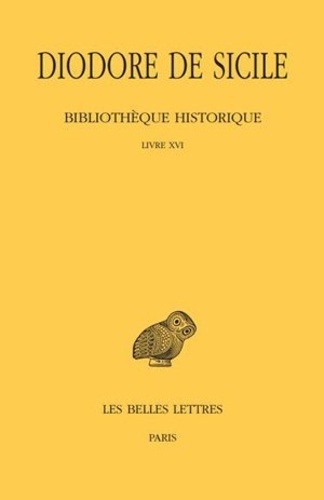
Critique littéraire
Bibliothèque historique. Tome 11 Livre XVI, Edition bilingue français-grec ancien
02/2016
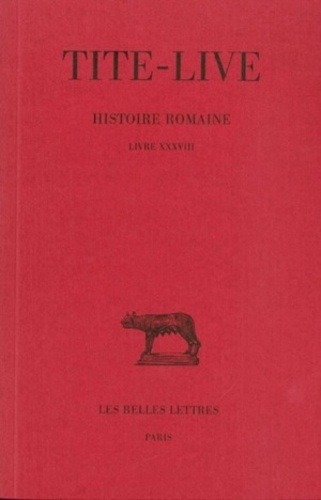
Critique littéraire
Histoire romaine. Livre XXVIII, Edition bilingue français-latin
07/1997
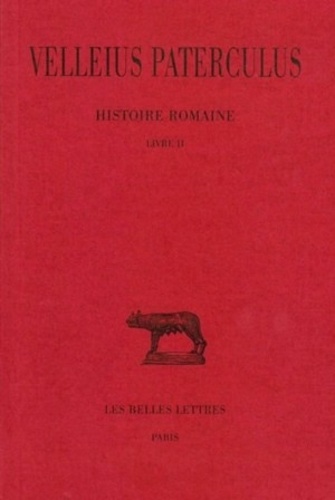
Critique littéraire
Histoire romaine. Livre II, Edition bilingue français-latin
07/1997
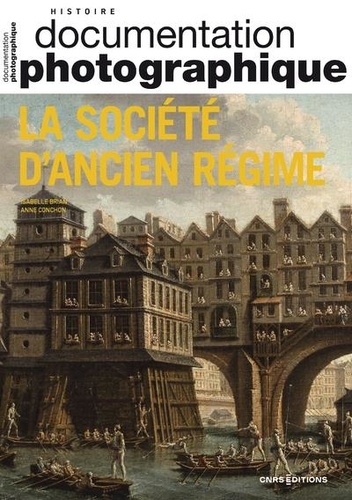
Ouvrages généraux et thématiqu
La Documentation photographique N° 8155/2023-5 : La société d'ancien régime
11/2023
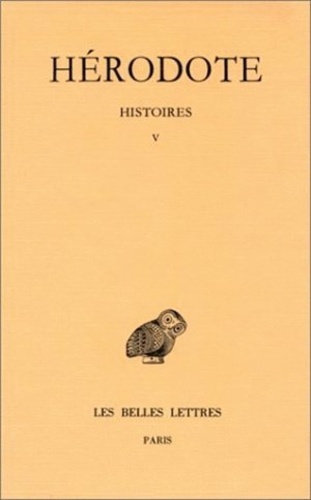
Critique littéraire
Histoires. Tome V, Tepsichore, Edition bilingue français-grec ancien
01/1968
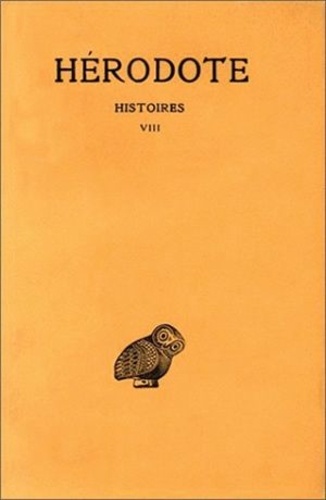
Critique littéraire
Histoires. Tome VII, Uranie, Edition bilingue français-grec ancien
01/1973

