sorbonne
Extraits
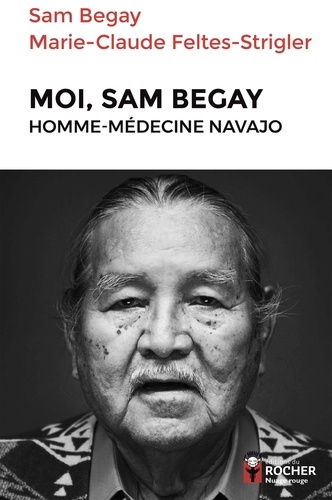
Histoire internationale
Moi, Sam Begay, homme-médecine Navajo
04/2019
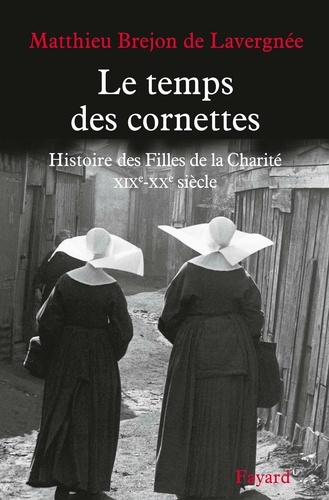
Religion
Le temps des cornettes. Histoire des Filles de la Charité. XIXe-XXe siècle
05/2018
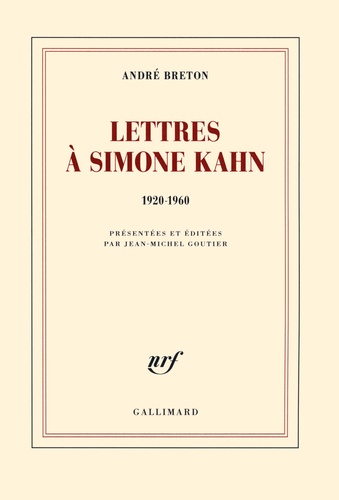
Critique littéraire
Lettres à Simone Kahn. 1920-1960
06/2016
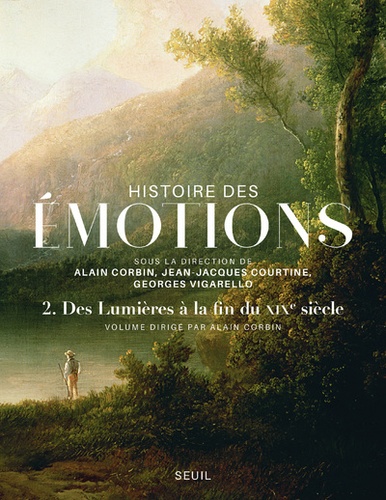
Sciences historiques
Histoire des émotions. Tome 2, Des Lumières à la fin du XIXe siècle
10/2016
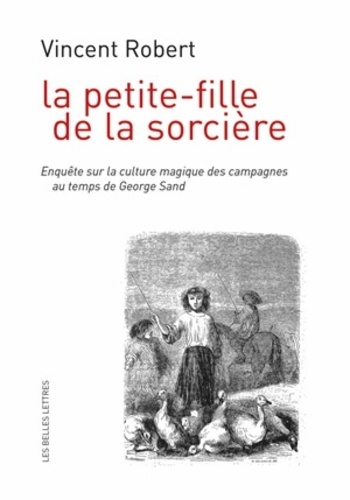
Critique littéraire
La petite-fille de la sorcière. Enquête sur la culture magique des campagnes au temps de George Sand
04/2015
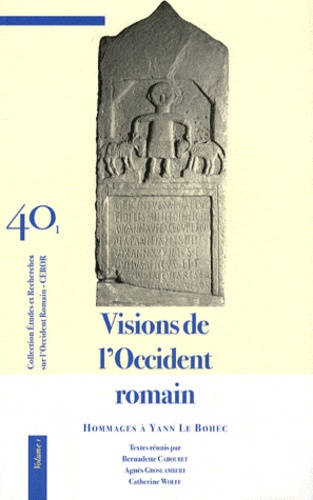
Histoire ancienne
Visions de l'Occident romain. Hommages à Yann Le Bohec, 2 volumes
01/2012
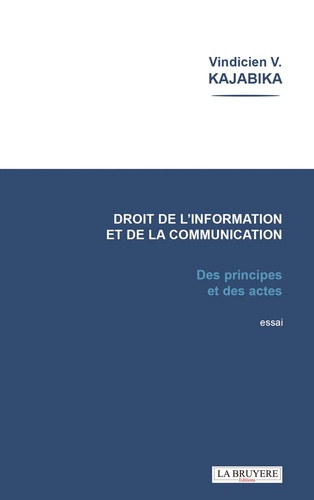
Presse, audiovisuel
Le droit de l'information et de la communication. Des principes et des actes
04/2021
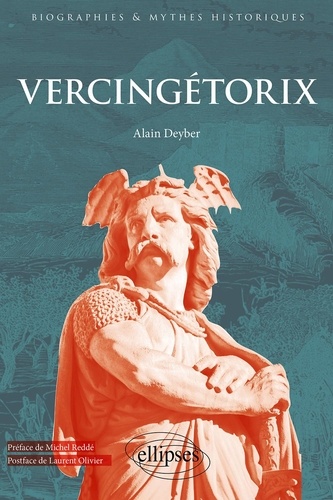
Celtes
Vercingétorix
05/2023
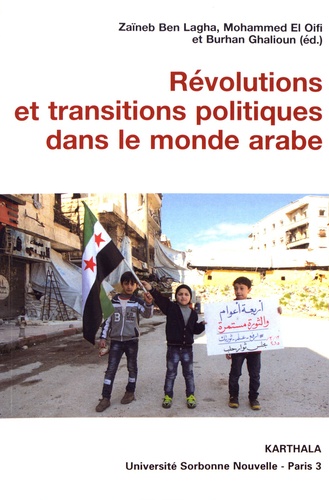
Sciences politiques
Révolutions et transitions politiques dans le monde arabe
08/2017
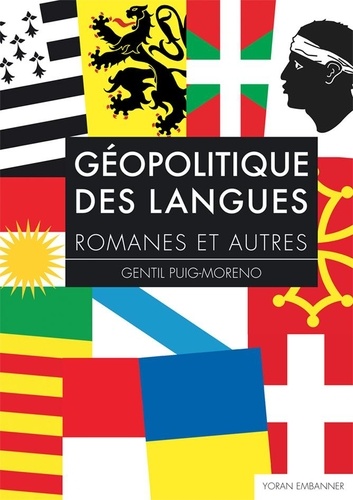
Linguistique
Géopoltique des langues romanes et autres
11/2022
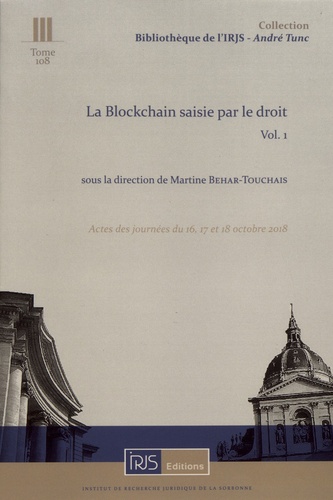
Droit
La blockchain saisie par le droit. Volume 1, Textes en français et en espagnol
10/2019
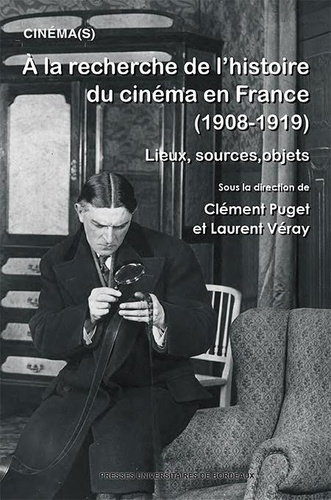
Histoire du cinéma
A la recherche de l’histoire du cinéma en France (1908-1919). Lieux, sources, objets
05/2022
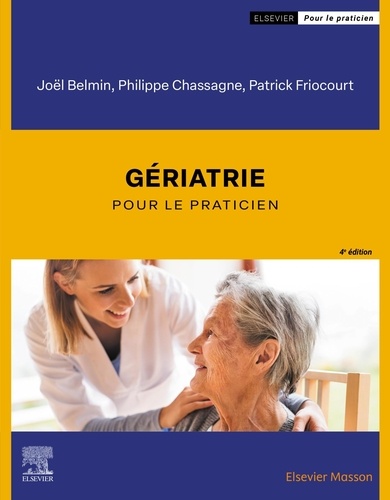
Gériatrie, gérontologie
Gériatrie. 4e édition
11/2023
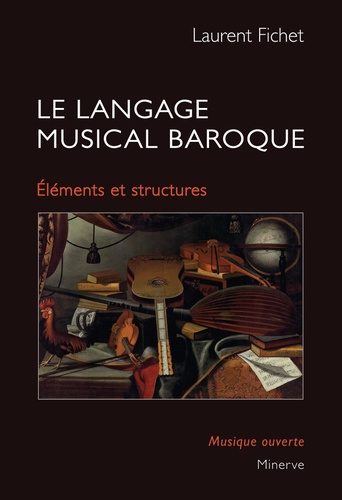
Musicologie
Le langage musical baroque. Eléments et structures, Edition revue et augmentée
02/2024
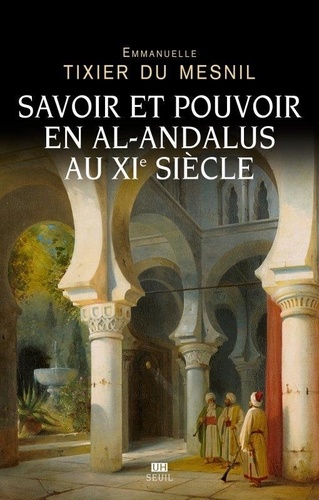
Ouvrages généraux
Savoir et pouvoir en Al-Andalus au XIe siècle
05/2022
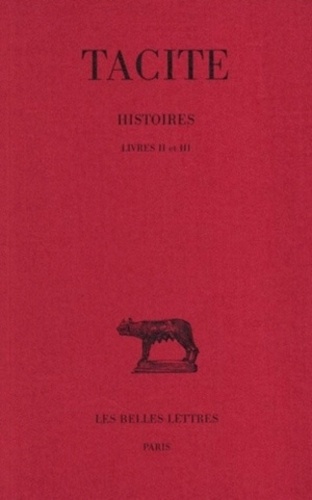
Critique littéraire
Histoires / Tacite Tome 2 : Livres II et III
06/1998
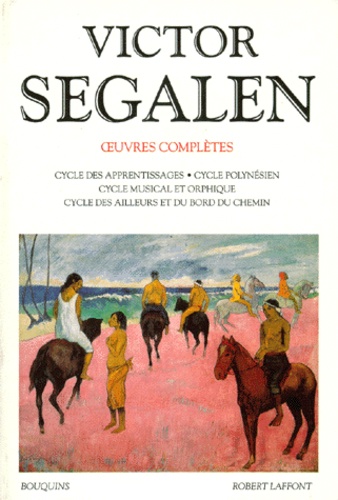
Littérature française
Oeuvres complètes / Victor Segalen. Tome 1
10/1995
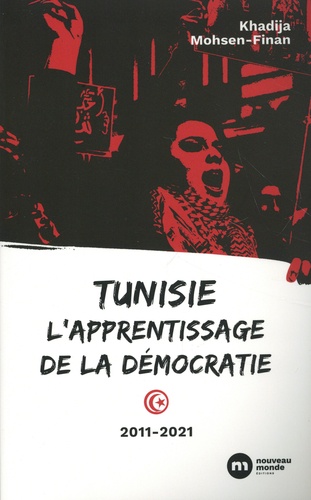
Sciences politiques
Tunisie, l'apprentissage de la démocratie. Edition 2021
01/2021
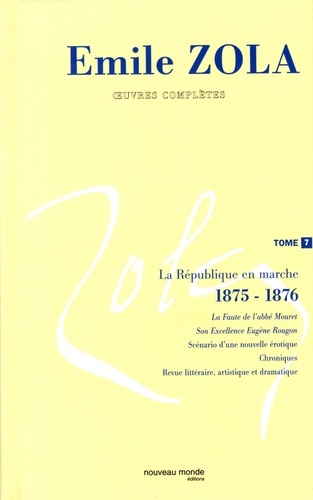
Littérature française
Oeuvres complètes. Tome 7, La République en marche (1875-1876)
01/2004
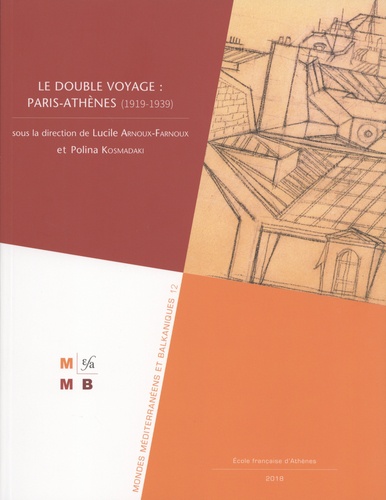
Beaux arts
Le double voyage : Paris-Athènes (1919-1939)
05/2018
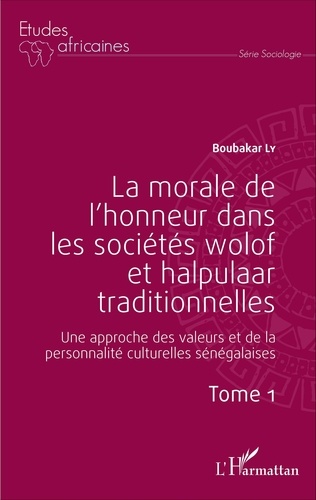
Sociologie
La morale de l'honneur dans les sociétés wolof et halpulaar traditionnelles. Une approche des valeurs et de la personnalité culturelles sénégalaises Tome 1
01/2016
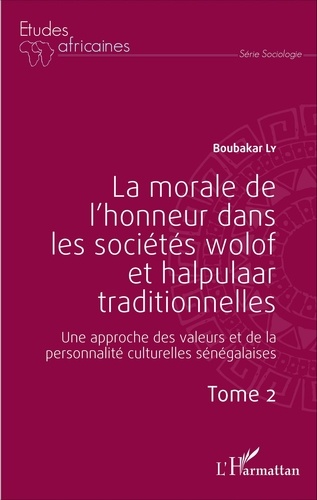
Sociologie
La morale de l'honneur dans les sociétés wolof et halpulaar traditionnelles. Une approche des valeurs et de la personnalité culturelles sénégalaises Tome 2
01/2016
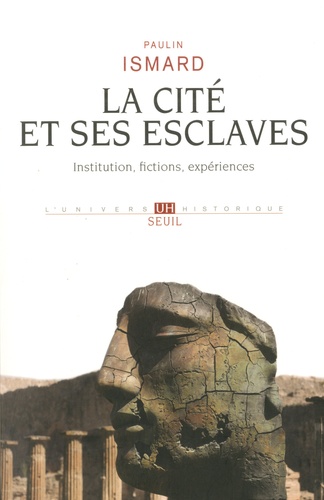
Histoire ancienne
La Cité et ses esclaves. Fictions, institution, expériences
10/2019
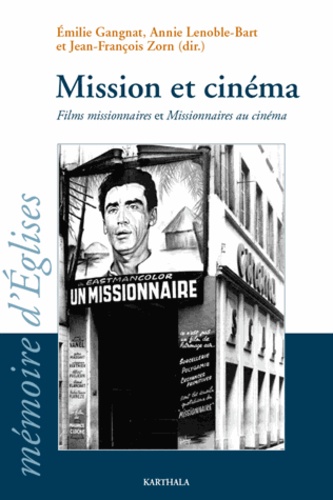
Religion
Mission et cinéma. Films missionnaires et Missionnaires au cinéma
08/2013
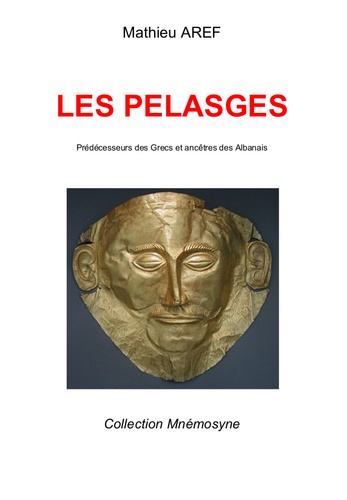
Histoire antique
Les Pélasges. Prédécesseurs des Grecs et ancêtres des Albanais
02/2022
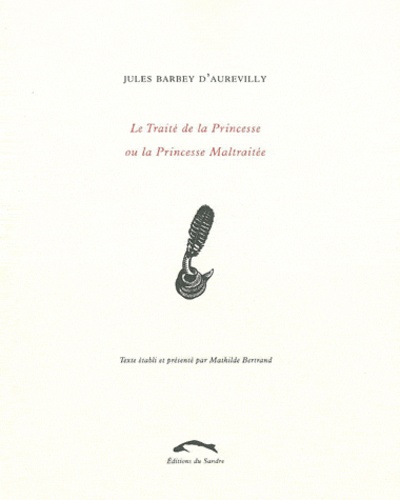
Littérature française
Le Traité de la Princesse ou la Princesse Maltraitée
01/2012
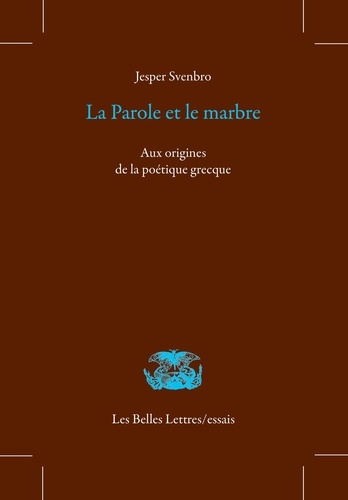
Grec ancien - Littérature
La parole et le marbre. Aux origines de la poétique grecque
06/2021
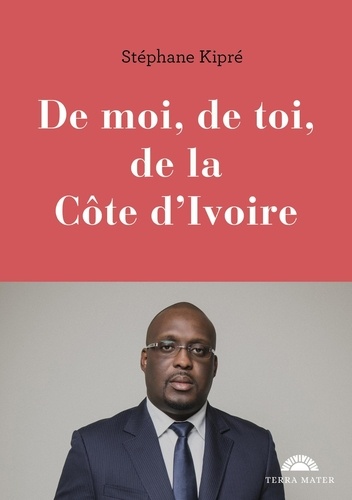
Histoire internationale
De moi, de toi, de la Côte d'Ivoire
09/2020
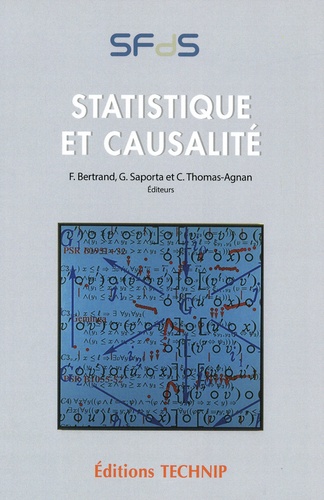
Statistiques et probabilités
Statistique et causalité
10/2021
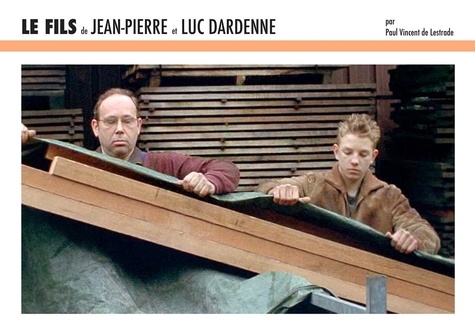
Album de films
Les fils de Jean-Pierre et Luc Dardenne
09/2021

