aérobic philosophie
Extraits
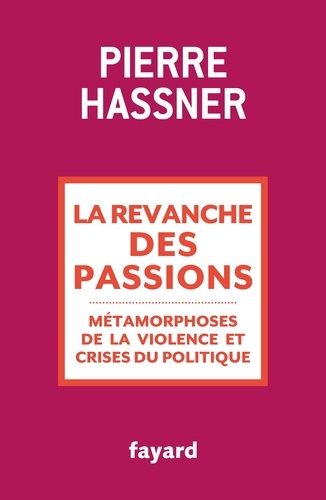
Philosophie
La revanche des passions. Métamorphoses de la violence et crises du politique
10/2015
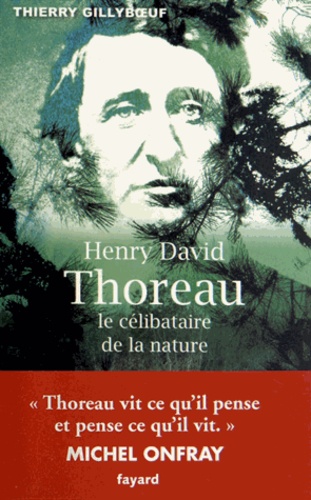
Critique littéraire
Henry David Thoreau. Le célibataire de la nature
10/2012
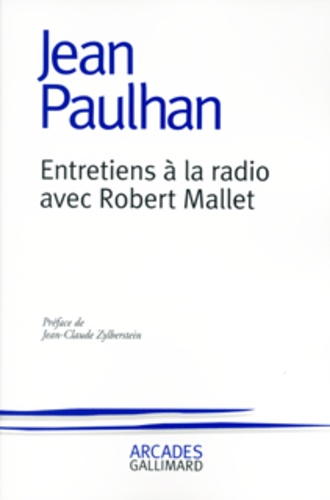
Critique littéraire
Entretiens à la radio avec Robert Mallet
11/2002
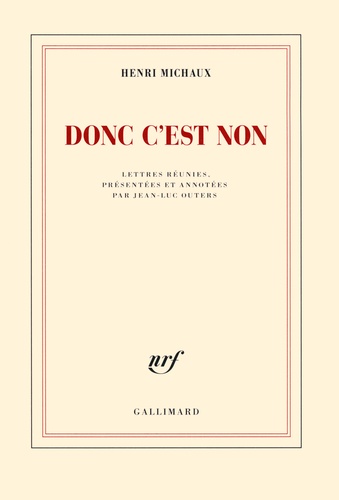
Critique littéraire
Donc c'est non
03/2016
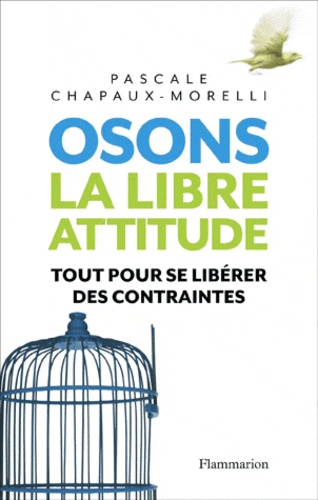
Développement personnel
Osons la libre attitude
03/2012
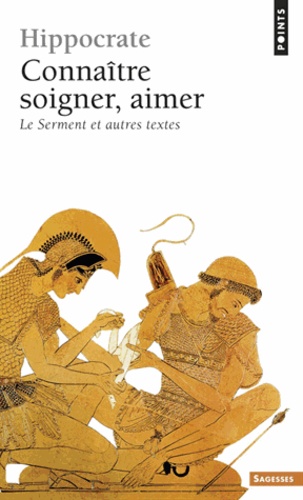
Généralités médicales
CONNAITRE, SOIGNER, AIMER. Le Serment et autres textes
03/1999
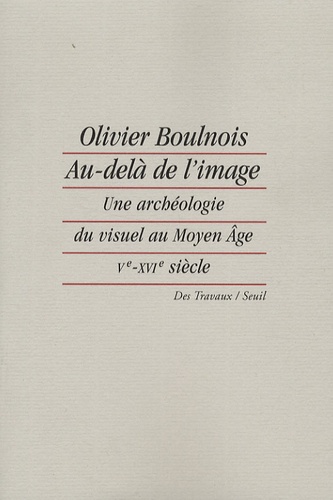
Philosophie
Au delà de l'image. Une archéologie du visuel au Moyen Age (Ve-XVIe siècle)
03/2008
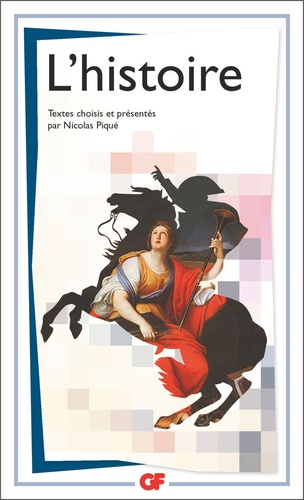
Philosophie
L'histoire
03/2012
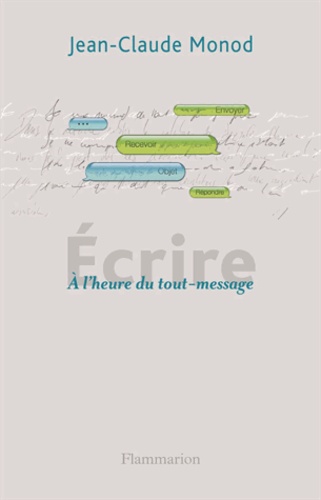
Philosophie
Ecrire. A l'heure du tout-message
04/2013
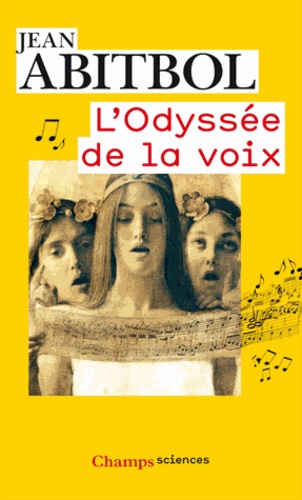
Paramédical
L'odyssée de la voix
05/2013
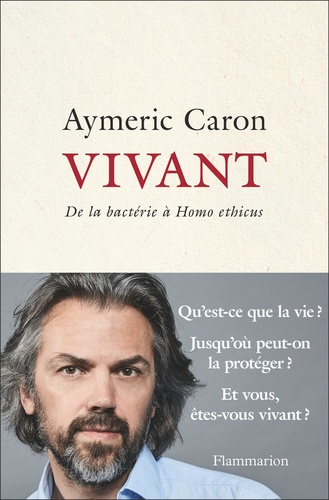
Philosophie
Vivant. De la bactérie à Homo ethicus
11/2018
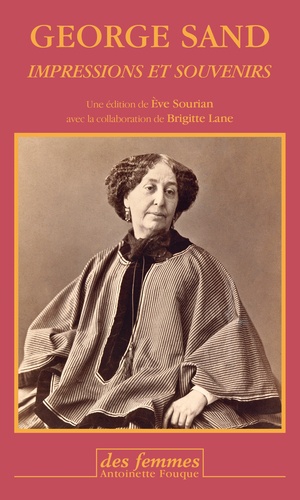
Littérature française
Impressions et souvenirs
03/2005
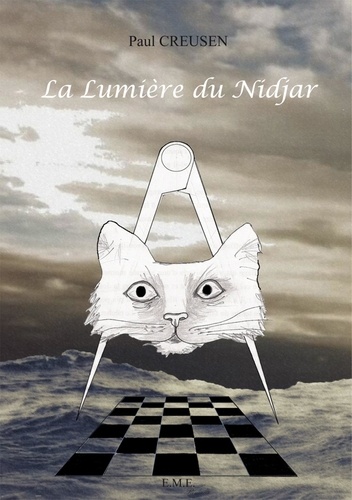
Littérature française
La Lumière du Nidjar
10/2010
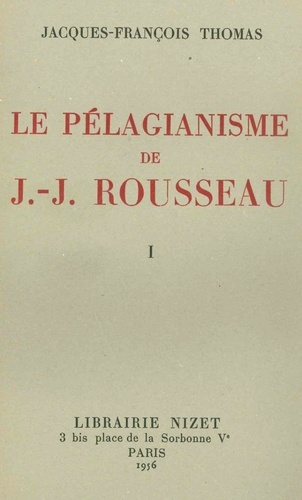
Critique littéraire
Le Pélagianisme de Jean-Jacques Rousseau
08/2015
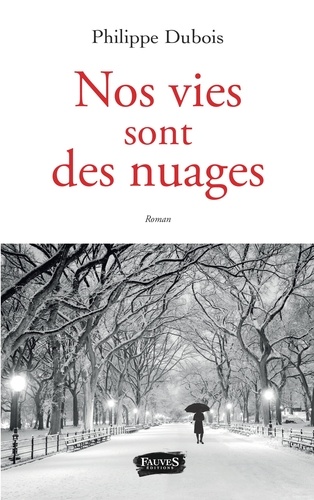
Littérature française
Nos vies sont des nuages
11/2020
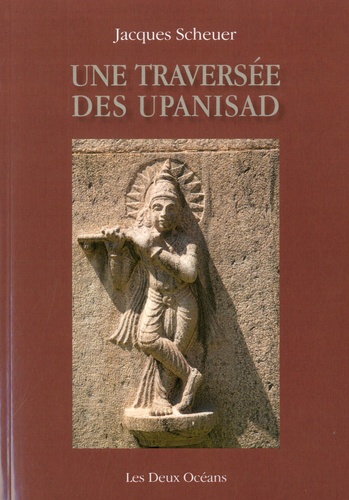
Religion
Une traversée des Upanishad
06/2019
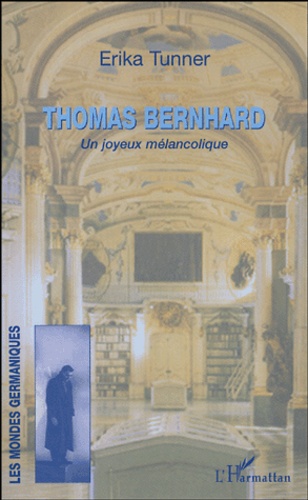
Allemand apprentissage
Thomas Bernhard. Un joyeux mélancolique
09/2004
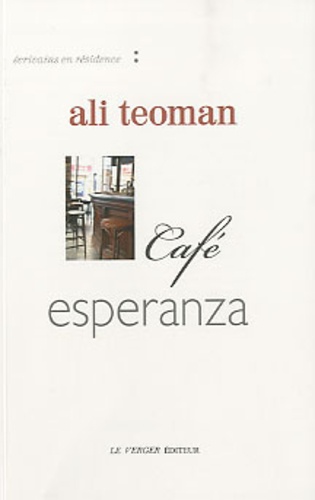
Littérature étrangère
Café espéranza
05/2010
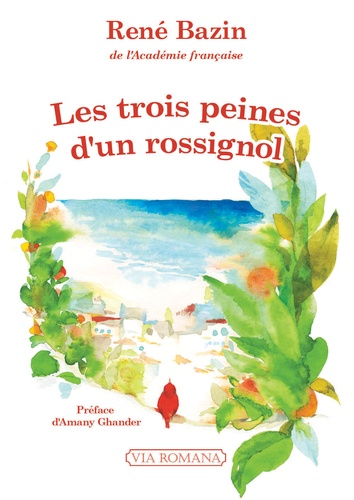
Littérature française
Les trois peines d´un rossignol
04/2018
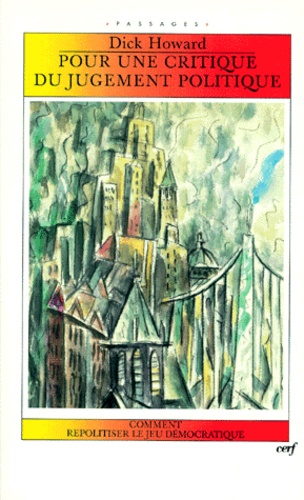
Philosophie
Pour une critique du jugement politique. Comment repolitiser le jeu démocratique
05/1998
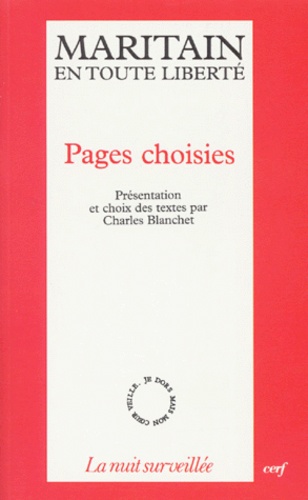
Religion
MARITAIN EN TOUTE LIBERTE. Pages choisies
08/1997
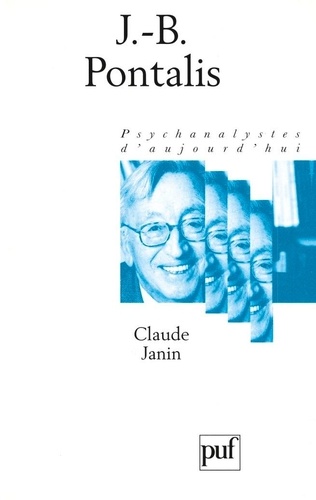
Psychologie, psychanalyse
J.-B. Pontalis
11/1998
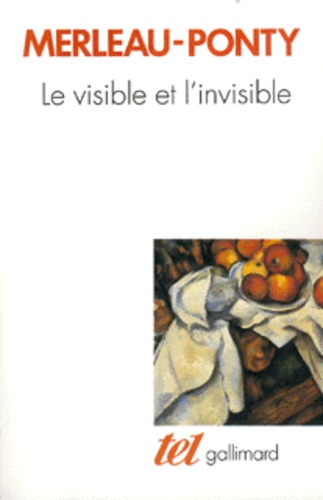
Philosophie
Le Visible et l'invisible. Suivi de notes de travail
02/1979
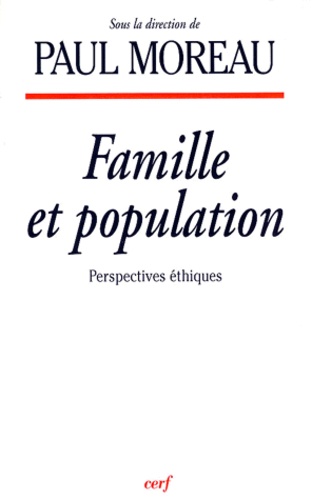
Religion
FAMILLE ET POPULATION. Perspectives éthiques
09/1998
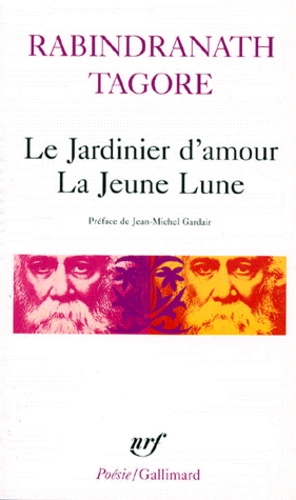
Poésie
Le jardinier d'amour. suivi de La jeune lune
01/1980
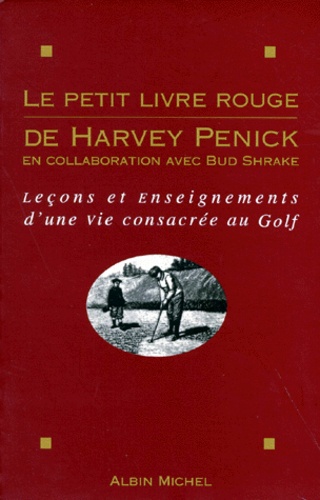
Sports
LE PETIT LIVRE ROUGE DE HARVEY PENICK. Leçons et enseignements d'une vie consacrée au Golf
05/1998
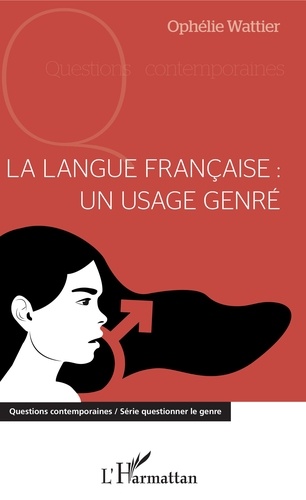
Sociologie
La langue française : un usage genré
01/2019
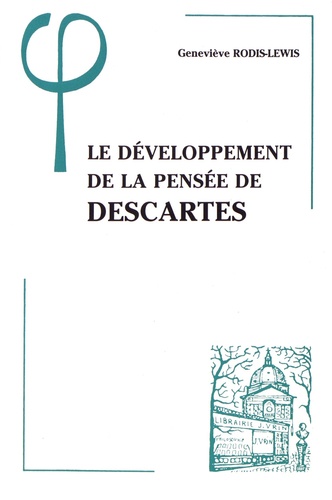
Philosophie
Le développement de la pensée de Descartes
03/1997
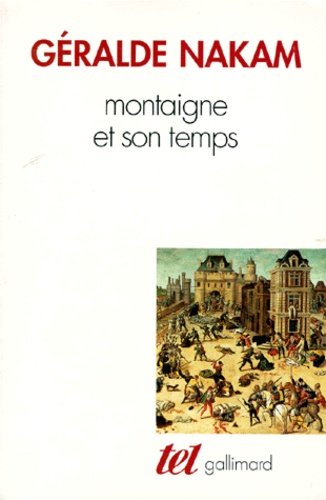
Critique littéraire
Montaigne et son temps. Les événements et les "Essais", l'histoire, la vie, le livre
02/1993
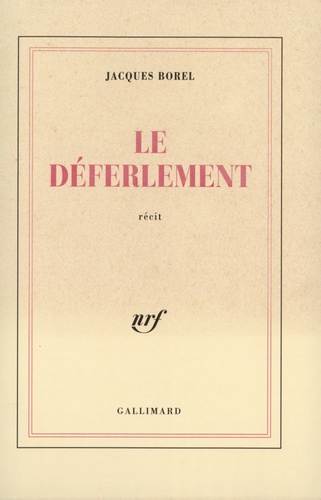
Littérature française
Le déferlement
12/1993

