Maimonide
Extraits
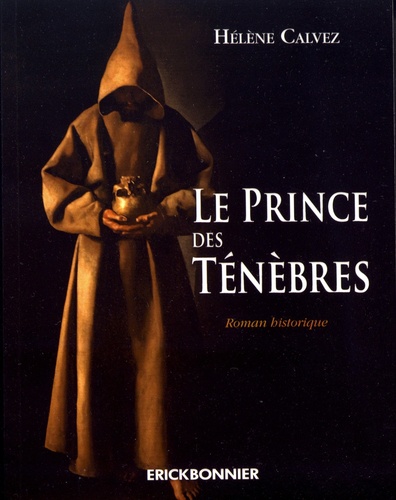
Romans historiques
Le prince des ténèbres
04/2018
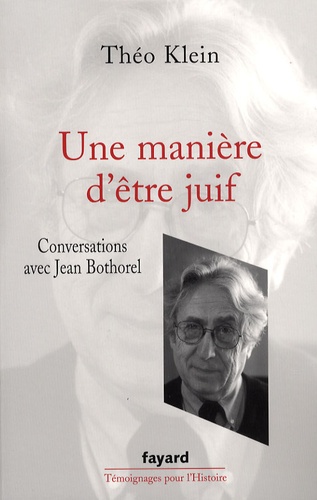
Religion
Une manière d'être juif
10/2007
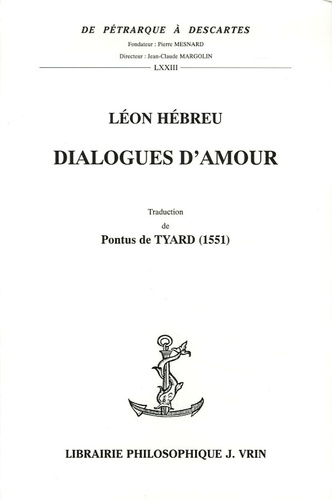
Religion
Dialogues d'amour
04/2006
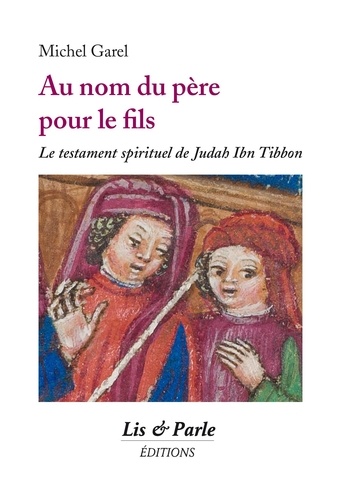
Histoire du judaïsme
Au nom du père pour le fils. Le testament spirituel de Judah Ibn Tibbon
11/2021
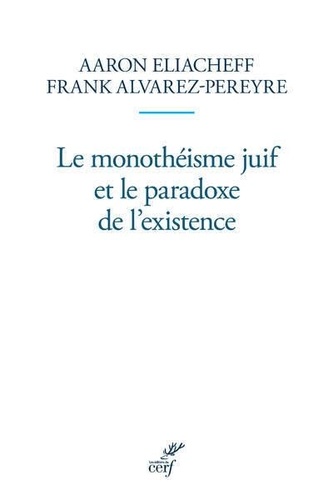
Religion
Le monothéisme juif et le paradoxe de l'existence
10/2019
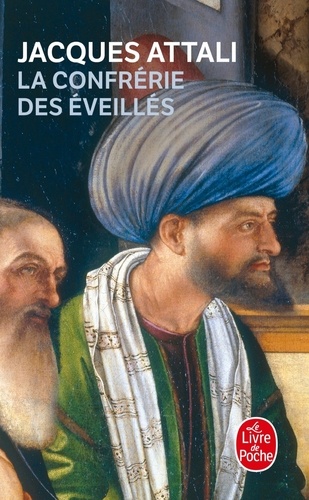
Littérature française (poches)
La Confrérie des Eveillés
03/2006
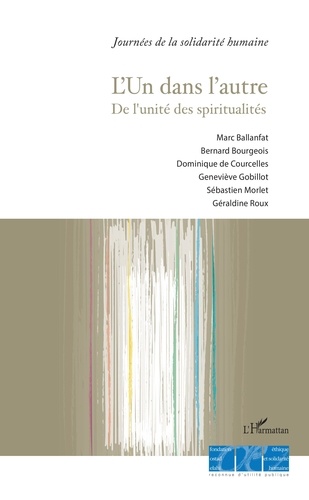
Philosophie
L'un dans l'autre. De l'unité des spiritualités
01/2018
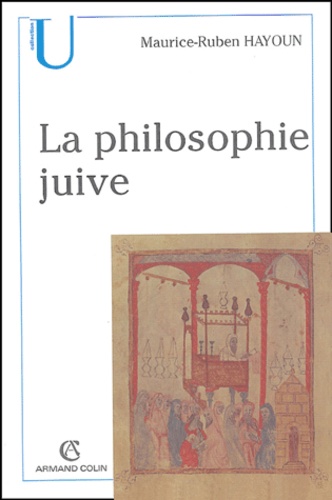
Histoire de la philosophie
La philosophie juive
04/2023
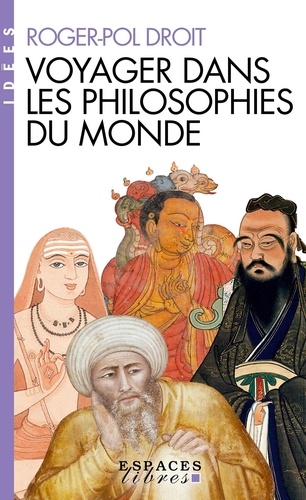
Ouvrages généraux
Voyager dans les philosophies du monde
02/2024
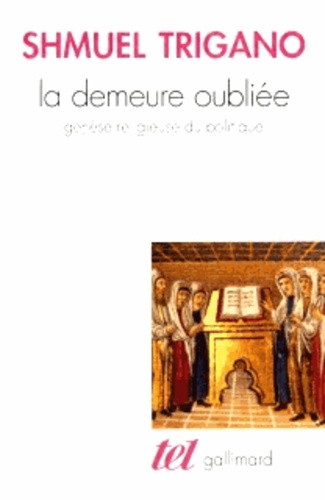
Religion
La demeure oubliée. Genèse religieuse du politique
03/1994
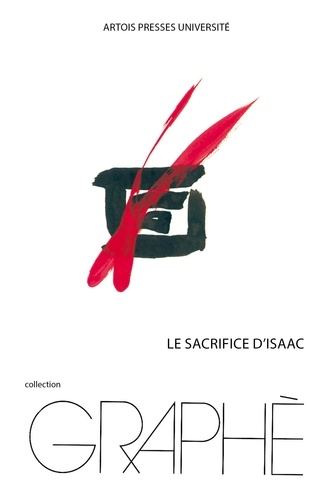
Bibles
Le sacrifice d’Isaac
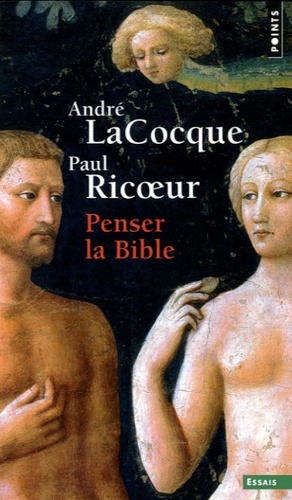
Religion
Le Buisson et la Voix. Exégèse et pensée juives
02/1987
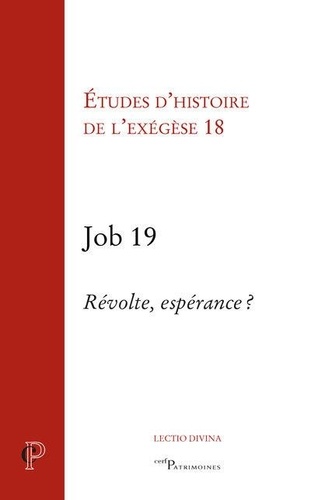
Exégèse
Job 19. Révolte, espérance ?
02/2022

Théologie
Sur les lois de l'Ancien Testament. Quatre questions disputées ; Traité sur les préceptes cérémoniels ; Neuf points sur les préceptes judiciels ; Mystère du parcours de la Loi et de la Synagogue, Edition bilingue français-latin
05/2022
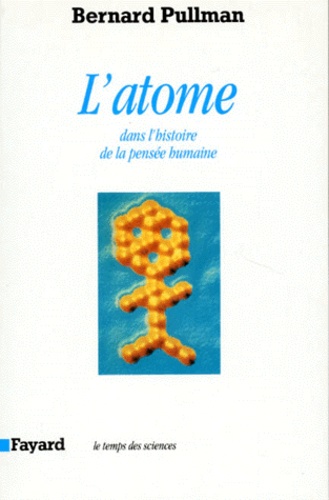
Histoire et Philosophiesophie
L'atome dans l'histoire de la pensée humaine
04/1995
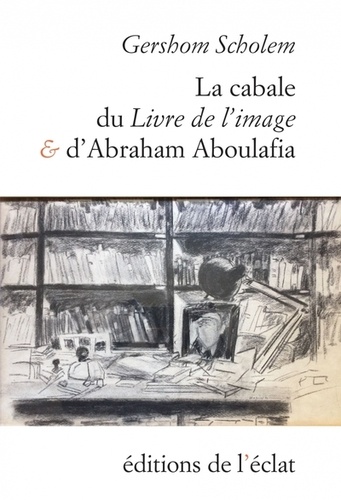
Religion
La cabale du Livre de l'Image et d'Abraham Aboulafia. Chapitres de l'Histoire de la Cabale en Espagne
11/2019
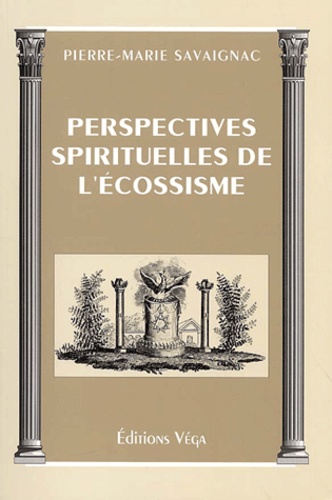
Esotérisme
Perspectives spirituelles de l'écossisme
05/2002
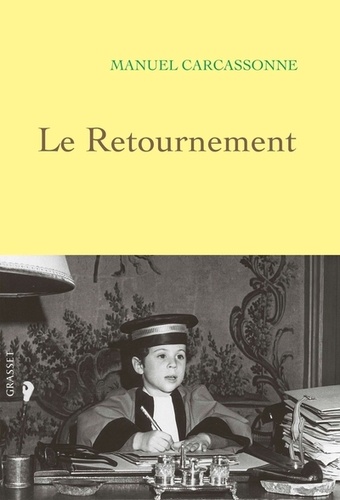
Littérature française
Le Retournement
01/2022
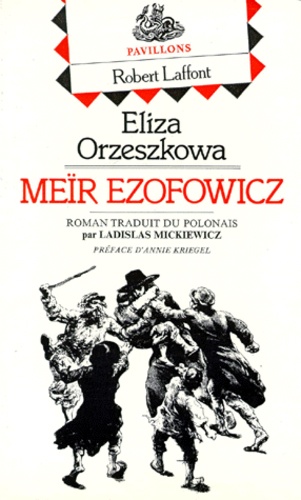
Littérature étrangère
Meïr Ezofowicz
11/1983
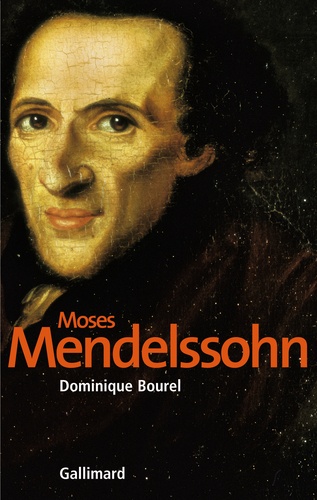
Religion
Moses Mendelssohn. La naissance du judaïsme moderne
05/2004

