romancière invitation SILQ
Extraits
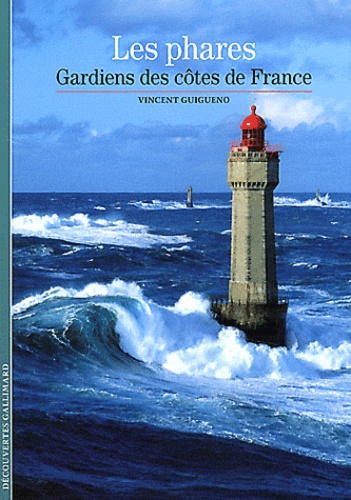
Encyclopédies de poche
Les phares. Gardiens des côtes de France
01/2012
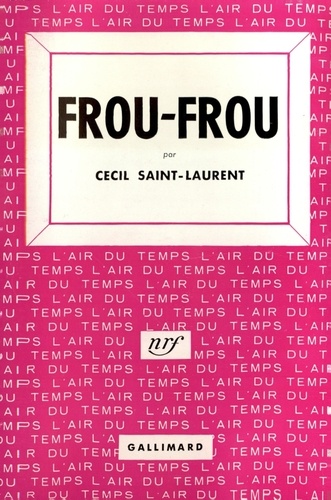
Littérature française
FROU-FROU
10/1955
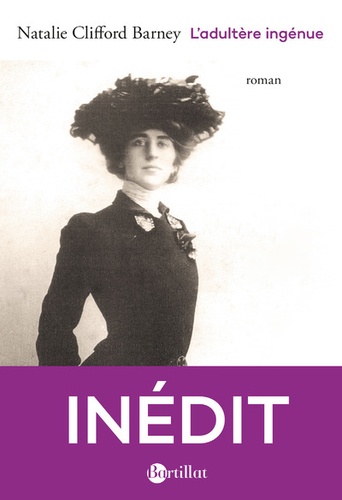
Littérature française
L'adultère ingénue
08/2022
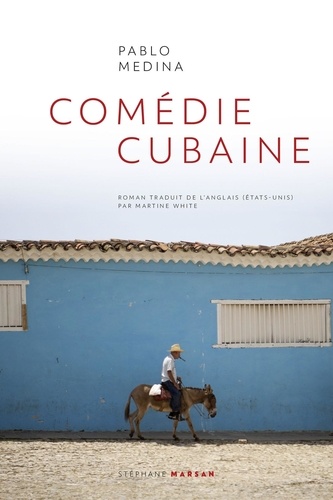
Littérature étrangère
Comédie cubaine
06/2020
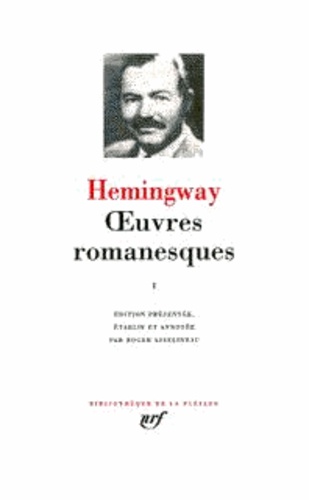
Pléiades
Oeuvres romanesques. Tome 1, Poèmes de guerre et d'après-guerre
01/1966
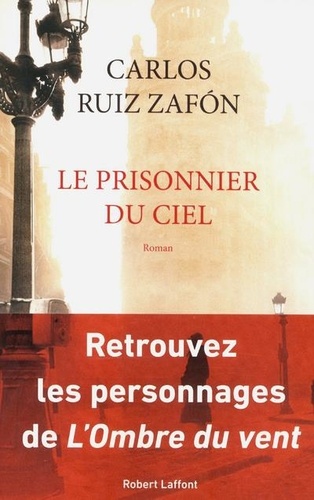
Littérature étrangère
Le prisonnier du ciel
11/2012
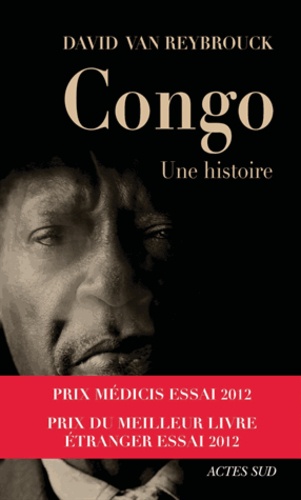
Histoire internationale
Congo, une histoire
09/2012
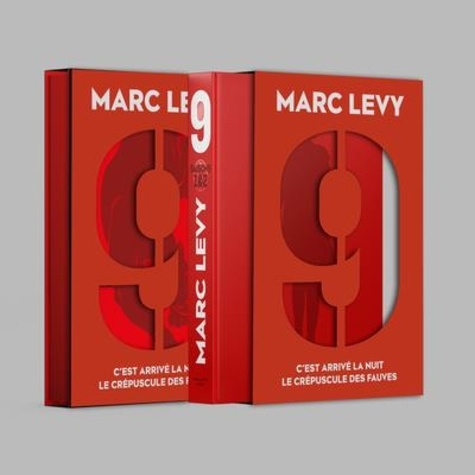
Littérature française
9 : Tome 1, C'est arrivé la nuit ; Tome 2, Le crépuscule des fauves
12/2021
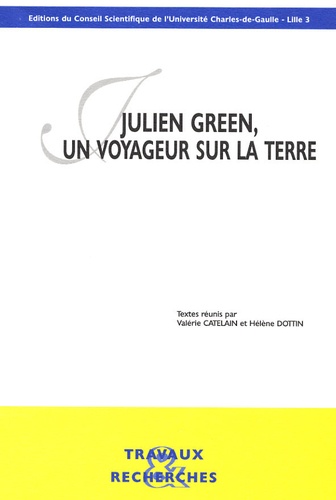
Critique littéraire
Julien Green un voyageur sur la terre
10/2006
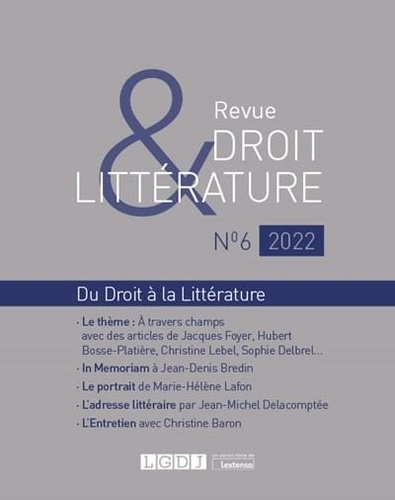
Revues de droit
Revue Droit & Littérature N° 6/2022
06/2022
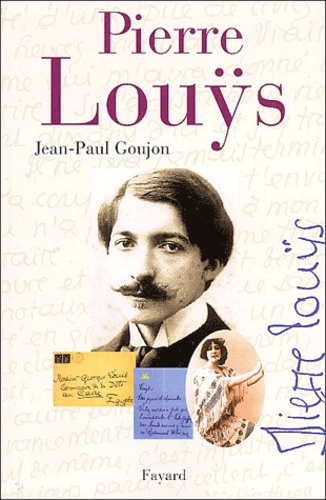
Critique littéraire
Pierre Louÿs. Une vie secrète (1870-1925)
05/2002
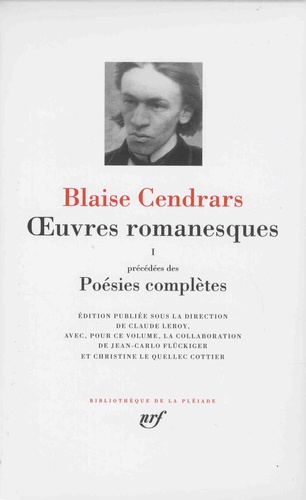
Pléiades
Oeuvres romanesques Tome 1. Précédées des Poésies complètes
11/2017
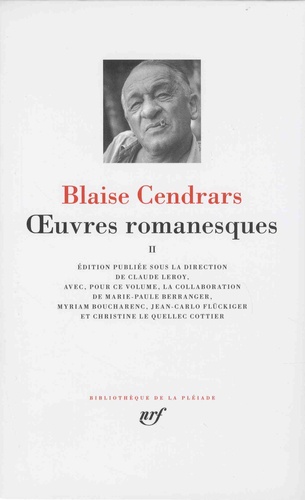
Pléiades
Oeuvres romanesques Tome 2
11/2017
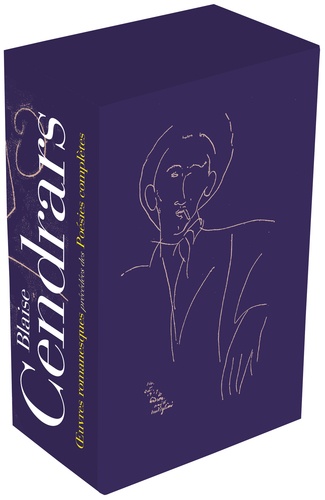
Pléiades
Oeuvres romanesques précédées des Poésies complètes. Coffret en 2 volumes
11/2017
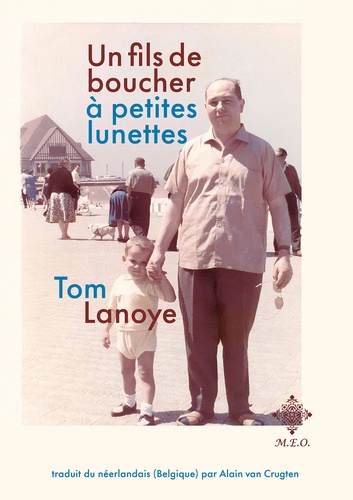
Littérature francophone
Un fils de boucher à petites lunettes
06/2024
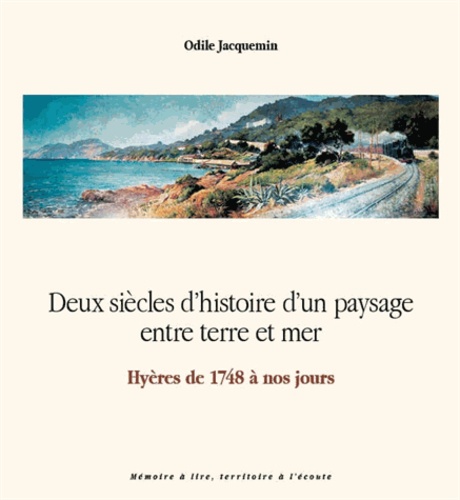
Sciences historiques
Deux siècles d'histoire d'un paysage entre terre et mer. Hyères de 1748 à nos jours
10/2010
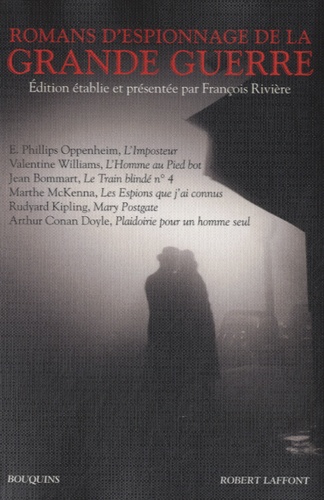
Policiers
Romans d'espionnage de la Grande Guerre
02/2014
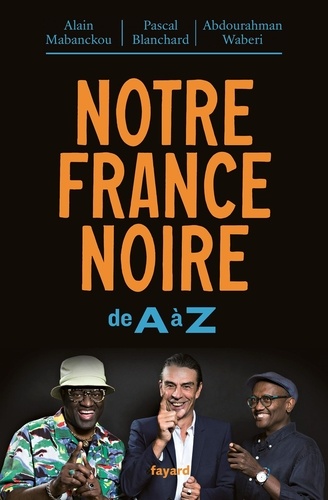
discriminations, exclusion, ra
Notre France noire. De A à Z
10/2023

Littérature française
Le cratère
09/1975
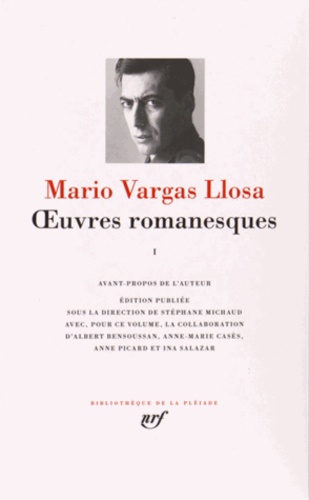
Pléiades
Oeuvres romanesques. Tome 1
03/2016
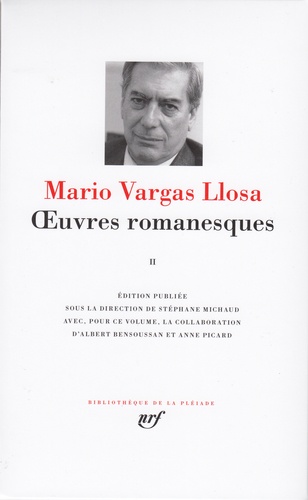
Pléiades
Oeuvres romanesques. Tome 2
03/2016
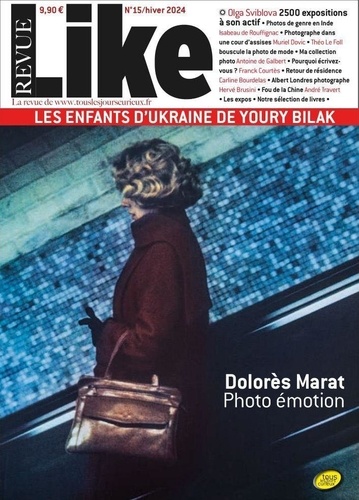
Histoire de la photographie
Like N° 15, hiver 2024 : Dolores Marat
02/2024
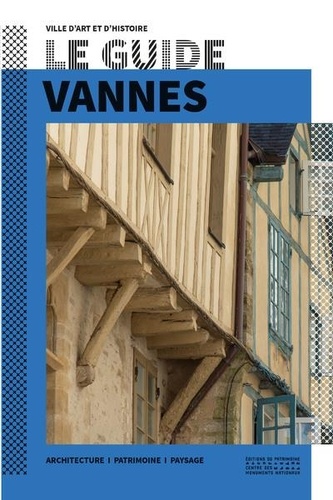
Bretagne
Vannes
11/2021

Cuisine
La pâtisserie en famille
10/2019
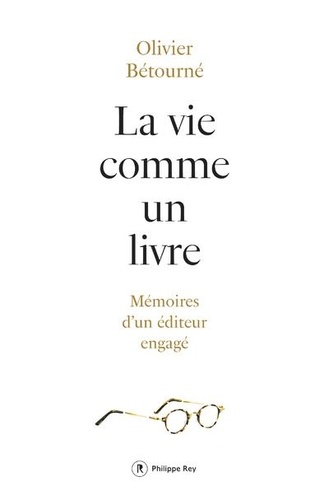
Littérature française
La vie comme un livre. Mémoires d'un éditeur engagé
09/2020
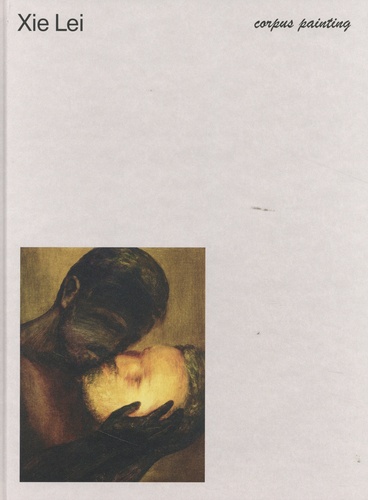
Monographies
Corpus Painting, Xie Lei
02/2023
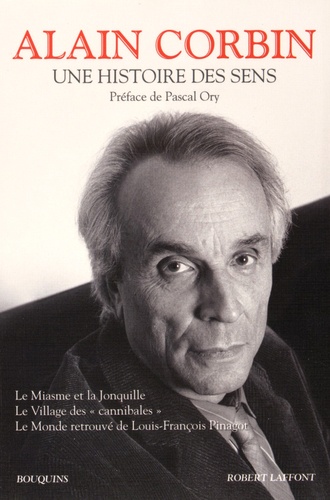
Sciences historiques
Une histoire des sens
01/2016
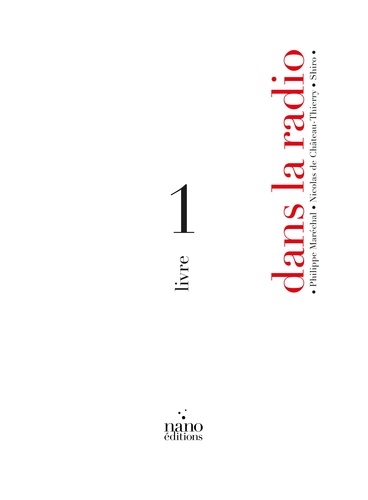
Littérature française
dans la radio. livre 1
03/2023
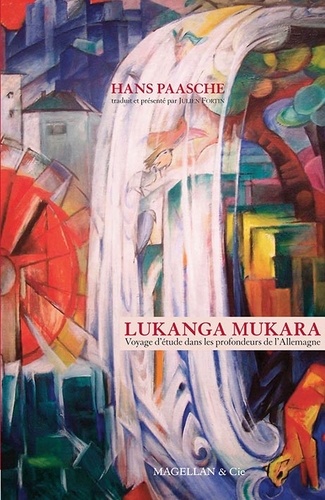
Récits de voyage
Lukanga Mukara. Voyage d'étude dans les profondeurs de l'Allemagne
09/2012
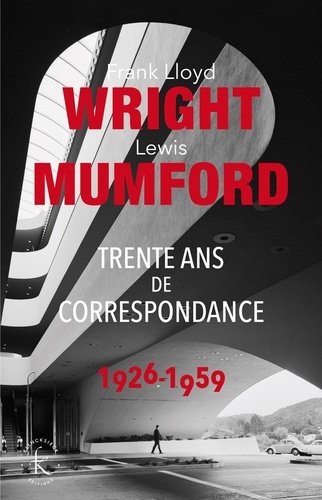
Beaux arts
Trente ans de correspondance 1926-1959
02/2017

