Philipus Education
Extraits
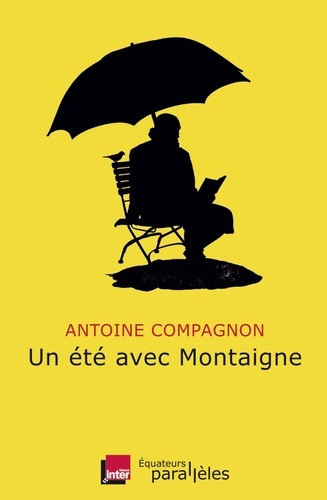
Philosophie
Un été avec Montaigne
05/2013
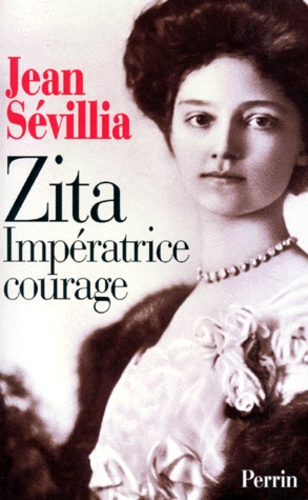
Histoire internationale
Zita, impératrice courage. 1892-1989
04/1997
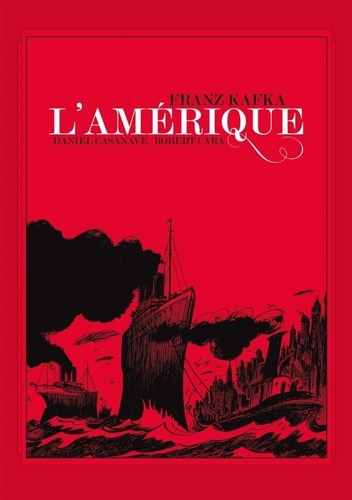
BD tout public
L'Amérique
05/2012
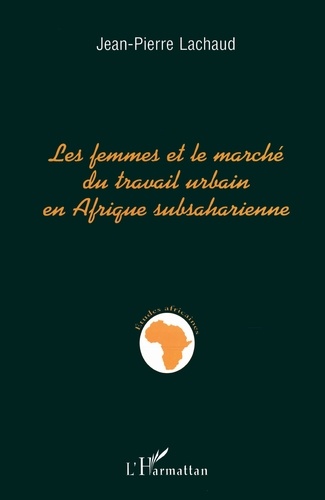
Ethnologie
Les femmes et le marché du travail urbain en Afrique subsaharienne
09/1997
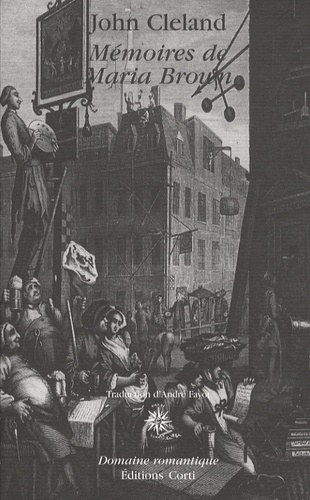
Littérature étrangère
Mémoires de Maria Brown
10/2013
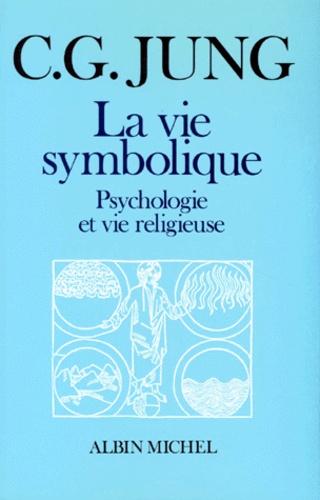
Psychologie, psychanalyse
VIE SYMBOLIQUE. Psychologie et vie religieuse
04/1990
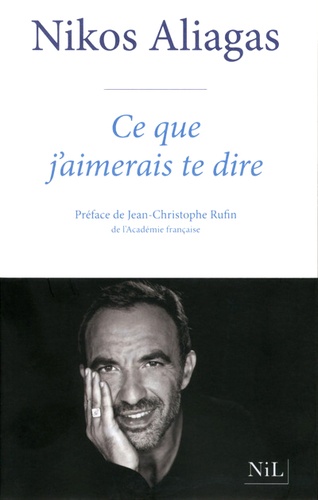
Cinéma
Ce que j'aimerais te dire
10/2014
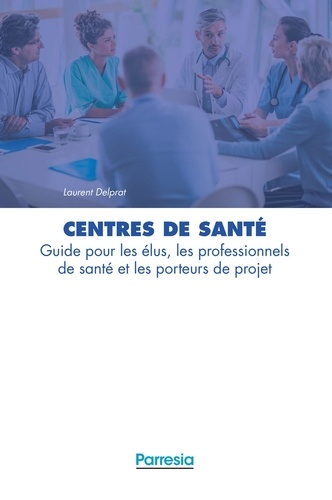
Spécialités médicales
Centres de santé. Guide pour les élus, les professionnels de santé et les porteurs de projet
11/2019
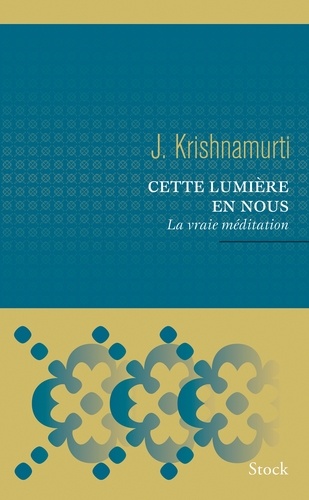
Religion
Cette lumière en nous. La vraie méditation
06/2014
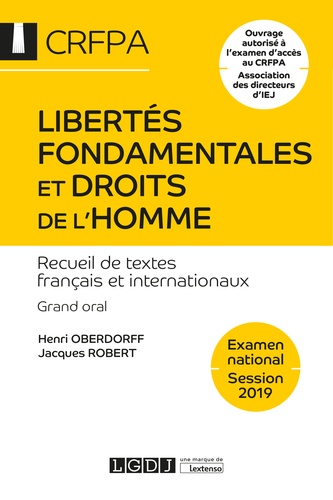
Droit
Libertés fondamentales et droits de l'homme. Recueil de textes français et internationaux, grand oral CRFPA, Edition 2019
06/2019
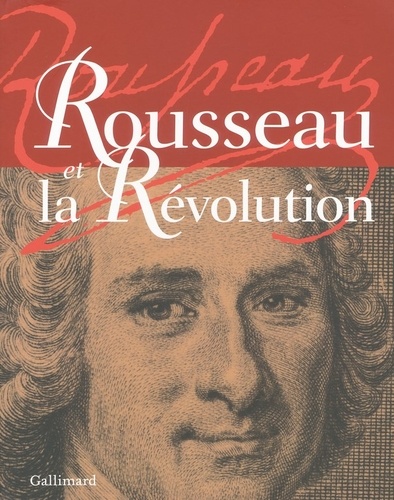
Philosophie
Rousseau et la Révolution
02/2012
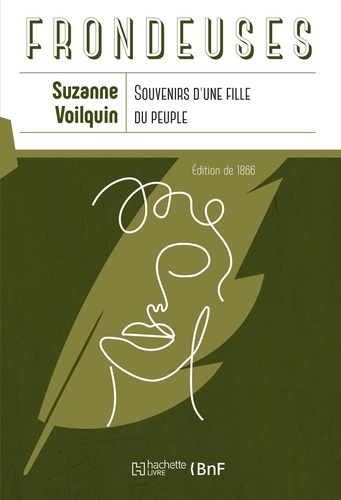
Littérature française
Souvenirs d'une fille du peuple, ou La Saint-Simonienne en Égypte, 1834-1836
09/2021
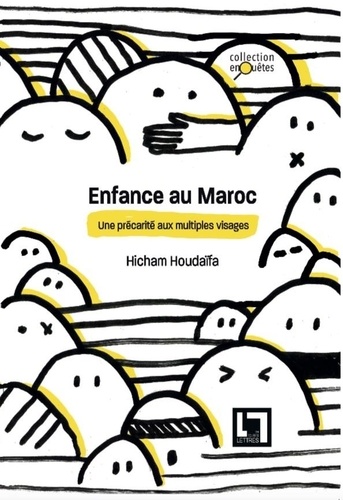
Sociologie
Enfance au Maroc, une précarité aux multiples visages
10/2020
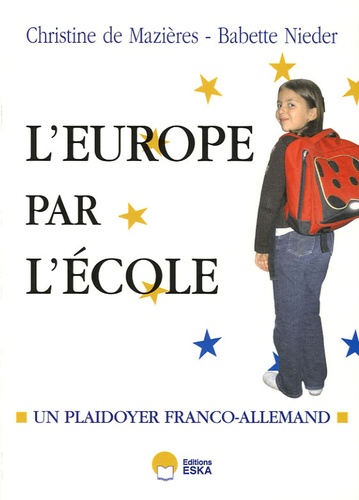
Pédagogie
Et si on recommençait l'Europe par l'école ? Plaidoyer franco-allemand
01/2006
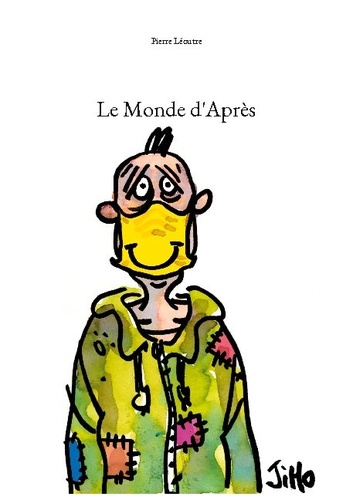
Actualité politique France
Le Monde d'Après
09/2021
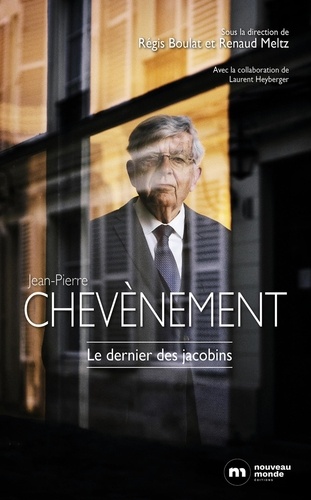
Actualité politique France
Jean-Pierre Chevènement. Le dernier des jacobins
11/2021
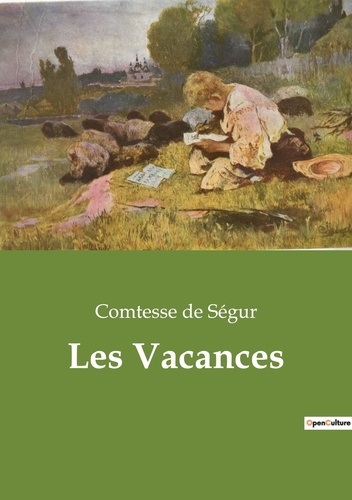
Romans historiques
Les Vacances
10/2022
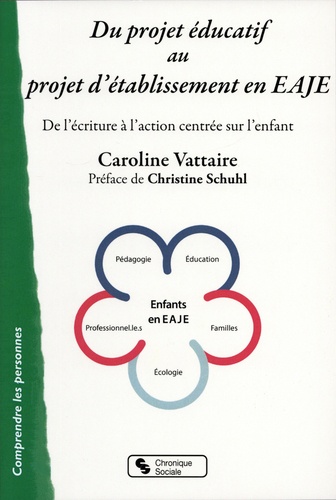
Pédagogie
Du projet éducatif au projet d'établissement en établissement d'accueil de jeunes enfants. De l'écriture à l'action centrée sur l'enfant
04/2023

Correspondance
Epistolaire, Revue de l'Aire N° 47/2021 : Le geste épistolaire
10/2021
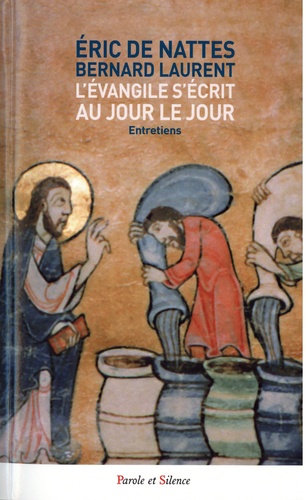
Exégèse
L'Evangile s'écrit au jour le jour. Entretiens
03/2023
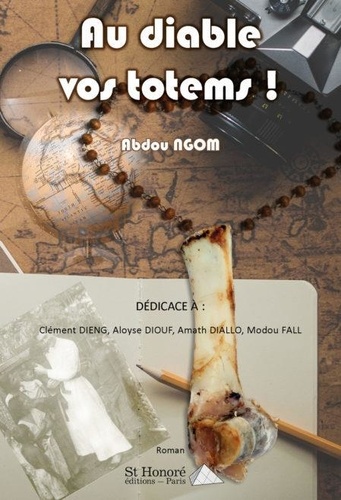
Littérature française
Au diable vos totems !
09/2020
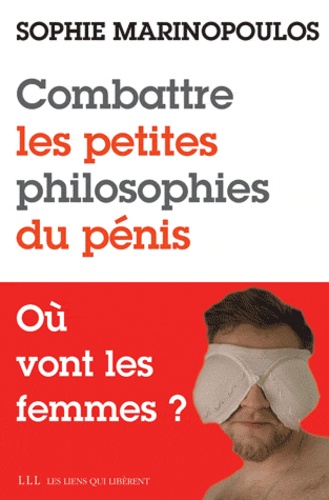
Psychologie, psychanalyse
Combattre les petites philosophies du pénis. Où vont les femmes ?
11/2011
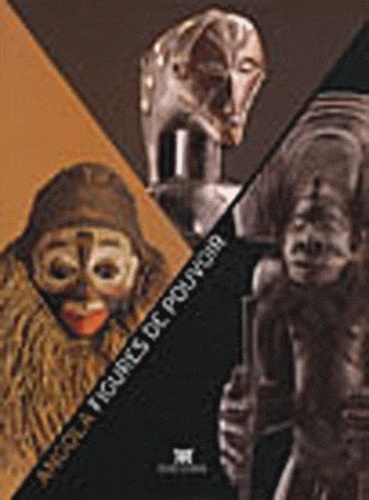
Beaux arts
Angola figures de pouvoir
10/2010
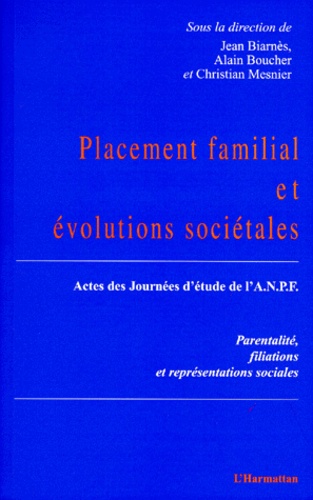
Droit
PLACEMENT FAMILIAL ET EVOLUTIONS SOCIETALES. Parentalité, filiations et représentations, Actes des journées d'étude de l'ANPF
10/1999
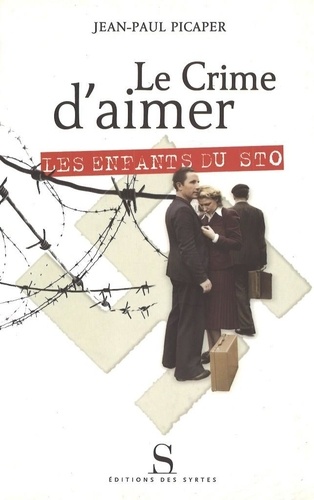
Histoire de France
Le crime d'aimer. Les enfants du STO
04/2005
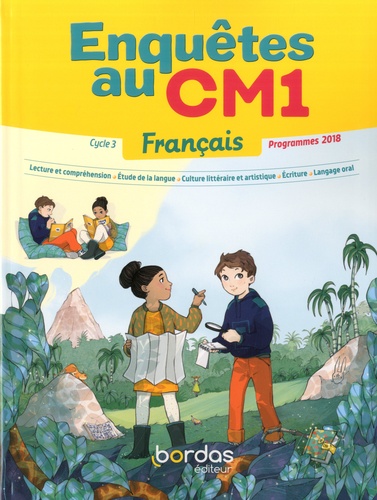
Enseignement primaire
Français Enquêtes au CM1. Edition 2019
02/2019
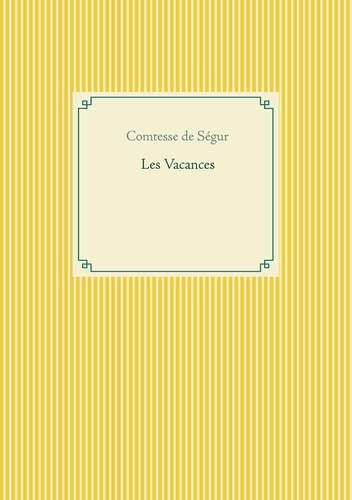
Autres collections (6 à 9 ans)
Les Vacances
04/2021
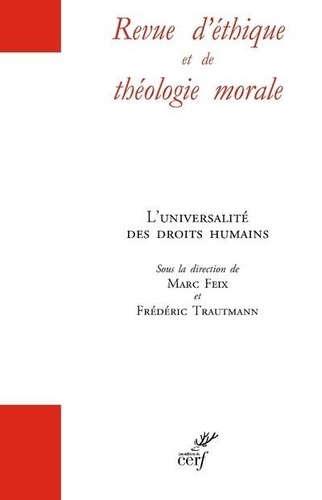
Ethique
Revue d'éthique et de théologie morale Hors-série, Août 2022
09/2022
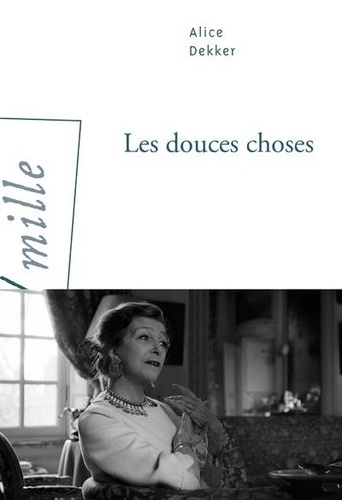
Littérature française
Les douces choses
04/2022

Pédagogie
Monsieur le proviseur
10/2020


