Librairie religieuse
Extraits
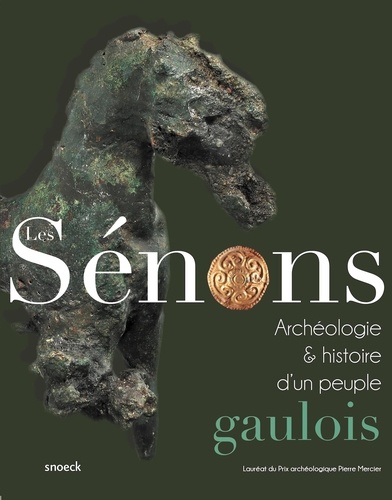
Histoire ancienne
Les Sénons. Archéologie et histoire d'un peuple gaulois
05/2018
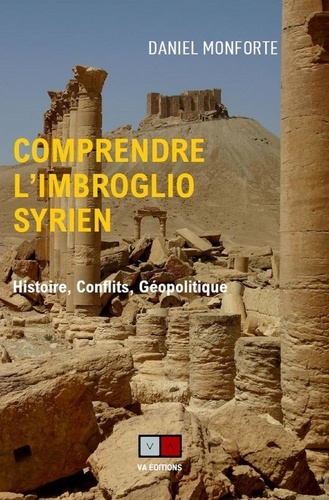
Syrie
Comprendre l'imbroglio syrien. Histoire, Conflits, Géopolitique
03/2023
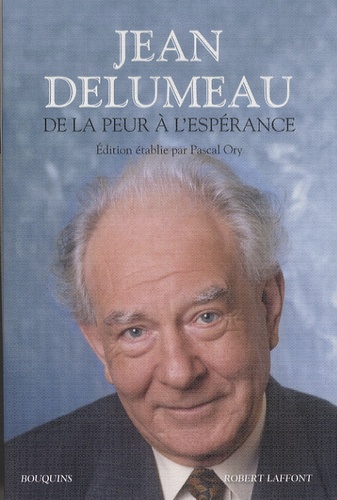
Sciences historiques
De la peur à l'espérance. Contient : La peur en Occident (XIVe-XVIIIe siècle) ; Guetter l'aurore ; Parcours, recherches, débats
10/2013
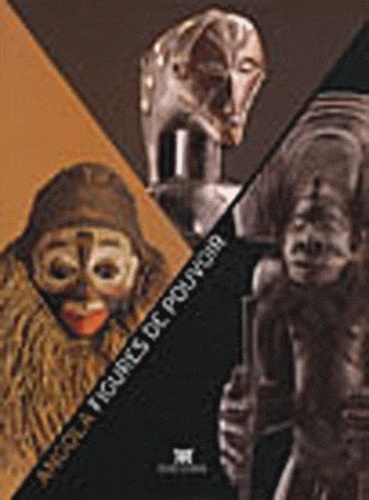
Beaux arts
Angola figures de pouvoir
10/2010
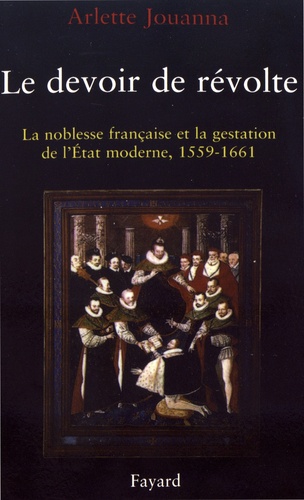
Histoire de France
Le devoir de révolte. La noblesse française et la gestation de l'Etat moderne (1559-1661)
02/1989
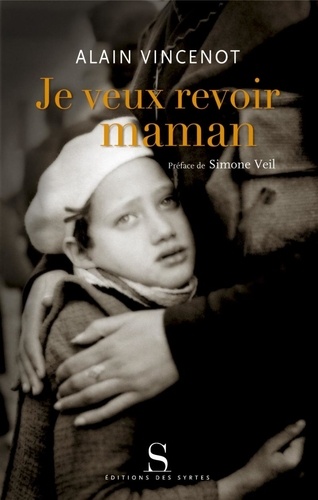
Histoire de France
Je veux revoir maman
01/2005
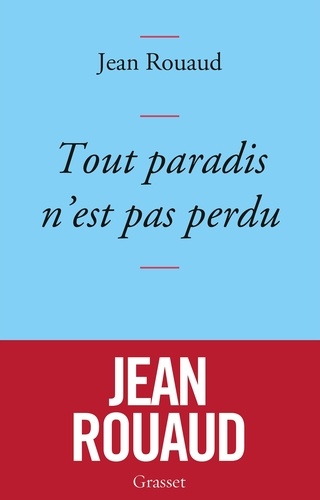
Littérature française
Tout paradis n'est pas perdu. Chronique de 2015 à la lumière de 1905
01/2016
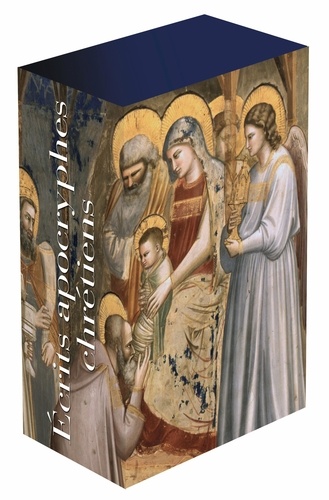
Pléiades
Ecrits apocryphes chrétiens. Coffret en 2 volumes : Tomes 1 et 2
10/2019
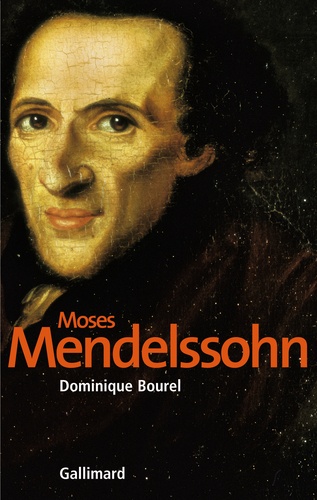
Religion
Moses Mendelssohn. La naissance du judaïsme moderne
05/2004
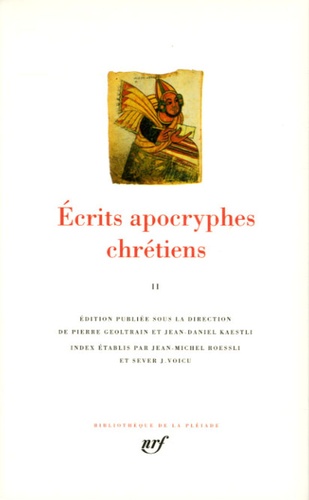
Pléiades
Ecrits apocryphes chrétiens. Tome 2
09/2005
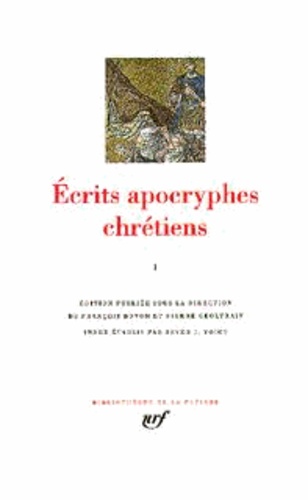
Pléiades
Ecrits apocryphes chrétiens. Tome 1
10/1997
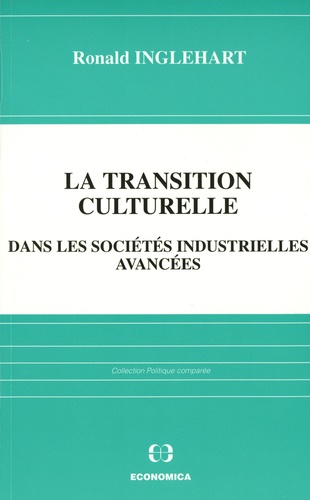
Sciences politiques
La transition culturelle dans les sociétés industrielles avancées
09/1993
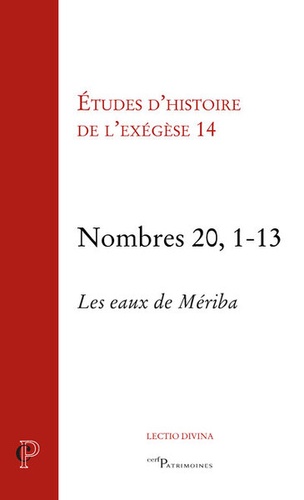
Religion
Nombres 20, 1-13. Les eaux de Mériba
02/2019
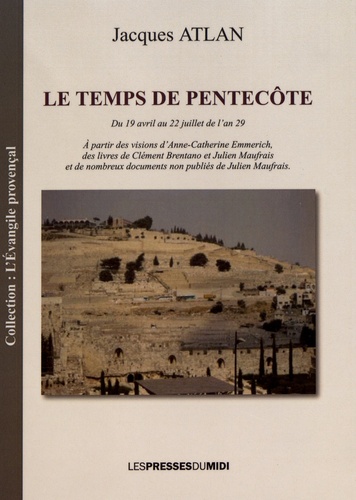
Religion
Le temps de Pentecôte. Du 19 avril au 22 juillet de l'an 29
04/2019
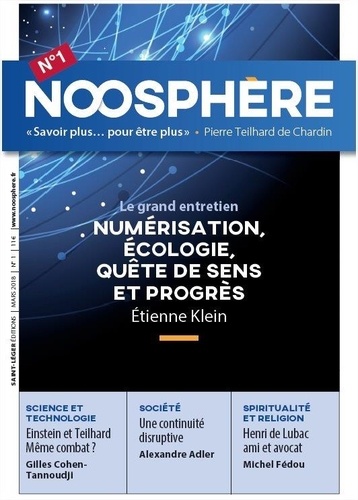
Religion
Noosphère
04/2018
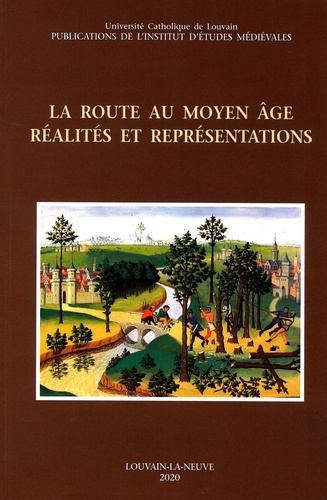
Ouvrages généraux et thématiqu
La route au Moyen Age. Réalités et représentations
03/2021
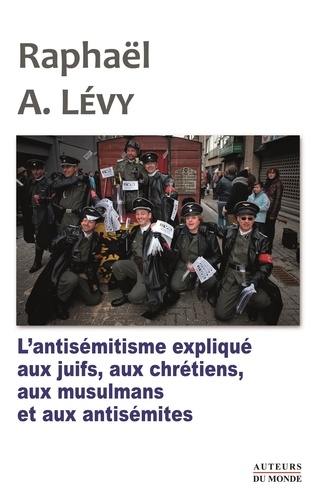
Violence
L'antisémitisme expliqué aux juifs, aux chrétiens, aux musulmans et aux antisémites
05/2022
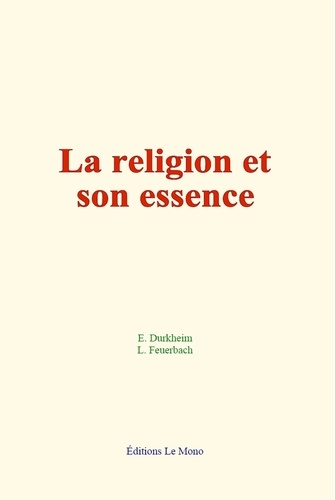
Histoire des religions
La religion et son essence
02/2023
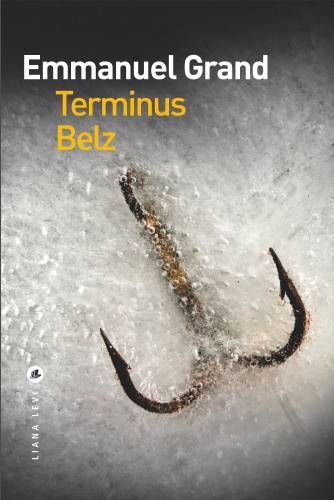
Policiers
Terminus Belz
01/2014
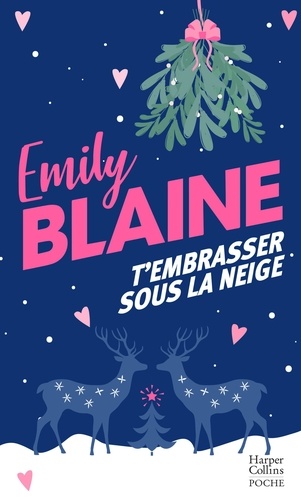
Roman d'amour, roman sentiment
T'embrasser sous la neige
10/2021
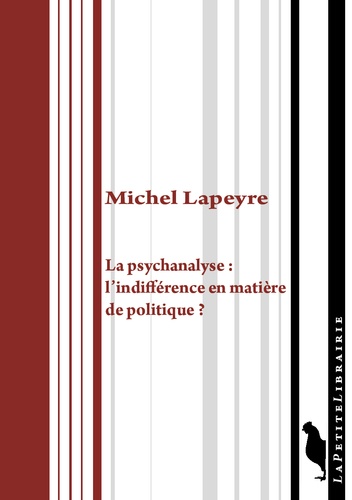
Essais
La psychanalyse : l'indifférence en matière de politique ?
11/2021

Histoire militaire
De la guerre N° 1, été 2021 : Hitler a-t-il eu une chance de l'emporter ?
06/2021
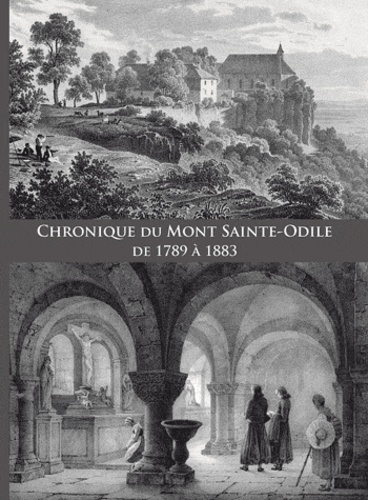
Sciences historiques
Chronique du Mont Sainte-Sainte Odile de 1789 à 1883
07/2011
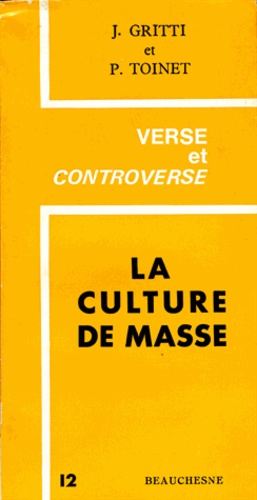
Sociologie
La culture de masse. Promesses et détresse
10/1969

Religion
La théologie de Saint Paul. 2 volumes
01/1961
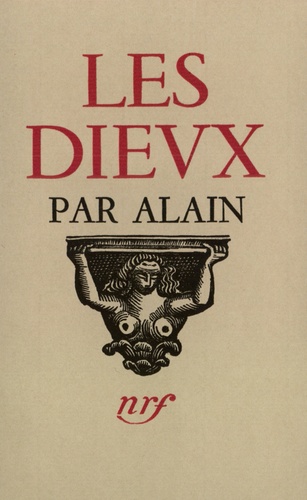
Autres philosophes
Les Dieux
04/1934
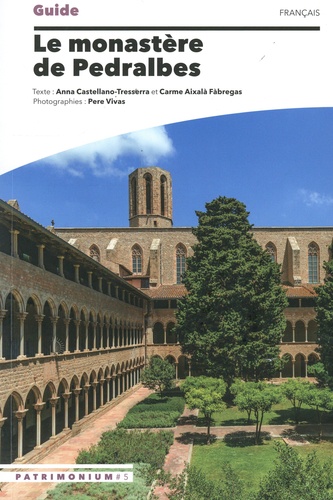
Grandes réalisations
Guide du monastère de Santa Maria de Pedralbes
03/2023
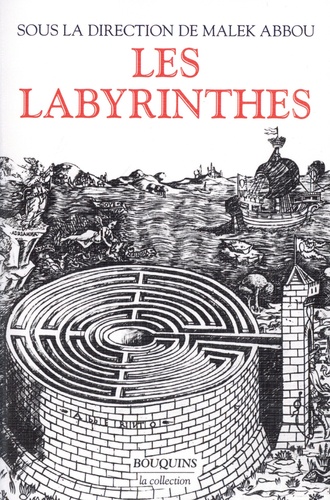
Histoire littéraire
Les Labyrinthes. Vingt mille ans de métamorphoses
09/2023
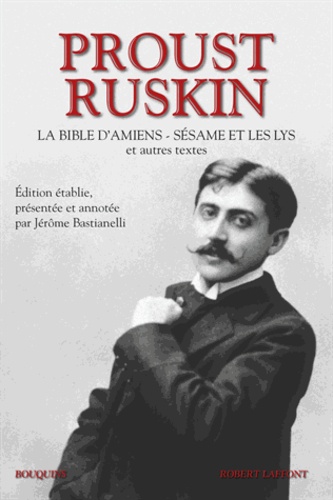
Critique littéraire
La Bible d'Amiens ; Sésame et les lys. Et autres textes
04/2015
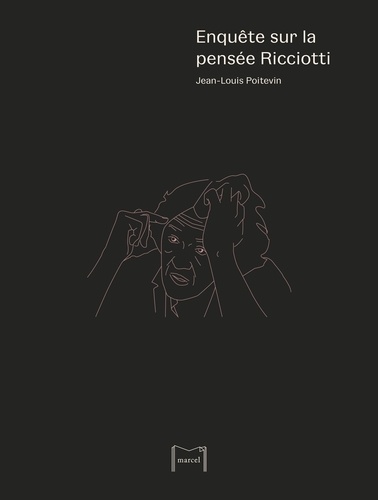
Architectes
Enquête sur la pensée Ricciotti
05/2021

