élections présidentielles
Extraits
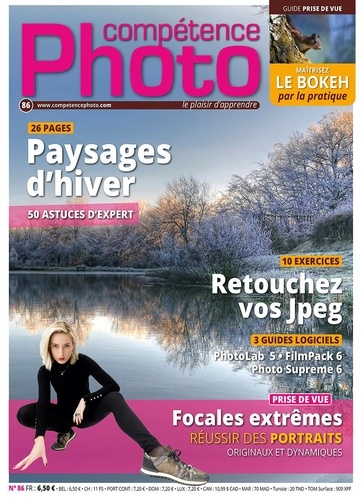
Techniques photo
Compétence Photo n°86 - Paysages d'hiver - 50 Astuces d'expert
03/2022
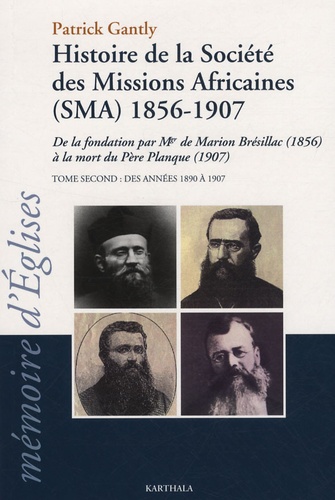
Religion
Histoire de la Société des Missions Africaines (SMA) 1856-1907. Tome 2 ; Des années 1890 à 1907, de la fondation par Mgr de Marion Brésillac (1856) à la mort du Père Planque (1907)
11/2010
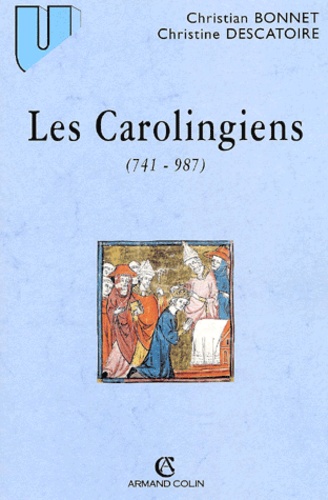
Histoire de France
Les Carolingiens (741-987)
05/2001
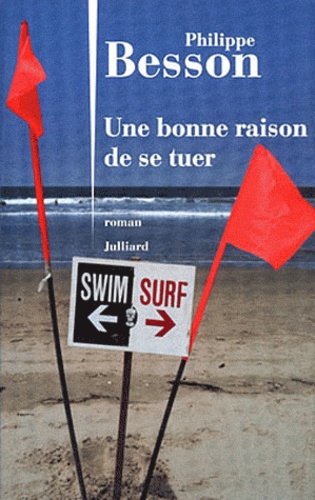
Littérature française
Une bonne raison de se tuer
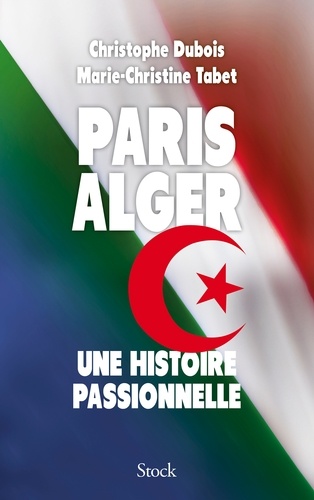
Sciences politiques
Paris-Alger. Une histoire passionnelle
04/2015
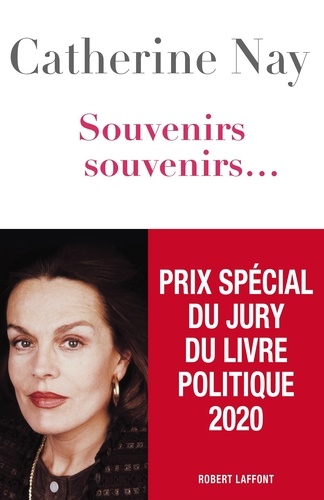
Actualité et médias
Souvenirs, souvenirs... Tome 1
11/2019
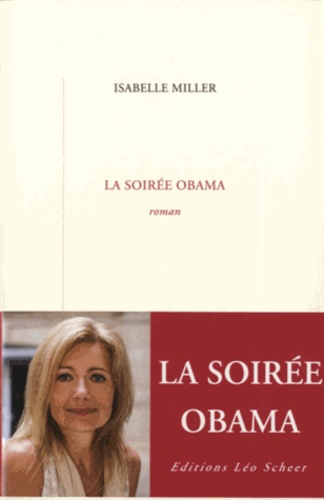
Littérature française
La soirée Obama
11/2012
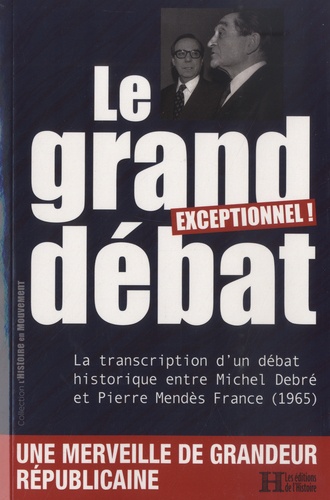
Histoire des idées politiques
Le grand débat. La transcription d'un débat historique entre Michel Debré et Pierre Mendès France (1965)
03/2022
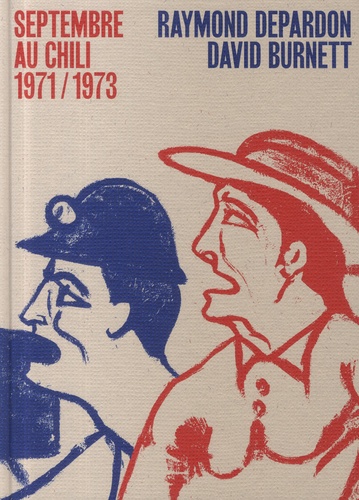
Thèmes photo
Septembre au Chili 1971/1973
09/2023
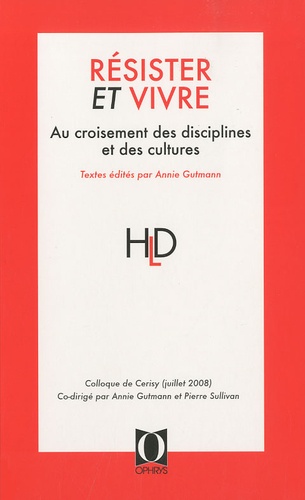
Sciences historiques
Résister et vivre. Au croisement des disciplines et des cultures
04/2010
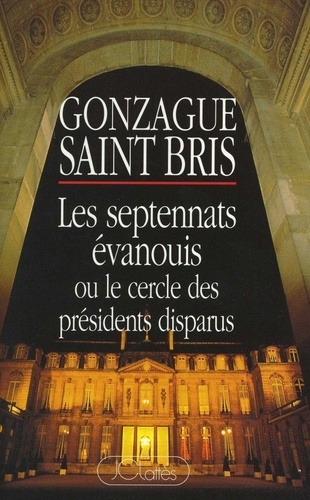
Histoire de France
Les septennats évanouis ou Le cercle des présidents disparus
12/1995
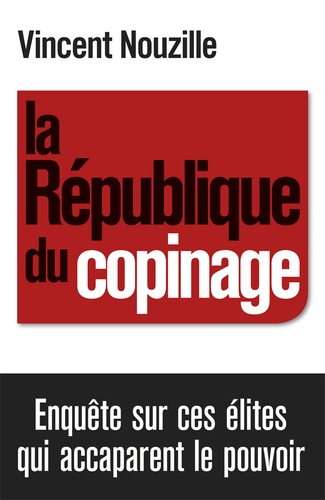
Faits de société
La République du copinage
10/2011
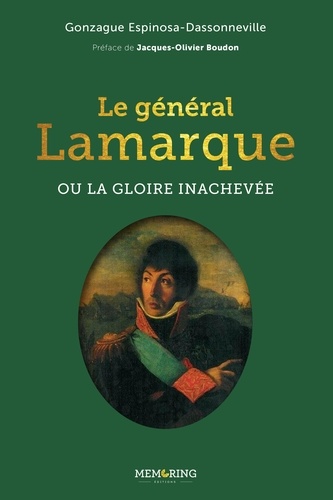
Ouvrages généraux et thématiqu
Le général Lamarque ou la gloire inachevée
06/2021
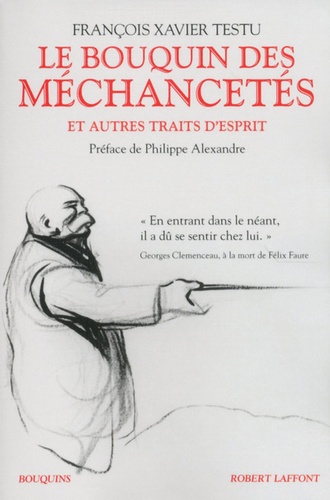
Humour
Le bouquin des méchancetés. Et autres traits d'esprit
11/2014
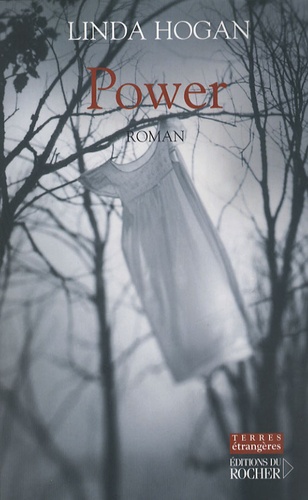
Littérature étrangère
Power
08/2006
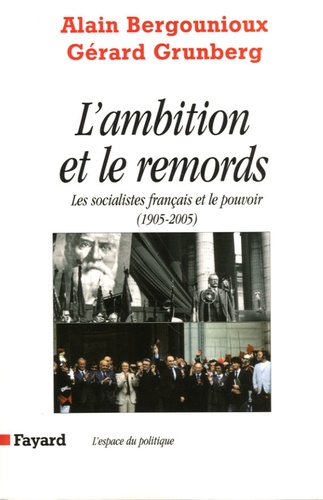
Histoire de France
L'ambition et le remords. Les socialistes français et le pouvoir (1905-2005)
10/2005
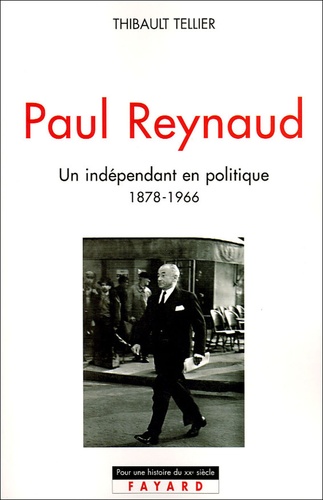
Histoire de France
Paul Reynaud (1878-1966). Un indépendant en politique
04/2005
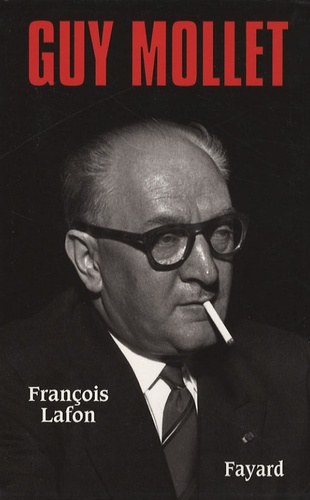
Histoire de France
Guy Mollet. Itinéraire d'un socialiste controversé (1905-1975)
10/2006
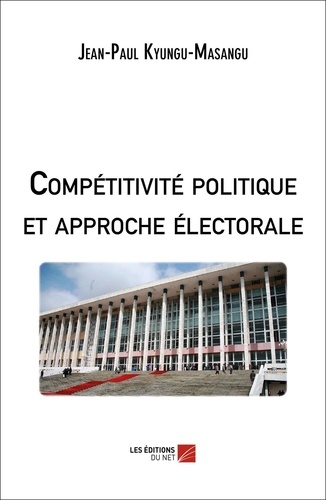
Sciences politiques
Compétitivité politique et approche électorale
05/2016
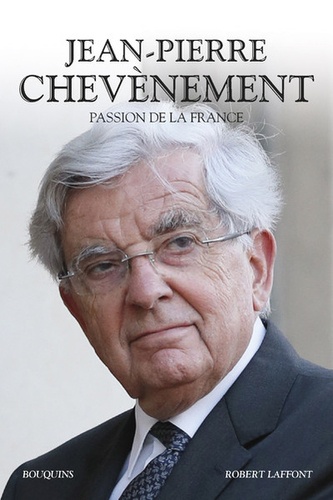
Sciences politiques
Passion de la France
02/2019
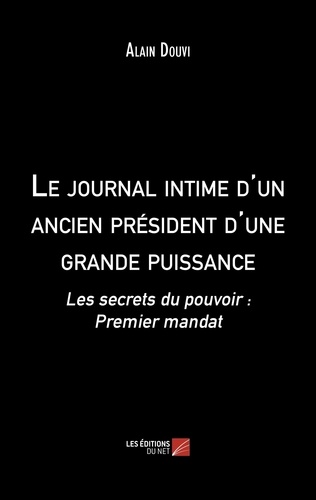
Littérature française
Le journal intime d'un ancien président d'une grande puissance. Les secrets du pouvoir : Premier mandat
05/2021
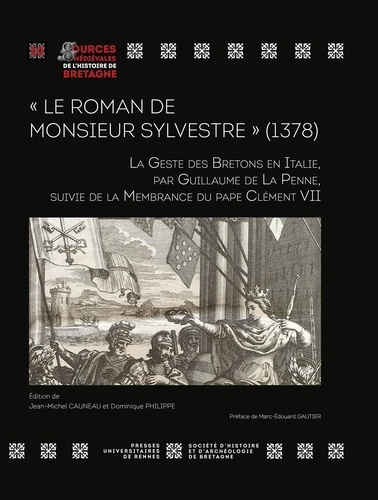
Ouvrages généraux et thématiqu
"Le Roman de Monsieur Sylvestre" (1378). La Geste des Bretons en Italie, par Guillaume de La Penne, suivi de la Membrance du pape Clément VII
02/2023
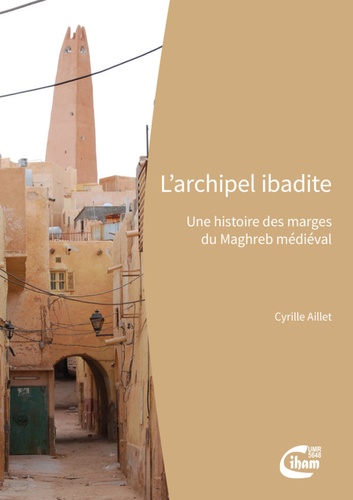
Ouvrages généraux
L'archipel ibadite. Une histoire des marges du Maghreb médiéval
02/2022
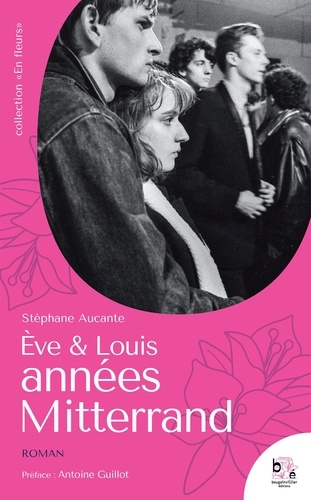
Littérature française
Ève et Louis, années Mitterrand
01/2024
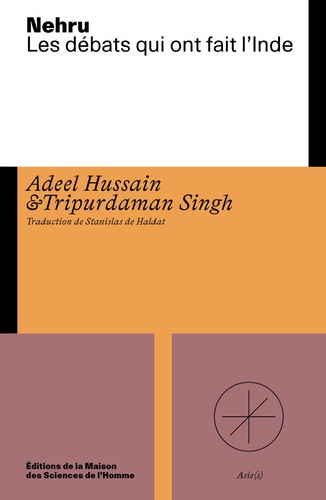
Sciences politiques
Nehru. Les débats qui ont fait l'Inde
04/2024
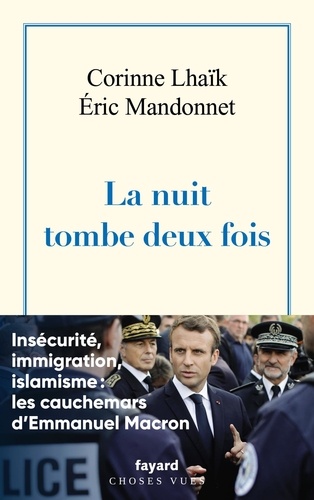
Actualité politique France
La nuit tombe deux fois
02/2022
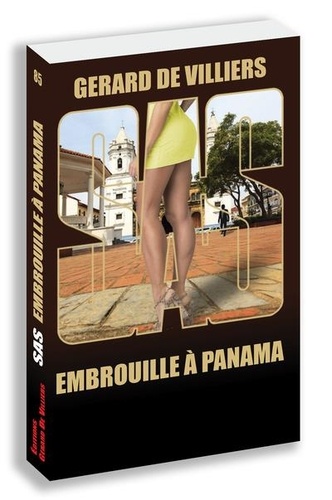
Policiers
Embrouilles à Panama
11/2020
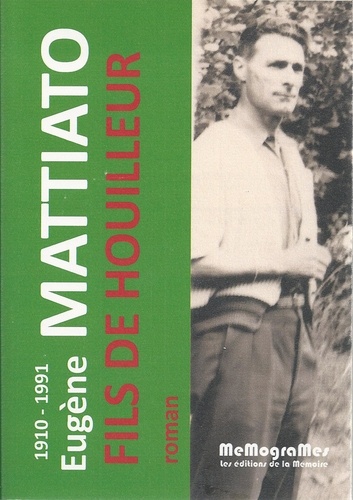
Littérature française
Fils de houilleur
09/2010
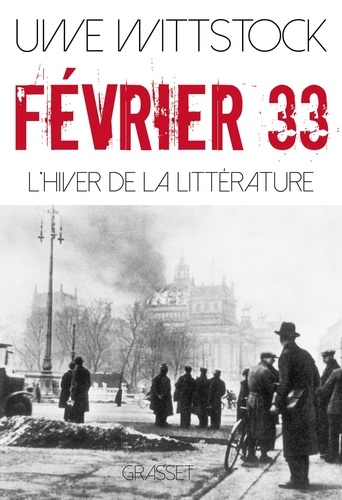
Allemagne
Février 33. L'hiver de la littérature
01/2023
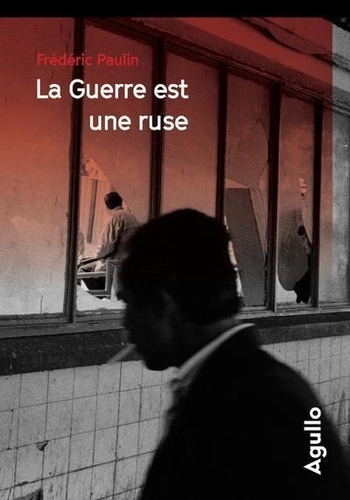
Romans policiers
La guerre est une ruse
09/2021

