Voyage de classes. Deux étudiants de Seine-Saint-Denis enquêtent dans les beaux quartiers
Nicolas Jounin
Editeur
Genre
Sociologie
1
Partages
Introduction
20 septembre 2011. Dans un vaste couloir de la mairie du 8e arrondissement de Paris, j’attends. Le couloir fait l’équivalent de trois ou quatre pistes de bowling, mais la moquette rouge au sol, les ciselures dorées, les plafonds ouvragés créent une tout autre ambiance. À un bout, une sorte d’huissier, assis derrière un bureau solitaire, reçoit les visiteurs. Il m’a demandé de patienter, et j’ai donc pris place sur un côté, assis sur une chaise que je qualifie intérieurement de « Louis quelque chose », faute de mieux. En fait, ce serait plutôt du Napoléon III. Je ressens la nécessité d’être capable de décrire ce décor avec minutie, d’aller au-delà des mots convenus qui me viennent – c’est classe, riche, chargé, baroque, rococo… –, et dont je sens qu’ils sont trop vagues, peut-être même faux, inaptes à décrire une telle pièce et l’effet qu’elle produit.
La mairie du 8e arrondissement de Paris occupe un ancien hôtel particulier qu’un capitaliste enrichi, Jean-François Cail, se fit construire sous le Second Empire (1852-1870). Actif dans la métallurgie et les chemins de fer, cet homme engagea également ses capitaux dans la production sucrière aux Antilles. Dans son ancienne demeure, on dirait que le moindre centimètre carré a été conçu pour aguicher. Comme si, dans cette période de folle accumulation protégée par la dictature impériale, le trop-plein de capitaux1 approprié par une poignée d’individus devait s’écouler dans une surproduction de moulures.
Dans ce monument exubérant, où le luxe tient autant aux grands vides de l’espace qu’aux petits détails des ornements, il y a pourtant un accroc. Dans une ancienne salle à manger singulièrement sombre, que peinent à égayer des peintures de scènes de chasse, un trou dans un mur. C’est une balle qui est passée par là, le 22 mai 1871 à deux heures de l’après-midi si l’on en croit l’inscription qui souligne sa présence. C’est-à-dire pendant les derniers jours de la Commune de Paris, ce moment suspendu que Karl Marx avait qualifié de « reprise par le peuple et pour le peuple de sa propre vie sociale ». Ce même 22 mai, le propriétaire de l’hôtel particulier, Jean-François Cail, décédait, mais c’est pure coïncidence, car il s’éteignit bien loin du tumulte parisien. Les troupes « versaillaises » avaient déjà commencé à mater l’insurrection qui depuis quelques mois faisait de la capitale un îlot. Elles entrèrent dans Paris par l’Ouest bourgeois, qui leur était acquis, avant de s’attaquer au Nord et à l’Est populaires. Quelques jours après que cette balle – tirée par qui ? – eut troué un auguste salon de l’hôtel particulier, la Commune de Paris était écrasée dans un bain de sang. L’armée soulagée retrouvait les coudées franches pour réprimer dans la foulée le mouvement de révolte qui secouait l’Algérie colonisée ; pendant ce temps, les condamnations pleuvaient sur les insurgés de Martinique – île dont dépendait en partie la fortune de Jean-François Cail –, qui avaient, juste après la chute de l’Empire, manifesté leur soif d’égalité à leurs anciens propriétaires esclavagistes3. Il faut faire parler les murs ; ils ont tant à dire d’une histoire indissociablement urbaine, sociale et coloniale.
C’est entre ces murs que j’attends, donc, de rencontrer M. Lejoly, maire du 8e arrondissement. Pour ce rendez-vous, j’ai un peu potassé. Lu les livres de Michel Pinçon et Monique Pinçon-Charlot, les célèbres spécialistes des quartiers bourgeois. On devine qu’ils ont rencontré plusieurs fois cet homme qui, maire du cru depuis bientôt trente ans, s’est battu contre ce qu’ils décrivent, le grignotage des résidences bourgeoises par les bureaux et les entreprises de luxe. J’ai lu également sa notice Wikipédia, et sa fiche du Who’s who à six euros. Sans destin national, ce maire de droite chaque fois réélu, y compris en 2008 lorsque la direction de l’UMP ne le soutient plus, n’est guère connu du grand public que pour avoir marié Nicolas Sarkozy et Carla Bruni. Un an après notre rendez-vous, il se rendra un peu plus célèbre en critiquant le « mariage pour tous » en ces termes : « Pourquoi interdire plus avant les mariages consanguins, la pédophilie, l’inceste qui sont encore monnaie courante dans le monde ? » peut-on lire dans son éditorial du journal municipal. Aux élections municipales de 2014, il passera la main après trente et un ans comme maire.
Je lui ai envoyé un mail à la fin du mois d’août 2011, lui présentant mon projet : faire étudier un quartier du 8e arrondissement à quelques dizaines d’étudiants de l’université de Saint-Denis, où je travaille comme enseignant de sociologie. C’est-à-dire les y amener régulièrement, leur demander d’y faire des observations, d’y administrer des questionnaires, d’en interviewer des habitants, des commerçants, des travailleurs, et pourquoi pas le maire lui-même. Un collaborateur de M. Lejoly m’a très vite répondu en fixant le rendez-vous d’aujourd’hui.
C’est accompagné de son directeur de cabinet que M. Lejoly me reçoit, dans un bureau tout aussi vaste et paré que les autres pièces de la mairie. Il tient en mains une version imprimée de mon message. D’entrée, la voix grave et le ton bourru, il interroge : pourquoi cet intérêt pour le 8e arrondissement ? Est-ce que j’aurais l’ambition de faire comme les Pinçon-Charlot ? Sa moue me laisse imaginer qu’il ne pense pas que du bien du couple de sociologues. Petit malaise de mon côté. J’ai l’habitude de répondre à des interlocuteurs suspicieux, voire hostiles à la démarche sociologique ; pas de souci sur ce point. Le malaise vient plutôt, soudainement, de mes mains dont je me demande où les mettre, de mes jambes qui hésitent à se croiser, de tous les points de contact entre mon corps et le costume que je porte.
Car j’ai choisi de porter un costume pour ce rendez-vous. Sombre, neutre, bon marché, le seul dont je disposais. En sortant de chez moi, j’ai surmonté l’impression erronée que tout le monde me regardait et j’ai oublié peu à peu ce que je ressens comme un accoutrement. Mais, dans le métro, la lecture du Voyage en grande bourgeoisie des Pinçon-Charlot m’a replongé dans le problème4. Je lisais ce passage paradoxal où les deux sociologues conseillent d’adapter son habillement au milieu bourgeois étudié, tout en soulignant que c’est une mission impossible. Quand bien même on finirait par comprendre quels sont les bons habits, les bonnes adresses et les bons codes, quand bien même le porte-monnaie suivrait, on ne saurait pas comment se tenir dedans, disent-ils en substance.
Et là, je me tiens face à deux hommes mûrs qui arborent des costumes dont je suppose qu’ils sont bien choisis et bien portés – mais qui sait, peut-être les prend-on dans leur milieu pour le comble du mauvais goût ? Mon propre costume m’apparaît plus que jamais comme un corps étranger qui pique. Je ne suis pas sûr d’être convaincu par le raisonnement des Pinçon-Charlot, par la bonne volonté vestimentaire qu’ils recommandent quand on va discuter avec des puissants. N’empêche, j’ai joué ce jeu. Et me voici en face d’un puissant relatif qui a lu les Pinçon-Charlot, et me toise de haut en bas… J’évacue le vertige de cette mise en abîme en m’engouffrant dans le baratin que j’ai préparé.
Je m’explique donc, en ramenant la démarche à sa juste proportion. Il ne s’agit pas d’une véritable investigation – rien de comparable aux Pinçon-Charlot –, mais d’initier de tout jeunes étudiants de première année aux techniques de la recherche par l’étude d’un quartier. Pourquoi dans le 8e précisément ? La proximité : moyennant une dizaine de stations de métro, la ligne 13 qui a pour terminus notre université nous dépose en plein cœur de l’arrondissement. Je reste discret sur l’exotisme que je viens chercher au bout de ces dix malheureuses stations. La distance sociale que nous traverserions se déplie dans les sous-sols implicites de notre discussion, sans jamais émerger.
J’ajoute que je souhaitais le rencontrer avant de commencer pour voir s’il aurait des interlocuteurs à suggérer, si lui-même serait disposé à répondre à un entretien. Et aussi, avant tout, pour lui signaler notre présence. M. Lejoly et son directeur de cabinet acquiescent : c’est mieux qu’ils aient connaissance de ce débarquement d’étudiants, des fois que des choses remontent à leurs oreilles. Là encore, je suis mal à l’aise. Ils ne m’ont pas adoubé, puisque je ne l’ai pas demandé. Mais pourquoi vais-je signaler notre présence à une autorité, si ce n’est pour solliciter implicitement une autorisation ? J’avais hésité avant d’entreprendre cette démarche. Après tout, la ville est à tous et le 8e n’est à personne, pas même à son maire. Pourtant, un mélange d’anxiété et de timidité m’a poussé à passer par cette étape : annoncer officiellement notre venue. Tant pis, c’est fait.
Je n’ai pas gagné grand-chose à cette présentation déférente. Peu de suggestions, aucune facilité donnée. Le maire me fait un tableau des évolutions de son arrondissement, de la lutte concertée avec la police contre « toute l’Europe mendiante » qui déferlerait autour des Champs-Élysées, des errements « absurdes » et « provocateurs » de la municipalité socialiste qui impose des logements sociaux – est-ce bien rendre service à leurs occupants, questionne-t-il, alors que l’épicerie la plus proche s’appelle Hédiard, où le paquet de biscuits coûte une quinzaine d’euros ? Mais il donne peu de pistes concrètes – « Vous pourriez interviewer les vrais-faux mendiants qui vous diraient que c’est plus rentable ici qu’à Crimée [dans le 19e arrondissement] » –, et aucun contact.
En revanche, il craint la manière dont nous prendrons langue avec ses administrés. C’est dit sous couvert de sollicitude à l’égard des étudiants : « Ça risque d’être difficile pour eux. » Surtout, qu’ils n’aillent pas directement dans les immeubles, ils risqueraient de se faire « tirer dessus ». C’est une plaisanterie, mais elle est répétée plusieurs fois. M. Lejoly ajoute que « les concierges et gardiens sont bien entraînés à mettre dehors les intrus ». Je le rassure : nous passerons par des intermédiaires. Nous trouverons nos « fixeurs », comme disent les journalistes de ceux qui les introduisent dans des pays en guerre… et en banlieue5.
Je ressors du rendez-vous avec le sentiment d’un devoir ambigu accompli. Du moins le maire est-il prévenu pour cette première édition. Les deux années suivantes, je reviendrai dans le 8e arrondissement avec d’autres étudiants en m’exemptant d’une nouvelle rencontre. Ce mélange de cordialité et de déstabilisation dans l’échange, c’est au tour des étudiants de le vivre ; c’est là-dessus qu’il va falloir travailler ensemble.
Objectif : prendre à contresens la voie ordinaire de la curiosité institutionnelle. Des grandes « enquêtes sociales » du XIXe siècle jusqu’à aujourd’hui, il n’y a pas plus enquêté que les pauvres. Des disciplines entières, dont la sociologie, se sont construites autour de leur auscultation, qu’elle soit méprisante ou solidaire, compassionnelle ou indignée. Nombre de professions productrices d’enquêtes et de rapports, des policiers jusqu’aux travailleurs sociaux, les ont pour principale clientèle. Qu’ils donnent leur consentement ou qu’ils y soient contraints, les membres des classes populaires sont rarement célèbres et pourtant sous le feu de multiples projecteurs.
Il n’y a pourtant pas de pauvres sans riches. Prétendre étudier la société en s’attachant aux uns et en oubliant les autres, c’est comme effacer un continent d’un planisphère, c’est se rendre borgne.
En France, les rares recherches sur les riches, l’élite, la bourgeoisie, sont le fait de chercheurs confirmés et appointés. Comme si cet objet était trop gros, ou trop beau, pour les apprentis qui font leurs premières armes. Comme si cette population était trop cuirassée de mérites et d’honneurs pour être accessible aux novices.
Dans le même temps, les textes et manuels qui s’adressent aux apprentis enquêteurs imaginent plutôt pour eux des situations asymétriques dont ils seraient les dominants. Le texte de Pierre Bourdieu concluant La Misère du monde, si souvent cité, n’envisage que des situations où « l’enquêteur occupe une position supérieure à l’enquêté dans la hiérarchie des différentes espèces de capital, du capital culturel notamment », et où il lui revient donc de « réduire au maximum la violence symbolique » qu’il exercerait6 – et non celle qu’il subirait. L’incontournable Guide de l’enquête de terrain7 de Stéphane Beaud et Florence Weber, à la fois recueil de conseils et bilan d’expériences de recherche d’étudiants de l’École normale supérieure de Paris dans des petites villes de province, évoque peu ce problème.
Pourtant, ne serait-ce que par leur âge, par leur statut d’être social en devenir, pas encore investi d’une place, les apprentis chercheurs sont rarement dans une position dominante. Pour peu qu’il s’agisse également de femmes, d’origine populaire, non blanches, étudiant dans une université de banlieue, c’est-à-dire appartenant à des catégories symboliquement dévalorisées et voyant matériellement leurs opportunités réduites ; pour peu que les personnes enquêtées soient l’envers d’un tel profil, hommes blancs, mûrs, intégrés aux sommets de la société, représentants d’une bourgeoisie, voire d’une aristocratie séculaires ; alors l’écart qu’il faut réduire n’est pas favorable à celles et ceux qui mènent l’enquête.
C’est à un tel grand écart que se consacre ce livre, à partir d’une expérience pédagogique menée à l’université Paris-8 Saint-Denis : j’ai conduit trois promotions d’étudiants de première année de sociologie, entre 2011 et 2013, à étudier trois quartiers du 8e arrondissement de Paris où se concentre la haute bourgeoisie (Triangle d’or au sud des Champs-Élysées, Monceau et Élysées-Madeleine au nord). Une demi-heure de transports en commun sépare les quartiers parmi les plus pauvres de la France de ses zones les plus riches. Là d’où nous venons, c’est la « banlieue ». Le terme a depuis longtemps quitté son sens initial, géographique et administratif (le territoire voisin d’une ville demeurant sous sa dépendance), qui désignerait strictement dans le cas de Paris les communes au-delà des limites des vingt arrondissements dessinées en 1860. La « banlieue » s’est muée en « métaphore permettant de circonscrire et de territorialiser commodément les peurs sociales8 ». Aujourd’hui, on identifie davantage Saint-Denis que Neuilly-sur-Seine à la banlieue, quoique les deux communes se situent outre-périphérique. La population de Saint-Denis est plus diversifiée que celle de Neuilly, moins éloignée socialement de l’ensemble des résidents du pays9. Pourtant, c’est elle surtout qui fait les frais de montées en épingle publiques et de la présomption du particularisme. Alors, enquêter sur les bourgeois quand on vient de Saint-Denis, c’est prendre le risque de trimballer avec soi une cargaison de fantasmes lourds d’un siècle et demi de répétition, tout en espérant qu’ils ne seront jamais activés. C’est aussi inverser le sens de l’étonnement, sinon de l’inquiétude.
Ainsi, depuis une de ces banlieues sur lesquelles on glose tant, une grosse centaine d’étudiants ont constitué trois quartiers bourgeois en « cabinets de curiosités », comme on disait au temps naissant de l’exotisme. Ces étudiants sont plutôt des étudiantes, puisque ces promotions étaient constituées aux trois quarts de femmes ; elles sont âgées de dix-huit à vingt ans pour la plupart ; elles résident aux deux tiers dans la banlieue nord (Seine-Saint-Denis ou Val-d’Oise), et pour le tiers restant dans d’autres banlieues, hormis quelques exceptions issues des arrondissements périphériques de Paris ; une petite moitié sont titulaires d’un bac technologique ou professionnel ; elles ont majoritairement des parents ouvriers ou employés ; elles sont rarement blanches. Ajoutons à ce tableau qu’une partie d’entre elles sont en sociologie sans bien savoir de quoi il retourne ou faute d’avoir obtenu l’orientation qui avait leur préférence. Et elles ont donc dû se familiariser, dans le 8e arrondissement, avec un monde nouveau et étrange, dont les indigènes présentent des coutumes et préoccupations insolites.
Si les étudiants ne connaissent pas grand-chose à ces quartiers et ces milieux, il faut préciser que moi non plus. L’important n’est pas là : mon apport n’est pas celui d’un professeur délivrant un savoir figé, mais d’un professionnel de la recherche, lui-même en perpétuel apprentissage, qui fournit aux étudiants l’escorte d’une réflexivité un peu plus outillée par des lectures et une expérience. Ce n’est pas un cours sur les quartiers bourgeois, mais une familiarisation précoce avec des méthodes de recherche, une course d’orientation sur les chemins typiquement sociologiques d’accès au monde. Les quartiers bourgeois n’en sont que le terrain, le prétexte, choisis pour le dépaysement et le sentiment d’étrangeté qu’ils suscitent.
Pourtant, ce monde étrange n’est pas étranger. Ces étudiants qui en feront la description et l’analyse appartiennent à un même monde, fait de biens inégalement répartis, de tâches et d’honneurs hiérarchisés, de destins séparés. Les étudiants sont renvoyés dans le cours de l’expérience à une position de dépossession, parfois clairement considérée comme inférieure par leurs interlocuteurs du monde étudié. En même temps qu’il faut dépasser l’exotisme pour entrer dans la compréhension, il faut encaisser l’humiliation des multiples rappels à l’ordre social que suscite et affronte la démarche d’enquête.
Pédagogie sadique ? Peut-être bien. Mais je ne suis pas le créateur de ce gouffre social. Je me contente d’inviter à le sonder, au risque d’être pris de vertige. De retour de cette plongée, chez eux puis dans les quatre murs de la salle de classe – pas toujours bien chauffée –, les étudiants couchent par écrit ce qu’ils ont vu, ce qu’on leur a montré ou dit, ce qu’ils ont ressenti. On en discute, on essaie de l’analyser, et on en rit parfois. Parce que la mise en dérision des situations, comme l’objectivation qui vient avec, permet d’apaiser l’émotion, de mettre de la distance, de mieux saisir (c’est-à-dire à la fois de comprendre et d’empoigner) le monde dans lequel on vit. À l’abri d’un campus excentré et exigu, on reprend pied, on déploie les doutes, les nouvelles questions et les premières interprétations, on les confronte, on les solidifie, avant de lancer un nouvel assaut.
Ce livre décrit les étapes des batailles constituées par ces trois enquêtes collectives, depuis les premières incursions anonymes et timides, où l’on essaie de se fondre dans le décor, jusqu’aux face-à-face sans échappatoire. Les différents moments suivent le catalogue des méthodes des sciences sociales que j’ai pour fonction de présenter à ces apprentis. L’observation, d’abord, qui cherche à faire le lien entre le regard et l’écriture, à mettre en relief l’ordinaire rendu invisible par l’évidence, ou au contraire à capturer l’extraordinaire dans les filets d’une description communicable. Le questionnaire, ensuite, qui recueille et additionne des opinions, des pratiques, des parcours individuels, non pour en extraire l’inexistant « Français moyen » des sondages, mais pour dessiner les lignes de partage d’une population. L’entretien, enfin, par lequel on tente d’accéder à la finesse des processus, aux plus petits mécanismes des trajectoires personnelles comme à l’obscurité des mondes intérieurs. Les outils sont banals ; c’est la mise en rapport de leurs usagers et du matériau travaillé qui l’est moins.
Précisons que le public étudiant, dont j’ai décrit l’hétérogénéité, a diversement saisi la perche que je tendais. Certains sont allés bien au-delà de mes espérances pédagogiques, et ont eu de leur côté l’impression de comprendre assez vite en quoi peut consister une recherche sociologique. Cependant, ce n’est pas le cas d’autres, distraits par la nécessité de travailler à côté des études, brimés par leurs difficultés d’expression, doutant de l’utilité ou de la légitimité de leur place à l’université (et pour qui la pratique pédagogique que j’ai mise en œuvre n’a pas suffi, peut-être pas même aidé), ou découvrant tout simplement que la sociologie ne leur plaît pas. On verra pourtant que le ton de ce livre donne peu d’écho aux moments de découragement, que ce soient les miens ou ceux des étudiants. Parce qu’elles rejouent le cheminement de l’enquête plutôt qu’elles ne décrivent minutieusement le déroulement d’un cours, les pages qui suivent présenteront les investigations des étudiants et les écrits qu’ils en tirent uniquement sous l’angle de l’accroissement de connaissance qu’ils produisent. Elles n’envisageront dans les difficultés que ce qu’elles permettent de comprendre encore mieux, et dans les moments de perplexité rien d’autre qu’une pensée en marche.
En racontant le petit combat des étudiants pour la connaissance d’un monde social dominant, ce livre ne veut pas apitoyer le lecteur sur les déconvenues et humiliations subies dans ce parcours d’investigation, mais plutôt l’amener à les envisager de manière crue et joyeuse. Peut-être cela permettra-t-il de tracer les pistes de leur dépassement, d’augmenter le désir comme la capacité d’enquêter. S’il me paraît nécessaire de consolider l’un et l’autre, en particulier auprès des étudiants de Saint-Denis, ce n’est pas par seul amour de la science, mais au nom d’une exigence politique de symétrie. L’enquête au sens large est un outil trop important de la démocratie pour ne s’intéresser qu’à la condition des opprimés, et pour n’être réalisée que par certains individus privilégiés. Toute recherche en sciences sociales (et au-delà tout rapport public, toute expertise officielle, toute parole autorisée sur le monde social) contient une part d’insolence et de prétention, car elle entend réduire la variété des expériences humaines pour en accroître l’intelligibilité. Il n’est pas question de museler de telles passions, qui sont nécessaires à la compréhension et la maîtrise de notre monde. Mais, à l’heure où l’université massifiée est menacée, accusée de tous les maux et soumise à un régime amaigrissant10, pendant que les grandes écoles demeurent grasses et intouchables, il faut travailler à une répartition égalitaire de cette insolence et de cette prétention. Afin que ceux qui en sont dépositaires et ceux qui en sont les objets ne soient pas toujours les mêmes.
Extraits

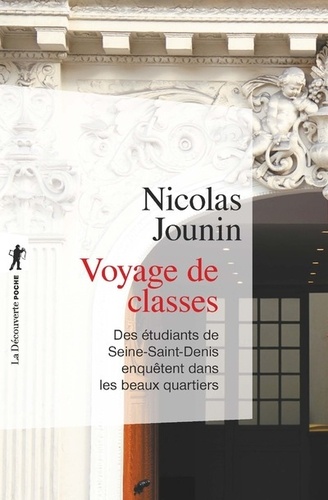


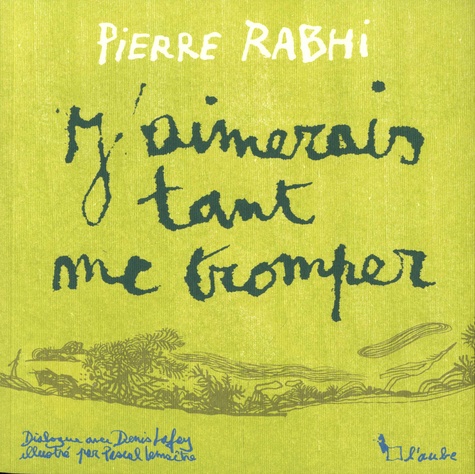
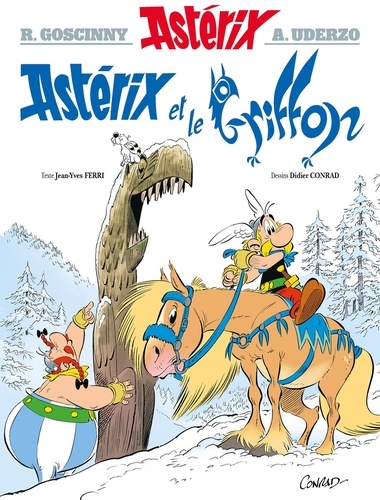
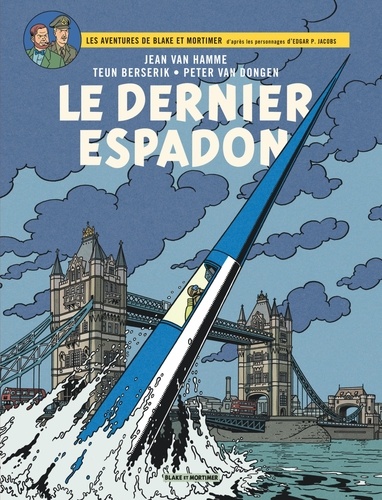
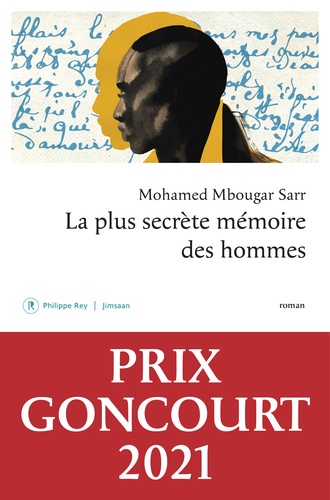
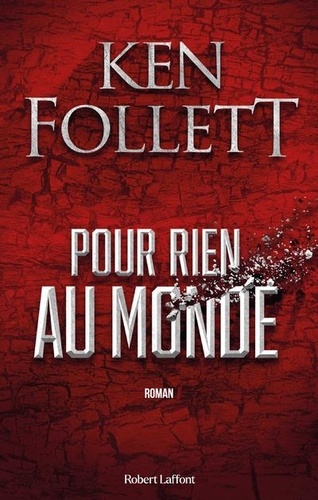
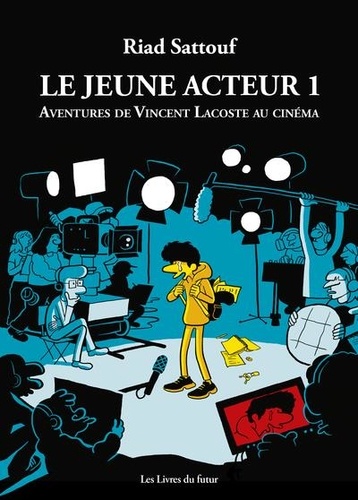
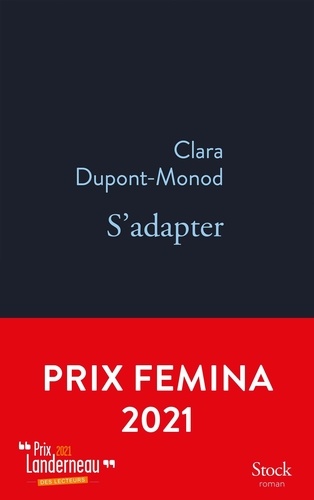
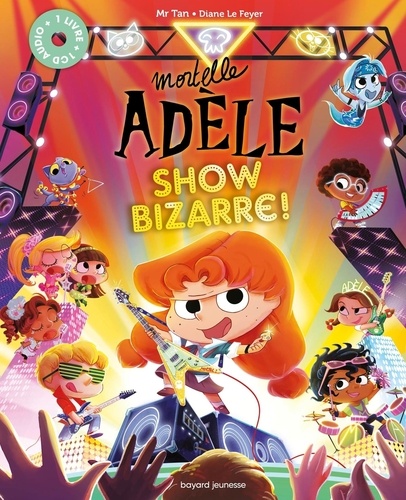
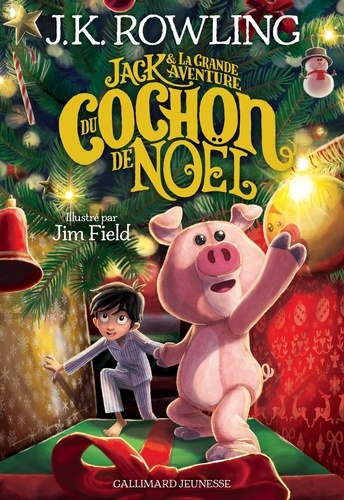
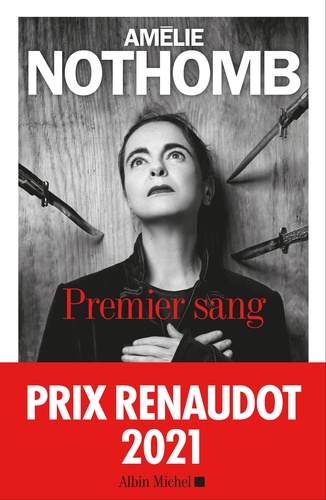
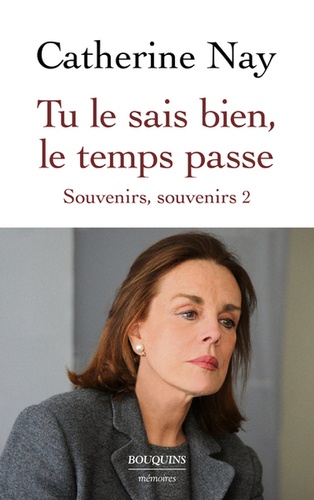
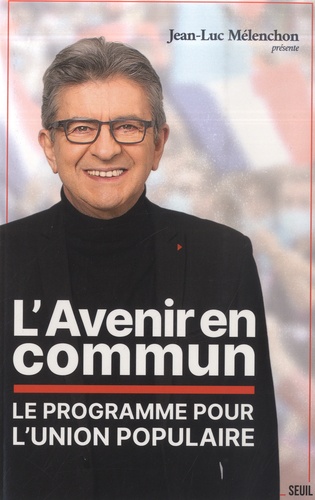

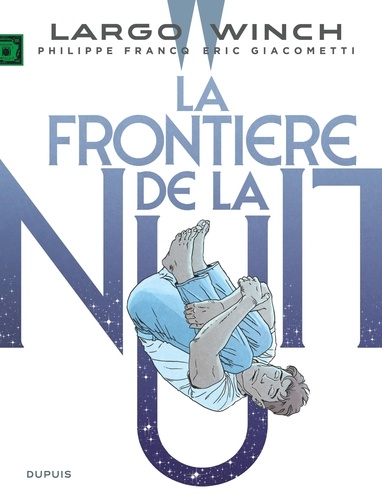
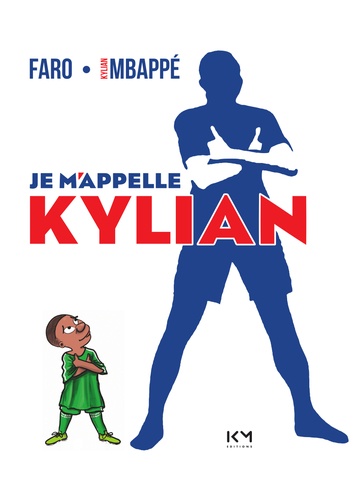
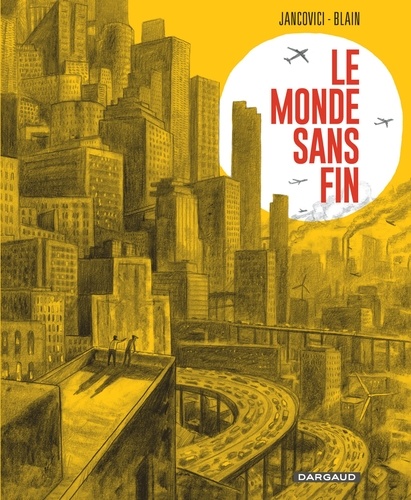
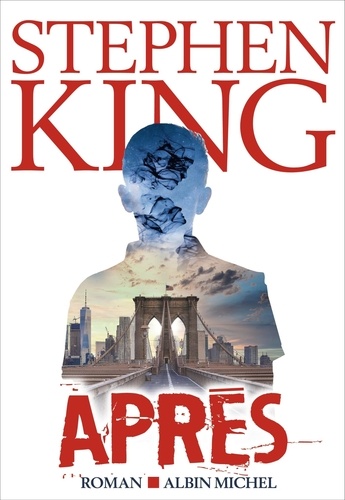
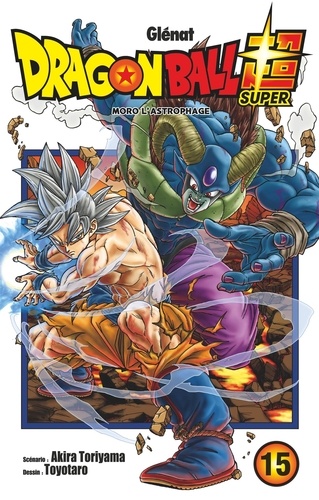
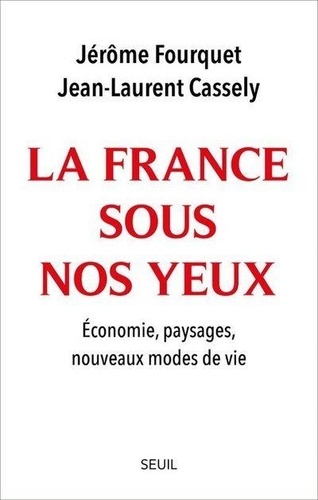
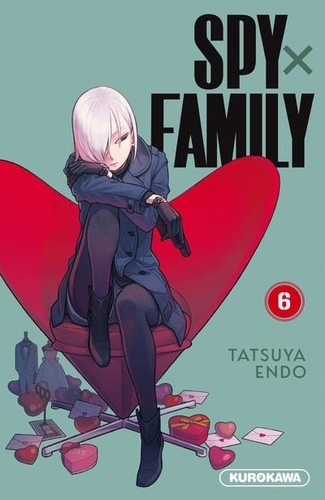
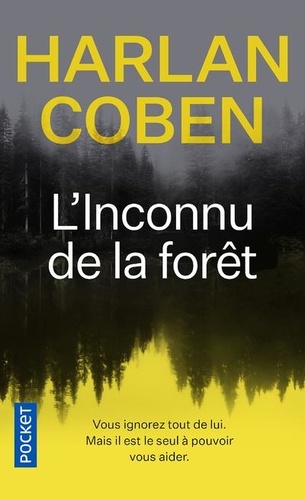
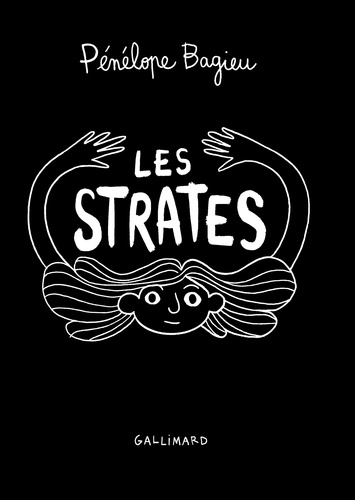
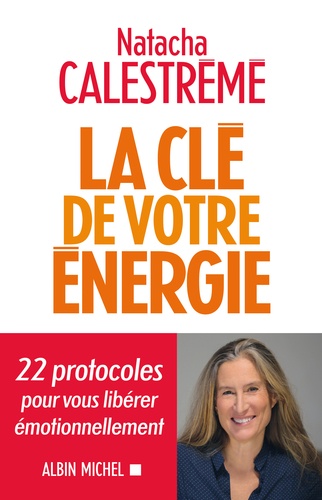
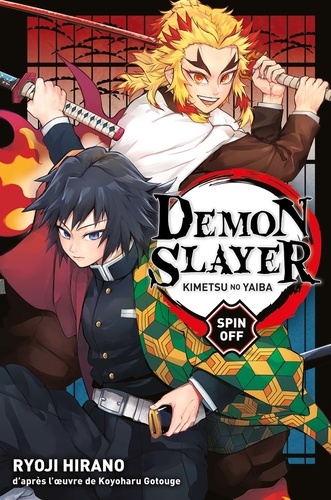

Commenter ce livre