Avant Jésus, l'espérance
Jacques Briend
Jacques Briend, l'un des meilleurs biblistes francophones, propose une étude essentielle sur les différentes formes de l'espérance exprimée dans l'Ancien Testament. Il répond à deux questions décisives : "Qui peut espérer ?" et "Que pouvons-nous donc espérer ?". Un éclairage sur cette attente qui préparera la reconnaissance de Jésus comme Christ.
Voici un livre longuement mûri ! Son auteur, mon ami Jacques Briend, dit la vérité lorsque, dans son « Avant-propos », il fait remonter à « plus de vingt ans » les premières formulations du projet qui devait aboutir à cette publication que je suis, dès lors, tout particulièrement heureux de présenter.
1. Un projet ancien dans la collection
Nous étions à l’époque, depuis quelques années déjà, collègues à la Faculté de théologie et de sciences religieuses de l’Institut catholique de Paris. Je venais de lancer la collection « Jésus et Jésus-Christ » avec un certain nombre d’ouvrages repérés par André Paul, alors directeur littéraire des éditions Desclée et Cie. Ils avaient ouvert la problématique de la réflexion à laquelle la collection se proposait de convier, mais je ressentais la nécessité de ne pas tarder à documenter davantage, à la fois au plan historico-critique et au plan biblico-théologique, ce dossier « jésu-christologique » qu’il s’agissait justement de globalement reprendre. Pour définir avec précision la tâche que cette perspective m’assignait, je constituai un groupe de travail avec plusieurs collègues, tous biblistes de l’Institut catholique de Paris : Henri Cazelles, Pierre Grelot, Charles Perrot, Antoine Vanel (déjà affecté, hélas, de la grave maladie qui devait l’emporter) et… Jacques Briend. Le simple parcours de la liste des numéros à ce jour parus dans la collection fera facilement apparaître l’importance des contributions effectivement déjà apportées par chacun des trois premiers noms de cette liste.
Restait l’apport de Jacques Briend. Il devait se faire un peu plus longtemps attendre en raison des « diverses fonctions et responsabilités » par ailleurs exercées par lui, pas seulement dans le cadre universitaire. Pour me consoler de mon attente qui se prolongeait, je me raisonnais en me disant qu’il était simplement logique, après tout, qu’un ouvrage sur l’espérance se fasse lui-même quelque temps… espérer. Et je peux dire que je n’ai jamais douté un seul instant, durant toutes ces années, que cette espérance serait effectivement un jour exaucée. Comme elle l’est bel et bien aujourd’hui, on comprendra – ce qui précède ayant été précisé – que j’en éprouve une grande joie. Et que je sois avant toute autre chose désireux d’exprimer, au signataire de ce 93e numéro de la collection « Jésus et Jésus-Christ », mes chaleureux remerciements amicaux.
2. Le livre d’un maître
Mais je ne manquerai pas de lui adresser, dans le même temps, mes vives félicitations ! Car, il ne faut pas s’y tromper, ce livre longuement mûri est celui d’un maître capable de ramasser en un nombre limité de pages un très substantiel apport.
Au titre de sa longue fréquentation personnelle de la Bible et grâce à sa compétence historique et théologique avérée, dont son enseignement universitaire et ses publications scientifiques témoignent amplement, Jacques Briend rassemble ici ce en quoi lui paraît consister l’espérance du peuple de la Première Alliance1. Clarté de l’exposé (et, déjà, du plan !), sobriété de l’expression, limpidité de l’affirmation : il fallait une vraie maîtrise ès choses bibliques pour aboutir à pareil résultat. Les références bibliographiques ciblées qui sont données en note et la manière dont, au cours de la rédaction, il est tranché sur les questions de critique textuelle ou dans les débats en cours entre spécialistes, font la preuve de la solidité scientifique du discours tenu, sans attenter à sa large accessibilité.
Jacques Briend nous propose ici sa lecture de l’espérance biblique vétéro-testamentaire. Il en dit à la fois l’énorme importance et la portée considérable, l’omniprésence dans la Bible et les diverses modalités d’expression. Il ne nous fait pas apparaître seulement qu’Israël – le peuple en son entier et chacun de ses membres – vit dansl’espérance ; il manifeste qu’en Israël, on a vécu d’espérer. Cela apparaît tant du point de vue du sujet que du point de vue de l’objet de ladite espérance.
La question de l’espérance ne peut être abordée sans que l’on s’interroge sur les personnes ou les groupes qui en sont les sujets. Autrement dit, il s’agit d’abord de répondre à la question : Qui peut espérer ?À cette question décisive, cet ouvrage apporte une réponse claire. L’auteur présente en effet successivement plusieurs personnes ou catégories de personnes, présentes dans la Bible à différents titres, qui y expriment une forme particulière d’espérance, que ce soit par leur prière (le psalmiste), par leur annonce (le prophète), ou par leur attente (le peuple).
Ce parcours met en lumière les circonstances de l’espérance, qui apparaissent la plupart du temps liées à des situations de détresse individuelle (Job) ou collective. Alors que les éléments extérieurs semblent s’acharner contre une personne ruinée dans sa santé, dans sa réputation ou dans sa fortune, l’espérance apparaît comme une force inattendue qui la soulève, la redresse, la remet en marche. Il y a dans cette espérance, on le voit, une dimension salvatrice très marquée.
Du reste, ce qui vaut pour l’individu s’applique mutatis mutandis au peuple lui-même, lorsqu’il rencontre la défaite, la honte, l’humiliation, la déportation, la captivité. Tout semble alors ligué pour briser définitivement toute vision positive, pour convaincre du caractère durable de la situation nouvelle dont le peuple est la victime, de la pérennité du joug que lui a imposé l’ennemi, tant la bataille semble irrémédiablement perdue… Or voici que, dans un tel contexte, l’espérance apparaît comme la petite flamme qui prélude au grand feu du redressement, au grand jour de la victoire permettant le retour sur la terre promise.
À la faveur de son parcours, l’auteur nous convainc que l’espérance biblique est étroitement corrélative à la foi. Sans le Seigneur, cette espérance serait sans fondement. Dès lors, la question s’élargit : les nations païennes, elles qui ignorent la foi au Dieu d’Israël, peuvent-elles devenir sujets de l’espérance ? Et qu’apportent sur toutes ces interrogations les livres dits « de sagesse », amenés à définir l’espérance dans le pire cas que puisse entrevoir un Juif pieux, à savoir la mort d’un homme juste dans la force de la jeunesse, et sans descendance ? Ici, l’espérance traditionnelle du peuple biblique vient imparablement buter contre une impasse… sauf à s’ouvrir à l’espérance la plus folle que l’homme puisse imaginer : celle, ni plus ni moins, de la résurrection des morts. Or voilà que ce pas sera franchi.
4. L’objet de l’espérance
J’ai dit et écrit plusieurs fois – notamment dans La grâce de vivre en chrétien2 (qui reprend les conférences de Carême que j’ai données en Alsace successivement sur la foi, l’espérance et la charité) – que, dans ma fonction de doyen de théologie, j’ai été amené à interpeller tel ou tel professeur chargé d’un cours sur l’eschatologie. Il ne suffit pas, disais-je, de décrire en long, en large et en travers le mécanisme psychique voire l’attitude spirituelle de l’espérance, comme il arrive aujourd’hui qu’on le fasse. Encore faut-il, si l’on veut être fidèle à sa responsabilité de théologien catholique, s’efforcer de rendre compte de l’espérance qui nous est propre : Que pouvons-nous donc espérer ?, question qui a du reste constitué le titre même de ma seconde intervention de Carême sur le thème de l’espérance.
Je me réjouis que, comme je n’en doutais pas un instant, Jacques Briend ait lui-même pris aussi cette interrogation au sérieux. Et qu’il y réponde ici avec clarté dans plusieurs chapitres de son livre, consacrés respectivement à : un avenir ; la paix ; l’unité ; l’alliance nouvelle ; l’alliance perpétuelle.
L’intérêt du développement qu’il consacre à chacun de ces thèmes est d’aller au-delà des banalités conventionnelles et consensuelles. La paix, l’unité, l’avenir sont ici traités comme des concepts bibliques, illustrés par la citation et l’examen attentif des passages où ils sont évoqués ou invoqués. Or, si l’on s’étonne que le message biblique fasse de Dieu lui-même la source de ces biens si importants pour l’homme, il ne faut pas oublier que cela suppose en réalité que le désir profond de l’homme rejoigne l’intention qui est celle de Dieu. Il est clair, par exemple, que la paix advient quand le projet pacifique de Dieu rencontre l’action très concrète de l’homme qui consiste à faire disparaître les armes, comme nous le rappelle le célèbre passage du prophète Isaïe sur la transformation des lances en faucilles. Mais il en va, somme toute, semblablement des différents objets de l’espérance biblique.
La progression de l’alliance « nouvelle » vers l’alliance « perpétuelle » attire tout spécialement notre attention, dans la mesure où elle annonce les paroles du Christ sur la coupe, et l’évocation de son sang versé pour une « Alliance nouvelle et éternelle ». Pour le chrétien, Jésus est celui qui accomplit l’Alliance, de même qu’il incarne en plénitude la Paix, l’Unité, l’Avenir…
5. Un livre de christologie
Faut-il parler pour autant, alors, d’un livre de christologie ? Dans son « Avant-propos » déjà évoqué, Jacques Briend rappelle que c’est moi qui ai « choisi » le titre qu’il a lui-même estimé indiqué de donner à son ouvrage.
Avant Jésus, l’espérance : c’est l’amplitude de sa signification possible qui m’avait paru recommander pareilleformulation. D’un côté, en effet, on peut comprendre : « avant Jésus, il y al’espérance », à savoir l’attitude subjective, la démarche existentielle qui permettra effectivement de reconnaître ce Jésus comme Christ, comme le Christ deDieu, et finalement comme Dieu lui-même. Mais d’un autre côté, il est aussi loisible de comprendre selon la perspective paulienne : « avant Jésus, qui est l’espérance » – c’est-à-dire : qui, en son œuvre et en sa personne même, exauce l’espérance humaine, et en représente donc finalement le véritable objet.
Dans ce second cas, il faudrait donc comprendre qu’avant Jésus, qui est « notre espérance », il y a non seulement le lent et douloureux cheminement de l’attente subjective des hommes, mais un certain nombre d’« objets » attendus/espérés… qu’on finira par reconnaître comme tellement liés à Dieu (qui peut seul les donner), qu’on en viendra alors à comprendre qu’en réalité l’espérance va bel et bien à Dieu lui-même. Et donc, que si Jésus est susceptible d’en apporter et d’en réaliser l’exaucement, c’est son propre rapport à Dieu qu’il s’agira alors de tirer au clair ! Et nous sommes évidemment là sur le chemin de la christologie : celui qui, selon le « régime » de la nouvelle et éternelle Alliance, reconnaîtra en Jésus de Nazareth le Christde Dieu, messie de Dieu et Fils de Dieu.
† Joseph DORÉ
Archevêque émérite de Strasbourg
19/10/2007
154
pages
19,50
€
Extraits

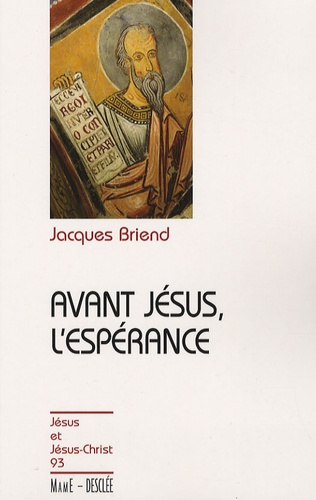


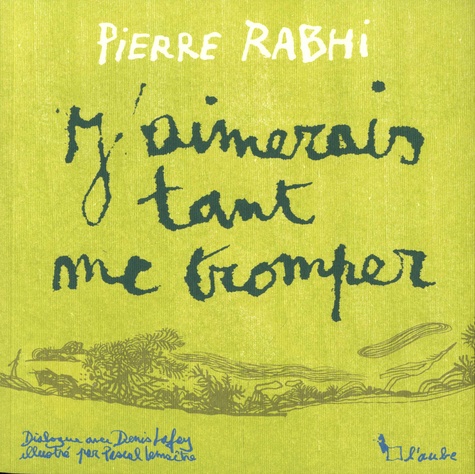
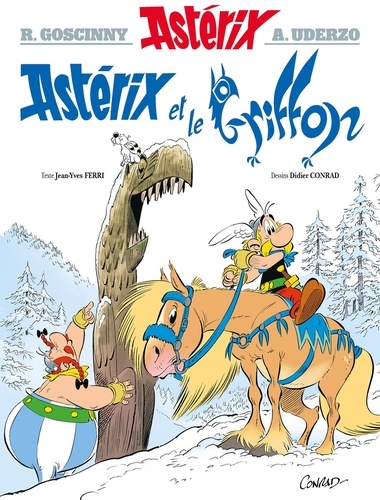
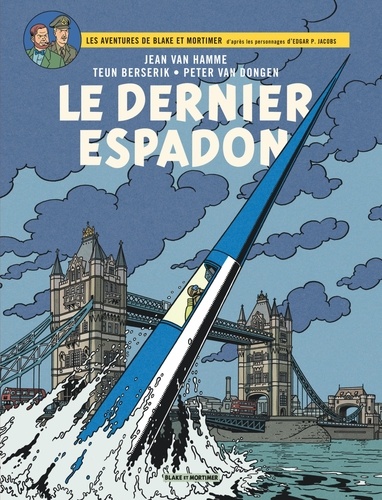
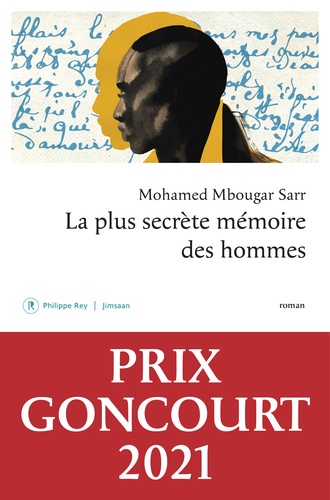
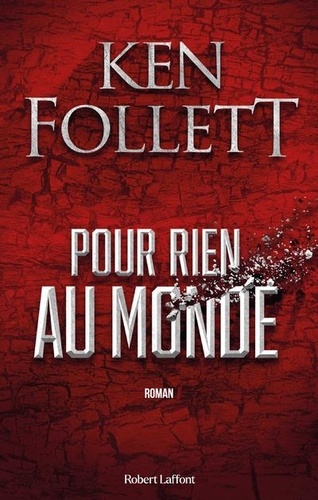
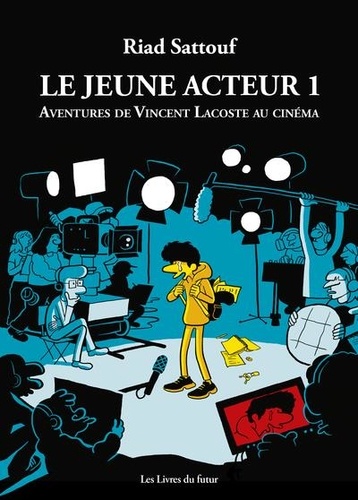
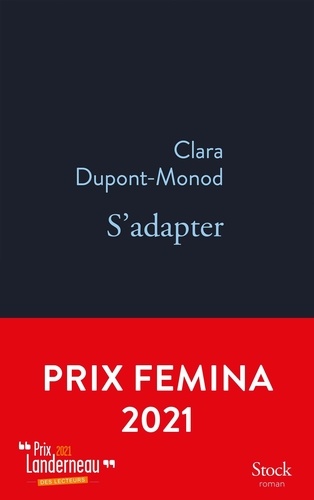
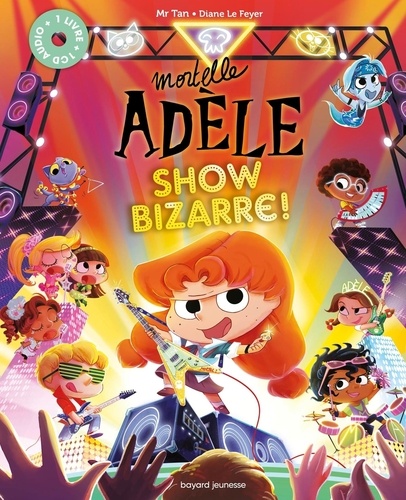
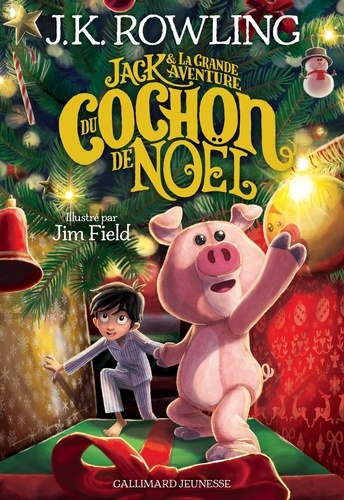
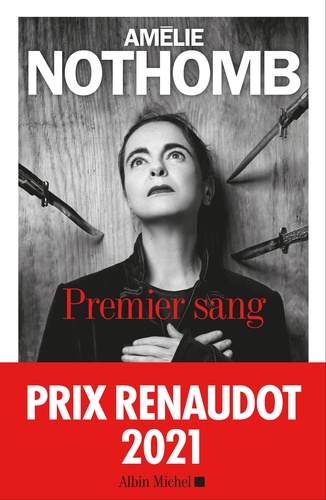
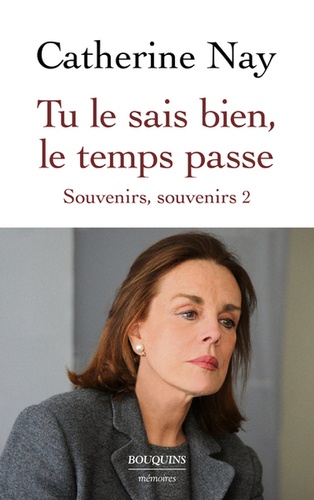
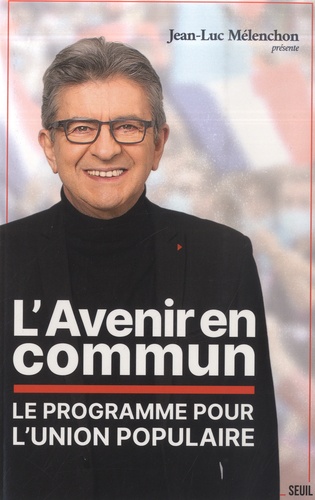

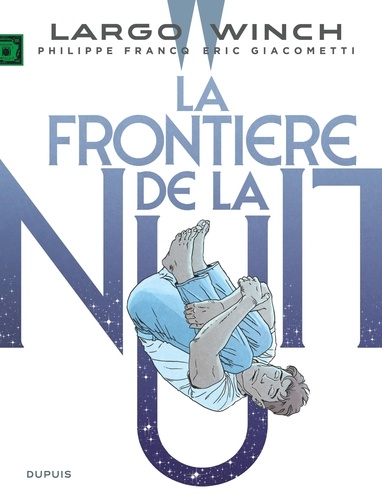
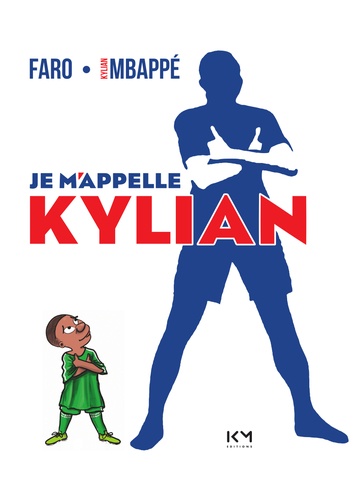
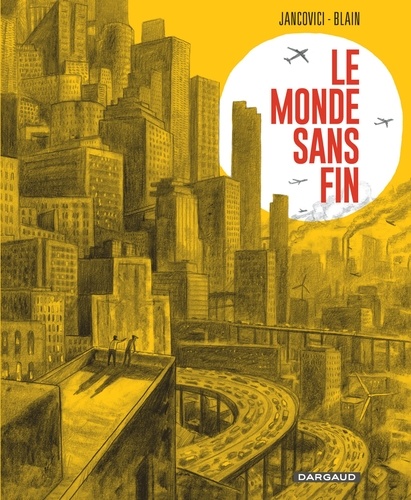
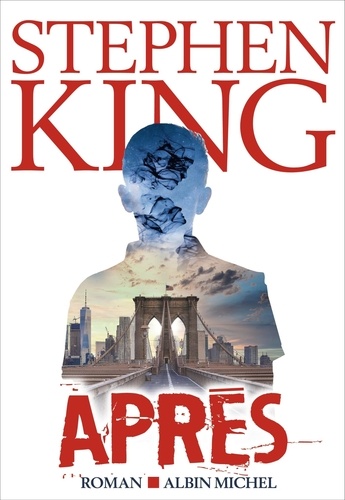
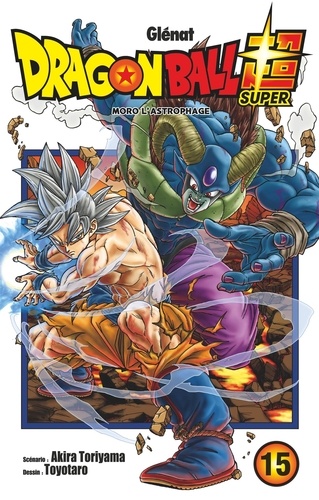
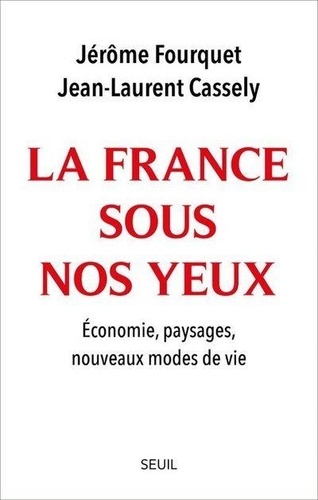
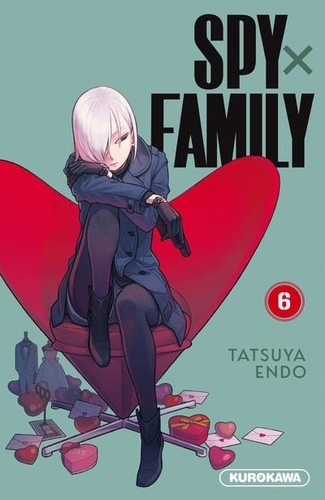
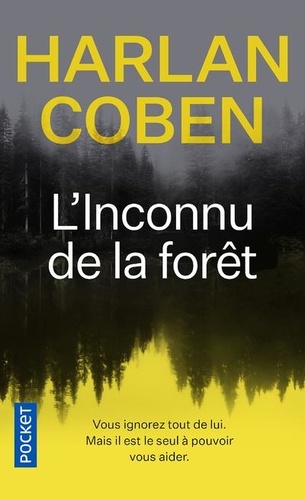
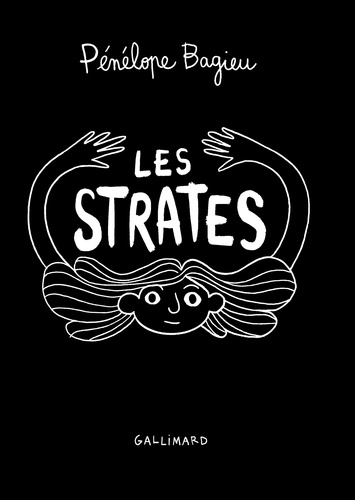
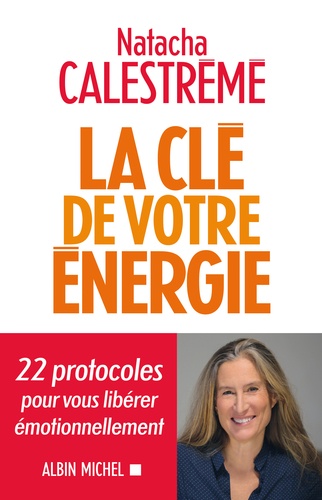
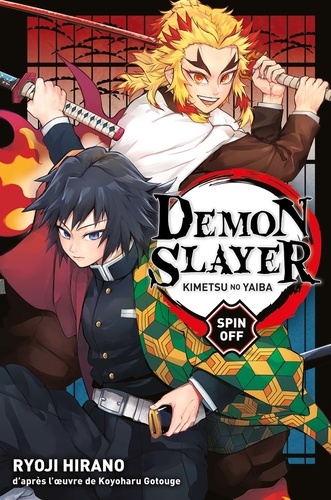

Commenter ce livre