Denyse Saab
Extraits
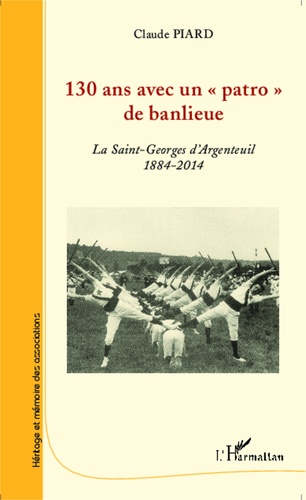
Sports
130 ans avec un "patro" de banlieue. La Saint-Georges d'Argenteuil (1884-2014)
08/2014
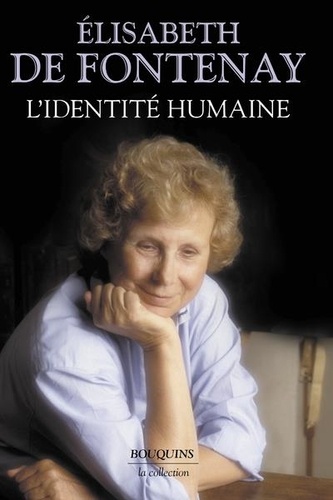
Autres philosophes
L'identité humaine
10/2021
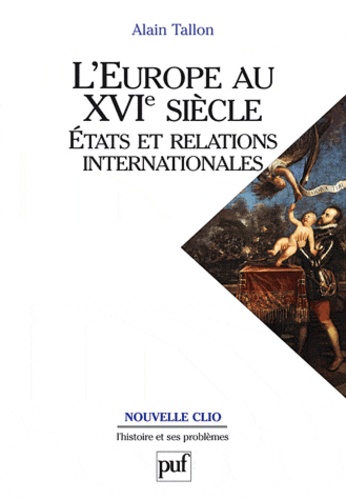
Histoire internationale
L'Europe au XVIe siècle. Etats et relations internationales
07/2010
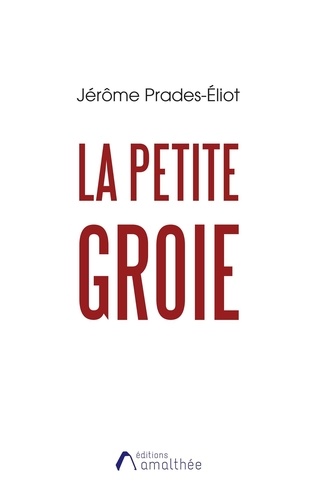
Littérature française
La petite groie
07/2021
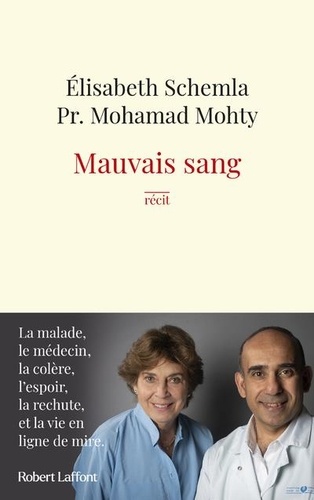
Essais médicaux
Mauvais sang
10/2023
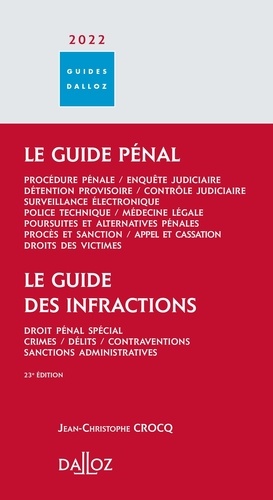
Droit pénal
Le guide pénal ; Le guide des infractions. Edition 2022
12/2021
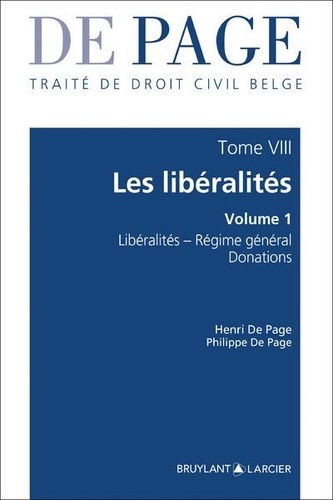
Droit européen - Textes
Traité de droit civil belge. Tome 8, Les libéralités Volume 1, libéralités, régime général
12/2021
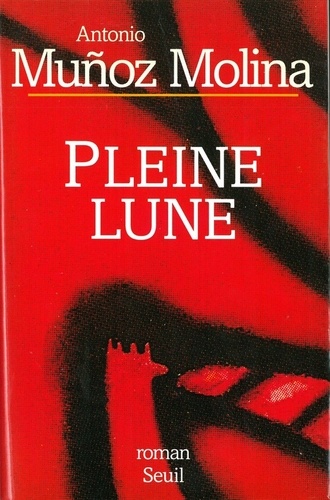
Littérature étrangère
Pleine lune
07/1998
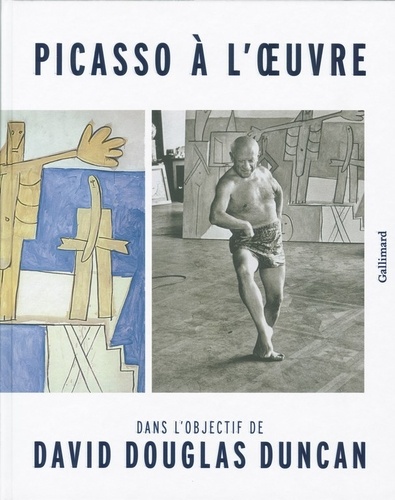
Beaux arts
Picasso à l'oeuvre. Dans l'objectif de David Douglas Duncan
02/2012
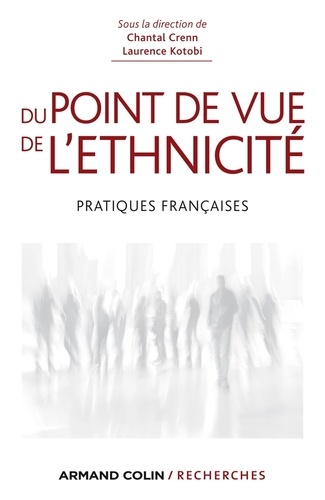
Ethnologie
Du point de vue de l'ethnicité. Pratiques françaises
02/2012
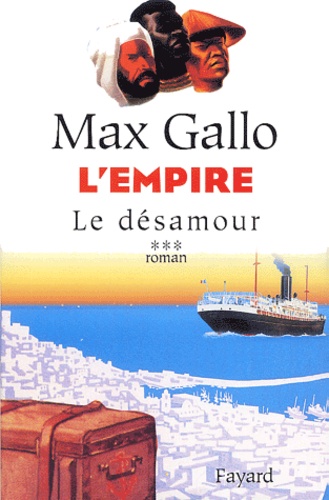
Romans historiques
L'Empire Tome 3 : Le Désamour
09/2004
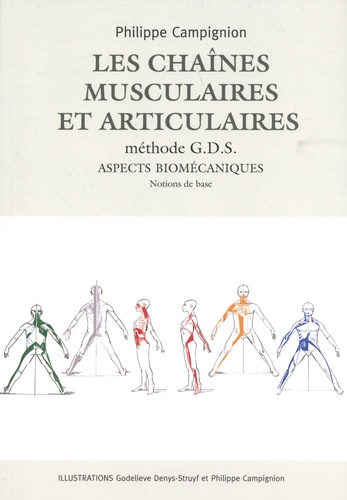
Autres médecines
Les chaînes musculaires et articulaires Méthode GDS. Aspects biomécaniques Tome 1, Notions de base, 3e édition
07/2019
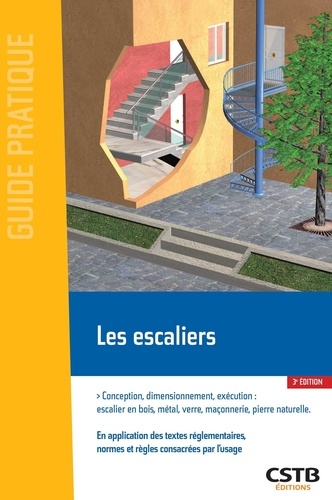
Bâtiments et travaux publics
Les escaliers. Conception, dimensionnement, execution : escalier en bois, metal, verre, maconne
10/2022
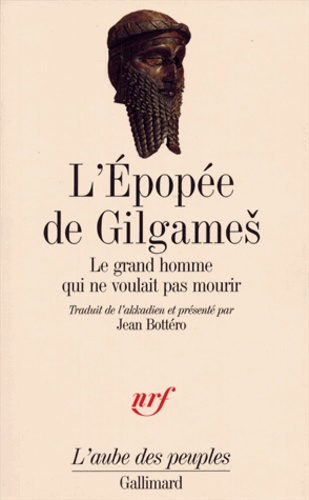
Proche-Orient
L'Epopée de Gilgames. Le grand homme qui ne voulait pas mourir
10/1992
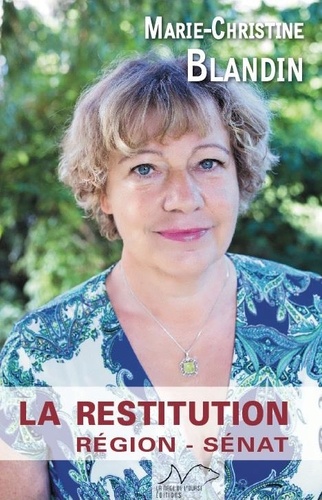
Sciences politiques
La Restitution. Région - Sénat
04/2021
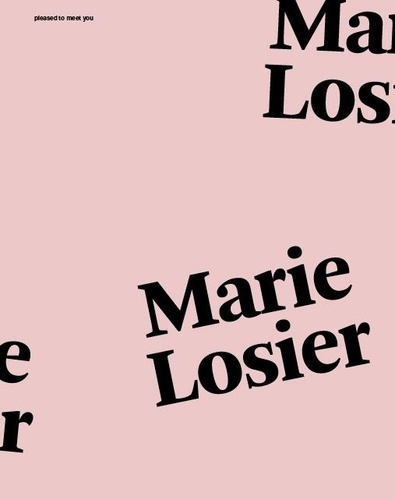
Monographies
Pleased to meet you N° 10, avril 2021 : Pleased to meet you Marie Losier
04/2021
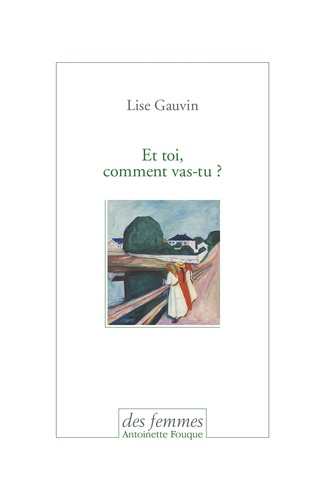
Littérature française
Et toi, comment vas-tu ?
04/2022
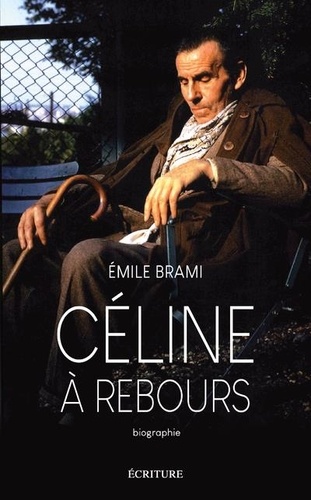
Biographies
Céline à rebours. Biographie
04/2023
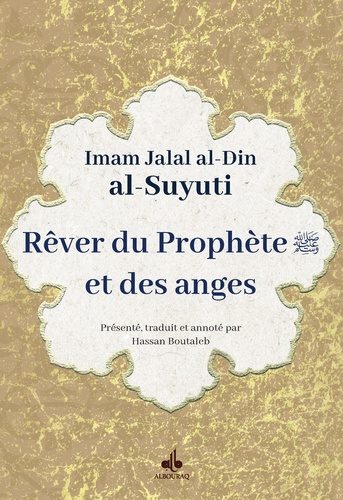
Islam
Lumière sur la possibilité de voir le Prophète et les anges
05/2023
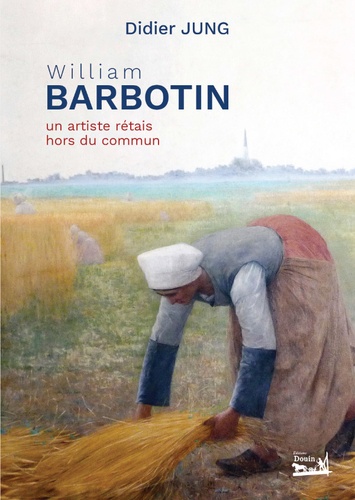
Histoire de la peinture
William barbotin. Un artiste rétais hors du commun
09/2021
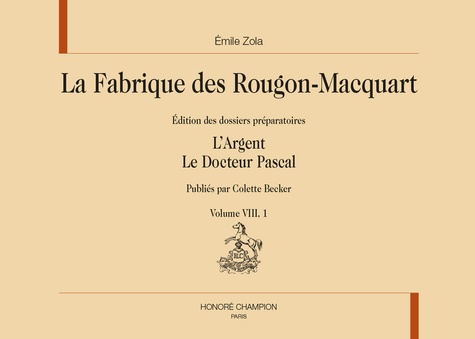
Histoire littéraire
La fabrique des Rougon-Macquart. Volume VIII, 1 ; L'Argent ; Le Docteur Pascal. Volume VIII, 2 ; La débâcle
11/2022
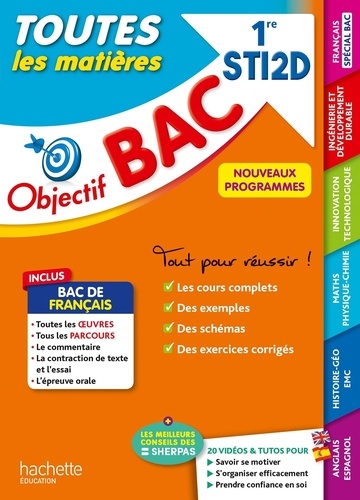
STI2D (Sciences et technologie
Objectif BAC 2024 - 1re STI2D Toutes les matières
07/2023
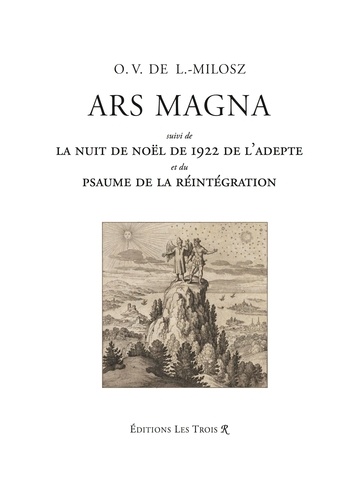
Non classé
ARS MAGNA suivi de la Nuit de Noël de 1922 et du Psaume de la réintégration
01/2017
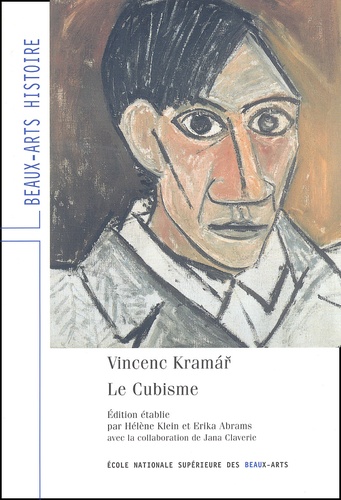
Beaux arts
Le cubisme
11/2002
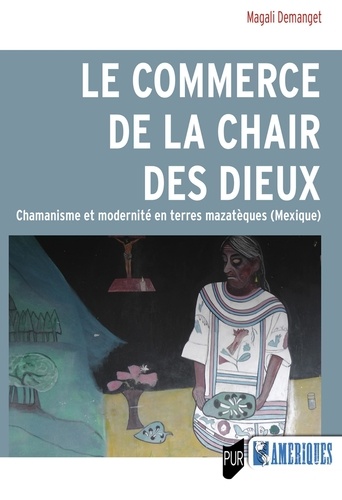
Ethnologie et anthropologie
Le commerce de la chair des dieux. Chamanisme et modernité en terres mazatèques (Mexique)
11/2022
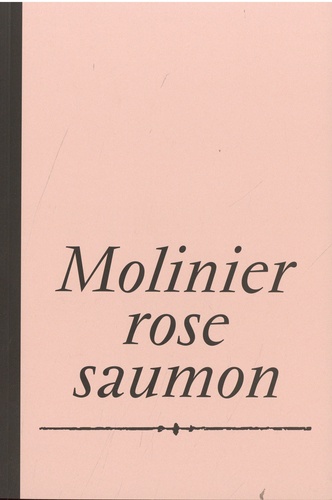
Monographies
Molinier Rose Saumon
06/2023
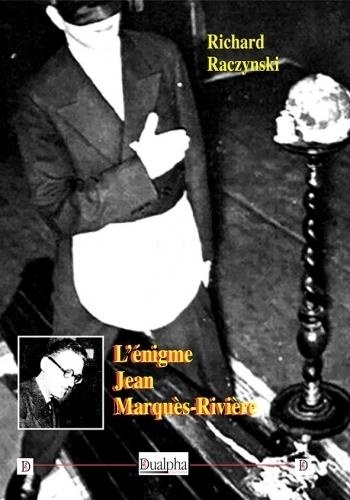
Biographies
L'énigme Jean Marquès-Rivière
09/2021
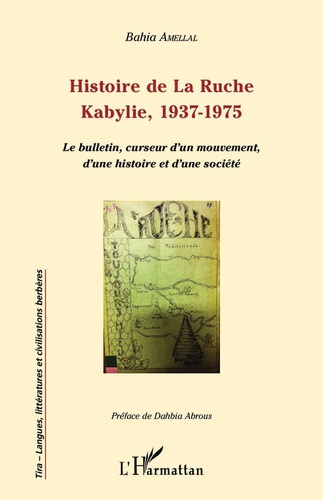
Histoire internationale
Histoire de La Ruche, Kabylie, 1937-1975. Le bulletin, curseur d'un mouvement, d'une histoire et d'une société
03/2019
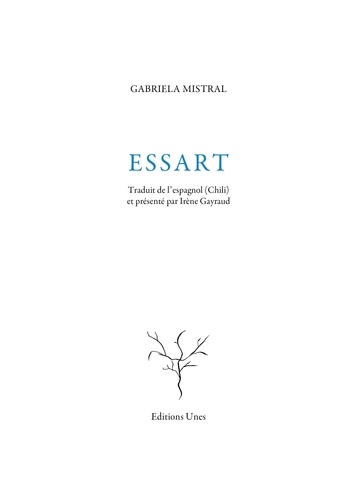
Poésie
Essart
08/2021
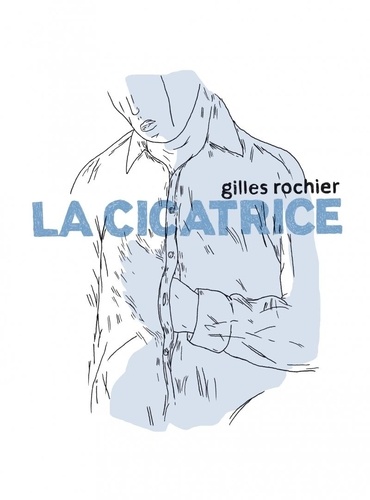
BD tout public
La cicatrice
03/2014

