librairie République Hollande
Extraits
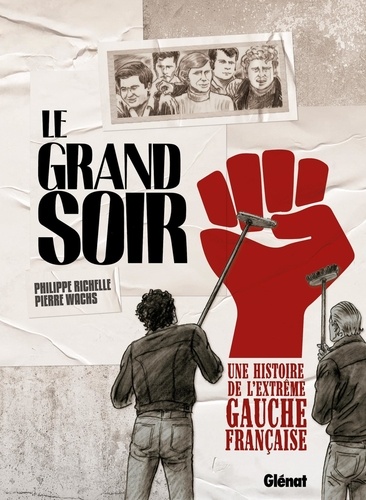
Historique
Le Grand Soir. Une histoire de l'extrême gauche française
09/2023
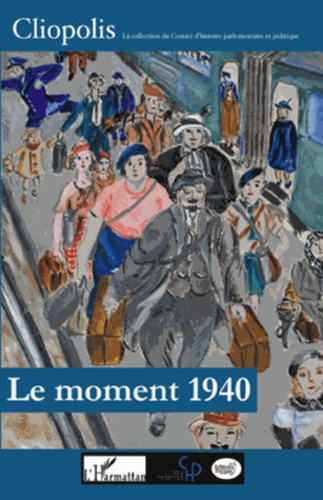
Histoire de France
Le moment 1940. Effondrement national et réalités locales. Actes du colloque international d'Orléans, les 18 et 19 novembre 2010
05/2012
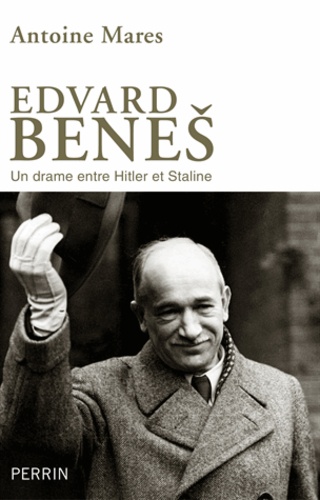
Histoire internationale
Edvard Benes, de la gloire à l'abîme. Un drame entre Hitler et Staline
01/2015
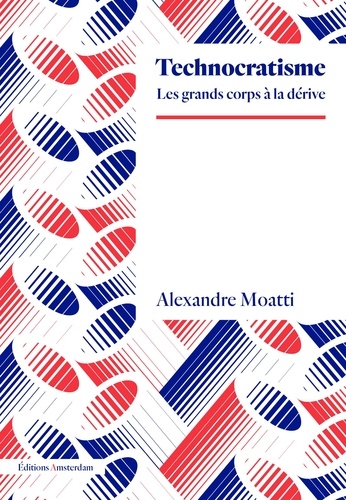
Sciences politiques
Technocratisme. Les grands corps à la dérive
09/2023
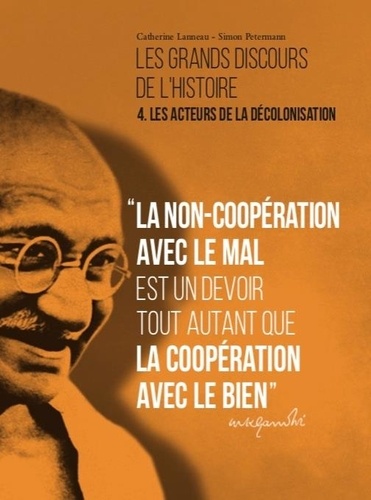
Ouvrages généraux
Les acteurs de la décolonisation
03/2024
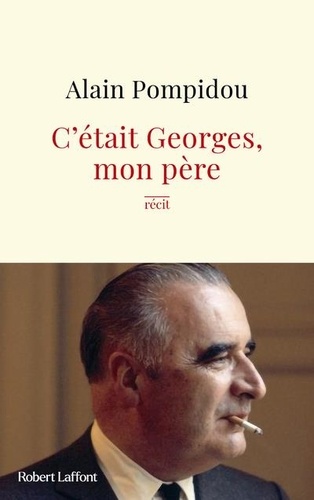
Ouvrages généraux
C'était Georges, mon père
09/2023
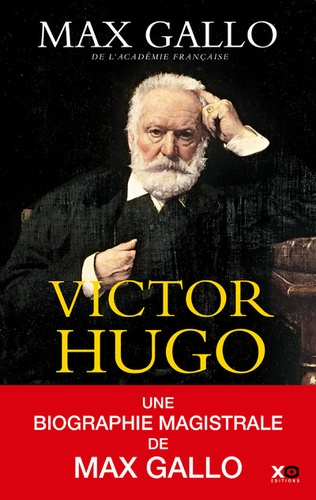
Critique littéraire
Victor Hugo
09/2017
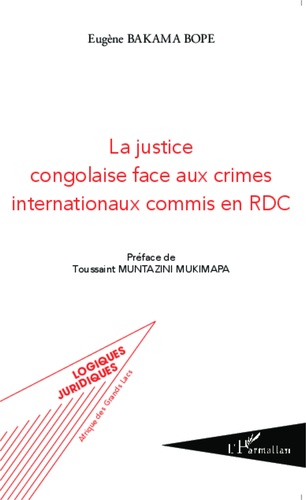
Droit
La justice congolaise face aux crimes internationaux commis en RDC
09/2014
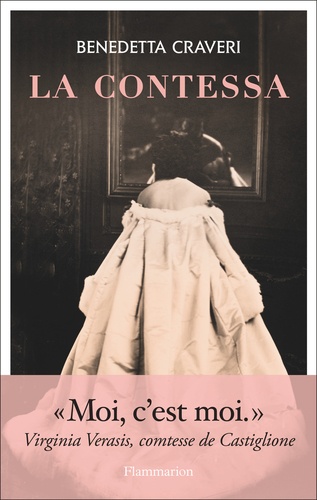
Ouvrages généraux et thématiqu
La Contessa
10/2021
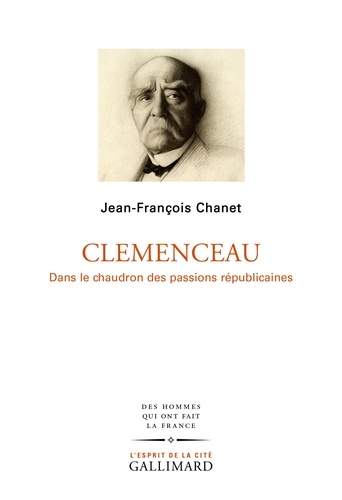
Histoire des idées politiques
Clémenceau. Dans le chaudron des passions républicaines
10/2021
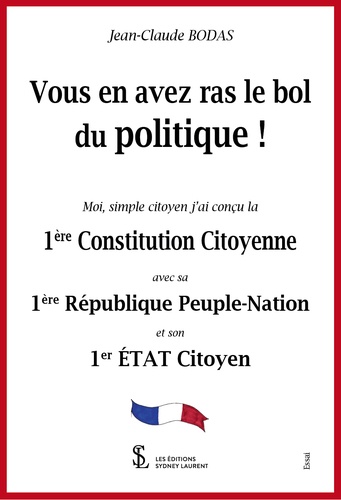
Sciences politiques
Vous en avez ras le bol du politique ! Moi, simple citoyen j ai concu la 1ère constitution citoyen
11/2021
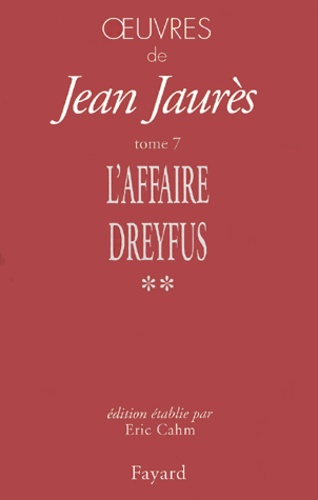
Histoire de France
Oeuvres. Tome 7, Les temps de l'affaire Dreyfus (1897-1899) Volume 2, Octobre 1898-Septembre 1899
06/2001
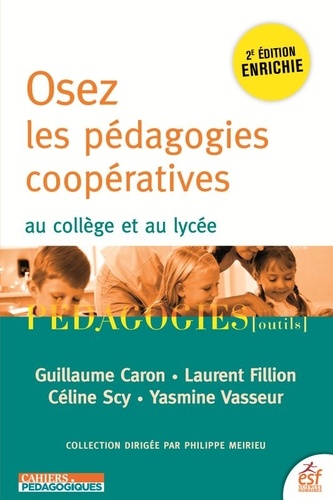
Pédagogie
Osez les pédagogies coopératives. Au collège et au lycée, 2e édition actualisée
06/2021
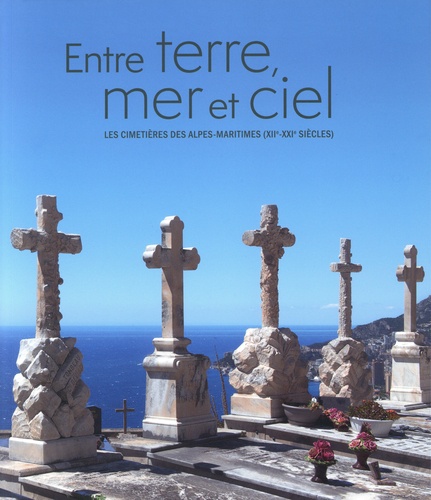
Beaux arts
Entre terre, mer et ciel. Les cimetières des Alpes-Maritimes (XIIe-XXIe siècle)
01/2021
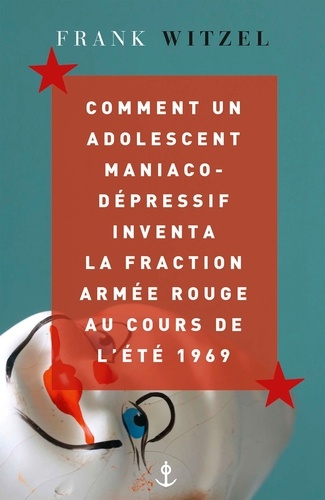
Littérature étrangère
Comment un adolescent maniaco-dépressif inventa la Fraction Armée Rouge au cours de l'été 1969
04/2018
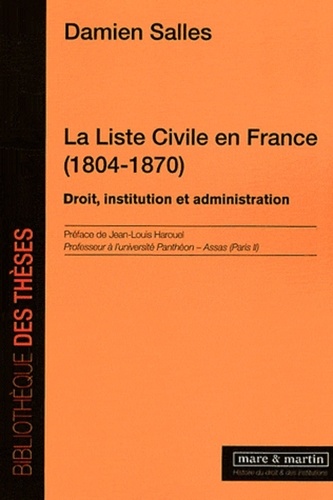
Droit
La Liste Civile en France (1804-1870). Droit, institution et administration
01/2012
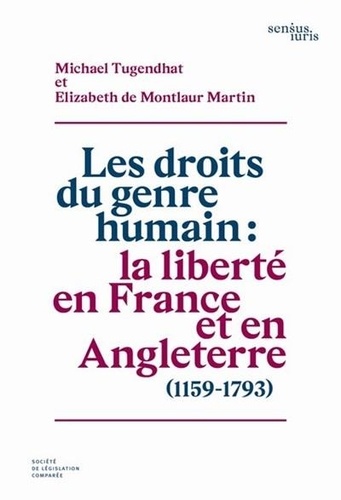
Histoire du droit
Les droits du genre humain : la liberté en France et en Angleterre (1159-1793)
10/2021
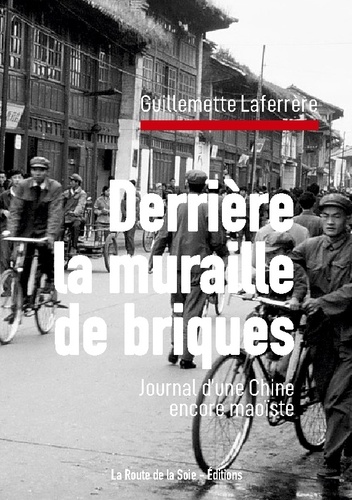
Chine
Derrière la muraille de briques. Journal d'une Chine encore maoïste
07/2023
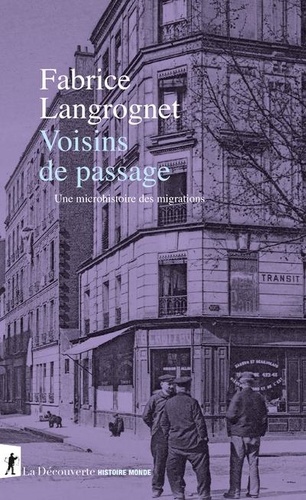
Généralités
Voisins de passage
09/2023
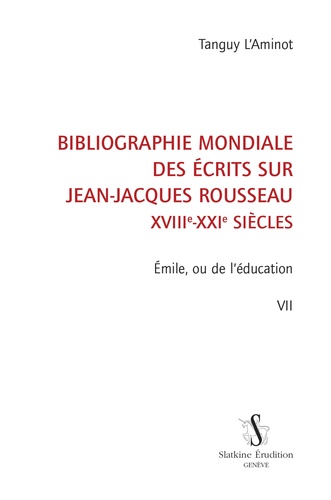
Rousseau
Bibliographie mondiale des écrits sur Jean-Jacques Rousseau. Tome 7, Emile, ou de l'éducation
10/2021
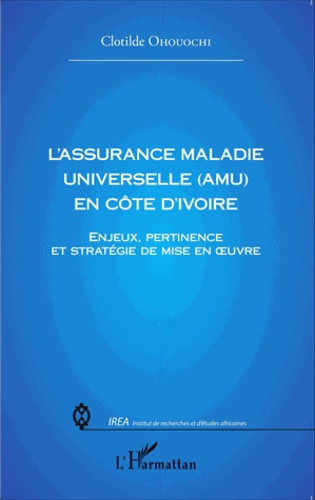
Généralités médicales
L'assurance maladie universelle (AMU) en Côte d'Ivoire. Enjeux, pertinence et stratégie de mise en oeuvre
04/2015
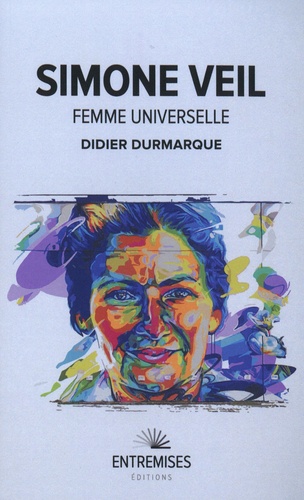
Ouvrages généraux
Simone Veil. Femme universelle
03/2023
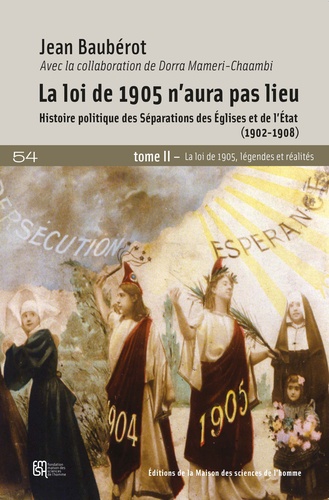
Troisième République
La loi de 1905 n'aura pas lieu. Histoire politique des séparations des Eglises et de l'Etat (1902-1908) Tome 2, La loi de 1905, légendes et réalités
11/2021
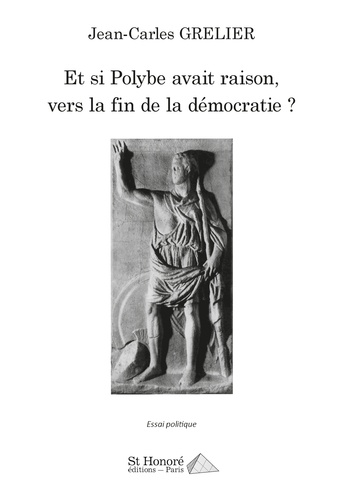
Sciences politiques
Et si Polybe avait raison, vers la fin de la democratie ?
11/2021
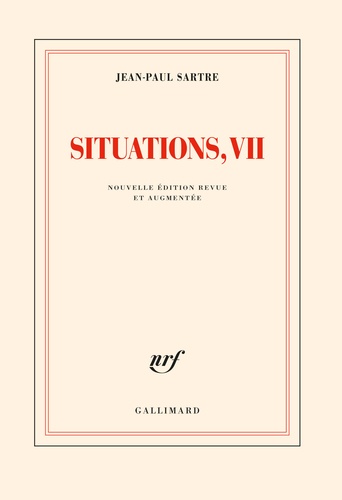
Sartre
Situations. Tome 7, Octobre 1964 - Octobre 1966, Edition revue et augmentée
11/2021
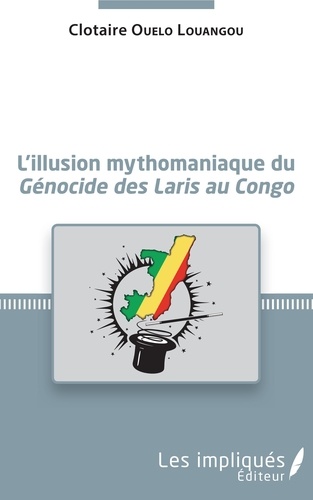
Sciences politiques
L'illusion mythomaniaque du Génocide des Laris au Congo
05/2019
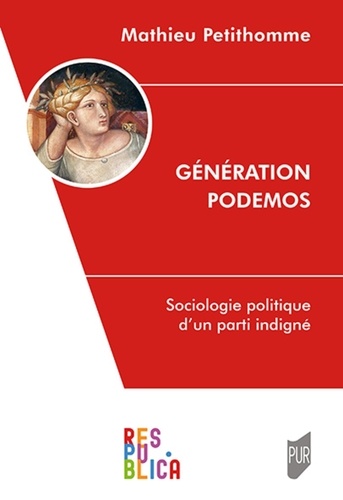
Sociologie politique
Génération Podemos. Sociologie politique d'un parti indigné
10/2021
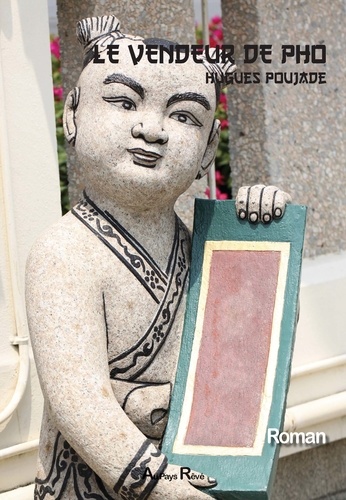
Littérature française
Le vendeur de pho
06/2014
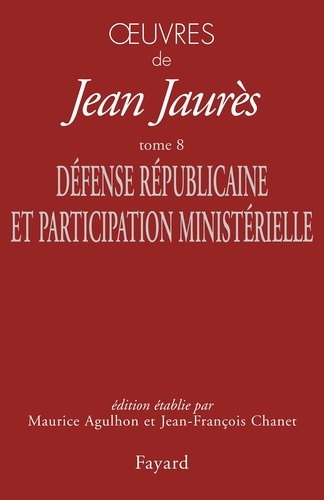
Histoire de France
Oeuvres. Tome 8, Défense Républicaine et participation ministérielle (1899-1902)
09/2013
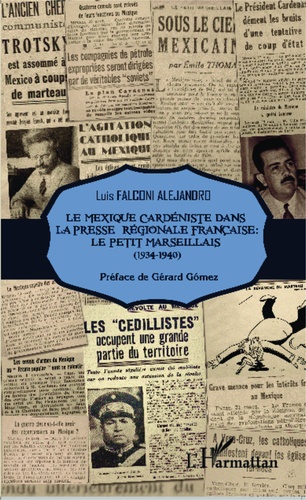
Histoire internationale
Le Mexique "cardéniste" dans la presse régionale française : Le Petit Marseillais (1934-1940)
09/2014

