Pablo Mira
Extraits
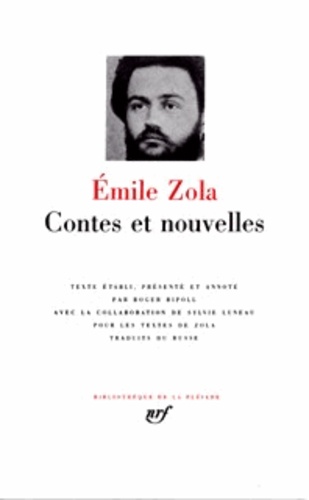
Pléiades
Contes et nouvelles
04/1976
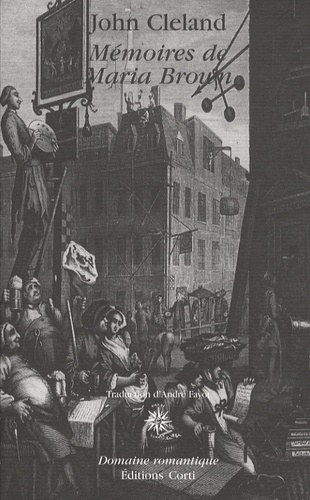
Littérature étrangère
Mémoires de Maria Brown
10/2013
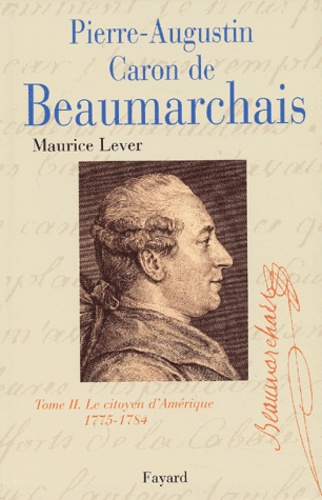
Critique littéraire
Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais. Tome 2, Le citoyen d'Amérique 1775-1784
02/2003
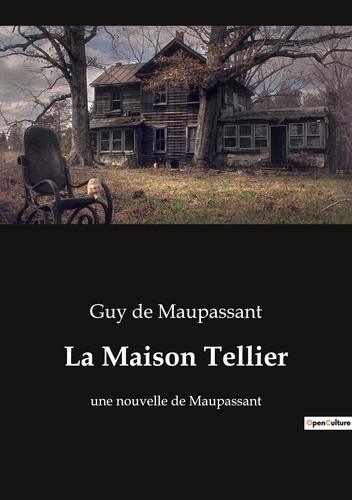
Littérature française
La Maison Tellier. une nouvelle de Maupassant
11/2022
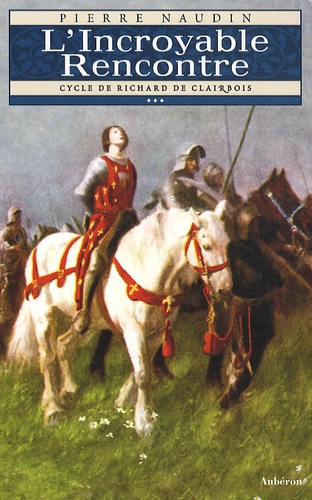
Romans historiques
Cycle Richard de Clairbois Tome 3 : L'incroyable rencontre
04/2010
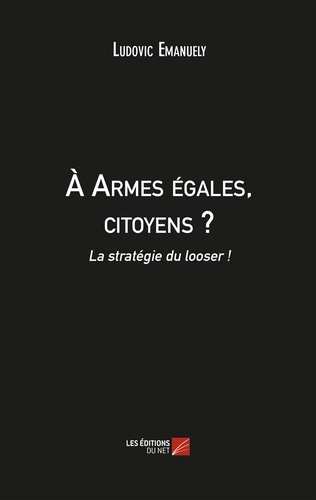
Economie
À Armes égales, citoyens ? La stratégie du looser !
05/2015
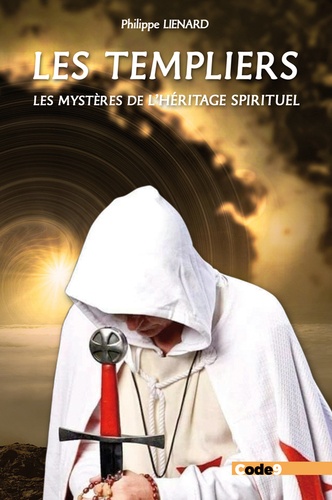
Templiers
Les Templiers Les mystères de 1312 à aujourd'hui - La part spirituelle templière à l'épreuve du temp
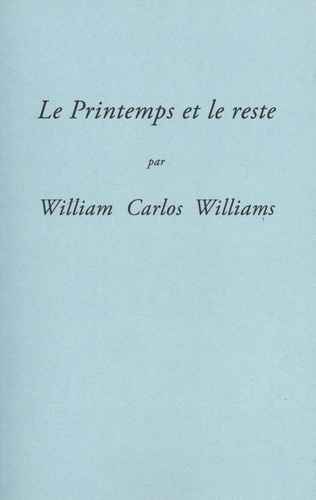
Poésie
Le Printemps et le reste
06/2021
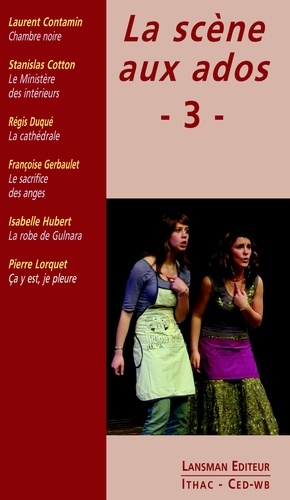
Lecture 6-9 ans
La scène aux ados. Tome 3
11/2019
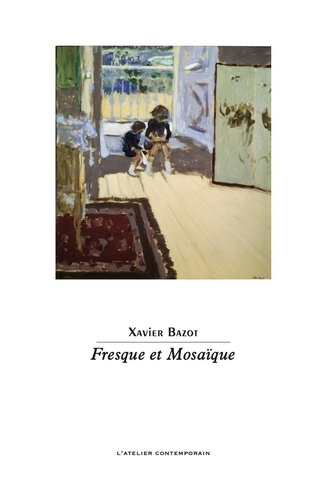
Littérature française
Fresque et Mosaïque
08/2021
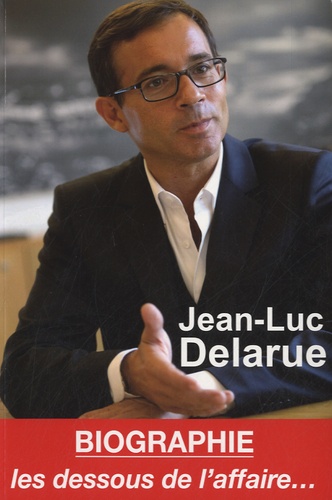
Cinéma
Jean-Luc Delarue. Révélations : les dessous de l'affaire...
12/2012
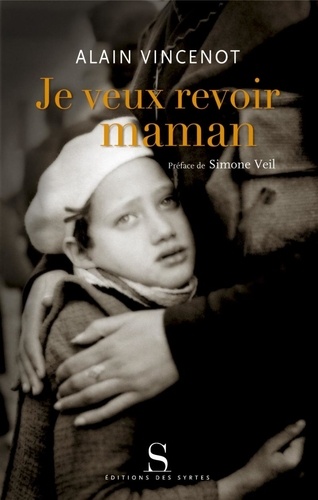
Histoire de France
Je veux revoir maman
01/2005
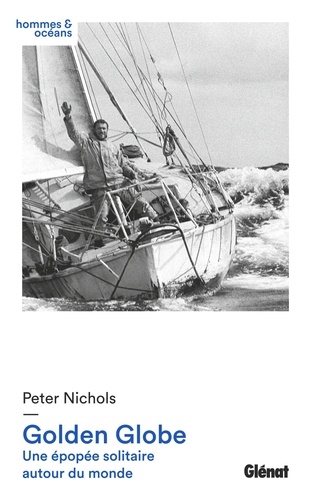
Mer
Golden Globe. Une épopée solitaire autour du monde
03/2018
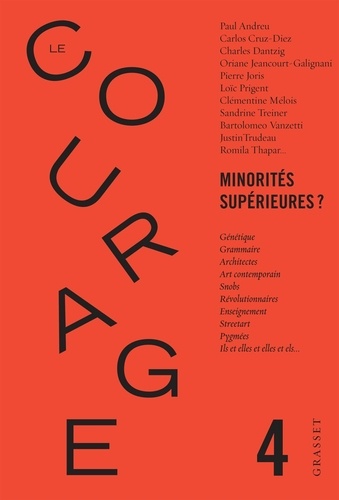
Critique littéraire
Le courage N° 4/2018 : Minorités supérieures ?
04/2018
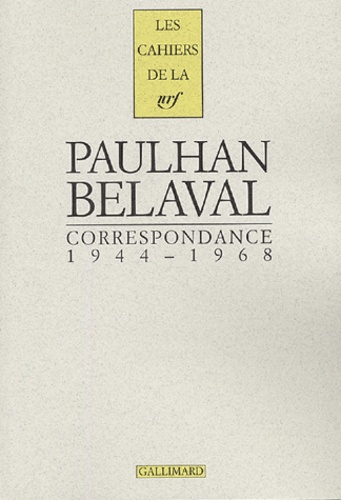
Critique littéraire
Correspondance. 1944-1968
12/2004
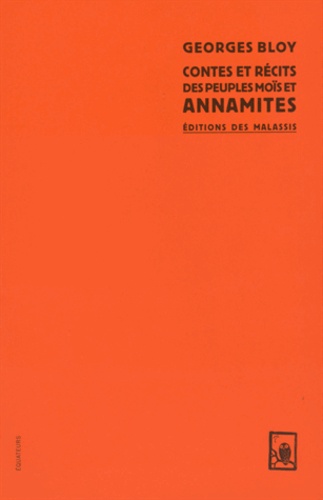
Littérature française
Contes et récits des peuples moïs et annamites
05/2015
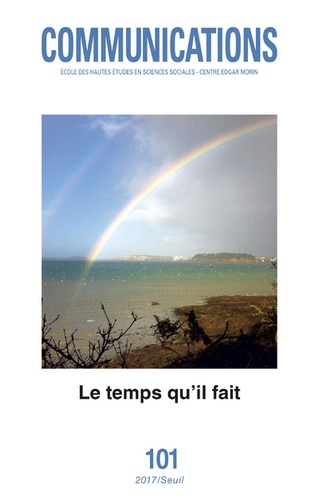
Sociologie
Communications N° 101 : Le temps qu'il fait
11/2017
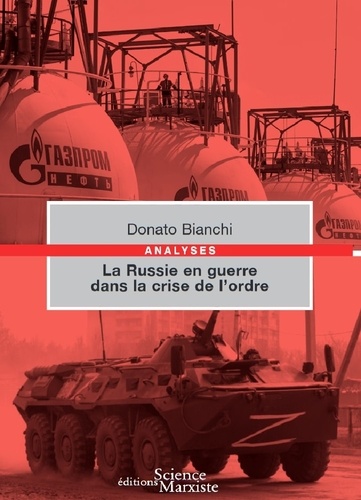
Actualité politique internatio
La Russie en guerre dans la crise de l'ordre
01/2023
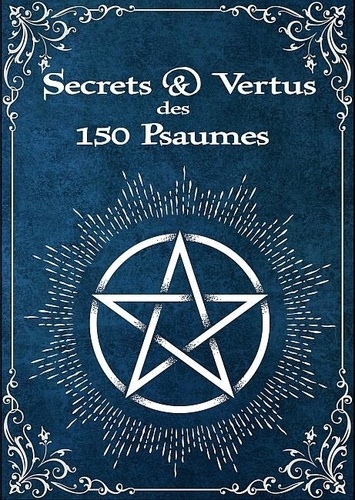
Esotérisme
Secrets & Vertus des 150 Psaumes. Secrets & Vertus des 150 Psaumes
02/2023
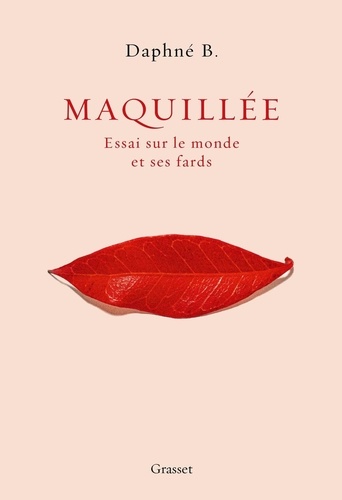
Littérature française
Maquillée. Essai sur le monde et ses fards
09/2021

Revues de psychanalyse
Essaim N° 52 : L'invention de l'objet a à l'épreuve de sa réinvention
04/2024
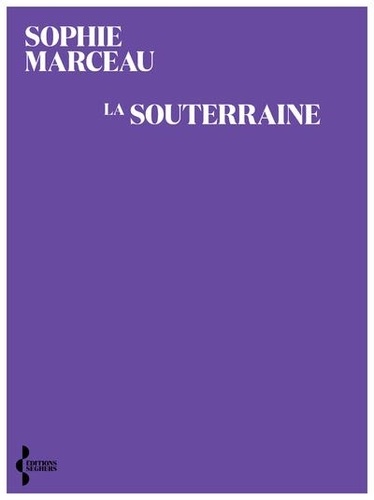
Littérature française
La Souterraine
05/2023
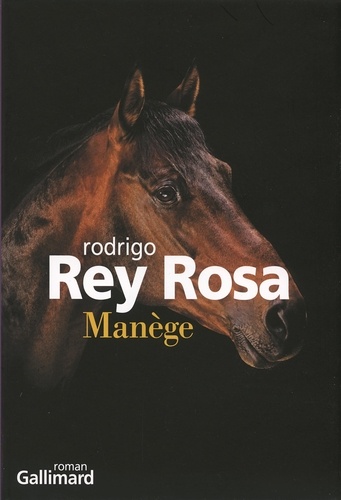
Littérature étrangère
Manège
09/2012
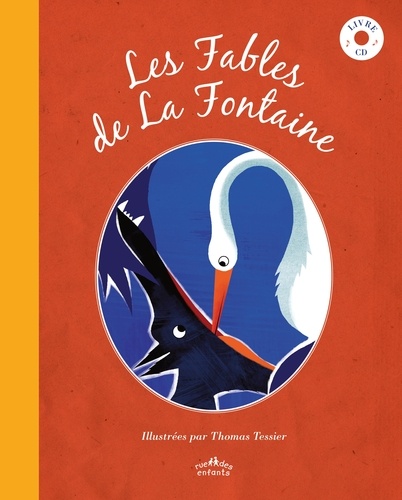
Livres 3 ans et +
Les Fables de La Fontaine. Avec 1 CD audio
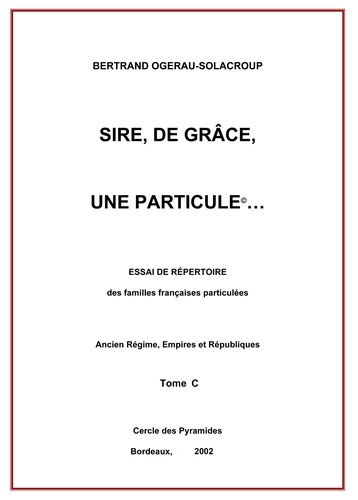
Sciences historiques
Sire, de grâce, une Particule Tome C
03/2002

Essais
Oeuvres complètes. Tome 6 (1986-1990)
05/2021
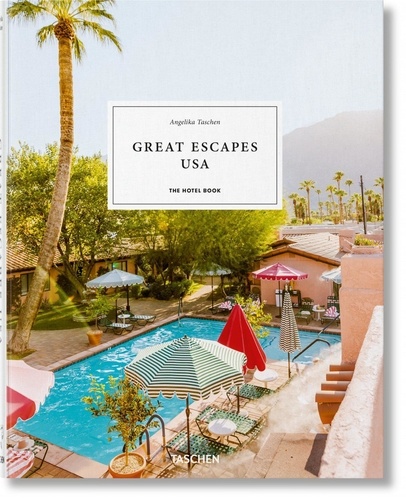
Amériques
Great Escapes North America. The Hotel Book, Edition 2021, Edition français-anglais-allemand
08/2021
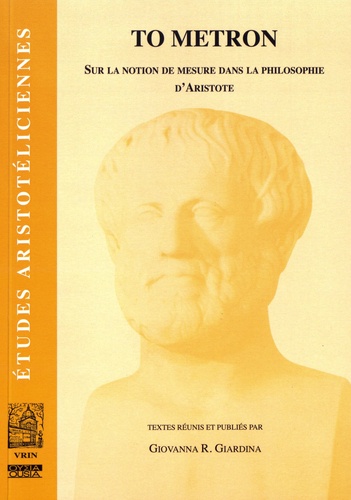
Philosophie
To metron. Sur la notion de mesure dans la philosophie d'Aristote
08/2020
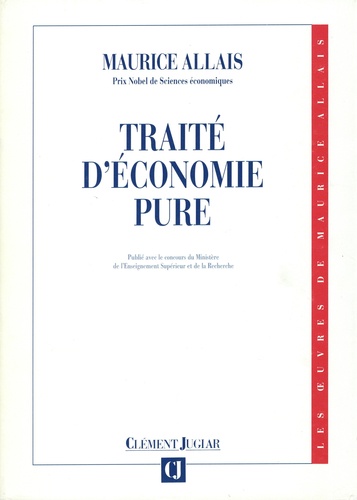
Economie
Traité d'économie pure. 3e édition
05/1994
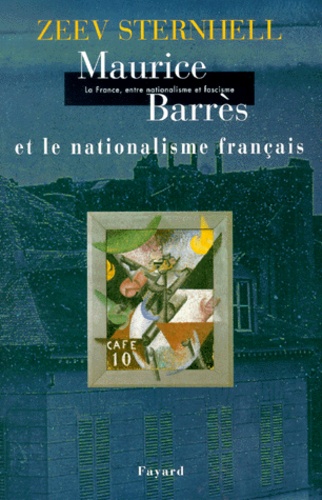
Sciences politiques
Maurice Barrès et le nationalisme français. Edition 2000
09/2000

