OSS 117 : OSS 117 préfère les rousses
Jean Bruce
Avant-propos
Beaucoup de lecteurs m’écrivent pour me poser des questions concernant Hubert Bonisseur de la Bath, aussi connu sous le matricule d’OSS 117. On me reproche de ne pas le décrire avec assez de précision et surtout, à l’exemple de Montesquieu qui s’étonnait : « Comment peut-on être persan ? », on me demande le plus souvent : « Comment peut-on s’appeler Bonisseur de la Bath ? »
Comment ? Je peux répondre… L’histoire de cette « noble » famille est parfaitement connue et l’on sait que l’origine en remonte à l’an de grâce 1461.
1461… Rappelez-vous : Louis XI venait de succéder à Charles VII sur le trône de France. Les Anglais, comme l’avait prédit la Pucelle, avaient été reconduits chez eux manu militari, et le nouveau roi s’employait à consolider sa puissance.
L’Université de Paris était déjà célèbre et très fréquentée. Dans les tripots de la cité, les existentialistes de l’époque menaient grand tapage autour de leur maître incontesté, grand poète et joyeux brigand : messire François Villon.
Or, dans les derniers mois de 1461, une fois de plus, François Villon eut maille à partir avec la justice royale et passa en jugement. Un seul témoin se présenta en faveur du poète. L’histoire n’a pas retenu son nom, peut-être n’en avait-il pas. On sait seulement que, comme Villon, il était membre de la confrérie des Merciers et qu’il y jouissait du titre et des privilèges de « Coesmelotier-Huré ». Cet homme, en bon mercier qu’il était, ne parlait que la langue des argotiers. Aussi, quand le greffier du tribunal lui demanda qui il était, il répondit naturellement :
— Bonisseur de la bath.
Ce qui signifiait en argot : témoin à décharge, « bonisseur » découlant de bonir, parler, et bath signifiant : bien. Le bonisseur de la bath était celui qui parlait en bien, autrement dit : le témoin à décharge.
Mais le greffier n’entendait pas l’argot. Et il inscrivit sur son registre : « Nom du témoin : Bonisseur de la Bath. » L’instant d’après, le témoin s’étant montré insolent fut arrêté en pleine audience et conduit séance tenante au Petit Châtelet où on l’incarcéra sous le nom de Bonisseur de la Bath.
Tout simplement !
Libéré au printemps suivant, notre homme se retrouva nanti d’un bulletin de levée d’écrou portant le patronyme que l’ignorance d’un greffier lui avait donné. Il se fit fort adroitement passer pour une victime « politique » de Louis XI, qui ne manquait pas d’adversaires parmi les grands seigneurs du royaume, et réussit à épouser la fille d’un de ces grands seigneurs qui lui légua son fief.
Cet Hubert Bonisseur de la Bath, premier du nom, fit des enfants à sa noble épouse, et la famille ne cessa de prospérer, s’illustrant surtout par des chefs de guerre qu’un penchant héréditaire pour l’indiscipline et le pillage, doublé d’une conception assez particulière de l’exercice du droit de cuissage, maintint toujours à l’écart des grands commandements. Sans être très riche, la famille ne fut jamais pauvre ; on disait pourtant au xviiie siècle que les seigneurs de la Bath avaient toujours eu plus de bâtards que d’écus.
Quelques années avant la révolution de 1789, on ne sait pas la date exacte, le Bonisseur de la Bath d’alors, pris d’un mauvais pressentiment, vendit tous ses biens et s’embarqua pour les Amériques. Il acheta un grand domaine en Louisiane, près de Lacombe, sur la rive nord du lac Pontchartrain.
Je connais bien ce domaine. Des paquets de mousse espagnole tombent des arbres séculaires qui ombragent la maison, de style colonial, construite au bord d’un bayou dont les eaux vertes et lentes se laissent envahir par les roseaux et par les nénuphars. Chaque soir, lorsque s’allongent les ombres des haies de buis taillé, Bobbo, le vieux domestique noir, insensible aux piqûres des énormes moustiques, fait sa ronde, solitaire et mélancolique, dans les allées du jardin à la française.
Bobbo connaît Hubert bien mieux que moi. Il l’a vu naître, il l’a fait sauter sur ses genoux, il a guidé ses premiers pas…
À l’époque de Pearl Harbor, Hubert Bonisseur de la Bath était un des plus jeunes officiers-pilotes de l’US Air Force. Son insolence native et un penchant immodéré pour le sexe faible ne tardèrent pas à lui attirer des ennuis. Compromis dans une histoire scandaleuse avec la jeune et jolie femme de son colonel, il fut mis à la porte de l’armée de l’air.
Un ami de son père le recommanda alors au général William J. Donovan, qui commandait l’OSS (Office of Strategic Services). L’OSS était à cette époque le principal service de renseignements des États-Unis. Hubert y fut inscrit sous le matricule 117 et aussitôt admis dans une école d’espionnage installée près de Washington, au Country Club du Congrès.
À la fin de son entraînement, Hubert Bonisseur de la Bath, devenu OSS 117, fut versé à la Section autonome des Opérations spéciales, chargée du sabotage. Entre 1942 et 1945, il fut parachuté une douzaine de fois sur l’Allemagne et sur les pays occupés et s’en tira sans dommages.
La guerre terminée, il fut muté à la 2e division de l’OSS, chargée de la recherche des informations par des moyens clandestins. Il avait le grade de commandant.
Le 26 juillet 1947, une loi fédérale créait la Central Intelligence Agency, plus connue sous le sigle de CIA, sous la direction du docteur Allen W. Dulles, le propre frère de Foster Dulles. Hubert passa presque aussitôt de l’OSS à la CIA dont il est un des meilleurs agents.
Nommé colonel en 1950, il a été récemment proposé pour les étoiles. On sait qu’il a refusé, cette élévation au grade de général devant s’assortir d’une renonciation au service actif.
Ses aventures, dans tous les pays du monde, doivent maintenant remplir, si mes fiches sont à jour, une centaine de volumes.
J’allais oublier l’apparence physique. On me demande souvent, surtout les femmes : comment est-il fait ? À quoi ressemble-t-il ?… Là, il m’est difficile de répondre. Peut-être, lorsqu’il aura « raccroché », Hubert m’autorisera-t-il à publier une photographie de lui. En attendant, et bien que cela puisse paraître un peu ridicule à certains, tout ce que je peux dire… c’est qu’il a vraiment l’allure d’un prince pirate.
1
Mon nom est Ernest Peter Nicol. Je suis citoyen des États-Unis, né à Morristown, dans le New Jersey, le 3 décembre 1910.
Ce soir-là, c’était un vendredi, j’assistais à une réception donnée dans les salons du Cumberland, à Londres, par les anciens de l’OSS, le célèbre Office of Strategic Services, créé pendant la dernière guerre et qui fut le premier service de renseignements des États-Unis digne de ce nom.
Il était près de minuit et, l’alcool aidant, l’ambiance était joyeuse. Mon vieil ami John Breck me parlait des derniers événements de Cuba et jugeait sévèrement les gens de la CIA.
— De notre temps…
Il s’interrompit pour regarder une femme brune, entre deux âges, qui venait de s’arrêter près de nous, une cigarette à la bouche.
— Puis-je avoir du feu ? demanda-t-elle.
Elle était de taille moyenne, plutôt rondouillarde, vêtue d’une robe de soie verte un peu trop décolletée sur de gros seins blancs vigoureusement remontés par une gaine qui débordait sous les aisselles trempées de sueur. Elle était anglaise, d’après son accent, et elle avait trop bu. Son visage luisant était congestionné et sa main potelée tremblait un peu en dirigeant la cigarette vers la flamme du briquet de John Breck.
Elle rejeta la fumée, toussota, écrasa du doigt une larme qui perlait au coin de son œil droit irrité, puis retira la cigarette de sa bouche.
— Comme c’est excitant ! dit-elle.
— Quoi ? demandai-je poliment.
Sans répondre, elle regarda les étiquettes que nous portions à nos revers et reprit :
— Monsieur Nicol… Monsieur Breck… Je suis très honorée de vous connaître… Mon nom est Rose Darracott…
Elle épela soigneusement Darracott. Nous fîmes une courbette.
— Enchanté, mademoiselle Darracott…
Elle haussa les sourcils.
— Comment savez-vous que je suis une demoiselle ?
John Breck, qui manie la vacherie avec art à ses moments perdus, répliqua gracieusement :
— Vous êtes encore bien jeune pour être mariée, n’est-ce pas ?
Elle se demanda visiblement pendant un instant si elle devait ou non se fâcher. Elle choisit de rire et gratifia mon ami d’une claque énergique sur le ventre.
— Vous êtes un rigolo, assura-t-elle. Vous me plaisez.
Elle remit sa cigarette entre ses lèvres mal peintes, nous prit chacun par un bras et nous entraîna un peu à l’écart de la foule agglutinée autour des buffets. L’œil droit fermé, à cause de la fumée qui montait de sa cigarette, elle reprit sur le ton de la confidence :
— Je suis fonctionnaire à l’Amirauté… archiviste à la base de Portland…
— Ce doit être un métier très intéressant, dis-je.
Elle toussota, m’examina un instant de son œil gauche, le droit restant fermé, et répliqua :
— Passionnant.
Elle nous tira davantage vers elle et mon coude éprouva la dureté d’une baleine de corset. Pressés sur deux côtés, ses seins semblaient sur le point de bondir à l’extérieur.
— Je suis un peu du bâtiment, chuchota-t-elle.
Puis, comme nous ne réagissions pas, elle précisa :
— Nous sommes un peu collègues, quoi !
— Je suis garagiste, rétorqua John Breck, et mon ami est pharmacien…
Elle soupira, la tête levée vers le plafond comme pour prendre le ciel à témoin de notre bêtise.
— Vous ne comprenez pas… Vous avez été des agents secrets… Eh bien, moi aussi…
— Très intéressant, dit John Breck.
— Je travaille pour vous, continua-t-elle, pour les Américains. C’est à votre attaché naval que j’ai affaire, quel homme charmant… Je lui ai déjà donné beaucoup de renseignements, vous savez, et il est très content de moi…
Nous étions un peu étonnés ; il y avait de quoi. À ce moment précis, deux couples amis, qui faisaient partie de notre pèlerinage en Europe, nous rejoignirent et nous proposèrent de les accompagner pour une tournée dans les cabarets de Soho. Rose Darracott nous lâcha. Nos amis étaient excités et volubiles et il s’écoula un temps assez long avant que j’eusse la possibilité de présenter notre nouvelle connaissance.
Elle n’était plus là. Je la cherchais du regard et la vis sortir par la grande porte du salon.
— Vous nous avez sauvés d’un sort affreux, dit John Breck à nos amis. Nous étions tombés dans les griffes d’une Mata-Hari bourrée d’alcool.
Il ne semblait pas plus que cela préoccupé par l’incident, mais je n’étais pas comme lui. Que cette bonne femme ait dit ou non la vérité, il fallait l’empêcher de continuer de raconter qu’elle trahissait ses compatriotes à notre profit. Je m’excusai auprès de mes amis et partis à la recherche de Seymour, notre attaché naval à Londres, dont j’avais fait la connaissance en début de soirée.
Je le découvris près d’une fenêtre, en compagnie d’une fort jolie brune qui ne semblait pas insensible au charme de sa conversation. Cela me fit hésiter, mais il m’aperçut et me fit un signe de la main.
— Hello ! dit-il.
Une grosse femme en robe de dentelle me bouscula. Nous nous fîmes des excuses. Je pus enfin arriver près de Seymour.
— Il faut que je vous parle, c’est important.
Il fronça les sourcils, visiblement ennuyé, et fit machinalement les présentations :
— Madame Gardner… Nicol…
— Ernest, précisai-je, comment allez-vous ?
Elle me sourit.
— Comment allez-vous ?
— Je suis navré, repris-je à l’intention de Seymour, mais je crois que c’est vraiment important.
Son visage se crispa, exprimant un réel agacement. Ses affaires étaient peut-être en bonne voie avec la séduisante Mme Gardner et il avait plus envie de m’envoyer au diable que de m’écouter. Il balançait encore lorsque la jeune femme intervint gentiment :
— Écoutez-le, George. Je vous attends là.
— Merci, dis-je, et veuillez me pardonner.
Seymour et moi nous éloignâmes de quelques pas. Je lui pris le bras et me penchai vers lui afin de pouvoir me faire entendre sans élever la voix. Il m’écouta, de plus en plus attentif. Lorsque j’eus terminé, il était soucieux.
— Cette bonne femme est folle, répliqua-t-il. Je ne la connais pas…
Il me considérait avec une grande attention.
— Vous me croyez, n’est-ce pas ?
Je haussai les épaules.
— Vous savez, rétorquai-je, j’ai fait du renseignement et je sais comment ça se passe… Même entre alliés, il est quelquefois nécessaire de s’informer. Ce n’est pas le fait lui-même qui me choque, mais je pense simplement qu’il faut empêcher cette folle de raconter ça partout…
Il sortit un carnet et un stylo de sa poche et demanda :
— Vous dites qu’elle s’appelle Rose Darracott et qu’elle est employée à l’Amirauté ?
— Archiviste à la base de Portland ; c’est du moins ce qu’elle prétend…
Je lui épelai le nom. Il nota l’essentiel sur son calepin, remit le tout dans sa poche et me toucha l’épaule.
— Merci, Nicol. Si j’avais besoin de vous ?
— Je suis au Westbury.
— Okay.
Il me quitta pour aller rejoindre la jolie Mme Gardner qui l’attendait patiemment. J’étais soulagé d’avoir pu le prévenir et je partis à la recherche de John Breck et des autres. Ils étaient près de la sortie.
— Où étiez-vous passé ? grogna John. J’ai demandé un taxi et il nous attend.
Nous sortîmes. Il pleuvait. À droite, des lanternes balisaient des travaux, de l’autre côté de Marble Arch ; les frondaisons de Hyde Park étaient à peine visibles. Nous montâmes dans les voitures qui nous emmenèrent par Oxford Street en direction de Soho.
Nous passâmes deux heures dans une boîte de strip-tease, à regarder sans enthousiasme des mémères exhiber leur cellulite. Puis nous rentrâmes au Westbury, qui est l’hôtel américain de Londres, dans Conduit Street, à deux pas de l’aristocratique New Bond Street, à cinq minutes à pied de Piccadilly.
Un message m’attendait sous la porte. Seymour me prévenait qu’il passerait me prendre à huit heures, sans autre explication. La pendule, au-dessus de la penderie, indiquait deux heures trente-cinq. Il ne me restait pas beaucoup de temps pour dormir.
*
Mon nom est Colin Paul Arbuckle. Sujet de Sa Majesté Très Britannique et content de l’être, je suis âgé de quarante-quatre ans, assez bel homme paraît-il, grâce à Dieu, et content de l’être. Je suis inspecteur au MI5.
MI5, cela signifie Military Intelligence division 5. Malgré ce que pourrait laisser supposer le terme Military, cet organisme ne dépend pas de l’armée mais uniquement du Premier ministre. Sa tâche est essentiellement le contre-espionnage à l’intérieur du royaume. Ses effectifs sont recrutés parmi les policiers, les anciens officiers et les hommes de loi. La fonction de ces hommes est strictement limitée à la recherche, la répression ne dépend pas d’eux. Lorsqu’ils sont parvenus à établir des preuves suffisantes contre un espion, ils passent le coupable et le dossier à la Section spéciale de Scotland Yard.
Cette nuit-là, je dormais, comme il m’arrive de le faire, à côté de Victoria, mon épouse, dans le lit conjugal. La sonnerie du téléphone me réveilla. Il était une heure du matin. Mon collègue de service à la permanence de nuit m’appelait pour me demander de me mettre d’urgence en rapport avec George J. Seymour, attaché naval à l’ambassade des États-Unis à Londres.
Je connaissais Seymour depuis quelque temps déjà. Nous avions été en rapport au sujet des événements de Holy Loch. Vous vous souvenez sans doute de ces manifestations de pacifistes contre l’installation de la base de ravitaillement des sous-marins atomiques américains.
Seymour voulait me voir immédiatement. Dans mon métier, c’est chose assez courante d’être ainsi dérangé au milieu de la nuit et, de toute façon, un gentleman ne doit jamais manifester la moindre humeur en pareille circonstance. Je sortis donc du lit sans réveiller Victoria et me dépêchai de m’habiller.
Seymour m’attendait à son bureau de l’ambassade. Il me raconta qu’au cours d’une réception offerte par des anciens de l’OSS dans les salons du Cumberland, une certaine Rose Darracott, qui se disait fonctionnaire à l’Amirauté, avait prétendu fournir à l’attaché naval américain des renseignements sur la base de Portland.
J’aime bien les Américains, bien qu’ils ne soient pas des gentlemen, mais la sympathie que j’éprouve à leur égard ne m’aveugle pas. Ils sont parfaitement capables de nous espionner, ce que nous sommes également capables de leur rendre, et il serait stupide de leur en vouloir. La confiance totale entre alliés n’existe pas encore dans notre monde. On peut être d’accord sur une ligne générale à suivre, mais les intérêts divergent souvent sur certains cas particuliers. La conduite d’une grande nation pose tellement de problèmes qu’il est absolument nécessaire d’être toujours exactement renseigné sur les intentions secrètes des autres pays, y compris ses partenaires. Néanmoins, je crus tout de suite en la bonne foi de Seymour en cette affaire ; d’autant plus facilement que les Américains connaissent bien Portland, où leurs sous-marins atomiques faisaient escale avant que nous ne leur concédions Holy Loch, et que la plupart des expériences secrètes réalisées là-bas le sont en collaboration avec leurs techniciens.
Il y avait donc là un mystère, mais je croyais que ce mystère serait rapidement éclairci. Nous avions suffisamment de renseignements sur la suspecte et, pour ne rien dissimuler, ma première idée fut qu’il s’agissait d’une plaisanterie ayant trouvé sa source dans un excès d’alcool.
Tout de même, il fallait vérifier. Nous autres, agents du contre-espionnage, sommes là pour ça. Il est difficile pour un profane d’imaginer combien de vérifications nous pouvons faire dans une année, qui n’aboutissent à rien ; mais nous devons les faire. Une fois sur cent, nous découvrons le pot aux roses…
Je demandai à George Seymour de bien vouloir m’amener Nicol, l’homme qui avait reçu les confidences de Rose Darracott, dès que possible dans la matinée, à mon bureau. Après quoi, j’alertai un de mes collègues de la sécurité navale et lui donnai rendez-vous à l’Amirauté, au fichier du personnel.
Maintenant, il était huit heures trente et j’avais le dossier de Rose Darracott sur mon bureau. La personne qui portait ce nom exerçait bien les fonctions de secrétaire archiviste à la section expérimentale de la base de Portland. Je savais que la section expérimentale s’occupait plus spécialement des essais et de la mise au point de nouveaux appareils de détection sous-marine assez extraordinaires et qui devaient nous assurer une large suprématie en ce domaine.
Un planton vint m’annoncer que Seymour et Nicol étaient là. Je les fis entrer. Seymour est un grand type racé, qui aurait pu devenir quelqu’un de bien s’il avait reçu une éducation britannique. Nicol était de taille moyenne, brun, avec des lunettes, des cheveux coupés en brosse et de mauvaises manières. Il devait coller son chewing-gum à la tête de son lit avant de s’endormir et mettre les pieds sur la table pour le breakfast, entre les œufs au bacon et la marmelade d’orange. Je me refuse à croire que ces gens-là, bien qu’ils portent des noms bien de chez nous, soient d’origine britannique…
Nicol raconta son histoire, que j’avais déjà entendue de la bouche de Seymour. J’avais de plus en plus la certitude d’une plaisanterie. Je montrai à Nicol une photographie de Rose Darracott, sortie du dossier.
— La reconnaissez-vous ? demandai-je.
Il n’hésita même pas une seconde.
— Sans aucun doute, affirma-t-il. C’est bien elle…
Extraits

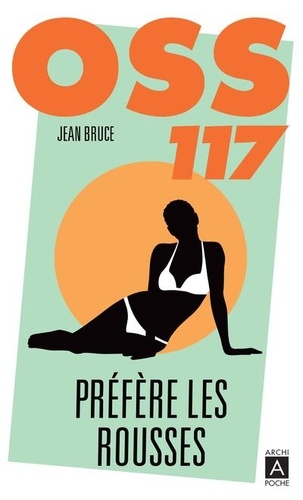


























Commenter ce livre