Je me suis tue
Mathieu Menegaux
Editeur
Genre
Littérature française
« C’est propre, la tragédie.
C’est reposant, c’est sûr… Dans le drame, avec ces
traîtres, avec ces méchants acharnés,
cette innocence persécutée, ces vengeurs,
ces terre-neuve, ces lueurs d’espoir,
cela devient épouvantable de mourir, comme un accident.
Dans la tragédie on est tranquille.
D’abord, on est entre soi.
On est tous innocents en somme !
Ce n’est pas parce qu’il y en a un qui tue
et l’autre qui est tué. C’est une question de distribution.
Dans le drame, on se débat parce qu’on espère en sortir.
C’est ignoble, c’est utilitaire.
Là, c’est gratuit. C’est pour les rois.
Et il n’y a plus rien à tenter, enfin ! »
Jean Anouilh, Antigone
1
La porte vient de se refermer derrière moi. J’attends le claquement coutumier du verrouillage électronique, et voilà. Je suis tranquille, jusqu’à demain matin, 7 heures. Tranquille, façon de parler : il suffit de faire abstraction des plaintes des nouvelles arrivées, du grincement des œilletons qui coulissent et des éclairs de lumière dans la cellule toutes les trois heures. D’en face, du grand quartier des hommes, me parvient le raffut angoissant et obsédant du bâton des surveillants qui tape et retape méthodiquement sur les barreaux des fenêtres avant la nuit, pour s’assurer qu’ils n’ont pas été sciés. Routine de l’administration, qu’elle applique avec zèle. Pas vraiment une berceuse.
Avec moi sont enfermées une centaine de prévenues, mais je suis seule. Très seule. Cette solitude, si dure et si rude, qu’on peut la toucher. Seule et folle. Qui pour me comprendre ? Personne. Qui pour me pardonner ? Personne. Qui pour me juger ? Toutes et tous. Le peuple souverain est en train de le faire, et à coup sûr va me condamner. Il y a trois femmes parmi les six jurés populaires, mais je n’attends d’elles nulle « solidarité féminine ». Dès l’ouverture du procès j’ai été frappée par leur teint, qui n’a pas cette couleur de papier mâché que nous avons toutes, ici, après quelques semaines, comme si les murs déteignaient sur notre peau. J’avais oublié qu’on pouvait avoir bonne mine.
Quant à la cour, qui parade au centre de l’estrade, elle est présidée par un homme, dont la robe d’apparat rouge est bordée d’hermine, signe ostentatoire de pouvoir. Il est entouré d’un homme et d’une femme, ses deux assesseurs, en robe noire. Hommes ou femmes, jurés populaires ou magistrats, experts ou témoins, spectateurs ou commentateurs, peu importe, de toute façon. Tout ce beau monde, face à moi, m’a condamnée dès que je me suis installée dans le box, avant même la lecture de l’acte d’accusation. Je suis entrée dans ce procès sans aucune chance d’en sortir libre.
Voilà deux ans déjà que je suis enfermée dans ce quartier de femmes. Ma vie s’est résumée à des visites au Palais de justice pour les besoins de l’instruction et aux discussions avec mon avocate. Je ne peux pas descendre travailler avec les autres filles, ce serait trop dangereux pour moi. Le reste ? De longues périodes d’attente, ponctuées qu’il pleuve ou qu’il vente de mornes promenades, quelques pas quotidiens dans une cour exiguë où il faut se forcer à ne pas tourner dans le même sens. De fouilles impromptues en douches communes, apprendre à oublier sa pudeur, son intimité et sa féminité. Attendre. Conjuguer le verbe attendre, à tous les temps. J’ai passé ces deux années à attendre. A attendre que la justice accélère enfin pour que démarre mon procès, à attendre que tombe le couperet, la sanction que j’appelle de mes vœux, histoire d’expier enfin en paix et de tenter de redonner un sens à ma vie. Naïve, je croyais encore aux fadaises du catéchisme, à l’éventualité d’une rédemption après la punition.
Mais c’est fini. Je n’ai plus à attendre. Après aujourd’hui, je sais qu’il n’y a plus rien à reconstruire. Les murailles de Jéricho sont à terre. Il ne reste que ruines et gravats. J’ai tout gâché, seule, et tous les châtiments du monde n’y pourraient rien changer, il n’y a pas de rachat possible. Alors ce soir c’est décidé, c’est la belle. Je me ferai la belle. Et au matin, je serai libre, enfin. Je vais retrouver mon identité, je vais redevenir Claire. Fini le numéro d’écrou 13776. Terminé le « Beyle, parloir », le « Beyle, fouille de la cellule » ou le « Beyle, transfert ». Entre ces murs, ni courtoisie, jamais de « Madame », ni prénom. Ici règne en maître l’impersonnel : je ne suis plus que mon nom de famille. En l’occurrence, ce n’est pas même le mien, mais celui d’Antoine, mon mari.
C’est décidé, je vais faire le mur, donc. Tout est prêt. Je vais franchir les murs d’enceinte sans échelle, sans grappin, sans draps noués, je vais voler au-dessus des fils de fer barbelés sans ailes, disparaître sans trucage, m’évanouir sans arme, sans haine, ni violence. Demain matin je pars. Dès que j’aurai fini de noircir ces pages sur mon lit à barreaux, et de les mettre en ordre. Je vais pouvoir oublier, enfin. L’écriture est la dernière étape de mon chemin de croix. Je ne compte pas revenir au troisième jour. Ils ne me reverront pas.
Ecrire. J’avais déjà commencé à rédiger des pans entiers de mon histoire en attendant l’ouverture du procès, c’était une façon pour moi de me préparer à cette épreuve et de sortir pour quelques instants de ma posture mutique. Je ne pensais pas avoir à terminer si vite. Mais il le faut. Parce que avant de passer de l’autre côté, je veux pouvoir me défendre. Me défendre n’est probablement pas la bonne expression. Je suis confuse, j’ai du mal à trouver mes mots. Me justifier ? Comment justifier l’injustifiable ? Expliquer ? Expliquer, oui, c’est ça. Il est temps à nouveau de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Le poids écrasant de la culpabilité m’a ôté l’envie et la force nécessaires, qui m’auraient permis de me défendre, ces derniers jours, au procès. J’aurais pu m’en sortir, là encore.
A présent, je veux livrer mon témoignage dans sa totalité. Puisque la justice tient tant à la vérité, je vous la confie. Je reprends tout, depuis le début. Lisez-moi, qui que vous soyez, la surveillante, le directeur, le président de la cour d’assises de Paris ou un journaliste. Je reprends tout, pour vous, depuis le début. Lisez-moi. Vous êtes ma dernière conversation avant que je disparaisse.
Adieu. Dites à Antoine que je lui demande pardon. Du fond des 21 grammes de mon âme. Il est vain d’attendre ton pardon, Antoine, je le sais. Tu as toutes les raisons de me le refuser. Arrogante, je n’ai pas eu l’humilité de te faire confiance. Suffisante, j’ai voulu m’en sortir toute seule. J’ai été orgueilleuse, stupide et indigne. J’ai aujourd’hui, enfin, la force d’écrire. J’écris pour moi, pour m’évader, non pas en paix, ce serait impossible, mais soulagée du poids de mon silence. J’écris pour toi, Antoine. J’écris pour que tu comprennes et que tu cesses de me haïr. Et j’écris pour vous, policiers, citoyens, magistrats, journalistes, prompts à embastiller en prétextant la recherche de la vérité. Vous la voulez, la vérité ? Lisez.
J’ai choisi la mauvaise route. J’avais espéré qu’elle nous mènerait au bonheur, Antoine et moi. Ce n’est qu’une fois engagée sur cette route que je me suis aperçue qu’il n’y avait pas de sortie. Même cela, ce n’est pas vrai. Les sorties, je les ai toutes ratées, l’une après l’autre. Si bien que la route est devenue une Highway to Hell.
Encore une chanson. Toutes les situations de la vie, des plus gaies aux plus noires, des plus courantes aux plus improbables, ont été décrites en chansons. Alors que je suis incapable de me souvenir d’un film ou du détail des personnages d’un livre, j’ai développé avec le temps une incroyable mémoire musicale. Cet amour des chansons remonte du plus loin qu’il m’en souvienne, lors j’avais quinze ans à peine. J’ai toujours écouté de la musique en travaillant, en me promenant, en me levant, en me couchant, quand j’avais le cafard, quand j’étais heureuse. Je chantais ce que je pensais. Je me souviens ainsi d’avoir quitté un garçon, à dix-huit ans, attablée avec lui dans un café, en fredonnant I don’t need you any more, you’re nothing. Il m’a demandé en riant, insouciant : c’est vrai ? Et j’ai répondu oui. Il n’y avait rien à ajouter. Je ne l’ai jamais revu.
Les chansons ne m’ont jamais déçue ni trahie. Combien de fois ai-je écouté ou fredonné ce que je n’arrivais pas à formuler ? Elles m’ont toujours accompagnée et c’est peut-être grâce aux chansons que la solitude m’a été moins pesante. Cette nuit, derrière ma porte électroniquement close, je chantonne encore pour me donner du courage.
Assez tergiversé, il ne me reste que quelques heures pour mettre un point final à mon histoire.
Je reprends.
Extraits

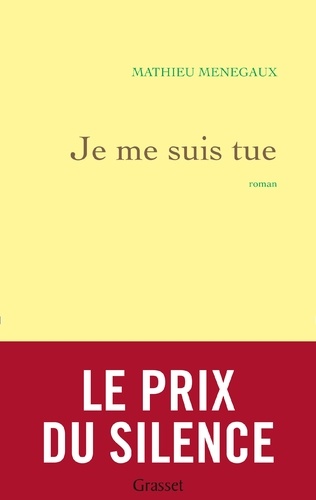


























Commenter ce livre