Une chinoise ordinaire
Stéphane Fière
I
PREMIÈRE JOURNÉE
Moi j’aime l’amour.
Enfin, entendons-nous, pas les sentiments – confusion de l’esprit, égarement du bon sens – ni les maux qui les accompagnent : inquiétude permanente, désarroi, absence insoutenable et raison qui chancelle, non, rien d’aussi fade, ces âneries je peux les lire sur mon iPad 5 (3 688 renminbi) ou ma liseuse Hanvon (Wisesmart M10690, 2 999 renminbi), dans nos romans gluants de mièvrerie, de regards fondants, de mains qui tremblent et de cœurs qui battent sans comprendre, non, non, non, trois fois non : moi, j’aime le sexe.
En plein milieu de l’enfer, seule dans la lutte pour n’être pas dévorée, face au grand traquenard de la vie, chacune se défend avec les armes dont elle dispose : les bras ou la tête.
Mon arme à moi, c’est ma beauté, évidemment.
Évidemment.
Ah ma beauté, mon capital le plus précieux, un don de la nature, mes clients le disaient – le disent toujours –, qui les attire, qui les fascine j’oserais dire si j’étais moins modeste, une nouvelle Yang Guifei, “la beauté chinoise classique, cheveux de jais, taille flexible, œil de biche, féminité, féminité, si féminine”, ça c’est Lucien Gardenne qui parle, ha ha, j’étouffe un gloussement, je ne vais pas le désapprouver ce cher Lao Lu, mais il n’y connaît rien, pas plus lui que tous mes autres clients, la beauté chinoise classique elle est menue, plate et sans fesses, quasi poitrinaire, fragile et délicate, un souffle, une expiration, un soupir de femme, avec le visage triste, enduit de poudre blanche et, sur les lèvres, presque obscène, une touche de vermillon, grimage sur un être qui n’était déjà plus, ou n’avait jamais été, évanescent, comme cette chèvre de Lin Daiyu dans Le Rêve dans le pavillon rouge, quel plaisir aurait-elle pu donner, une véritable imposture et moi son exact contraire qui suis grande, spontanée, éclatante, toute de courbes, pleine de vie.
Mes clients, non, le mot est mal choisi, je devrais plutôt parler de mes patients, ces grands malades de la Chine, je les soigne en quelque sorte et leur procure de la joie avant les derniers soubresauts. Je suis l’infirmière des ultimes besoins, la thérapeute des corps qui cherchent à vibrer avant l’arrêt définitif, le terminus, le temps qui passe et ne reviendra plus.
Où en étais-je, oui, donc, la beauté classique : mensonge, supercherie, fraude à la marchandise, une irritation dans la journée, un désastre pendant la nuit ; rien à voir avec la mienne, et heureusement que mes patients ne comprennent rien aux femmes chinoises, ni à la Chine d’ailleurs sinon j’en perdrais jusqu’à ma valeur liquidative ! Ha ha je plaisante, je plaisante. Pour l’instant ma beauté est toujours là, qui maintient ma cote et mes prix, pas comme cette pauvre Liang Duoduo qui doit se soumettre aux dernières bassesses pour se nourrir, déjà au collège numéro 7 et dans notre quartier, on la montrait du doigt, Ciel qu’elle était moche, toute grêlée et les cheveux gras, une vraie piste d’atterrissage en plus et maintenant un autobus depuis que le sort s’acharne : dans son salon de coiffure elle est obligée de prendre ce qui monte – et qui monte demanderez-vous – mais les masses grouillantes des culs-terreux des échafaudages environnants, ma ville, la Perle de l’Orient, ou la Pute de l’Asie, un chantier perpétuellement à ciel ouvert, et ces mingong hideux qui rappliquent en flots ininterrompus du fond de leurs campagnes pourries, pas fameux comme gagne-pain pour assurer le loyer et le repas du soir, grosses mains gros pieds1, c’est sale, ça empeste et ça ne se lave que la veille du retour au village natal pour la fête du Printemps, et mon tout pour quarante renminbi le tourniquet, quarante renminbi, renminbi, renminbi, la Monnaie du Peuple, renmin de bi, le Vagin du Peuple, oui2 ! Je ne la vois plus depuis longtemps la femme de tout le monde, mais j’ai de ses nouvelles quand Wang Li-Mei ou Shuang Lang redescendent à Shanghai une semaine par mois pour jouer les numéros deux et justifier auprès de leurs papas en sucre les appartements dans la résidence Upper Luxury Magnificence et les MiniCar dont l’utilité principale consiste à se garer sur une place en vue à l’entrée du Posh Posh, la boîte de nuit des happy few : elles passent exprès devant le bouge de Duoduo et si elle est inoccupée, elles la prennent en photo derrière sa vitrine, épandue sur son fauteuil, le sourire racoleur pour amorcer le pouilleux n’ayant rien d’autre que cet aspirateur-éponge pour se soulager, ses lingettes qui pendent à sécher entre deux arbres sur le trottoir, ses rideaux dépenaillés, son enseigne qui ne clignote même plus, et la tête qu’elle fait, hilarant, on y lit toute la détresse et l’humiliation de la terre, et moi quand je reçois les images sur mon iPad, ça me rend heureuse, et plus sucrée encore et savoureuse l’intensité de ma réussite.
Extraits

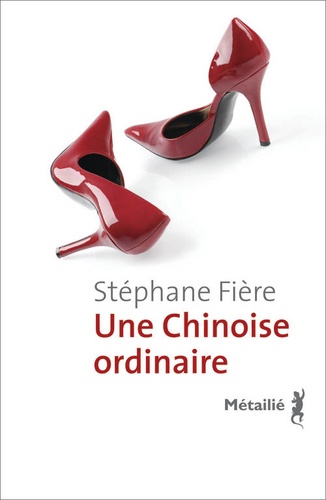


























Commenter ce livre