La route des clameurs
Ousmane Diarra
L’aube des temps
Un : Ne vous attendez pas à connaître mon nom. Parce qu’à force d’ajouts et de rallonges à n’en plus finir, il était devenu trop long à porter dans ma seule tête de gamin. Quant aux autres personnes, vous pouvez imaginer ce que cela pouvait leur coûter, à chaque fois qu’elles devaient m’appeler, d’aligner huit prénoms comportant chacun autant sinon plus de syllabes que le mot français « anti-constitutionnellement », clôturés ensuite par un patronyme tout aussi immense et long que le fleuve Niger dont il tire ses origines lointaines. Voilà donc quelques raisons pour lesquelles je m’en suis débarrassé très vite. Et pour avancer plus vite dans la vie.
Je l’ai fait sans regret aucun. Et aussi en me disant qu’après tout, un nom, ce n’est pas une marque déposée dans l’éternité. Surtout dans notre cas d’espèce, nous autres Blacks nègres afro-africains désespérément vissés au bled-continent, taillables et corvéables à merci. Où n’importe quel malabar doté d’un minimum de muscle et de cervelle peut nous tomber dessus et nous en imposer de son cru.
Deux : En me débarrassant de ce nom trop long et trop lourd à porter, je suis devenu un homme à l’âge où d’autres s’accrochent encore au pagne de leur maman. Et ça, c’était le plus important. Le reste, on verra quand j’aurai conduit mon papa à Bazana, et que j’aurai retrouvé ma mère et Kany et Nématou, mes sœurettes éprouvées par tant de malheurs tombés du ciel. Alors qu’elles n’ont rien fait de mal à personne. Et Manamani de Bazana, surtout elle, mon double au féminin, mon premier et dernier amour !
Eh Allah ! moi qui croyais qu’elle n’était qu’un songe, Manamani de Bazana ! Une apparition improbable au détour d’un méchant cauchemar ! Je n’allais donc la revoir qu’au paradis ! Et pour la rejoindre dans le jardin des délices éternelles, il me fallait me dépêcher de mourir ! Eh Allah ! et pour mourir vite et bien, combien de fois ai-je nargué la mort pour qu’elle se fâche contre moi et dégaine son sabre étincelant ? Qu’elle m’emporte vite, vite, au paradis où m’attendait Manamani de Bazana !
Mais tout s’était passé comme si elle ne voulait pas de moi, la mort. Je l’ai provoquée, narguée, insultée, en vain. Je me la serais proprement donnée si le Calife et tous ses cadis réunis, ils ne m’avaient pas dit que c’était la meilleure façon pour ne plus jamais entendre parler du paradis ! Il fallait plutôt donner sa vie, le meilleur de sa vie en se battant pour la noble cause des Morbidonnes du Calife Mabu Maba dit Fieffé Ranson Kattar Ibn Ahmad Almorbidonne.
C’est ainsi que pour tuer mon ennui de la vie et mon impatience de rejoindre mon amour éternel au jardin des délices éternelles, j’avais composé une chanson que je continue de fredonner en maniant mon kalach souverain :
En or, en argent,
Petit éventail du paradis,
En or, en diamant poli
Pour t’envoyer courant d’air frais
Depuis ici, mon Mali rêvé !
Oh Manamani de Bazana !
Manamani de Bazana, elle n’était donc pas qu’une apparition, mais bien Mariama ! Et dire que le grand Calife Mabu Maba dit Fieffé Ranson Kattar Ibn Ahmad Almorbidonne m’avait fait croire qu’elle était sa propre fille, la seule et unique qu’Allah lui avait donnée ! Et qu’il me la destinait ! Quelle fabulation ! Et d’office, je devenais l’héritier de son trône et de tous ses mensonges de faux grand Calife !
Eh Allah ! Or donc, le grand Calife, il avait volé Manamani de Bazana. Ou plutôt, il l’avait prise de force à ses parents. Et puis il avait changé son nom. Il l’avait rebaptisée Mariama Ibn Mabu Maba dit Fieffé Ranson Kattar Ibn Ahmad Almorbidonne ! Et il croyait ainsi pouvoir me tromper et tromper le monde entier jusqu’à la fin des temps ! Il s’est trompé lui-même, le faux grand Calife. Et c’est bien fait pour sa vilaine gueule. Si moi je retourne à Maabala — je jure sur tout ce que je me rappelle de noms d’ancêtres que je vais y retourner —, je vais rechercher son cadavre fétide et le massacrer de nouveau et encore et encore... jusqu’à massacrer le coin maudit de la terre qui aurait accepté de le recevoir dans son sein, ce macchabée puant ! Wallahi !
C’est maintenant que je vois distinctement les choses : le prétendu grand Calife, il s’est fait rouler dans la farine par le prétendu plus grand Calife dont il faisait souvent les éloges dans ses prêches grandiloquents. Et lui aussi, notre faux Calife, pour se venger d’avoir été trompé par son plus grand Calife, il s’est mis à son tour à tromper tout le monde. Et tout le monde aussi s’est mis à nous tromper, nous les petits riens d’Afrique et des environs. Et nous les petits riens d’Afrique et des environs, nous nous sommes mis à nous tromper les uns les autres. Voilà pourquoi le monde entier est devenu ce qu’il est devenu, un mouroir, une grosse boule de feu suspendue entre ciel et terre. Et voilà pourquoi je serai encore plus féroce avec tout le monde. Et aussi pourquoi je vais tuer jusqu’à tuer la portion de la terre qui accepterait de recevoir les cadavres de mes ennemis. Oui, quand je vais retourner à Maabala. Eh Allah !
Depuis quatre jours que nous marchons à pas de foie, mon papa et moi. On coupe à travers champs. On grimpe sur des collines. On escalade des montagnes. Nos pieds, nos mains, nos genoux, ils sont si abîmés que nous ne ressentons plus la douleur des morsures des épines et des rochers aigus comme des couteaux de Tabaski. Même que mon papa, il a cessé de gémir à chaque chute et de maudire ciel et terre d’avoir vomi sur nos pauvres têtes à claques tous leurs chargements de calamités.
Mon papa ouvre la marche. Moi je le suis. En silence. On se glisse dans les fourrés épais à couper à la machette. Moi, en bon Morbidonne djihadiste aguerri, je guette la moindre présence humaine. Je sens l’homme comme le chien sent le gibier. Prêt à brandir mon sabre étincelant ou mon kalach, selon. Mon lance-roquettes et mon missile Stinger portatif, j’ai dû m’en débarrasser parce qu’ils n’étaient pas faciles à porter par moi seul. Et mon papa, il répugne toujours à porter toute arme, lui qui se dit descendant de guerriers intrépides ! Je le regrette maintenant parce qu’il n’y a pas meilleur moyen de bousiller un homme ou n’importe quel engin méchant. Un lance-roquettes. Un missile Stinger portatif. Une grenade offensive antichar, ou quelque chose de ce genre. Même que le diable en personne hésiterait à deux tours avant de se montrer au travers de notre chemin.
Au départ de Maabala, j’avais voulu prendre un des pickups flambant neufs que le grand Calife m’avait offerts. Mais Zabani Zabata m’avait dit que ce n’était pas une bonne idée. « Trop con ! Toi, mon propre frangin, au volant d’un pickup flambant neuf pour traverser tout Kallakatta ! Et après Kallakatta tout Maabala dévasté ! T’as idée de ce que ça va donner ? » Des Morbidonnes djihadistes allaient donc chercher à en savoir plus sur cette sortie suspecte, et faire tous les boucans du monde autour. D’autant plus que tous, ou presque, savaient qu’à pareille heure, j’aurais dû être avec le grand Calife, dans sa résidence privée. Ne voyais-je pas le palais truffé d’Égyptiens, Iraniens, Pakistanais, Syriens, Tchétchènes et tant d’autres jeunes déboussolés que d’autres fous et menteurs fieffés avaient envoyés en renfort au Calife et au capitaine Aldansira Ibn Nababa ?
C’était donc pour toutes ces raisons et pour assurer la sécurité de notre famille que Zabani Zabata, mon grand frère, avait fait appel à son ami et compatriote, le capitaine Almamara dont le Calife — Zabani Zabata avait fini par me le confier sous le sceau du secret — avait exterminé la tribu aux premières heures de l’invasion des Almorbidonnes djihadistes. Le capitaine Almamara avait déjà réussi à faire partir ma mère, mes sœurs, Dramane Makamba et Mariama.
« Mariama ? que je demandai à Zabani Zabata.
— Oui, Manamani de Bazana, la fille de tonton Dramane Makamba, l’homme que le Calife voulait obliger à épouser maman !... Le capitaine Almamara va vous conduire hors de portée des canons ennemis. Dépêche-toi donc ! Demain va être un autre jour ! »
Et par Allah, le capitaine morbidonne supérieur Almamara, personne ne pouvait l’arrêter. Tous les autres Morbidonnes le reconnaissaient tout de suite au drapeau noir qui flottait toujours devant son pickup et la poussière qu’il soulevait derrière lui. Et il fallait être fou suicidaire pour lui demander de s’arrêter à un barrage. Boum ! Boum ! Paratata ! Il arrosait tout le monde et se frayait gaillardement son chemin.
En outre, le capitaine morbidonne supérieur Almamara me connaissait bien, puisque c’était à lui que Zabani Zabata m’avait confié pour ma formation.
Il nous avait donc embarqués, mon papa et moi, dans son pickup et avait filé à toute allure. Il avait traversé tout le palais sans être inquiété, traversé tout Maabala à la même allure, sans qu’aucun Morbidonne nous ait sifflés. C’est à vingt kilomètres de Maabala, après avoir franchi le dernier barrage de contrôle qui ne nous avait pas contrôlés non plus, qu’il nous avait déposés pour rebrousser chemin. Pendant tout le trajet, il n’avait pas placé un seul mot. Ce n’était pas un homme de parole mais d’action, le capitaine morbidonne supérieur Almamara.
Nous avons marché dans la nuit, mon papa devant, moi derrière. Zabani Zabata nous avait dit de tout faire pour être le plus loin possible de Maabala avant le lever du jour. Car le lever du jour pouvait être très compliqué ! Il oubliait que depuis l’arrivée des Morbidonnes au Mali, tous les levers du jour étaient compliqués. Des fois, le jour ne se levait même pas. Le soleil restait caché derrière des montagnes de brouillards denses, compacts. Comme s’il avait peur, lui aussi, des Morbidonnes djihadistes.
On n’avait pas de lampe, du moins, on n’avait pas le droit d’en allumer. Même mon papa n’avait pas le droit d’allumer sa pipe. Eh Allah ! comme il en avait pourtant besoin par ces temps de peine ! Je le sentais à son humeur massacrante. Quel que soit le problème, il lui suffisait d’allumer sa grosse pipe, et de la fumée, faire une grosse moue à la vie. Et voilà, il retrouvait tout de suite sa tranquillité d’esprit. Mais cette fois, malheureusement, il ne pou-vait allumer sa pipe qu’au lever du jour. Et pour ne rien arranger, à peine le capitaine morbidonne supérieur Almamara nous avait-il débarqués qu’une grande méchante pluie, comme si elle nous attendait au tournant, s’était mise à nous mitrailler de toutes parts. On n’avait même pas prêté attention aux nuages qui s’accumulaient à l’ouest depuis l’après-midi. Mais voilà donc que la pluie elle-même se faisait complice de nos ennemis, les Morbidonnes étrangers venus des quatre coins du monde pour nous voler nos terres et nos âmes. Ils n’allaient peut-être pas tarder à se lancer à nos trousses quand ils auraient découvert le cadavre puant de leur maître, et échappé peut-être à la mitraille impitoyable de Zabani Zabata.
Nous avons donc marché jusqu’au lever du jour, mon papa devant, moi derrière. Mais j’étais très souvent obligé de passer devant parce que si mon papa pouvait bien connaître la brousse, il ne connaissait rien des œufs de la mort. « C’est quoi ça encore, les œufs de la mort ? », qu’il m’a demandé quand je lui ai dit de faire attention de ne pas marcher sur un œuf de la mort que je voyais devant lui. Il ressemblait à une boule de billard, et était enfoui dans un petit tas de sable et recouvert à moitié par des branchages. « Les œufs de la mort, mon vieux papa, j’ai répondu en riant malicieusement, c’est de petits trucs comme des boîtes d’allumettes ou encore des boules de billard. Les grands méchants qui en veulent à tout le monde, bêtes et gens, les cachent dans le sol. Et, eh Allah ! ils font plus de mal que mille millions de mille boîtes d’allumettes parce que quand par malheur tu montes dessus, que tu sois un homme, un animal ou même un arbre, ils déclenchent la Troisième Guerre mondiale contre toi et te charcutent comme on aurait fait d’un cochon de lait si les cochons de lait avaient le droit de vivre dans notre foutu pays ! »
Ouais, mon vieux papa, il connaissait bien la brousse mais les œufs de la mort, moi, je les connaissais mieux que quiconque. Même que je les connaissais mieux que les traces de ma propre main. Parce que j’avais vu des tas de gars se les ramasser en plein bidon. Et boum ! Leurs jambes partaient au nord pendant que la tête et le reste fonçaient tout droit au sud. Eh Allah ! les œufs de la mort, même une mouche, wallahi, si elle marche dessus, elle est morte en mille morceaux avec chacun dans sa direction ! Comment reconnaître les endroits où les œufs de la mort sont cachés dans le sol ? Pas facile, mon gars, je t’avoue ! Tu vois un petit tas de bout ou de sable recouvert d’herbes sèches ou de branchages ? N’y pose pas le pied sinon aucun macchabée ne te devancera à Lahara, le pays des ossements. Tu vois un objet comme un petit ballon enfoui dans le sable, avec une partie qui scintille aux rayons du soleil ? N’y touche pas, sinon personne ne te devancera à Lahara. Et c’est en vain qu’on recherchera tes restes à la loupe. C’est dire combien ces petits machins sont méchants et combien ceux qui les fabriquent sont encore plus méchants...
« Tiens, papa, regarde ! » que j’ai dit à mon papa en lui montrant ce qui restait d’une chamelle déchiquetée et dispersée sur vingt mètres à la ronde. « C’est ça le travail de l’œuf de la mort. La pauvre chamelle, elle a marché dessus. » Plus loin encore : « Tiens, papa, regarde devant toi, tout droit ! » Les restes d’une jeune femme jonchaient le sol, éparpillés comme des feuilles mortes. Elle était venue chercher du bois de chauffe, que j’ai expliqué à mon papa demeuré sans voix. Elle a marché sur un œuf de la mort. Et elle en est morte.
Eh Allah ! Si je pouvais faire en sorte que les œufs de la mort disparaissent de la terre. Parce que même une tortue qui n’a rien fait de mal à personne, si elle marche dessus, eh ben, badaboum, elle est première à répondre présente à Lahara, ossements sur ossements. Et même qu’on ne peut pas utiliser sa carapace parce que l’œuf de la mort, il a tout carbonisé.
« Tiens, mon vieux papa, regarde cette grosse bête ! Comment c’est déjà ? — Un bubale », a répondu mon papa. Le pauvre, il avait marché sur un œuf de la mort. Et maintenant, son ventre était ouvert, ses tripes répandues sur trente mètres à la ronde. Eh Allah ! Même la viande de la bête, on peut pas y toucher alors qu’on meurt de faim, mon vieux papa !
Nous avons marché encore toute une journée et toute la nuit. Il fallait éviter les clairières. C’est là qu’il y avait le plus grand danger. Pas à cause de ces méchants génies de la brousse dont notre mère nous parlait souvent. Eux, ils avaient détalé dès que les premiers coups de pétard avaient tonné. Mais des œufs de la mort ! Et tant d’autres calamités que les Morbidonnes djihadistes avaient amenées au Mali, qui faisaient la terreur des hommes et des bêtes et des arbres ! Même que la pluie elle-même avait peur de tomber, désormais.
Mon papa connaissait mieux la brousse que la ville où il vivait pourtant depuis l’âge de dix-sept ans, et où il avait passé plus de quarante ans à bâtir une vie que des gamins malotrus avaient détruite en une matinée. La preuve, nous avions parcouru plus de cent cinquante kilomètres sans traverser un seul village, sans emprunter le moindre chemin, sans croiser un seul homme ! Au fur et à mesure qu’on s’éloignait de Maabala pour nous enfoncer dans la brousse orpheline, les œufs de la mort se faisaient rares. Et c’est pourquoi les lièvres, les phacochères solitaires et autres fouines au nez de musaraigne se montraient de temps à autre, surtout dans la grande vallée herbeuse du fleuve Folongo, premier cours d’eau que nous avions eu du mal à traverser à guet avant d’atteindre les grandes plaines de Bazana. Les phacochères, avec leurs défenses poussives qui leur sortaient du front et des deux côtés de leur vilaine gueule, étaient les plus féroces à nous provoquer à tout bout de champ. Ils se moquaient de nous en montrant leurs abominables défenses chaque fois qu’ils nous voyaient nous glisser sous les frondaisons. Et sans mon papa qui me disait de les laisser tranquilles, pour sûr que je leur aurais filé quelques rafales de mon kalach que je portais en bandoulière. Parce que je ne voyais pas la raison qui les poussait à se moquer de nous. Nous ne leur avions rien fait de mal. Mais même que papa ne voulait pas que j’en descende un pour notre repas. Alors même que le couscous sec que maman avait laissé avec Zabani Zabata comme viatique était presque fini.
Même les babouins aux fesses enflammées par je ne sais quoi ricanaient à notre passage, comme si eux qui ne portaient ni chemise ni pantalon, ils étaient plus évolués, plus civilisés que nous les hommes. « Bien fait pour vos vilaines gueules d’humanoïdes attardés ! » semblaient-ils dire en nous regardant nous faufiler entre les arbres.
Mais à chaque fois que je me fâchais et brandissais mon sabre étincelant et mon kalach pour bousiller tous ces misérables, il me disait, mon papa, de rengainer mes armes tout de suite, et me répétait que c’est dans les sociétés arriérées que la moquerie et les méchancetés sont les plus développées, de même que la peur et les superstitions. Et il me citait l’exemple vivant de Maabala où, disait-il, ce grand bandit de Mabu Maba (il ne disait jamais le grand Calife ni la longue liste d’épithètes qui suivait), où donc ce grand bandit de Mabu Maba avait réussi à prendre le pouvoir pour terroriser la population avec des fables tirées du VIIe siècle d’outre-désert !
C’est vrai que mon papa était d’accord avec peu de gens, surtout depuis l’invasion du pays par le Calife Mabu Maba dit Fieffé Ranson Kattar Ibn Ahmad Almorbidonne et sa horde barbare de Morbidonnes ramassés dans les caniveaux, aux quatre coins du monde ! Et c’était pourquoi beaucoup de gens voulaient sa peau.
Mais la peau de mon vieux papa n’était pas à la portée de n’importe qui. C’est pourquoi personne n’avait pu se la payer. Ni les voisins qui lui en voulaient à mort parce qu’il n’allait jamais à la nouvelle mosquée du quartier, ni ses cousins, cousines, frères, sœurettes, oncles et consorts, pour la même raison. Ni même le terrible grand Calife Mabu Maba dit Fieffé Ranson Kattar Ibn Ahmad Almorbidonne, qui, pourtant, avait juré devant Allah et devant les hommes et les femmes et les enfants réunis d’avoir sa peau s’il ne se soumettait pas à ses lois divines. Ma mère, elle-même, qui pourtant l’aimait bien, était entrée à son tour dans la terrible cabale. Elle avait en vain jeté toutes ses forces dans la bataille pour le faire plier. Elle avait échoué et avait quitté la maison en pleurant comme une orpheline, emmenant avec elle mes sœurettes. Ces dernières n’avaient d’ailleurs pas le choix. Elles étaient trop petites pour se débrouiller. Moi, je suis resté avec mon papa parce que je savais qu’il avait la peau dure et qu’il allait finir par gagner.
Au palais du grand Calife Mabu Maba dit Fieffé Ranson Kattar Ibn Ahmad Almorbidonne, ma mère était revenue à la charge. Mais là aussi, elle avait échoué à faire plier mon papa. Et nous en avions tous pris plein dans la gueule pour mon papa : Nématou et Kany, mes sœurettes que le Calife avait retenues en otage, Zabani Zabata, le premier à s’être fait avoir par le grand Calife...
Mais malgré tout, si le grand Calife Mabu Maba dit Fieffé Ranson Kattar Ibn Ahmad Almorbidonne, il n’avait pas publiquement prononcé le divorce de maman et de papa, sans même avoir demandé leur consentement, peut-être que je n’aurais pas fait ce que j’ai fait, et qu’on serait encore dans son palais. Non seulement il avait prononcé ce divorce, une vilenie et une humiliation suprême pour Zabani Zabata et moi qui avions tout fait pour lui, surtout moi, mais eh Allah ! il avait eu le culot de célébrer sur-le-champ le remariage de maman avec ce Dramane Makamba qu’il avait fait traîner jusqu’au stade !
Bien avant, j’avais moi-même supplié mon papa en vain. Je lui avais dit avec insistance que lui seul ne pouvait pas tenir tête à tout le monde, et qu’il devait se rendre à l’évidence : tout le monde s’était aplati devant le nouveau maître des hommes. Même les militaires, eux qui, dit-on, jurent sur le drapeau national de défendre la patrie au prix de leur vie, ils s’étaient tous mis à genoux pour demander la bénédiction d’Allah et du grand Calife Mabu Maba dit Fieffé Ranson Kattar ibn Ahmad Almorbidonne ! Pas parce qu’ils avaient peur de la mort ! Ah ça, non ! On n’est pas des descendants de trouillards, nous ! Le général de Gaulle peut le témoigner. Parce que pendant la Seconde Guerre mondiale, nous étions les plus nombreux des tirailleurs sénégalais, et au point que la langue bambara était la deuxième du manuel des tirailleurs. Après le français, bien entendu. Même le maréchal Pétain, il sait très bien que les Maliens, jadis appelés Soudanais, ils ne sont pas des lâches qui se dégonflent au moindre coup de pétard. Car nous avons participé aussi à la Première Guerre mondiale, où nous nous sommes battus comme des lions ! Comment comprendre alors cette défaite humiliante de nos soldats dont certains auraient jeté leurs armes et leurs tenues militaires pour fuir comme des lapins ? Eh Allah ! « La pire des défaites est celle de l’esprit ! Les gamins imams des nouvelles mosquées nous y préparaient depuis de longues années ! » C’est mon papa qui, un jour, a répondu à la question.
Je lui avais dit, toujours à mon papa, que la voie qu’il s’était choisie était devenue intenable, suicidaire, et qu’il ne pouvait que perdre. Il avait refusé en disant que sa liberté n’était pas négociable. Cette fois, il avait parlé comme un politicien : « Pas négociable ! » Lui qui détestait la politique parce que les politiciens disent toujours que des choses ne sont pas négociables pour mieux les négocier ! Donc, quand il m’avait dit que sa liberté n’était pas négociable et qu’il n’était redevable à personne sur cette terre, cela m’avait fait nourrir l’espoir qu’il allait enfin se rendre. Mais mon espoir avait été de courte durée. Car il avait tout de suite ajouté qu’il était hors de question que lui, il se soumette à un vaurien ! Il parlait ainsi du grand Calife Mabu Maba dit Fieffé Ranson Kattar Ibn Ahmad Almorbidonne. Et il avait parlé à haute et intelligible voix. Tout le monde avait entendu. Sans moi, et accessoirement Zabani Zabata, cela lui aurait coûté cent coups de trique sur-le-champ, et devant tout le monde, voire la décapitation pure et simple. Et a bana ! C’est terminé ! Il allait interdire qu’il fût inhumé dans le cimetière musulman. Et comme à Maabala, il n’y avait plus un autre cimetière, il allait ordonner d’offrir sa dépouille aux chacals de la brousse environnante...
Je le sens, mon vieux papa est très fatigué. Ses pas s’alourdissent, son souffle devient saccadé. Je lui demande qu’on prenne une pause, juste une demi-heure. Il refuse. Il m’assure qu’il tient bon et que Bazana n’est plus très loin. On peut entendre le chant de ses coqs, tout heureux d’être encore libres de chanter. Le martèlement des pilons de ses femmes, et bientôt, peut-être, je le souhaite de tout mon cœur, les voix de ses hommes et de ses femmes et de ses enfants heureux d’être encore libres de parler à voix haute. Bazana ! J’y retrouverai Manamani de Bazana, avec ma mère et mes sœurettes !
Il me l’avait dit, mon vieux papa, qu’il ne quitterait ce monde qu’une fois parmi les siens. C’est pourquoi je suis tellement heureux de le voir se glisser maintenant sous les hautes herbes, lentement.
On longe le fleuve Bazana qui l’avait vu naître. Dans quelques heures, on sera à Bazana. Et s’il devait mourir, il le sera au milieu des siens. Quant à moi, faut que je retourne à Maabala pour prêter main-forte à Zabani Zabata, mon grand frère. Il doit être maintenant au four et au moulin, peut-être assiégé par les nouveaux débarqués qui se seraient rendu compte de la mort du faux grand Calife, et voudraient en profiter pour nous prendre notre pays. Plutôt crever !
Le berger des dromadaires
Wallahi ! Bilahi ! Talahi ! C’est moi qui vous le jure, l’indolent et sommeilleux berger des dromadaires, s’il passe une journée à dormir, il en mettra deux à courir pour retrouver ses grandes bêtes aux pas amples !
Au Mali, les Morbidonnes djihadistes de la fin du monde ne s’étaient pas encore lourdement vautrés sur nos âmes damnées et nos consciences de nègres afro-africains condamnés au bled-continent, aussi amnésiques qu’une poulette de chair qui se fiche de la façon dont elle sera bouffée le lendemain ! Du moins, pas complètement. Mais déjà, la terre et le ciel grondaient de leurs colères immenses et de leurs menaces apocalyptiques de briser nos terres et nos cieux en mille morceaux, et de nous en balancer par-dessus bord, dans l’enfer aux sept milliards de laves incandescentes.
Mais malgré cette chape de plomb sur nos têtes de nègres, personne n’aurait eu l’outrecuidance de traiter mon papa de cochon. Car il restait un grand, le plus grand de tous ceux qui savaient encore faire travailler leurs méninges pour nous offrir autre chose que l’indigeste mélasse des gamins imams des nouvelles mosquées : matin sermons, midi sermons, soir sermons, sommeil sermons, réveil sermons ! Même que leurs sermons continuaient de nous terroriser jusque dans la tombe !
Mon papa était donc le plus grand peintre et sculpteur du pays, le seul à n’avoir pas pris la poudre d’escampette aux premiers cris d’orfraie des gamins imams des nouvelles mosquées, ou renoncé à sa liberté en échange de la promesse du jardin des délices éternelles. Bien entendu, après deux ou trois pèlerinages gratuits aux lieux saints de l’islam. Et la garantie signée et contresignée de la prise en charge totale de sa famille et de sa descendance sur trois géné-rations. Eh Allah ! Il faut pourtant avouer qu’à son âge, c’était terriblement tentant, le jardin des délices en sus de la grandeur éternelle de sa lignée ici-bas ! En échange de sa prétendue liberté d’esprit ! Un concept hors saison chez nous autres nègres afro-africains cloués au bled-con-tinent. Liberté ! Liberté ! Par Allah, qu’est ce qu’un va-nu-pieds-crève-la-faim a à cirer de sa liberté à côté du pain et du beurre à gogo, cadeau et gratuit ? Ici-bas et là-bas, au jardin des délices éternelles, la fin de toute souffrance, de toute maladie, de tout souci ?
Mais il avait refusé net, mon papa. Et quand les mêmes lui avaient gentiment suggéré : « Dans ce cas, on te conseille de te sauver à temps... » il leur avait répondu, sans se fâcher, que personne ne pourrait l’obliger à quitter les terres de ses ancêtres :
« J’ai vu le jour ici, je vais crever ici, wallahi ! jurait mon papa.
— Ce n’est pas sûr, mon ami ! lui répondait souvent tonton Ngoloni en riant de son rire malicieux. L’amour le plus passionné ne saurait infiniment résister à la souffrance ! Notre Mali nous échappe ! Les gamins imams des nouvelles mosquées l’ont vendu aux pays du Golfe contre deux dollars et un séjour à La Mecque ! Les “Bin-Ben” le transformeront bientôt en terrain de chasse à l’outarde !
— Tu es trop pessimiste !
— Non, je suis trop réaliste, mon ami ! Parce que, quand tout un peuple choisit dramatiquement de vivre à travers les rêves d’autrui, il est foutu ! Et c’est notre cas ! On ne peut vivre du rêve des autres. Il nous faut réinventer nos propres rêves du bonheur, de conquête du paradis ! Rêver par la tête d’autrui est toujours fatal !
Extraits

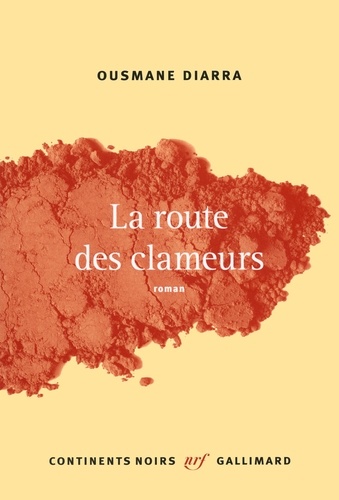



























Commenter ce livre