théâtre Rowling
Extraits
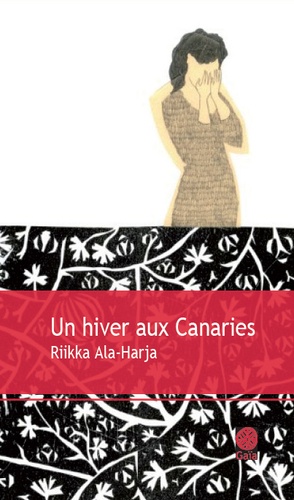
Littérature étrangère
Un hiver aux Canaries
11/2012
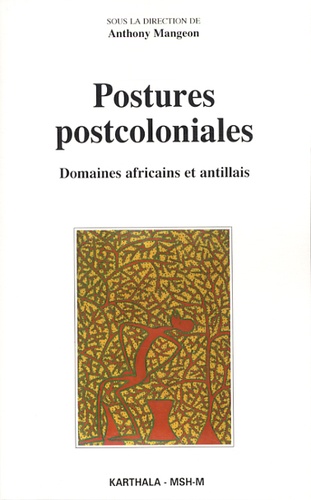
Critique littéraire
Postures postcoloniales. Domaines africains et antillais
12/2012
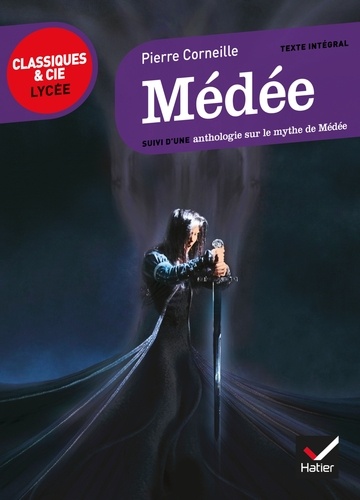
Petits classiques parascolaire
Médée. Suivi d'une anthologie sur le mythe de Médée
04/2013
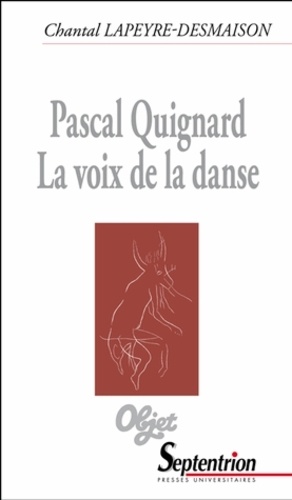
Critique littéraire
Pascal Quignard. La voix de la danse
02/2013
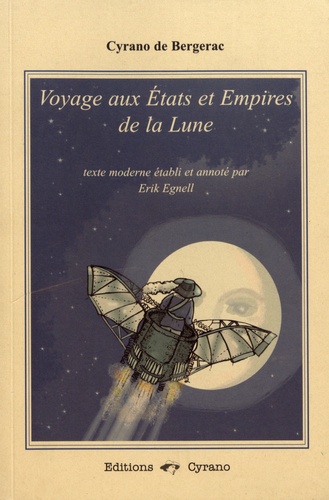
Littérature française
Voyage aux Etats et Empires de la Lune
10/2012
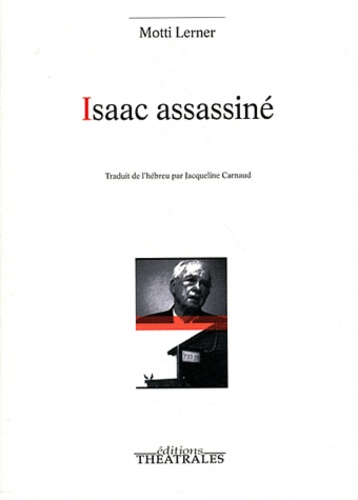
Théâtre
Isaac assassiné
06/2012
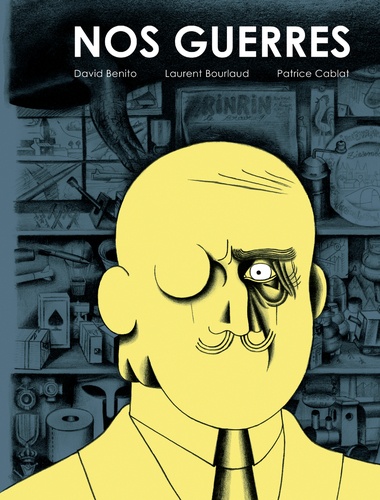
BD tout public
Nos guerres
10/2010
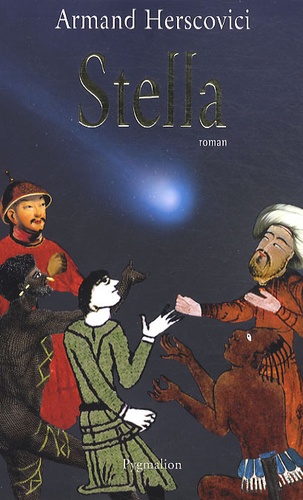
Romans historiques
Stella
03/2010
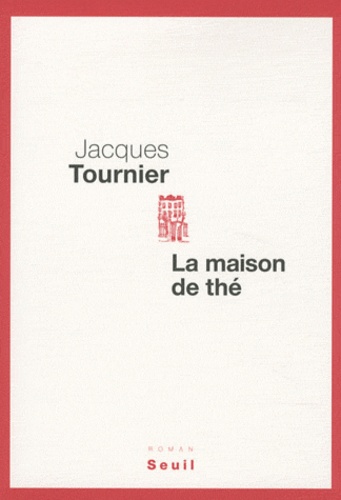
Littérature française
La maison de thé
03/2011
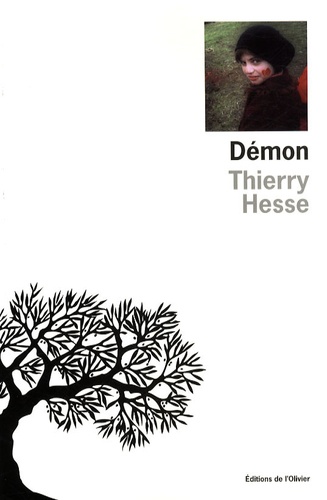
Littérature française
Démon
08/2009
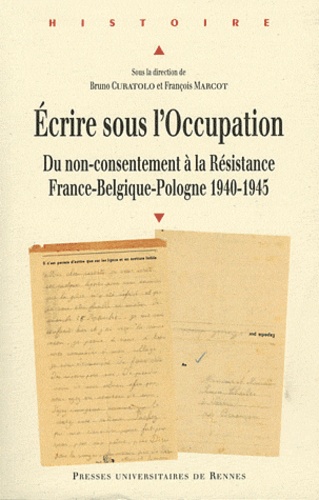
Histoire de France
Ecrire sous l'Occupation. Du non-consentement à la Résistance, France-Belgique-Pologne 1940-1945
09/2011
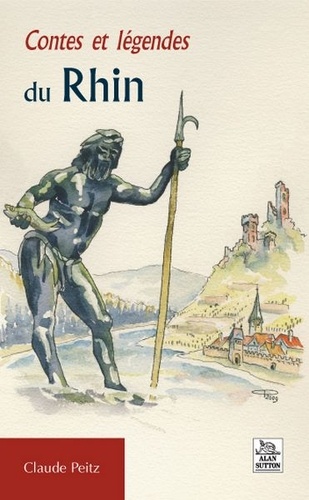
Littérature française
Contes et légendes du Rhin
10/2009
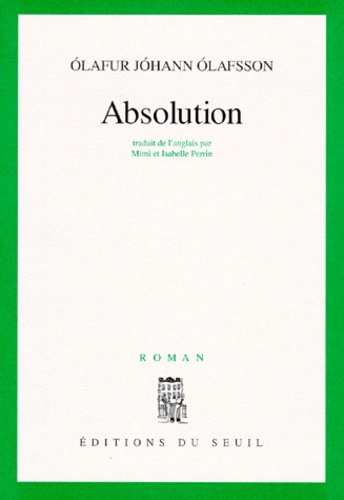
Littérature étrangère
Absolution
09/1996
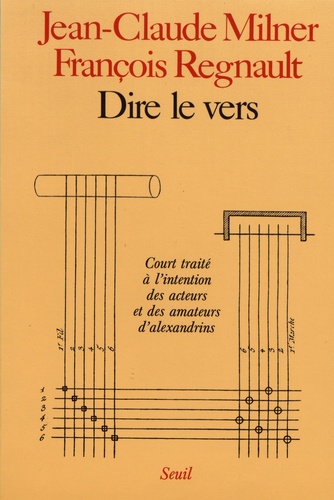
Critique littéraire
Dire le vers. Court traité à l'intention des acteurs et des amateurs d'alexandrins
02/1987
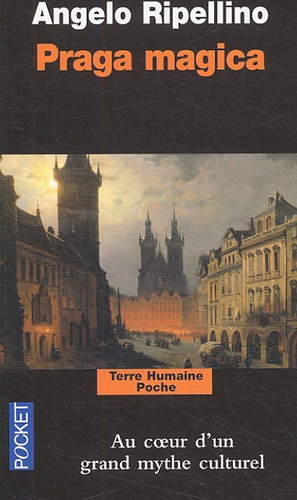
Ethnologie
Praga magica. Voyage initiatique à Prague
02/2005
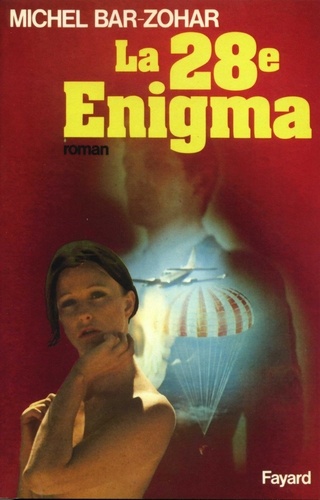
Policiers
LA VINGT-HUITIEME ENIGMA
04/1978
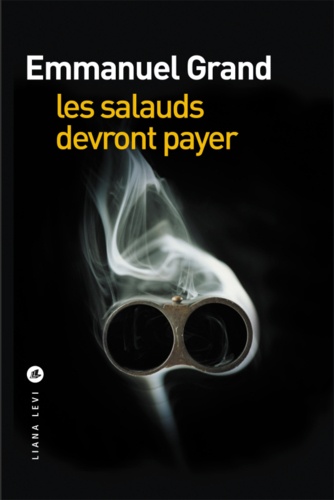
Policiers
Les salauds devront payer
01/2016
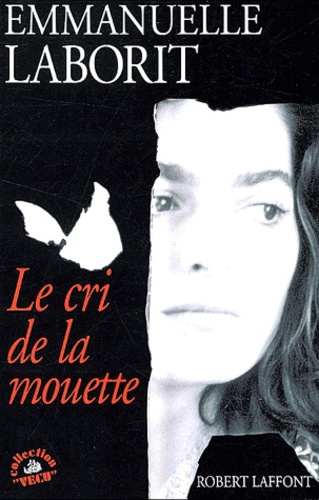
Santé, diététique, beauté
Le cri de la mouette
09/1994
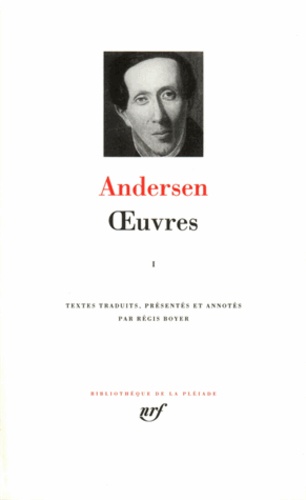
Pléiades
Oeuvres. Tome 1
05/2005
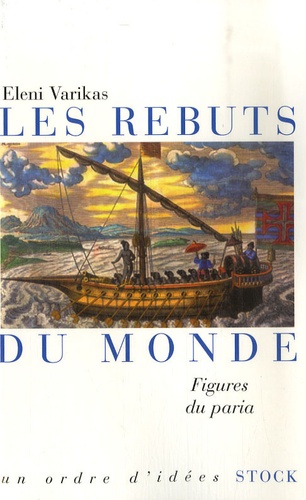
Sociologie
Les rebuts du monde. Figures du paria
10/2007
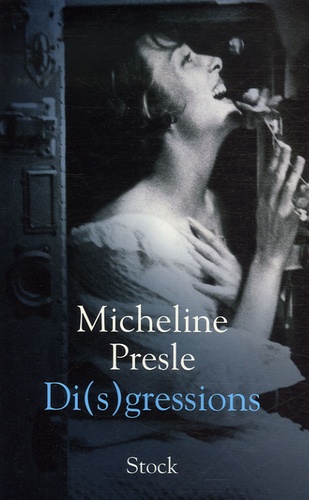
Cinéma
Di(s)gressions
01/2007
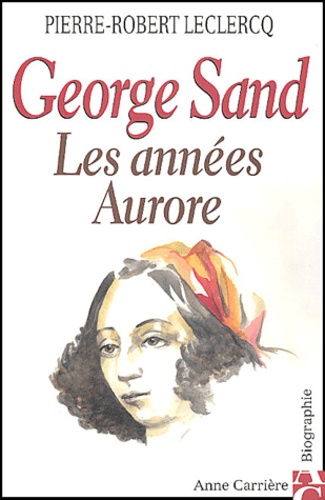
Critique littéraire
George Sand. Les années Aurore
02/2004
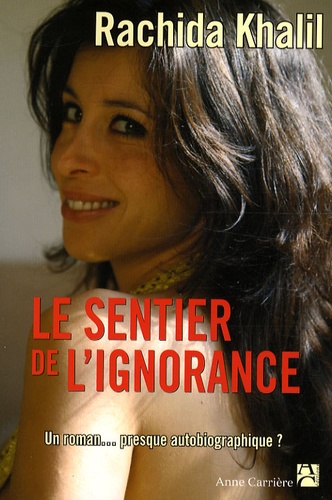
Littérature française
Le sentier de l'ignorance
05/2008
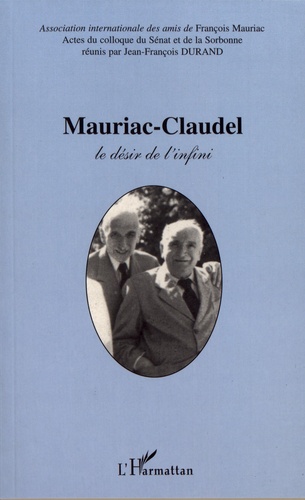
Critique littéraire
Mauriac-Claudel. Le désir et l'infini
04/2004
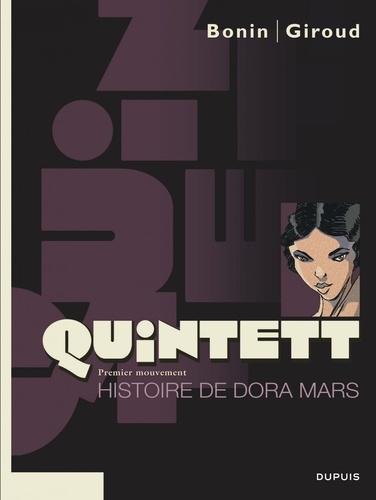
BD tout public
Quintett Tome 1 : Histoire de Dora Mars
08/2005
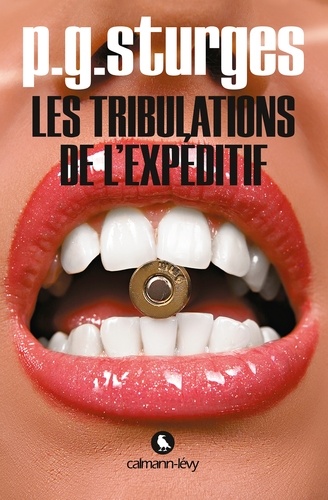
Policiers
Les tribulations de l'expéditif
03/2016

Critique littéraire
La critique littéraire en France. Histoire et méthodes (1800-2000)
06/2016
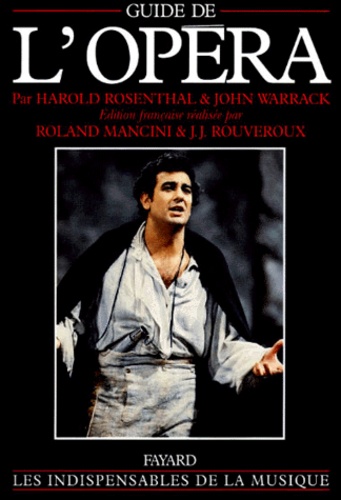
Musique, danse
Guide de l'opéra
07/2008
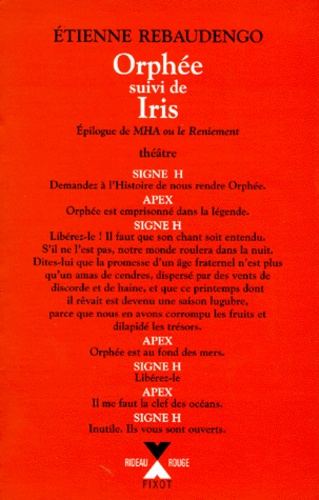
Théâtre
Orphée. suivi de Iris. Épilogue de "Mha ou le reniement"
10/1996
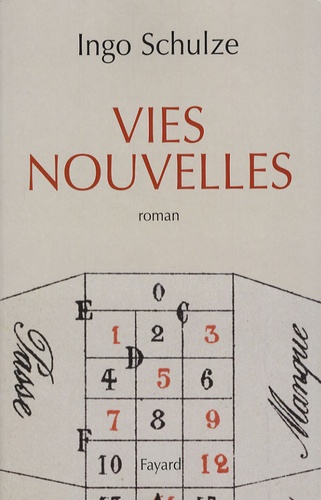
Littérature étrangère
Vies nouvelles. La jeunesse d'Enrico Türmer dans ses lettres et sa prose
01/2008

