Justine Reix
Extraits
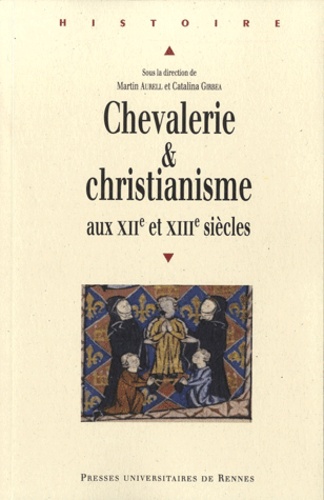
Histoire de France
Chevalerie et christianisme aux XIIe et XIIIe siècles
12/2011
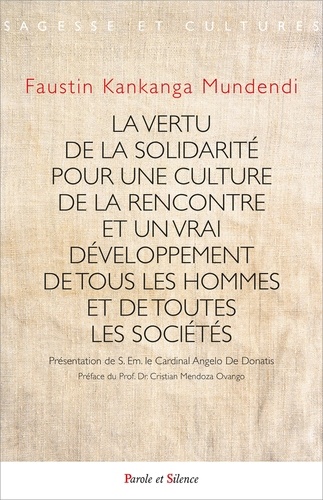
Théologie
La vertu de la solidarité pour une culture de la rencontre et un vrai développement de tous les hommes et de toutes les sociétés
02/2021
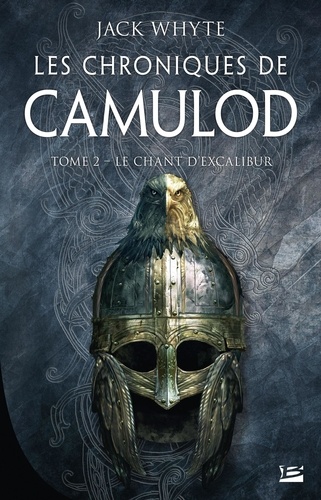
Fantasy
Les chroniques de Camulod Tome 2 : Le chant d'Excalibur
02/2021
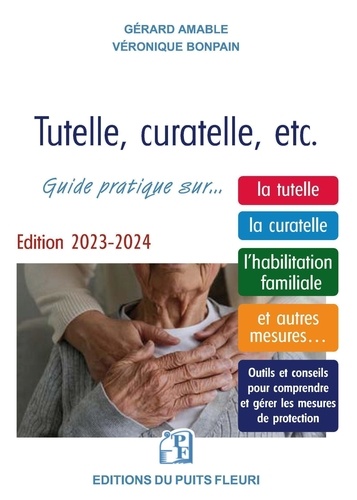
Incapacité, tutelle
Tutelle, curatelle, etc. Guide juridique et pratique sur... la tutelle, la curatelle, l'habilitation familiale et autres mesures...
01/2023
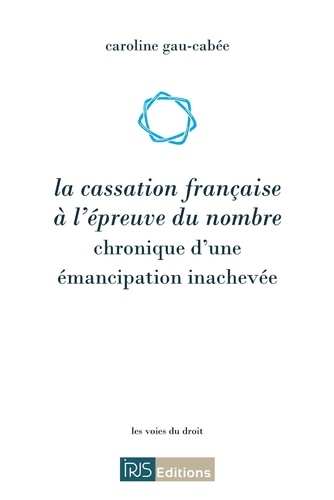
Histoire du droit
La cassation française à l'épreuve du nombre. Chronique d'une émancipation inachevée
09/2021
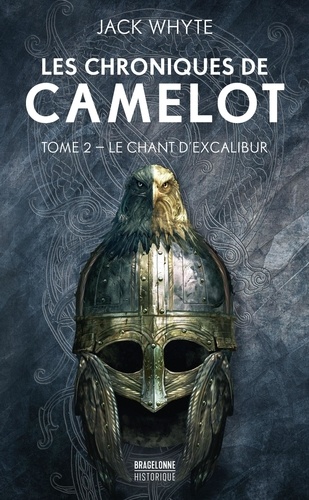
Moyen Age
Les Chroniques de Camelot Tome 2 : Le Chant d'Excalibur
07/2022
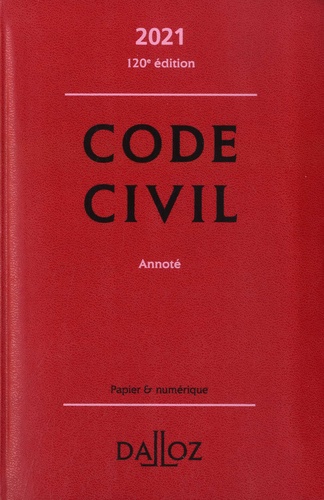
Droit
Code civil annoté. Edition 2021
07/2020
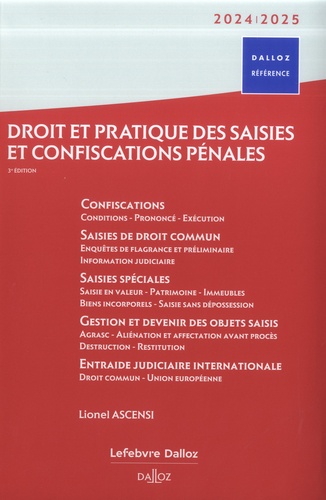
Droit pénal
Droit et pratique des saisies et confiscations pénales. Edition 2024-2025
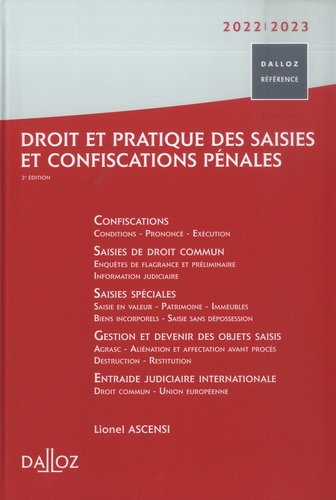
Droit pénal
Droit et pratique des saisies et confiscations pénales. Edition 2022-2023
09/2021
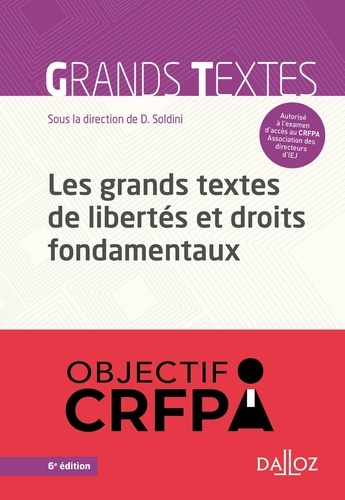
Droits de l'homme
Les grands textes de libertés et droits fondamentaux. Edition 2021
08/2021
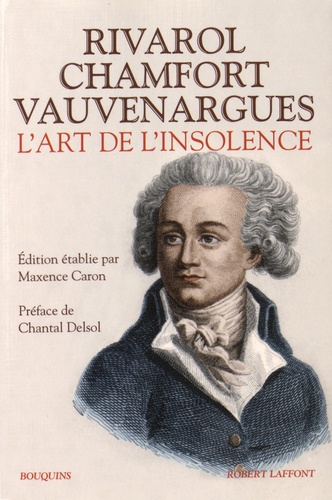
Littérature française
Rivarol, Chamfort, Vauvenargues. L'art de l'insolence
03/2016
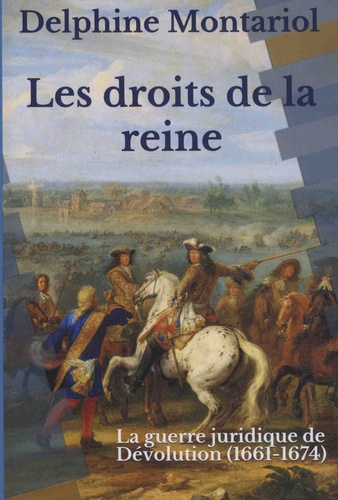
Droit
Les droits de la reine. La guerre juridique de Dévolution (1661-1674)
05/2018
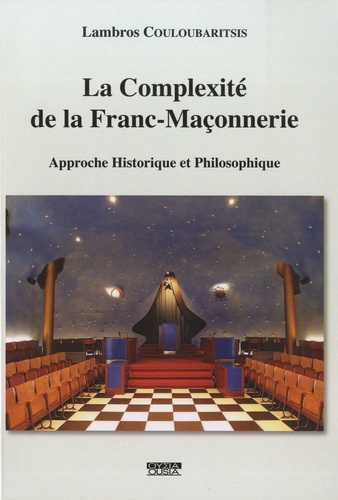
Esotérisme
La Complexité de la Franc-Maçonnerie. Approche historique et philosophique
02/2018
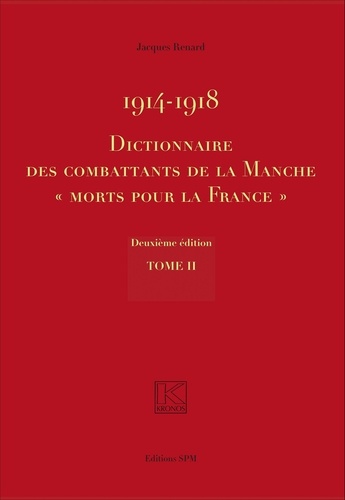
Histoire de France
Dictionnaire des combattants de la Manche "morts pour la France" 1914-1918. 2 volumes, 2e édition
05/2015
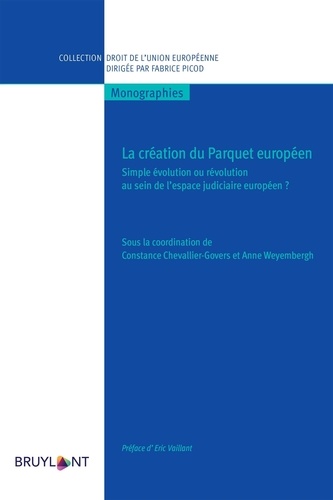
Droit fiscal communautaire
La création du Parquet européen. Simple évolution ou révolution au sein de l'espace judiciaire européen ?
03/2021
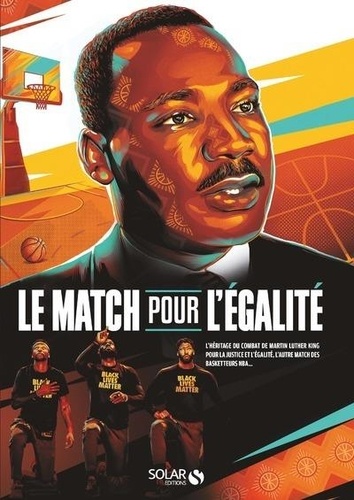
discriminations, exclusion, ra
Le match pour l'égalité. L'hommage de la NBA à Martin Luther King
10/2022
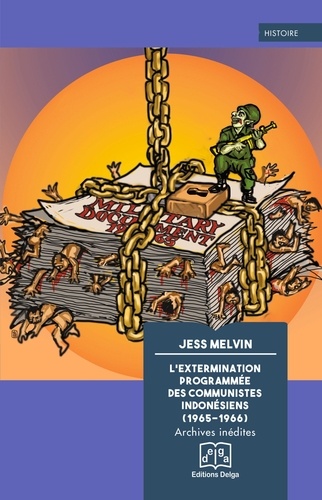
Cinquième République
L'extermination programmée des communistes indonésiens (1965-1966). Archives inédites
02/2023
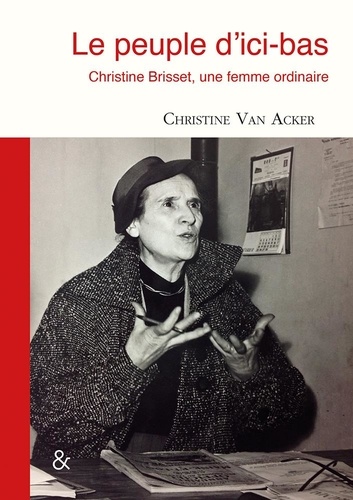
Travail social
Le peuple d’ici-bas. Christine Brisset, une femme ordinaire
10/2022
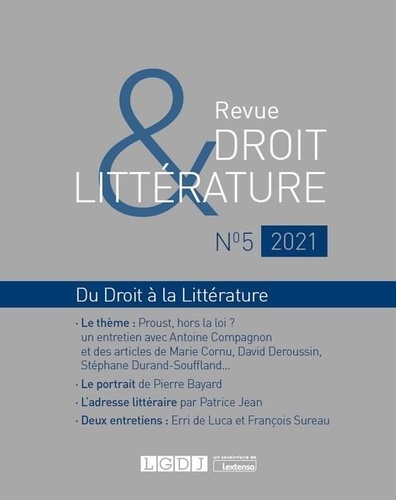
Revues de droit
Revue Droit & Littérature N° 5/2021 : Du droit à la littérature
05/2021

Sciences politiques
Souvenirs de police. La France des faits divers et du crime vue par des policiers (1800-1939)
11/2016
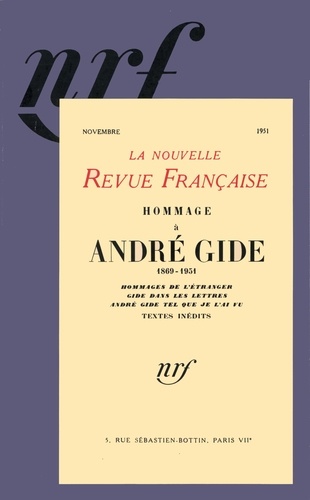
Critique littéraire
La Nouvelle Revue Française Novembre 1951 : Hommage à André Gide
10/1990
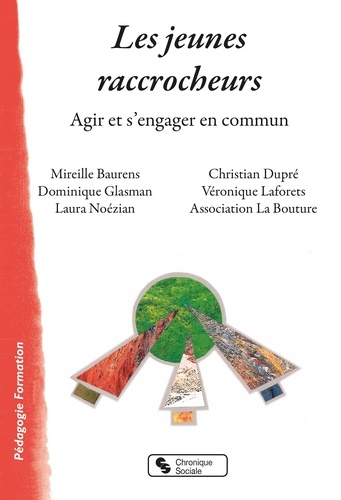
Pédagogie
Les jeunes raccrocheurs. Agir et s'engager en commun
08/2019
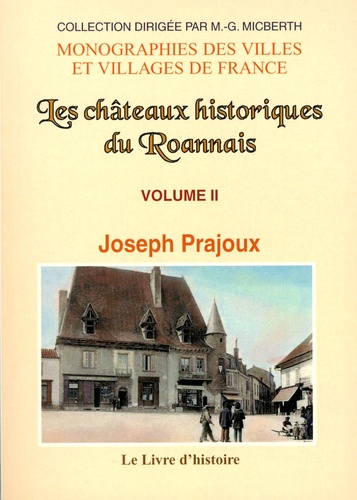
Régionalisme
Les châteaux historiques du Roannais. Volume 2
12/2012

BD tout public
La revue dessinée N° 29, automne 2020
09/2020
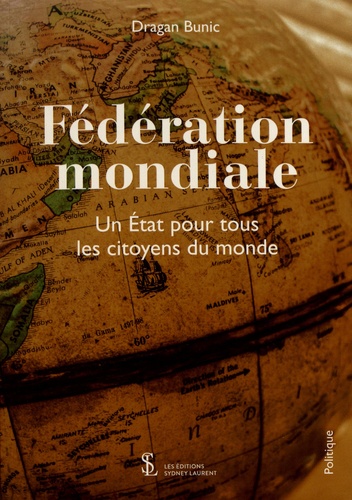
Sciences politiques
Fédération mondiale. Un Etat pour tous les citoyens du monde
11/2018
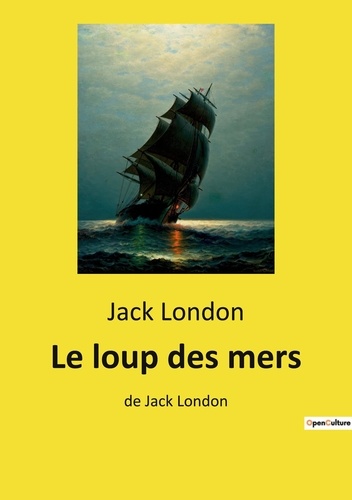
Littérature française
Le loup des mers. de Jack London
11/2022
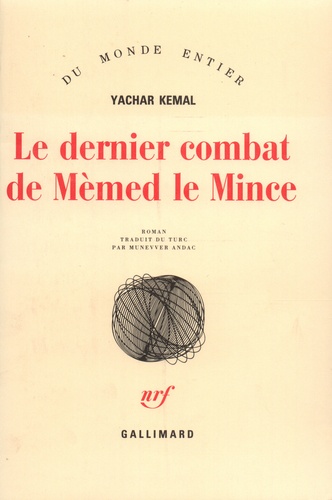
Littérature étrangère
Le Dernier combat de Mèmed le Mince
03/1989
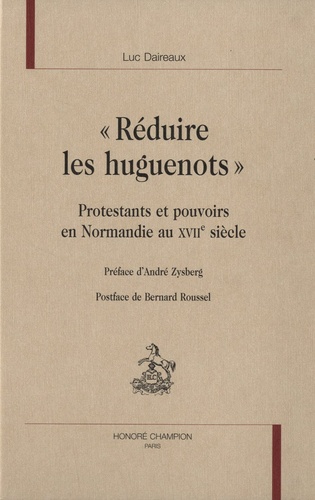
Religion
"Réduire les huguenots". Protestants et pouvoirs en Normandie au XVIIe siècle
11/2010
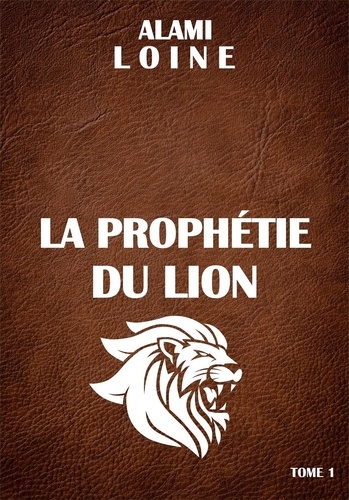
Religion
La Prophétie du Lion, tome 1
04/2019
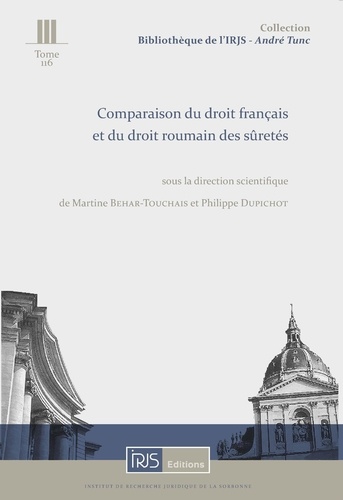
Droit comparé
Comparaison du droit français et du droit roumain des sûretés
02/2021

