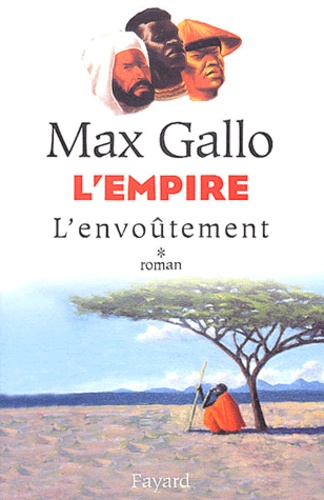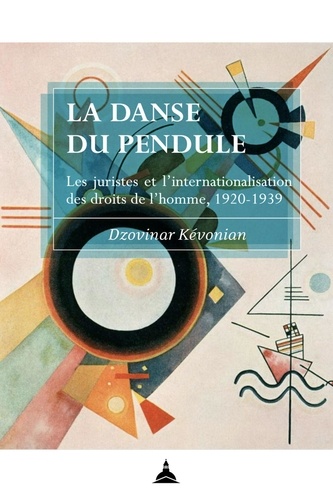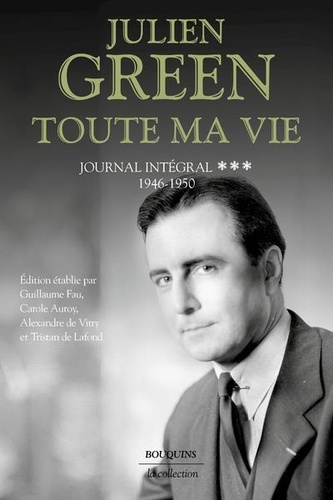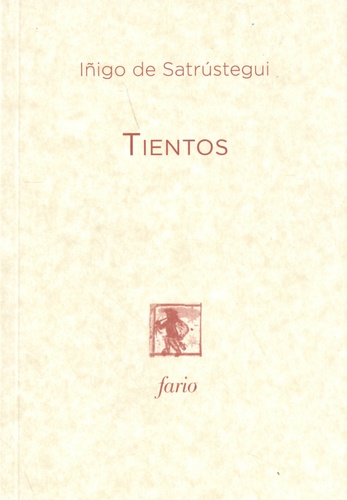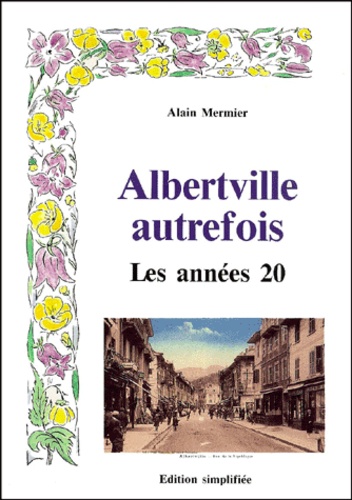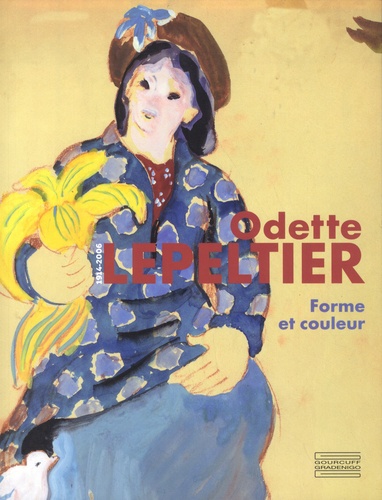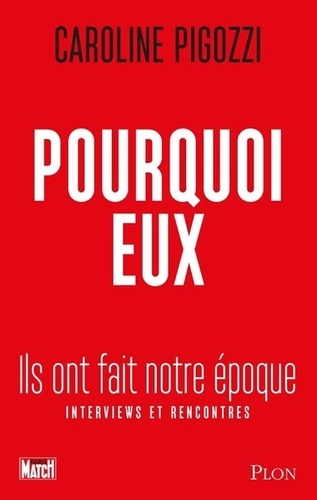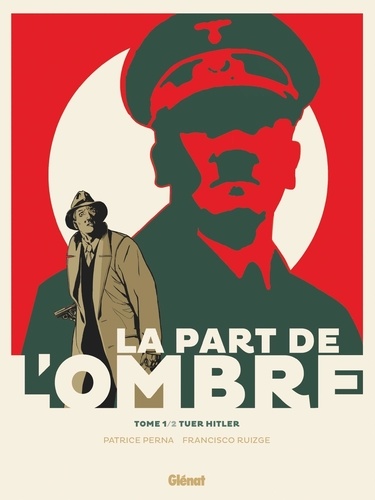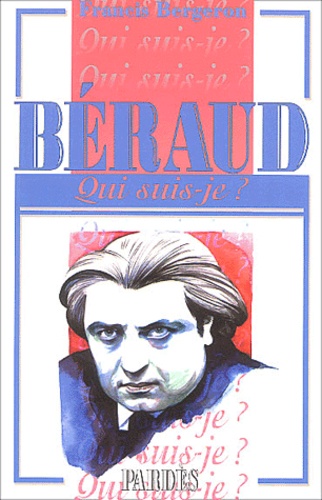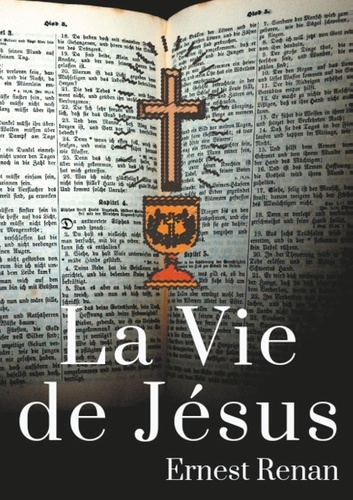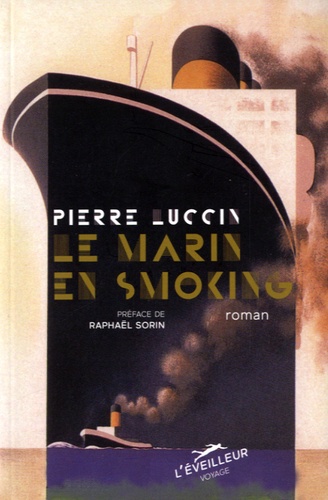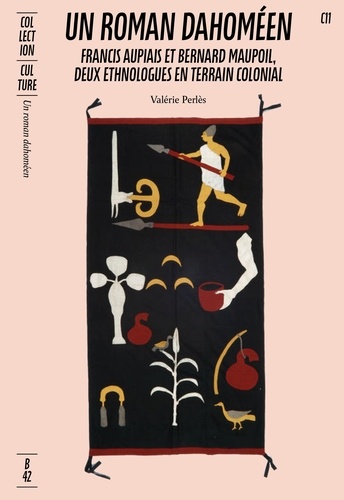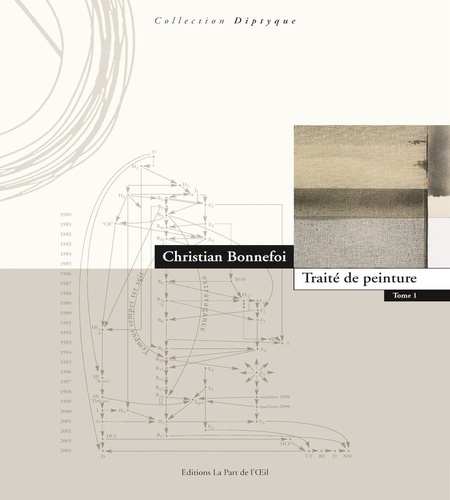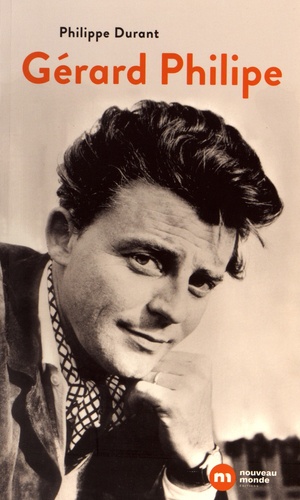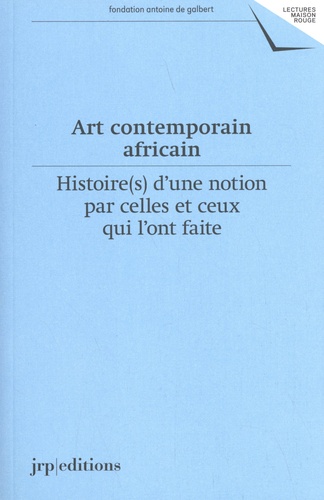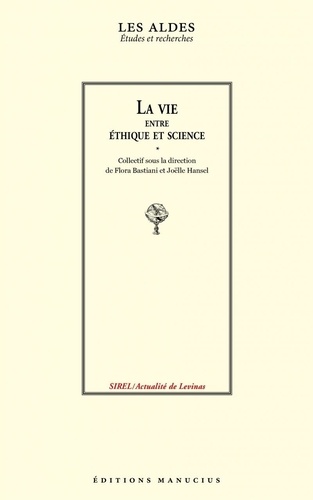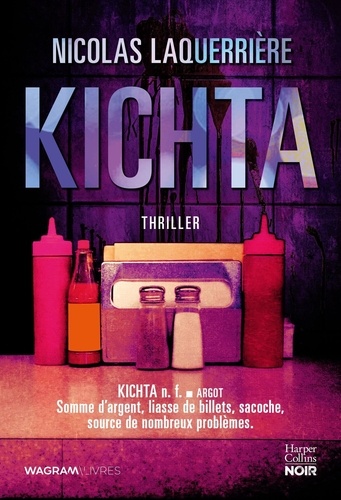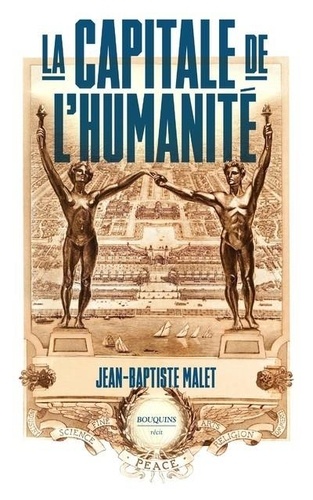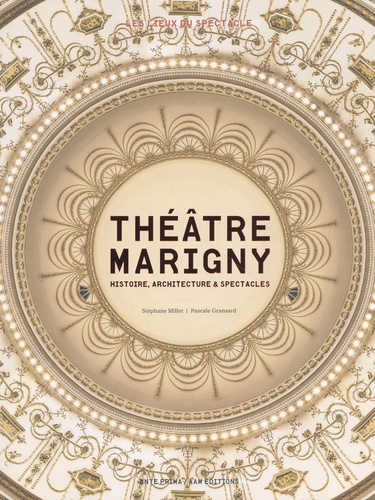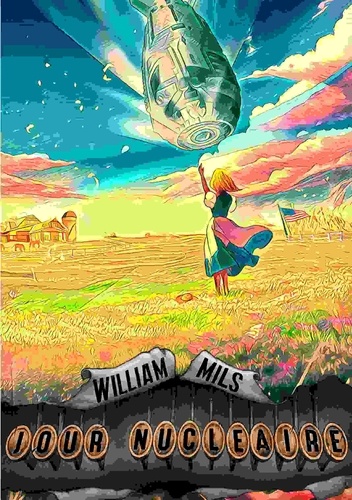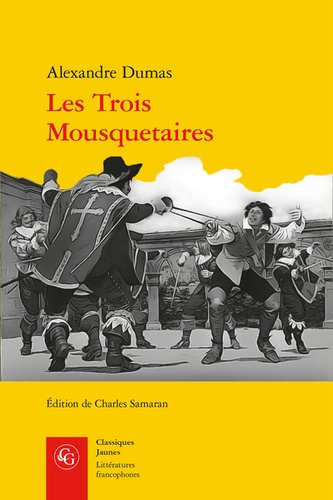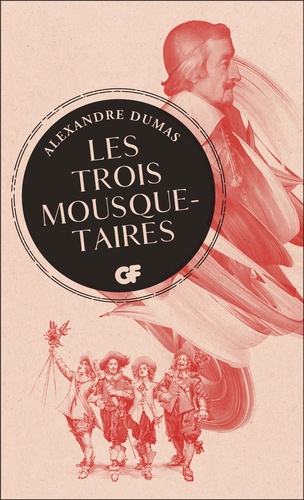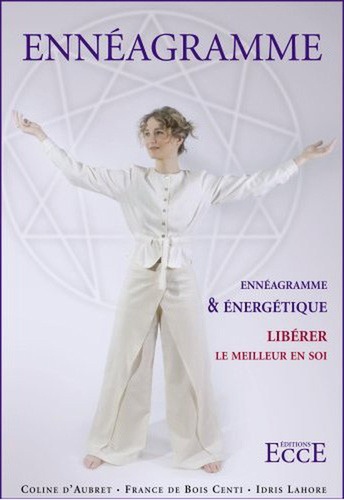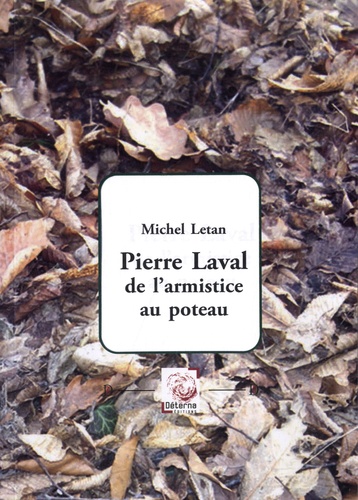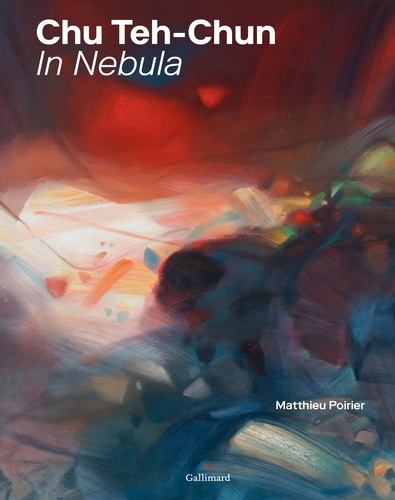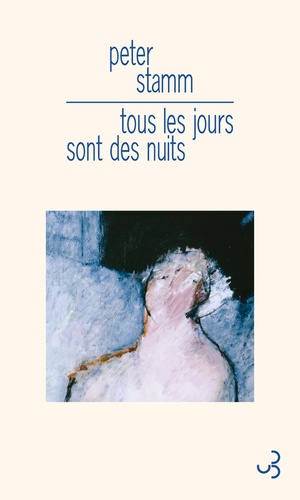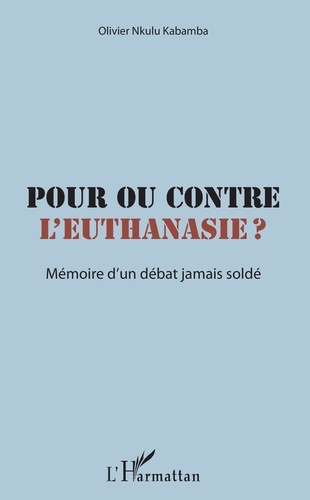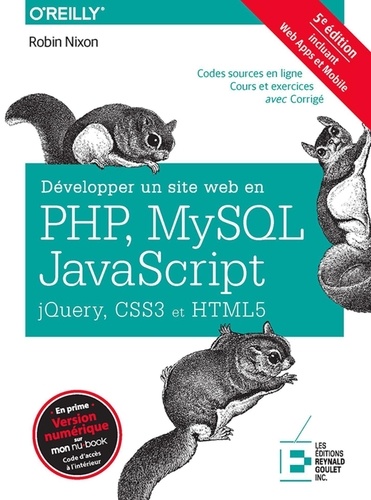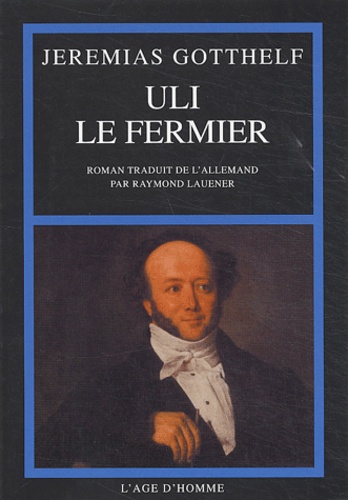Tous les jours sont des nuits
Elle s’appelle Gillian, elle est belle, elle a du succès, elle est aimée. Mais le début du livre renvoie toutes ces phrases au passé, y compris la première. Est-elle en effet encore Gillian au moment où débute le roman ? N’a-t-elle pas tout perdu, jusqu’au reflet d’elle-même ? Une nuit, au retour d’une soirée trop arrosée, après une dispute, Gillian et son mari Matthias, qui travaillent tous deux pour la télévision, ont un accident de voiture en heurtant un chevreuil sur une petite route qui traverse la forêt. Matthias, qui conduisait, meurt sur le coup. Gillian se réveille à l’hôpital et découvre qu’elle n’a plus de visage. Toute la belle façade s’écroule, tout ce qui faisait sa vie a disparu. Gillian doit subir plusieurs opérations de chirurgie plastique. Elle qui était toujours entourée, admirée, sollicitée, découvre la solitude et l’absence de vraie amitié. Même sa mère n’ose plus aller la voir. Pour Gillian, les jours deviennent des nuits. Après cette première partie, Peter Stamm fait un saut en arrière et raconte la rencontre entre Gillian et Herbert, un artiste qui peint des nus à partir de photos. Croisé sur un plateau de télévision, il finit, après quelques échanges de mails, par photographier et peindre Gillian nue dans son atelier. Ce sont en fait les photos de ce travail qui ont déclenché la dispute fatale avec Matthias. Ce dernier avait en effet découvert par hasard la pellicule dans un tiroir du bureau de Gillian et l’avait faite développer. Outre un fort sentiment de culpabilité, Gillian en retire l’idée que l’art peut tuer, mais aussi la conviction que sa vie n’était jusque-là qu’une simple mise en scène fondée sur les apparences. La troisième partie nous emmène sept ans plus tard. Herbert traverse une crise existentielle. Incapable de peindre depuis plusieurs années, il a finalement accepté un poste de professeur aux Beaux-Arts. Un jour, il reçoit l’invitation d’une fondation culturelle dans les montagnes de l’Engadine, qui lui donne carte blanche pour faire une exposition. Après de longues hésitations, il finit par accepter, d’autant plus que sa compagne, avec qui il a un petit garçon de sept ans maintenant, vient de le quitter. C’est là qu’il retrouve Gillian qui, après sa guérison, a fui le monde des médias et a trouvé un travail d’animatrice culturelle, loin de la ville et de ses attraits, dans le centre de loisirs qui jouxte la fondation culturelle. Peter Stamm est trop bon romancier pour confier cette rencontre au hasard : c’est en fait Gillian (qui se fait désormais appeler Jill) qui a convaincu le directeur du centre culturel d’inviter Hubert et de lui proposer de faire une exposition. Si tous les jours sont des nuits quand l’amour disparait, les nuits peuvent devenir des jours quand le bonheur d’être ensemble est là, pour reprendre les dernières lignes du sonnet de Shakespeare mis en exergue au début du livre. Mais Peter Stamm sait aussi éviter les pièges des réconciliations prématurées, c’est le prix de la liberté de ses personnages qui ne réagissent pas toujours comme on l’attend. Ici, la vie n’est pas un songe, elle est un jeu dont on doit maitriser les règles pour ne pas se faire rejeter. Mais dont on peut aussi rejeter les règles, si on en a le courage. Peter Stamm écrit comme on compose un patchwork, mêlant par assemblage de phrases courtes, des éléments parfois très dissemblables (souvent des notations psychologiques et des détails apparents ou bien des sensations physiques et des sensations mentales) qui, avec le recul, composent sans pathos la densité d’une histoire à la fois ordinaire et hors du commun, dans la mesure où la banalité des gestes et des pensées retrouvent mystère et intensité grâce à une prose discrète dont la simplicité et la naïveté apparentes sont d’une précision chirurgicale. Les personnages de Peter Stamm mettent ici en scène la possibilité de changer de vie après une brusque catastrophe ou même simplement une banale vie d’ennui et d’erreurs. Ainsi, après son accident et le deuil une fois surmonté, Gillian ne se laisse pas écraser par le chagrin, le regret, le remords : elle accepte la perte et tente de construire une nouvelle existence sur des valeurs qui ne sont désormais plus extérieures à ce qu’elle est au fond d’elle-même. Il n’en sera peut-être pas de même pour Hubert qui, après de merveilleux mois passés avec Jill, semble prêt à se laisser de nouveau happer par l’habitude et le confort d’une vie qui n’est autre que la répétition annoncée de l’échec. Peter Stamm ne nous dit pas tout. Il n’a d’ailleurs jamais tout dit au fil de ce roman, mais beaucoup suggéré, et les harmoniques du possible vibrent encore longtemps dans notre mémoire, une fois le livre refermé.
08/2014