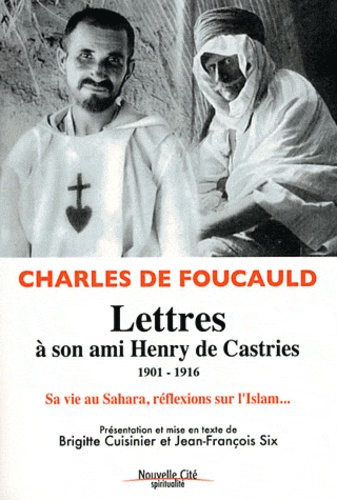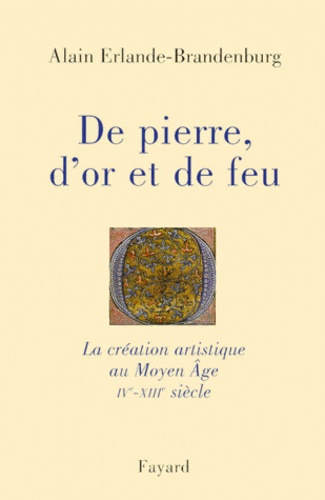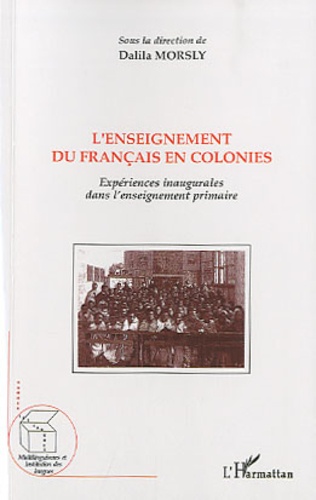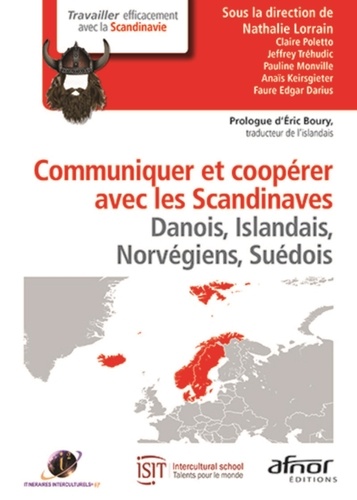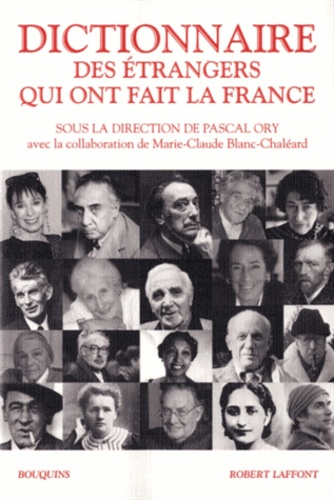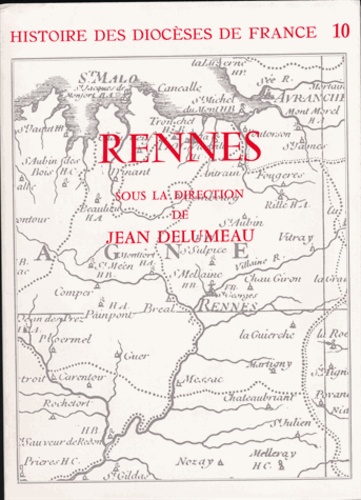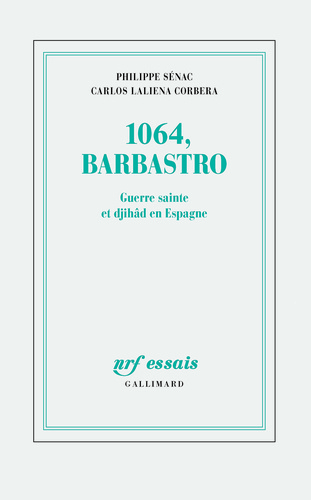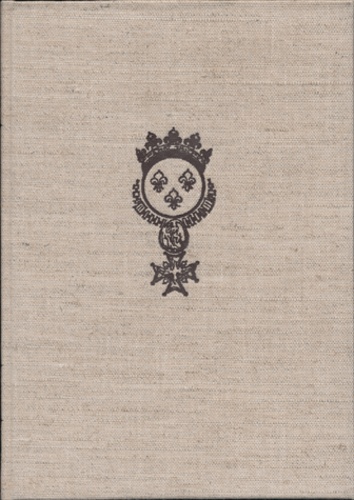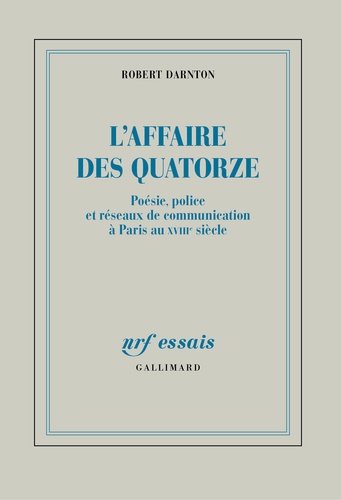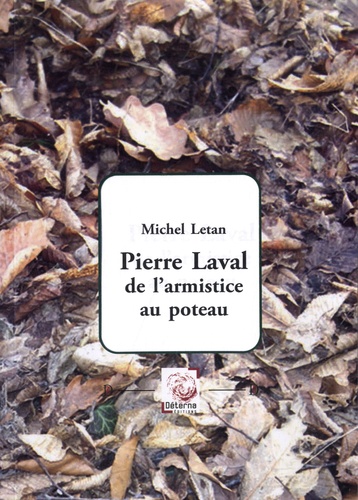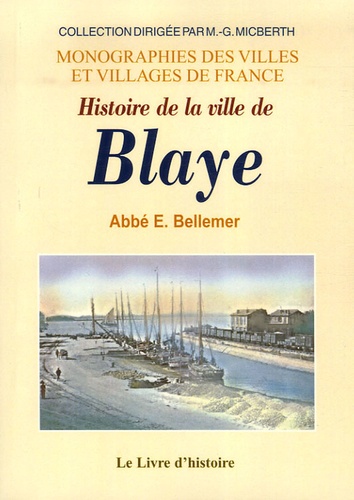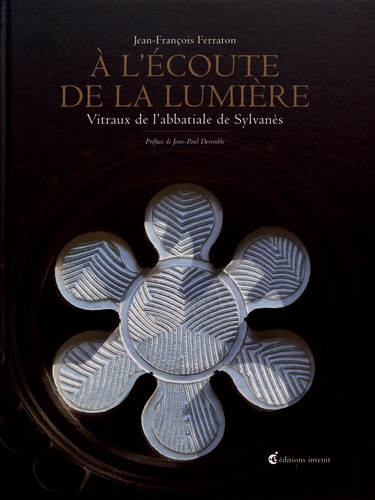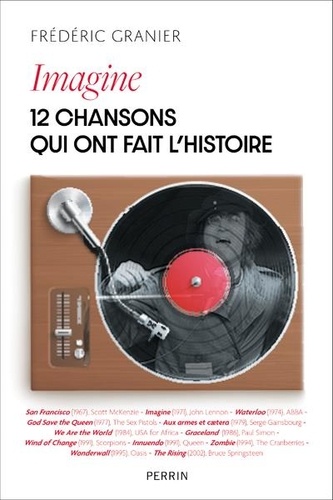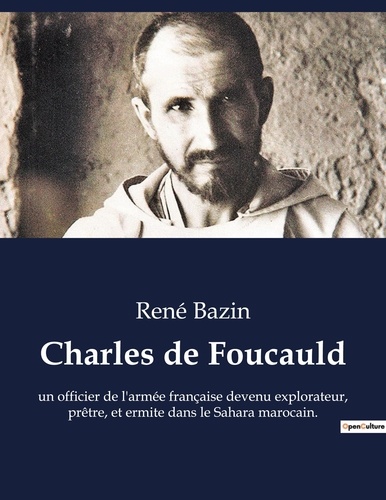Dictionnaire des étrangers qui ont fait la France
Qui de plus français que le couturier et mécène Pierre Cardin ou le premier vainqueur du Tour de France cycliste, Maurice Garin ? Sauf que l'un et l'autre sont nés Italiens. A l'inverse, combien de Français savent que le prix Nobel de littérature de l'an 2000 a été attribué à un citoyen français - naturalisé depuis trois ans -, Gao Xingjian, né à Ganzhou soixante ans plus tôt ? Ce que la plupart de nos compatriotes savent, en revanche, c'est que la renommée de la France doit beaucoup à Frédéric Chopin, Marie Curie, Pablo Picasso, Le Corbusier, Samuel Beckett ou Charles Aznavour. Et ceux qui s'intéressent au destin politique de ce pays ont sans doute remarqué, sans remonter plus haut que la Révolution française, que ladite Révolution n'aurait pas tout à fait été la même sans le modéré Necker ou le radical Marat - deux Suisses -, la IIIe République sans Gambetta ou Weygand, la Résistance sans Boris Vildé, du premier réseau, celui du Musée de l'homme, ou le groupe Manouchian et ses fusillés stigmatisés sur l'Affiche rouge "parce qu'à prononcer leurs noms sont difficiles"... Pour mieux connaître cet apport exceptionnel des étrangers à l'histoire de notre pays, il manquait un ouvrage comme celui-ci. Un dictionnaire regroupant aussi bien des notices "collectives" (Ecole de Paris) que des notices "communautaires" (Congolais) et, surtout, une masse de notices individuelles, d'Abbas à Zulawski, (Andrzej). Il sera, à coup sûr, pour ses lecteurs une source éclairante et vivifiante de surprises, de découvertes, d'émotions. La période choisie commence en 1789, avec la proclamation solennelle et inédite de la nation française comme principe de souveraineté, et va jusqu'à nos jours, avec Stéphane Hessel ou Marjane Satrapi. La notion "d'étranger" est prise ici au sens juridique du terme, pour éviter toute subjectivité : être né de statut étranger, en France ou hors de nos frontières, qu'on le soit resté ensuite (comme Pablo Picasso), qu'on ait obtenu sa naturalisation (comme Yves Montand), qu'on l'ait abandonnée (comme Igor Stravinsky) ou qu'on ait failli la perdre (comme Serge Gainsbourg). Les naturalisés de naissance, comme Georges Perec, ne figurent donc pas dans ce dictionnaire, non plus que les ressortissants des colonies ou des départements d'outre-mer. Tous les secteurs d'activités sont représentés, de la littérature (Emile Zola) au sport (Raymond Kopa) en passant par le monde de l'entreprise (Carlos Ghosn) et de la création sous toutes ses formes. Les notices communautaires permettent de redonner toute leur place aux obscurs et aux sans-grade, qui jouèrent leur rôle dans l'édification de l'économie comme de la culture françaises, des mineurs polonais aux maçons portugais, des musiciens de bal musette aux chanteurs de raï. L'ouvrage, qui comprend 1 186 articles (1 112 notices individuelles, 22 notices collectives, 52 notices communautaires), est précédé d'une préface de Pascal Ory, son maître d'oeuvre.
10/2013