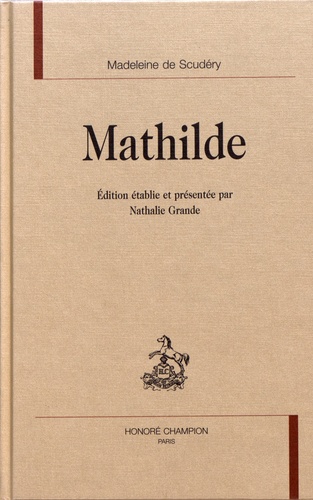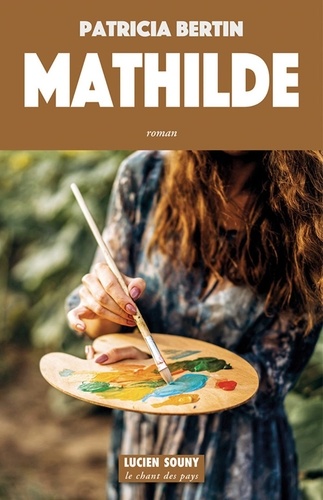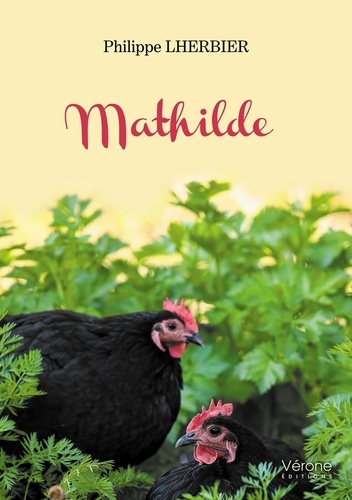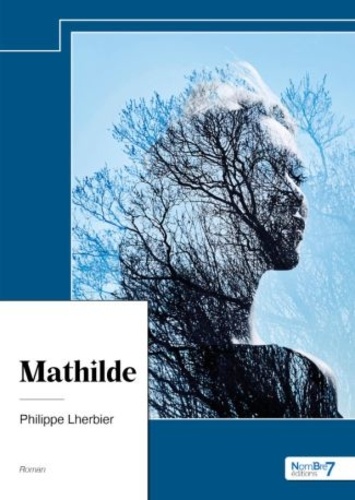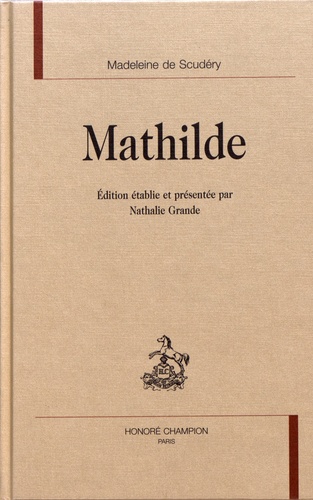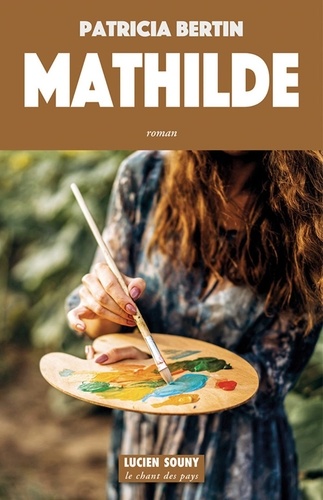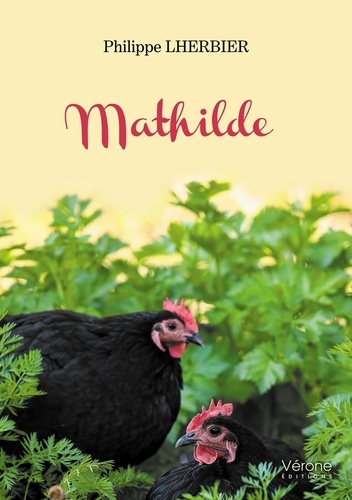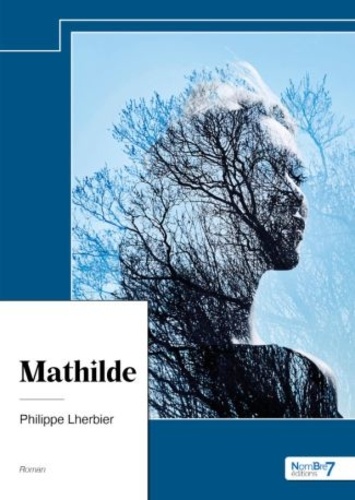C'est en 2008, lors d'une réception après spectacle du Festival d'Avignon que le dessinateur est présenté à la chorégraphe par un ami commun. L'auteur de bande dessinée veut apprendre à danser, la danseuse l'invite plutôt à venir dessiner son travail. C'est ainsi qu'est née « Mathilde, danser après tout », un épais volume de grand format publié chez Denoël Graphic. Dans les 176 pages de ce livre, à partir d'entretiens, le bédéiste raconte le parcours chorégraphique qui a permis à la jeune danseuse fauchée, qui dansait à New York sans trop savoir ce qu'elle faisait, de diriger aujourd'hui un Centre chorégraphique national et de figurer parmi les chorégraphes les plus reconnues de la scène française.
L'ouvreur qui voulait brûler les planches les dessine
Conquis par le travail de la chorégraphe depuis la période où il bossait comme ouvreur au Théâtre de la Ville, Olislaeger tente de transcrire en dessins à la fois les intentions de la chorégraphe et les émotions qui peuvent naître dans le corps des danseurs et celui des spectateurs. Il cherche aussi par moments à révéler une vérité plus intime de la danseuse, mais l'exercice est périlleux quand on sait que le livre a bénéficié pour sa publication du soutien du Centre national de la danse et que, pour réaliser ce livre, le dessinateur a séjourné à Montpellier et été accueilli dans les bureaux de la chorégraphe. Difficile de mordre la main qui vous a nourri.
Pourtant, ce n'est que lorsque la BD révèle les fêlures de la chorégraphe que le projet se met à avoir un sens : lorsqu'au bout du fil son ancien partenaire, Jean-François Duroure avoue qu'il ne peut témoigner pour le livre, car c'est trop dur pour lui encore aujourd'hui d'évoquer le travail de son ancienne complice, qui a poursuivi seule le travail qu'ils avaient imaginé à deux (et que la maladie empêchait alors Duroure de continuer), lorsque l'on comprend à travers les aveux de Mathilde Monnier elle-même que son travail, toujours intuitif, sensitif, instinctif, a parfois du mal à s'expliquer au travers des mots ou à se justifier de façon cohérente, si ce n'est par le retour biographique sur des blessures d'enfance.
Dessiner l'invisible
Olislaeger cherche un langage graphique pour transcrire les corps en mouvement. Un langage fait de répétitions, de positionnement des croquis dans l'espace de la page : tantôt avalanche, tantôt apparition singulière, très souvent bandeau répétitif qui rappelle les dessins des zootropes, ancêtres du cinéma. Étonnamment, on ne parle presque jamais de musique dans les pages du livre, comme si la bande-son de toutes ces pièces dansées n'était qu'un support mineur. La musique de Katerine est réduite à ses textes, celle de plusieurs spectacles est tout simplement passée... sous silence. En revanche, alors que les pages d'entretiens et de rencontres s'étalent sur de grandes images noir et blanc, les chorégraphies sont retranscrites avec de petits dessins qui envahissent l'espace, dans des pages chargées de corps en déséquilibre et en mouvement, alignés à l'infini, et ponctués par des à-plats de couleurs.
Bien que le boulot de François Olislaeger soit considérable, je suis resté un peu en marge de ce projet. Ni iconoclaste, ni vulgarisateur, il semble parler à ceux qui ont déjà vu les spectacles évoqués et qui connaissent bien les personnages dont il est question. Certes, Philippe Katerine et Christine Angot ne sont pas des inconnus, mais l'album ne les présente pas, considérant que le lecteur, cela va de soi, connaît ces artistes comme il connaît sans doute le travail de Mathilde Monnier. À quoi bon alors lui raconter tout cela dans un livre ? Ne suffit-il pas de l'inviter à boire un verre à la fin d'un spectacle, où l'on croisera forcément ces pipoles artistiques, venus échanger des félicitations avec la chorégraphe.
Mathilde Monnier semble avoir parcouru bien du chemin depuis qu'elle dansait dans sa chambre à New York, en kilt, avec un complice et qu'ils étaient inséparables. On s'étonne que ce passage de la contre-culture à la reconnaissance institutionnelle, ce grand écart entre le programme artistique instinctif et le rôle de cerbère officiel de la danse contemporaine ne soient pas présentés comme un paradoxe. Est-ce juste le passage du temps et des modes ou la présence au bon endroit et au bon moment ? Est-ce l'effet d'un renoncement, d'un hasard ou d'un travail d'infiltration des lieux du pouvoir chorégraphique ? Le livre ne répond pas à ces questions, car il ne peut évidemment pas les poser.