Le nom des étoiles
Pete Fromm
Editeur
Genre
Poches Littérature internation
À mes parents, pour m’avoir ouvert les portes
et m’avoir laissé les franchir.
Des histoires, des histoires et des histoires. Un monde, une terre et même une rivière remplis de cette sacrée matière, de cette matière insaisissable.
RICHARD FLANAGAN, À CONTRE-COURANT
Embrasse-moi pour me souhaiter bonne nuit et aide-moi à dire mes prières
Laisse la lumière allumée en haut de l’escalier
Dis-moi le nom des étoiles là-haut dans le ciel
Un arbre frappe à la vitre
Ce sentiment m’étouffe de nouveau
Papa, c’est vrai que nous devons tous mourir ?
BILLY BRAGG, TANK PARK SALUTE
1
North Fork, Sun River
Bob Marshall Wilderness, Montana
Mai 2004
PENDANT un moment, l’orage semble s’apaiser – bourrasques monotones, pluie qui ne tombe plus vraiment comme si le ciel même n’était fait que d’eau. Je me baisse pour regarder par la fenêtre de la cabane, examiner la couverture nuageuse, la colonne rouge du thermomètre qui atteint péniblement les 5 °C, les rafales qui parcourent en vagues la prairie. Les accalmies instaurent presque le silence, on entend juste parfois crépiter les branches de sapin dans le poêle, puis le souffle accru du vent fouette les rondins de la cabane, la pluie tambourine sur les bardeaux de cèdre. Déjà 9 heures passées et, malgré le mauvais temps, je dois faire ma ronde de seize kilomètres pour vérifier où en sont les œufs des ombres, ma tâche quotidienne. Je me tortille pour enfiler les vêtements de pluie fatigués, le haut et le bas, j’ajuste les fermetures Éclair situées en bas de la veste pour dégager le spray anti-ours et le revolver.
Dehors en plein vent, la pluie s’engouffre sous le bord du toit, me pique les joues, ruisselle dans le haut de ma barbe tandis que je contourne la cabane, soulève chacun des volets conçus pour résister aux ours, malmène les hayons. La routine. Je m’engage ensuite sur le chemin boueux, par-dessus le monticule et parmi les arbres, vers l’ouverture du brûlis, le virage qui descend vers la North Fork, le bras nord de la Sun River. Marchant d’un pas laborieux, je me réchauffe un peu et je regarde les gouttes d’eau glisser sur mes bottes que j’ai graissées hier soir, je regarde ma canne piqueter la boue, la cloche de vache que j’ai attachée à son sommet quasi silencieuse tant j’avance lentement. C’est le genre de temps qui vous oblige à rester tête baissée sous votre capuche, et je ne vois pas beaucoup plus loin que le chemin sous mes pieds, jusqu’au moment où je me mets à suivre les traces des ours qui se sont promenés cette nuit : cela me rappelle que je dois garder les yeux en l’air, rabattre derrière mes oreilles la capuche qui me rend sourd et commencer à faire du bruit. Je chante, c’est le seul moyen qui me vient à l’esprit pour signaler constamment ma présence, et j’entre dans les bois plus sombres en braillant Le noble duc d’York avait dix mille soldats…
Il s’avère que la pluie était en train non pas de se calmer, mais de prendre son élan : quand je traverse l’étroit pont de pierre par-dessus l’eau brune et tourbillonnante de la North Fork, elle tombe en biais avec une force étonnamment stupide, faisant mousser la surface de la rivière. Je gravis la pente vers les œufs de Spruce Creek, et je ris face à la sauvagerie du paysage. Déjà trempé jusqu’aux os, les pieds vers l’extérieur dans la boue comme si je remontais en canard une piste de ski, j’atteins la crête et je traverse un kilomètre et demi de brûlis récent. J’oublie de chanter pour les ours, car on voit sans problème à travers le fer de lance noirci de la cime des arbres.
Jusqu’au moment où j’arrive au passage digne de Hansel et Gretel. Ici, le sentier passe par un terrain incendié il y a plus longtemps, hérissé de pins lodgepole de quinze ans. Hauts de trois mètres cinquante et séparés par seulement quelques centimètres, ils forment une fourrure si dense de part et d’autre, une foule si oppressante, avec leurs branches aiguilleuses entrelacées, murmurant et chuintant dans le vent, qu’on dirait moins un chemin qu’un tunnel aux parois vertes. Malgré tout, incapable de voir à plus d’un mètre, incapable d’entendre autre chose que les soupirs et les gémissements des arbres, je n’émets guère plus qu’un murmure, car la pluie qui pisse dru est trop abondante, trop sonore. Quelle créature aurait l’idée de sortir par un temps pareil ?
Je n’ai qu’à tendre les bras pour toucher de chaque côté un mur de pins trempé, impénétrable. Je frappe ma canne aux rochers quand j’en rencontre un, la cloche de vache sonne, au rythme de la chanson de Burl Ives, The Big Rock Candy Mountain. Je marmonne Oh, les abeilles qui bourdonnent dans les arbres à cigarettes, la source d’eau gazeuse… Voilà que j’explore, une fois de plus, le répertoire d’airs que je chantais autrefois aux garçons pour qu’ils s’endorment, et dont les paroles me sont gravées dans le crâne à force de les avoir répétées.
Je négocie le virage en épingle près de la pente qui descend à la rivière, où jaillit la citronnade et où chante le merlebleu, puis, à deux pas devant moi, je découvre un jeune wapiti à demi dévoré. À demi seulement.
Je trébuche en arrachant ma capuche. Membres déployés, le wapiti gît sur le dos, éventré, une partie des cuisses déchiquetée de l’intérieur, des lambeaux de chair pendent mollement contre la ligne ivoire de l’os. Titubant en arrière, je sors mon spray anti-ours dont j’enlève la sécurité. De l’autre main, j’ouvre l’étui de mon revolver et je glisse mes doigts autour de la poignée.
Encore un pas en arrière, puis un autre, la pluie coule dans mon cou. Pour un grizzly, un wapiti né la veille ne saurait être qu’un casse-croûte. Pas quelque chose qu’il mange en partie et finit plus tard. Et de toute façon, si l’ours avait eu l’intention de revenir pour terminer son repas, il aurait entassé des choses sur le cadavre pour le dissimuler.
Je l’ai dérangé. Avec ma chanson. Reculant toujours, j’examine les arbres, leur muraille nue et humide, et je n’y vois pas au-delà d’un mètre cinquante.
Je prends le virage à reculons, spray brandi devant moi, alors que le wapiti disparaît derrière les branches, je me retourne et je reviens très vite sur mes pas. Je martèle le sol avec ma canne, j’essaye de crier, “On arrive, dégagez, dégagez”, ce que d’après mon père, ils criaient tout le temps dans la Navy quand ils couraient dans les couloirs étroits du bateau. Au début, ma voix est à peine plus audible qu’un couinement de souris. Je réessaye.
Les œufs de Spruce Creek seront tout seuls aujourd’hui. Et demain.
Je bondis hors des arbres, je cherche des traces sur le sol et n’y trouve que les miennes. Avançant à grands pas, comme j’y vois à nouveau clair, je regarde partout, au-delà de l’herbe rase, des rochers noircis, jusque dans les arbres calcinés, couleur de suie, de l’autre côté de la gorge abrupte de la rivière, vers la paroi brûlée de la falaise. Je me laisse glisser comme en ski sur la pente de boue jusqu’au petit pont, que je franchis en courant, et je ralentis quand je m’approche des bois sombres de cette autoroute pour ours. En criant Embrasse-moi pour me souhaiter bonne nuit et aide-moi à dire mes prières ! – paroles d’une chanson que je n’ai jamais chantée aux garçons –, je marche avec précaution dans les traces où j’ai cheminé ce matin, sous la pluie qui tambourine.
Je fais le tour de la cabane, j’ouvre les volets, je laisse la brume grisâtre s’infiltrer par les fenêtres. Le rouge-gorge qui niche sous le toit du porche s’envole sous mon nez et je lâche un rapide Putain ! comme si un grizzly ailé m’avait foncé dessus. En reprenant mon souffle, j’ouvre la fermeture de mes vêtements de pluie et je me débarrasse d’autant de boue que possible. Puis je tourne la clef dans la serrure et j’entre comme si mon retour n’avait jamais été tout à fait certain, je m’adosse à la porte et j’inspire profondément. Je crie dans l’unique pièce vide :
— Les garçons ! Je suis rentré !
Pas de doute : l’ours m’a fait une faveur en retournant en catimini dans les pins, d’où il m’observe peut-être, au lieu de me défier pour récupérer sa proie. Ou de m’ajouter à son butin. Il est seul maître à bord. Je secoue la tête, la chaleur du feu couvert dans le poêle me réchauffe, mais n’élimine pas le frisson qui me parcourt.
Je prends une bûche dans la caisse à bois, j’ouvre le poêle et je la place au-dessus des braises. Puis une autre. Je referme le poêle, je recule et je détache de ma chemise de laine un éclat de bois blanc et net.
Il y a un mois, je m’étais battu pour amener les garçons ici avec moi. Un mois en pleine nature. Une expérience de la vie sauvage qu’ils conserveraient toute leur vie.
Nolan, neuf ans, Aidan, six ans. Mes fils. Ni l’un ni l’autre n’est beaucoup plus gros que ce petit wapiti.
Neuf et six ans. Avec un sentiment proche de la surprise, je me rends compte que je suis père depuis neuf ans seulement. Mais qu’étais-je auparavant ? Un gosse moi-même, pendant quoi ? Dix-sept années ? Puis je suis parti pour l’université, les étendues sauvages du Montana, et ensuite ?
Plein de choses ont suivi, je le sais, des décennies entières, mais tout cela, tout ce que j’ai fait, ou du moins les raisons pour lesquelles j’ai agi, quand il y en avait, tout semble avoir simplement disparu. Avant de devenir père ? Il s’est juste écoulé ces trente-six premières années. Puis Nolan. Et Aidan.
Avant – Après.
Mais au bout de neuf ans à peine, j’ai failli les offrir en pâture aux grizzlys. Et pourtant, je ne pourrais souhaiter davantage leur présence ici.
2
Great Falls, Montana
Avril 2004
APRÈS m’être installé à dix-sept ans dans le Montana, j’ai passé des années à rêver aux montagnards et à leurs exploits virils et solitaires, je rêvais de trouver une cabane introuvable car trop isolée, digne d’une carte postale, avec peut-être un hybride de loup qui passerait la gueule à la porte pour anéantir tous les étrangers. Au lieu de quoi je me suis établi à Great Falls, dans les plaines accolées à l’épine dorsale des Rocheuses, mais pas dans les montagnes proprement dites. Une grosse rivière lente et boueuse traversait la ville, contrôlée par des écluses. Notre maison était un bungalow de style Craftsman construit quatre-vingts ans auparavant dans une rue bordée d’ormes. Tous les jours, j’emmenais Nolan et Aidan à pied à l’école ; l’aîné était en troisième année à l’école élémentaire Roosevelt, le cadet terminait la maternelle. De la nature sauvage à la vie bien sage.
En avril, sous un soleil qui chauffait à peine et alors que les arbres commençaient à bourgeonner, nous revenions tous les trois de l’école en donnant des coups de pied dans un caillou. Je les écoutais me raconter leur journée loin de moi quand, à vingt mètres de notre maison, un pick-up tourna au coin de la rue et, au lieu de redresser, fonça droit sur nous, pour ne s’arrêter qu’après avoir heurté le bord du trottoir. Les garçons ouvrirent de grands yeux en voyant Steve, un biologiste des pêches que je connais, se pencher à la vitre en souriant.
— Eh, dit-il, si jamais tu as envie d’un boulot, j’ai peut-être exactement ce qu’il te faut.
— Du boulot ? Moi ?
— On pourrait avoir besoin d’un baby-sitter pour des œufs d’ombre, sur la Sun River. Avec ton expérience…
Je souris. Mon hiver passé à surveiller des œufs de saumon, vingt-cinq ans auparavant, me revenait comme un boomerang.
Toujours penché à sa vitre, il dit que cette histoire d’ombres supposait sans doute de camper là-bas pendant environ un mois. Il sortait tout juste d’une première réunion à ce sujet et n’avait pas beaucoup plus de détails que ça.
— Après ton hiver au bord de la Selway, un mois de printemps là-haut, ça devrait être une promenade de santé, non ?
Les garçons, timides dans le meilleur des cas, se pressaient contre moi, sans en perdre une syllabe.
— Et j’en fais quoi, de ces deux-là ? demandai-je.
Si tant est que j’aie alors réfléchi, c’était pour espérer qu’on nous fournirait une tente-abri. On s’installerait à côté d’une route forestière déserte, d’un petit ruisseau, les garçons s’éclabousseraient dans les mares à castors, fabriqueraient des bateaux qu’ils lanceraient dans les rapides et bombarderaient de cailloux quand ils les verraient filer en aval. Un peu de pêche. Des arcs et des flèches. Couper du bois. Bâtir des feux. Assez de gens de passage pour les maintenir en éveil. Toutes ces images entrevues en une seconde ou moins.
— Ils pourraient venir avec moi ?
— Je ne vois pas pourquoi ils ne pourraient pas, répondit Steve.
Je lui demandai de se renseigner et de me tenir au courant. Il hocha la tête, un sourcil haussé comme si tout cela n’avait été qu’une plaisanterie, un bon mot sur mon goût pour les emplois extravagants.
Il alla se garer de l’autre côté de la rue dans son allée, mission accomplie, mais Nolan s’accrocha à ma main. Pour lui, ça ne faisait que commencer.
— On peut ?
— Il faudrait qu’on en sache un peu plus.
— Oui, mais on peut ?
— Il ne sait même pas si ça va vraiment se faire. Ni quand. Ni où.
— Mais si ça se fait, on peut ?
— On verra.
— Et même si ça ne se fait pas, on peut quand même partir camper un mois ?
— Attendons de voir ce qu’il nous dira.
— Mais on peut quand même partir camper un mois ? Pendant l’école ?
Ils étaient allés plus d’une fois au bord de la Selway River, à Indian Creek. Depuis des années, au moment de les endormir, je devais leur raconter des histoires inspirées de mon hiver là-bas. Le lynx qui entraîne le cerf dans sa chute d’une falaise. Le puma bondissant du haut d’un affleurement rocheux.
— On va réfléchir.
Il me regarda d’un drôle d’air. On va réfléchir ? Pire que On va voir.
Aidan ramassa un bâton, le fit pivoter à droite, à gauche, pour voir s’il faisait une bonne épée. Nolan trottinait à côté de moi.
— Si on y va, on pourra fabriquer des mocassins ? Comme ceux que tu t’es faits à Indian Creek ? Ceux qui montent jusqu’au genou ?
— On pourra en fabriquer même sans aller là-bas.
— Ce sera mieux si on les fait là-bas.
Là-bas. Dieu sait où. Déjà en train de tout prévoir avec le même soin méticuleux que son père.
— On pourrait fabriquer tous nos habits en peau de cerf, dit-il.
L’automne précédent, nous avions passé un temps fou à tanner avec de la cervelle une peau d’antilope et avions fini par obtenir assez de cuir souple pour en faire un chiffon qui tenait la route. Nous ne nous étions pas encore attaqués à une peau de cerf, nous n’en avions pas sous la main – mais vous savez, ce n’était que des détails.
— On pourra tailler un silex pour faire des pointes de flèche, tuer un oiseau pour l’empenne. On allumera tous nos feux avec un briquet à silex en acier.
Et il continua, encore et encore. Tout l’après-midi. Toute la soirée.
Pour terminer, cette nuit-là, dans son lit, une fois l’histoire lue et les lumières éteintes, alors que je me penchais pour lui faire un câlin et l’embrasser, il dit :
— On peut ?
— Je ne sais pas, mon bonhomme. On verra.
Même dans le noir je le vis rouler des yeux. On verra.
Une fois les garçons bien au chaud dans leur lit, je transmis à Rose le peu de détails dont je disposais, en concluant, de l’air le plus désinvolte possible, que ce serait génial pour eux, si ça marchait. Elle haussa un sourcil.
— Les grizzlys, dit-elle.
— Les grizzlys ?
— Il y en a partout, là-haut.
— C’est comme si on avait peur de la foudre.
— Au printemps ? Quand ils sortent de leur hibernation ? Affamés ? Toi dans une tente avec tes réserves de nourriture ? Autant accrocher un panneau : DÎNER TOUS LES SOIRS.
— La nourriture serait enfermée dans le camion.
— Si tu es au bord de la route.
— Ouais, eh bien ?
— Ils ne feraient qu’une bouchée des petits, dit-elle en secouant la tête.
Les pumas ne l’enthousiasmaient guère plus.
— Des sales bêtes sournoises.
Et il y avait aussi les loups. L’eau rapide et glacée. Les chutes. Les blessures. Les maladies.
J’agitai les mains en chantant :
— Les lions, les tigres et les ours, oh mon Dieu.
Elle me dévisagea.
3
Bob Marshall Wilderness, Montana Mai 2004
DEVANT le feu rugissant, j’enlève mes bottes ; des blocs de boue se détachent des semelles et tombent de mon pantalon de pluie. Mes pieds nus laissent des traces nettes sur le plancher en chêne tandis que je mets mes habits à sécher sur les fils à linge au-dessus du poêle, puis je me rhabille comme si je pouvais recommencer la journée. J’approche une chaise du poêle et je tends les mains, le bout des doigts un peu fripé.
Les battements de mon cœur ont depuis longtemps ralenti, la poussée d’adrénaline provoquée par le grizzly s’estompe, je m’avachis, je souffle. Mes vêtements fument sur leurs fils, de l’eau en ruisselle de temps à autre, les gouttes sifflent et dansent sur la plaque en fer recouvrant le poêle, et je ferme les yeux pour écouter. Je somnole peut-être, un peu, et je suis réveillé par quelque chose : un changement dans l’air, un son, un mouvement. Je me redresse. Le tambourinage de la pluie s’est tu. Je me lève, je marche jusqu’à la porte et je l’ouvre. Il ne pleut réellement plus.
Des volutes de brouillard s’accrochent aux saules près du ruisseau, autour des arbres dans la prairie, mais au-dessus on dirait presque qu’il y a des taches plus claires, que les nuages s’effilochent. J’enfonce mes pieds dans mes bottes moins humides, sans prendre la peine de nouer les lacets, et je pénètre dans la nouveauté de l’air sec. Mes pas finissent par me mener au tas de bois, et je décroche au passage la hache sous le porche de la grange.
Pendant une heure, le bruit régulier de la hache, le sapin sec qui se fend et les brassées que je transporte encore et encore vers la cabane me tiennent occupé. Je regarde de temps en temps vers les rangées d’arbres, cherchant des ours que je ne m’attends pas vraiment à voir, et vers le ciel, en quête d’un bleu que j’ai encore moins l’espoir d’apercevoir. Après avoir rentré ma dernière pile de bûchettes, une fois la caisse à bois pleine à craquer, j’ouvre le côté provisions du refuge, je grimpe à l’échelle jusqu’à la plateforme à l’abri des souris, et j’en tire le paquet de pâte à cookies aux pépites de chocolat que j’avais mis dans les bagages à l’époque où je pensais encore que les garçons viendraient.
— Dessert spécial, ce soir, dis-je comme s’ils étaient avec moi, habitude que je n’arrive pas à perdre. On n’est pas encore transformés en crottes d’ours, ça se fête !
Plus tard, je tire du poêle la dernière fournée, admettant enfin qu’il m’aurait été impossible de les pousser jour après jour sur le chemin de Hansel et Gretel. Pourtant, avec l’odeur des cookies chauds qui remplit la cabane, le soleil – je vous jure – qui fait une apparition quelques minutes avant de disparaître derrière les montagnes, je ne peux pas m’empêcher de me demander comment se serait passé un mois comme ça avec eux, les couveuses visibles depuis la cabane et non pas à huit kilomètres, sans boucle quotidienne de seize kilomètres à se farcir. Si, comme Indian Creek, cette expérience les aurait lancés sur une voie qu’ils suivraient toute leur vie. Et alors combien de grizzlys auraient reculé dans l’ombre pour les laisser passer. Ou pas.
Je dépose les cookies sur la table – personne n’est là pour s’en régaler – puis je les écarte, incapable de trouver l’appétit d’en grignoter un seul. Sans le dire à Nolan, j’avais découvert où m’approvisionner en peaux de cerf à Great Falls et j’en avais caché quelques-unes dans mes bagages avant de partir. Je les tire maintenant de sous mon lit, je les étale sur la table et, au milieu, roulés serré, presque oubliés, il y a leurs T-shirts – les patrons pour la tenue de montagnard que je leur aurais fabriquée ici. T-shirt Batman pour Aidan, Roosevelt Roadrunner pour Nolan. Cette découverte m’arrête net.
Il m’est tellement facile de les imaginer dans ces vêtements, ici, dans cette cabane, filant dehors sous la pluie, me demandant s’ils peuvent placer la prochaine bûche dans le feu, allumer la lanterne, débiter le bois. Je reste un moment à les regarder, avant de finalement prendre mon crayon et de tracer le contour des T-shirts, puis j’attrape mon couteau, je taille l’avant et le dos, je laisse délibérément les contours irréguliers de la peau pendre en bas, je perce des trous tout le long des bords. Au lieu de fil, pour assembler les deux morceaux, je découpe à la lumière de la lanterne des mètres de lacet de cuir que j’insérerai en croisillons. Le plus extraordinaire des habits de sauvage.
Entouré par eux, je rapproche ma chaise du feu, la pluie se remet à frapper le toit, et ils se pressent contre moi, ils me regardent serrer et croiser les lacets. Ils me cachent la lumière. Je jurerais sentir leur odeur.
4
Great Falls, Montana
Avril 2004
DANS les semaines qui suivirent la rencontre avec le biologiste des pêches, les détails arrivèrent au compte-gouttes. Il n’y avait pas vraiment de route. En fait, au bout des deux heures de voiture jusqu’aux montagnes, il fallait prendre un bateau pour traverser le Gibson Reservoir, et il restait une journée entière à cheval, pour remonter sur vingt ou trente kilomètres le bras nord de la Sun River, avec toutes les affaires portées par des mules.
Même si l’endroit était un peu plus éloigné encore, un peu plus isolé – genre en plein milieu de la Bob Marshall Wilderness, en réalité –, il y avait une cabane, un poste de garde du Forest Service. Un domicile en dur, à l’épreuve des ours. Je fis valoir tout cela à Rose, et elle contre-attaqua. Comment pourrais-je avoir un œil sur les deux garçons, vingt-quatre heures sur vingt-quatre ? Jusqu’où faudrait-il aller chaque jour pour veiller sur les œufs ? Comment comptais-je contenir Aidan, qui n’aimait rien tant que courir comme un chien fou ? Comment ferais-je pour les distraire ?
Ils ne regardaient pas la télé, nous n’avions pas de Xbox. En guise de PlayStation, ils avaient le jardin. Pas plus tard que l’année d’avant, en partant passer les vacances de printemps dans le Grand Canyon, une amie nous avait donné deux Gameboys pour le trajet. “C’est la seule solution, avec des gosses.” Je les avais fourrées au fond d’un placard, où je n’étais jamais allé les rechercher ensuite.
J’étais toujours à l’affût de toutes sortes de choses. Un jour, dans la rue, j’avais repéré une énorme souche de peuplier sciée, une rondelle d’un mètre de diamètre, épaisse d’une vingtaine de centimètres. Je l’avais remorquée jusqu’à la maison, j’avais construit un trépied sur lequel la dresser, ses trois anneaux tournés vers les garçons, en guise de cible pour les hachettes qu’ils avaient appris à lancer, pour leurs gigantesques couteaux de montagnards.
Dans notre jardin, j’avais bâti une cabane dans un arbre, en posant un plancher sur les quatre branches principales d’un pommier sauvage. Le tronc passait à travers le sol, sur les côtés, à travers le toit. Pour en sortir, une glissière recouverte de PVC leur donnait l’impression de franchir le mur du son à chaque descente. Les fenêtres donnaient sur tous les accès : vers la rue, vers la maison, à l’arrière vers notre mystérieux voisin, Earl, qui surveillait leurs cabrioles.
Un jour, les garçons revinrent du jardin, munis de plusieurs sphères d’acier massif, luisantes, un peu plus grosses que des balles de golf.
— C’est quoi ? voulurent-ils savoir.
J’en pris une, l’enveloppant dans mes doigts. Un poids respectable, un poli qui les faisait presque ressembler à du verre. Elles étaient très sympas, je devais le reconnaître.
— Vous les avez trouvées où ?
— Sous notre cabane, dit Aidan en désignant l’endroit.
Pour la plupart des gamins, ç’aurait été de vraies boules de démolition. Soit un dingue distribuait des instruments de carnage aux gosses du quartier, soit une sorte de Boo Radley1 déposait des trésors au pied de l’arbre.
Un jour, ce fut une petite boîte à matériel de pêche. Une autre fois, de vieilles chaises de jardin avec des pieds de dix centimètres. Parfaites pour leur cabane.
Lorsque Nolan décida de fabriquer un atlatl – un antique bâton à lancer les javelots, ancêtre de l’arc et des flèches – en vue d’une fête de la science à l’école, je surpris Earl qui nous observait par la porte ouverte de son garage, tandis que nous portions jusqu’à la voiture les dards longs d’un mètre cinquante ornés de plumes de dindon.
Et il nous attendait au même endroit quand nous revînmes du parc, où Nolan avait envoyé ses projectiles à cinquante mètres de distance.
— Un atlatl ? demanda-t-il. (Il s’avança dans l’allée et désigna le lance-javelot. Nolan acquiesça.) Comme ceux qu’utilisaient les chasseurs de mammouths ?
Nolan se tourna vers moi, l’air intrigué – Comment il a deviné ? –, puis hocha la tête de nouveau.
Earl nous fit signe de le rejoindre dans son jardin, dans sa maison, territoire inconnu pour nous tous.
Sur une longue table, dans son salon, sous une télévision bien plus grande que la nôtre, était posé un objet incurvé, d’un mètre quatre-vingts de long et de huit ou neuf centimètres d’épaisseur. Couleur cuir de Cordoue, entre le bois et l’ivoire.
— Une défense de mammouth, dit Earl. Je l’ai trouvée quand je travaillais sur le pipeline. De temps en temps, ils s’aventuraient hors de la toundra. Il y en avait une autre plus grosse, mais je n’ai pas pu la rapporter.
Les garçons ouvraient de grands yeux, comme si la chose était en or massif.
— Vous pouvez toucher, dit Earl.
Et ils ne se firent pas prier. Ils passèrent les mains sur cette courbe préhistorique, couverte d’un réseau de craquelures si fines qu’on les sentait à peine. Je savais qu’ils se représentaient la bête entière, le salon rempli et empuanti par les dreadlocks humides du mammouth, vibrant au rythme de son souffle océanique, l’affrontant tous les deux avec leurs dards soudain minuscules.
L’année suivante, comme l’intérêt scientifique de Nolan se portait désormais sur les châteaux et les chevaliers, les armures et les épées, nous assemblions d’innombrables petites boucles de métal pour fabriquer une cotte de mailles pendant les matchs de football à la télé. Un labeur sans fin, du sur-mesure pour ses étonnantes facultés de concentration, grâce auquel il produisit des pans où chaque anneau était rattaché à quatre autres, puis une pièce plus petite, un carré de quinze centimètres de côté, où chaque maille tenait à six autres : l’armure des rois.
Nous emportâmes le résultat dehors, le fixâmes sur la balle de foin qui délimitait l’espace de tir et Nolan cribla son œuvre de flèches. Il lança des javelots dessus. Ensuite il s’attaqua à un morceau de peau d’élan non tannée. Puis à une plaque d’acier dérobée à la déchetterie. Pour tester les différents moyens de défense de l’époque. En prenant des notes méticuleuses. De son garage, Earl nous observait.
Le lendemain, une fois les garçons à l’école, on sonna, la porte de derrière s’ouvrit avant que j’aie pu quitter ma chaise et quelqu’un cria :
— Vous êtes là ?
Sur le seuil, Earl tenait une épée de soixante centimètres en acier scintillant, avec un garde-main et même une pointe incurvée en arrière.
— J’ai pensé qu’il aurait peut-être envie de tester toutes ses armures avec une épée aussi. Mais je me suis dit qu’il valait mieux vous la donner d’abord, que vous puissiez décider.
Je passai le pouce sur le fil de la lame.
— Faites attention, je l’ai aiguisée.
En effet. C’est une blague ? me demandai-je. Mais il nous avait vus tendre, racler, tanner une peau d’antilope avec de la cervelle dans notre cabane haut-perchée. Il avait regardé les garçons lancer des couteaux, des hachettes, descendre la glissière en hurlant, en veillant bien à ce que leur peau nue soit préservée des dangers de la rentrée dans l’atmosphère terrestre. Une lame tranchante comme un rasoir pouvait-elle être pire que cela ?
Earl recula et repartit vers l’allée. Je le suivis, le remerciai, puis lui posai la question :
— C’est vous qui avez laissé des boules d’acier dans le jardin, un jour ?
Il se retourna et sourit.
— Elles viennent des roulements à billes des trains. J’étais allé voir des potes à l’atelier, j’ai pensé que ça plairait peut-être à vos gamins.
J’appris qu’il travaillait jadis dans les chemins de fer, à la maintenance.
— J’ai bien dit à vos gamins. Je donnerai jamais ça à mon neveu.
Il regagna son garage, en me saluant par-dessus son épaule.
Je clouai au bloc de peuplier les différentes pièces d’armures. À leur retour, les garçons s’acharnèrent dessus avec l’épée. Nolan prit des notes. Quand vint le jour de la fête de la science, il ne fut pas autorisé à apporter ses armes. Juste ses conclusions. Il termina à la deuxième place. Privé de sa victoire.
— Ç’aurait été mieux avec les armes, dit-il.
Au pied de leur lit, chacun avait un grand seau rempli d’épées en bois que je leur avais fabriquées, des copies des épées, couteaux, javelots, arcs et lances du Seigneur des Anneaux. Leurs seaux d’armes. Un de mes amis, venant chez nous pour la première fois, les avait suivis dans leur chambre, avait tiré une des épées et s’était étonné : “Qu’est-ce que c’est ?” Aidan avait répondu “Mon seau d’armes”, comme il aurait pu dire mon couvre-lit ou mes chaussures – cela allait de soi. Mon ami était ressorti en secouant la tête. “Un seau d’armes, j’aimerais bien en avoir un, moi aussi”, avait-il conclu.
Sur sa coiffeuse, contre le rebord de la fenêtre, Rose avait un long alignement de cailloux en forme de cœur, cadeaux d’Aidan.
Dans leur chambre, en plus des seaux d’armes, ils avaient un aquarium, perché sur leur vieille table à langer. Il contenait un morceau de basalte trouvé dans les champs de lave de l’Idaho, des pierres incrustées de cristaux ramassées dans les monts Pioneer. Et un crapet arlequin. Une perche. Deux poissons capturés dans un bassin en bordure du Missouri, une ancienne carrière de gravier que des gens avaient remplie d’eau, seau après seau. Nous descendions le Missouri, puis nous lancions nos lignes avec, au bout, des vers ou des flotteurs. Ils faisaient des ravages, et nous mangeâmes de la friture pendant des jours et des jours avant qu’Aidan décide qu’il voulait garder certaines de nos prises.
Durant tout l’hiver, il les nourrit avec ce qu’il trouvait comme bestioles, mais surtout des vers de terre. En les laissant pendre devant l’aquarium, en les promenant lentement d’un bout à l’autre de la vitre, il entraînait le crapet, baptisé Squiggles – gribouillis – à cause des motifs bleu vif qu’il avait sur la tête, à surgir de l’eau pour lui arracher le ver des mains. Un parc aquatique SeaWorld en miniature, à Great Falls.
Dans un autre étang, il attrapa un jour une carpe de huit livres avec sa canne à pêche Zebco qui mesurait un peu moins d’un mètre. Comme il tirait et tirait, moulinait et moulinait, nous crûmes qu’il avait pêché un sous-marin. Il fut hors de lui quand je relâchai l’animal, le plus gros poisson que nous ayons jamais vu. Plus tard, il attrapa une tortue serpentine, et il fut moins contrarié qu’on la relâche.
Pour la fête de la science de l’année suivante, fidèle à son goût pour le Moyen âge, Nolan se plongea dans la guerre de siège et nous construisîmes un trébuchet, sorte de catapulte mécanique améliorée.
Nous n’avions vraiment pas besoin de Gameboys.
Nolan pouvait passer des journées entières à lire, Aidan aimait aller à la pêche, mais si, en pleine nature sauvage, la rivière était haute et qu’il était impossible de pêcher ? Et vraiment, même si cette dernière était accessible, tiendraient-ils un mois entier ? Pourtant, depuis leur naissance, ils campaient, descendaient des rivières, séjournaient dans les cabanes du Forest Service. Je pourrais leur apprendre la pêche à la mouche. Nous aurions le temps. Nous emporterions des jeux de cartes, des balles et des gants de base-ball, des peaux de cerf à coudre (si je parvenais à m’en procurer), nous fabriquerions des frondes, des arcs et des flèches. Ils écumeraient les bois pour trouver des bâtons parfaits, par milliers (le tout sans jamais sortir de mon champ de vision). Nous fabriquerions assez d’épées et de lances, de couteaux et de poignards pour repousser des armées entières d’Orcs. Mais un mois ? Après la promenade jusqu’aux œufs de poisson, comment remplir les vingt-trois autres heures de la journée ? Jour après jour ?
Concernant cette promenade. Dave, le biologiste responsable, dit qu’il tâcherait de les maintenir à moins de deux kilomètres de la cabane, mais qu’il ne serait sûr de rien tant que la neige n’aurait pas fondu et que les poissons n’auraient pas pu choisir leur endroit. Mais s’ils s’installaient à plusieurs kilomètres ? Les garçons étaient capables de faire le trajet chaque jour. Rien que cela les occuperait, et permettrait de structurer la journée.
Honnêtement, je m’inquiétais plus pour le voyage que pour cette marche quotidienne. Au début, ce serait formidable, il y aurait l’immense nouveauté des chevaux, pour eux qui se rêvaient depuis toujours en cow-boys, et je me représentais presque Nolan endurant sa journée entière en selle, d’un sérieux imperturbable. Mais j’avais beaucoup plus de mal à m’imaginer Aidan se tenant juste tranquille, et surtout supportant une journée pareille sans décider qu’il en avait marre. Le tout en présence d’un groupe de cavaliers, de vieux briscards de la vie sauvage qui ne faisaient qu’une bouchée des enfants turbulents.
Afin de m’acquitter modestement de la dette que j’avais envers eux, je téléphonai à mes parents, comme je l’avais fait vingt-cinq ans auparavant pour leur annoncer que j’allais passer l’hiver seul dans une tente, en pleine nature, sans aucun contact avec le reste du monde. Cette fois, leur dis-je, j’emmènerais les garçons.
— Quoi ? s’exclama ma mère.
Je lui fournis tous les détails dont je disposais.
— Et s’ils décident qu’ils veulent rentrer à la maison ? Au bout d’un jour ou deux ? Et s’il pleut tout le temps ?
Lorsque nous étions gamins, nous avions passé des semaines à regarder tomber la pluie, dans une cabane louée au bord d’un lac du Wisconsin. Mes parents, qui se décarcassaient pour trouver des moyens de nous distraire, nous avaient emmenés en voiture visiter Mineral Point, ma mère nous abreuvant d’informations historiques tirées des brochures distribuées par la Chambre de commerce. Et ils nous avaient fait découvrir les curiosités naturelles, en expliquant tous les détails de la glaciation à un break rempli d’enfants humides et désespérés : les kettles, les moraines et les eskers, les crêtes terminales. Les seuls moments mémorables étaient les bosses sur la vieille autoroute. Mon père les prenait assez vite pour nous laisser un instant le ventre en suspens – les garçons hurlaient, les filles gémissaient. C’était quelques jours avant que tout le monde tombe malade, avant que les soirées se réduisent à des séances au cours desquelles mon père nous forçait à nous asseoir l’un après l’autre à la table de la salle à manger, et nous demande de renverser la tête en arrière en disant “Ah” tandis qu’il nous étouffait avec de longs cotons-tiges et nous barbouillait les amygdales de gentiane pourpre.
— Ce sera une nouvelle version des vacances familiales en enfer, dis-je. Mais ils adorent camper. Et s’il pleut, ou s’ils en ont marre, on fera avec.
— Tu seras bien obligé, répondit mon père.
— C’est de la folie, commenta ma mère.
Tandis que je pensais “Je vous ai simplement téléphoné pour vous prévenir, pas pour demander votre permission”, ils continuèrent ainsi jusqu’à ce que mon père conclue, sans pouvoir réprimer un gloussement :
— Bon, tiens-nous au courant. Ce sera pour eux une expérience inoubliable. En bien ou en mal.
Jouant sur les deux tableaux, je me mis à faire des achats, à mettre de côté des choses que nous pourrions emporter pour notre mois en pleine nature, et j’ouvris dans le même temps leur saison de base-ball, ce rituel de printemps, en tant que coach de leurs deux équipes, tout en cherchant d’autres pères pour me remplacer, au cas où. Je décrochais le gros lot dans l’équipe d’Aidan, quand le grand-père de l’un des joueurs ramassa une balle lancée trop loin et me la renvoya, une parfaite balle papillon. Je haussai le sourcil, m’approchai et lui demandai qui il était. Il répondit qu’il s’appelait Jack, mais affirma qu’il était venu en simple spectateur. Il évoqua ensuite ses années passées en ligue mineure, et m’expliqua qu’il avait dû arrêter lorsqu’il avait fondé un foyer. Quand je lui proposai de devenir coach, il sauta sur l’occasion. En matière de base-ball, il en avait oublié davantage que je n’en avais jamais su. Je parlai aussi du projet aux instituteurs, qui jugèrent absurde qu’on puisse renoncer à une telle expérience de peur de manquer quelques semaines en maternelle et en troisième année d’école élémentaire.
Le projet était devenu beaucoup plus ambitieux qu’un mois de camping au bord d’un chemin de terre, mais je l’avais aussi laissé dépasser le stade du “On verra”. Peut-être en était-on arrivé au stade du “Peut-être”. Même si j’ajoutais toujours qu’on ne savait pas encore, que rien n’était certain, j’aurais dû me rendre compte que Nolan s’y voyait déjà, et qu’une légère fébrilité pointait.
Puis, à juste une semaine de la date du départ que les garçons avaient en tête, Dave appela. Le Forest Service prêtait la cabane de Gates Park aux gens du Fish and Game2. Avec les garçons, se posaient des questions de responsabilité en cas d’accident. Dave avait réussi à convaincre les instances responsables de la chasse et de la pêche, mais il venait d’avoir au téléphone le garde forestier du district et, conformément à tout ce que j’avais appris en travaillant pour les parcs nationaux, ce personnage refusait d’assumer le moindre soupçon de responsabilité.
— J’ai tout essayé, expliqua Dave. J’ai même dit qu’on pouvait rédiger une clause excluant toute possibilité de poursuite. Il n’a pas voulu en démordre. Ils refusent que tes enfants t’accompagnent.
Je contemplai le téléphone.
Dave me demanda si j’étais toujours partant, même seul.
Je lui dis que je le rappellerais.
— TU leur en as parlé ? demanda Nolan. Qu’est-ce qu’ils ont dit ?
— Il y a un problème de responsabilité, répondis-je, avant de tenter de définir cette notion pour un enfant de neuf ans.
— Mais il ne va rien nous arriver.
— C’est au cas où il arriverait quelque chose.
— Mais les gars de la pêche et de la chasse diront que tout est de leur faute.
— Ils ont des règles pour les enfants de moins de douze ans.
— C’est juste parce que je n’ai pas encore douze ans ?
— Ils ne laissent pas leurs employés emmener leurs enfants, donc ils disent que vous ne pouvez pas m’accompagner.
— Tu ne travailles même pas pour eux. Ils pourraient dire ça à leurs employés, comme ça, tu pourras nous emmener.
— Je sais, mais…
— Appelle le type, supplia-t-il. Le type du district. Si c’est lui qui ne veut pas, ce serait peut-être mieux que tu lui parles toi-même.
C’était Nolan qui devrait parler au garde forestier du district, me dis-je ; il obtiendrait un résultat bien plus vite que moi. J’aurais aimé voir le bureaucrate essayer de se dépatouiller devant lui.
— Je pense que tu dois parler à ce type, Papa.
— QUI est à l’appareil ? demanda une voix de femme.
Elle me laissa patienter une minute, puis m’annonça que le garde forestier du district venait de sortir, mais qu’il me rappellerait.
Le lendemain, il était déjà en ligne.
Le surlendemain, il n’était pas à son bureau.
Le sur-surlendemain, en congé annuel. Jusqu’à une date postérieure à celle de notre départ.
Nolan était fou furieux. Chaque jour, il se précipitait hors de l’école, me prenait par le bras et s’y suspendait.
— Alors ?
— Le type du district ne veut pas me parler. Il ne me rappelle même pas.
— Continue à lui téléphoner.
— C’est ce que je fais.
Nolan émit un curieux rugissement étouffé, sa façon à lui d’exprimer la contrariété suprême. Il donna des coups de pied dans les gravillons.
Ce soir-là, je piquai une colère : c’était ce genre de fonctionnaire scrupuleux, obsédé par les règles, qui m’avait convaincu de quitter le National Park Service. Mais Rose répliqua :
— Ça ne se fera pas, voilà tout. De toute façon, c’était complètement dingue.
Je me hérissai en entendant ce dernier mot. Dingue ? De laisser les garçons s’ébattre en pleine nature ? De laisser tomber les jeux vidéo et les jeux de rôle pour exister vraiment ? D’avoir en eux ce qu’aucun autre gamin de leur âge ne connaîtrait jamais ?
— Alors je ne me vois pas y aller sans eux. À quoi bon ?
Rose me regarda.
— À quoi bon ? Parce que c’est le genre de trucs que tu fais, que tu as toujours fait. Tu ne peux pas sans cesse remettre les choses à plus tard à cause d’eux.
— Je ne remets pas les choses à plus tard.
— Pourtant, ce projet, c’est vraiment toi.
— C’est moi ? Quoi ?
— Ils survivront sans toi. On survivra. Tu ne pourras pas toujours renoncer à ta vie.
— Renoncer à ma vie ? C’est eux, ma vie.
— Oui, mais ce mois dans la nature, c’est toi aussi. C’est ta personnalité. Il faut que tu acceptes.
Je secouai la tête. Annoncer à Nolan qu’il ne pouvait pas venir, mais que moi j’y allais ? C’était moi, ça ?
— Et puis tu as déjà dit à Dave que tu irais. Comment trouvera-t-il quelqu’un d’autre, maintenant ?
Je téléphonai à Dave pour lui demander une fois de plus s’il pensait qu’il restait le moindre espoir, si une visite chez le garde du district pouvait changer la donne. Armé d’une grenade, peut-être. D’après Dave, c’était inutile, il avait déjà essayé. Tout essayé. Je lui demandai si en refusant, je les mettais dans la panade. Il y eut un silence prolongé, après quoi il dit simplement qu’il comprendrait.
J’étais devant mon bureau au sous-sol, ce sous-sol que j’avais aménagé moi-même, en accord avec le style octogénaire du rez-de-chaussée et des étages. J’avais aussi fabriqué le meuble de rangement, en chêne scié sur quartier, avec des tiroirs à queue d’aronde. C’était moi, ça ? Au-dessus de mon bureau, couvertures encadrées des livres que j’avais écrits et récompenses reçues s’alignaient sur le mur. C’était moi ? Derrière moi, dans la chambre d’amis, la peau du lynx qui était passé par-dessus la falaise à Indian Creek ornait une cloison. Au sommet de la bibliothèque reposait un vieux crâne de bison que j’avais trouvé sur la berge érodée d’une rivière du Wyoming. C’était moi ?
J’inspirai, et, en relâchant l’air, en me dégonflant, je déclarai à Dave que j’irais. Pour toutes sortes de vagues raisons. Ou aucune. Parce que je ne voulais pas le laisser tomber ? Parce que je ne voulais pas renoncer ? Simplement parce que je me laissais porter par le courant ? Parce que “c’était moi” ? Ou celui que j’avais été à une époque ?
Il s’agit du voisin étrange qui fascine et terrifie les jeunes protagonistes du roman de Harper Lee, Ne tirez pas sur l’oiseau moqueur. (Toutes les notes sont du traducteur.)
Extraits

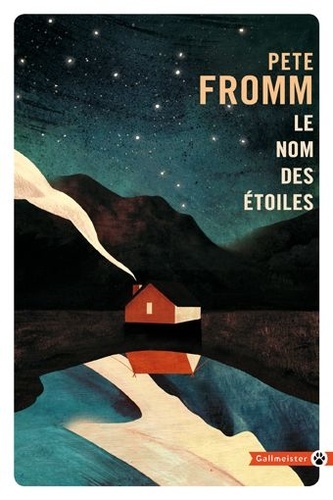


























Commenter ce livre