Du polar
François Guérif
Durant l'année 2012, nous nous sommes régulièrement rencontrés, François Guérif et moi, dans son bureau du boulevard Saint-Germain, pour parler du roman policier. Selon un rituel rapidement très bien huilé, ces entretiens ont vite pris la forme de longues et passionnantes conversations à bâtons rompus, sautant allègrement du coq à l'âne, à l'heure du café. Personnage curieux de tout, gros lecteur, cinéphile boulimique et averti, François Guérif peut en effet passer d'une anecdote sur James Ellroy à sa rencontre avec Clint Eastwood, de l'analyse de l'œuvre de James Cain (auquel il a consacré un livre) à ses souvenirs sur le tournage d'un film de Samuel Fuller. Du coup - et à mon grand plaisir - l'affaire a duré bien plus longtemps que prévu et s'est parfois embarquée sur de curieux sentiers.
Les choses se sont vaguement compliquées le jour où il a fallu commencer à trier. À couper impitoyablement dans des tonnes d'anecdotes, dans des dizaines d'apartés, dans des centaines de parenthèses ouvertes... et pas toujours fermées. Mais bon, tout ce qui était hors sujet devait sauter. Dans ce livre, vous ne lirez donc pas, par exemple, les vifs débats pour savoir quel est le meilleur western de l'histoire du genre (réponse : La Prisonnière du désert, à l'unanimité), ou pour déterminer quel est le disque le plus réussi de Neil Young (verdict : Rust Never Sleeps, pour le fan du Grand Sommeil). Mais l'essentiel est là : pour la première fois, François Guérif porte un regard général, érudit et enflammé, sur sa passion de toujours, le polar.
Des histoires qui me faisaient un peu frémir et dresser les cheveux sur la tête.
Premières lectures. Paul Berna. Serge Dalens. Robert Louis Stevenson. Gaston Leroux. Le cinéma américain. Conan Doyle. Sherlock Holmes, Rex Stout.
Parle-moi de tes premières lectures.
Ce qui est drôle, quand j'y repense, c'est que le polar était présent dès mes premières lectures. Je lisais les collections Idéal-Bibliothèque ou Rouge et Or, destinées à des gamins de huit ou neuf ans. La collection Rouge et Or, par exemple - je l'ai découvert après coup -, on trouve un type comme Paul Berna, connu aussi sous le nom de Paul Gerrard pour avoir écrit plusieurs romans noirs. Pour moi, son roman L'Affaire du cheval sans tête, dont les droits ont été achetés au début des années soixante par Walt Disney, c'est déjà du polar. Du polar pour gamin, mais du polar. Même chose pour la collection Signe de Piste. Les bouquins de Serge Dalens, comme Le Bracelet de vermeil, par exemple, c'était des histoires de mystère, d'enlèvement, de secret. Comme L'île au trésor de Stevenson, que j'adorais. Qui est vraiment ce pirate ? Qu'est-ce que cache cette carte ? Pourquoi le trésor est-il là ? Qu'est-ce qui va arriver ? C'est plein de mystères... Et puis, guère plus tard, j'ai lu des gens comme Gaston Leroux. Je garde toujours un souvenir ému du Mystère de la chambre jaune. Et bien sûr, j'ai lu pour la première fois, à cette époque-là, les aventures de Sherlock Holmes.
Ta passion pour le polar vient de ces lectures d'enfance ?
Au départ, sans doute. Mais ma passion pour le polar s'est affirmée un peu plus tard, dans mon adolescence, moins grâce aux livres qu'à travers le cinéma. Vers treize/quatorze ans, j'étais un fou de cinéma, et plus spécialement de cinéma américain et de cinéma de genre. Et dans ce cinéma de genre, il y avait le film noir.
C'est à cette époque que tu découvres Les Cahiers du Cinéma ?
Au tout début des années soixante, quand on s'intéressait au cinéma, surtout très jeune, on ressentait le besoin d'être guidé et mon frère me donnait à lire Arts, l'hebdo d'André Parinaud et Les Cahiers du cinéma, dont les critiques - mine de rien - s'appelaient Claude Chabrol, François Truffaut, Jean-Luc Godard ou Jean Douchet. Grâce à eux, on apprenait à lire les génériques.
On découvrait que, par rapport à ce qui se disait généralement, du genre « c'est un film avec Jean Marais » ou « c'est un film avec Gabin », c'était le metteur en scène et le scénariste qui étaient importants. Au fil des articles, tu découvrais alors que Le Grand Sommeil était tiré d'un roman de Raymond Chandler, et que Quand la ville dort était au départ un polar de William Riley Burnett. Après avoir vu le film, j'achetais le livre et je le lisais. Et comme j'ai toujours eu un côté curieux et collectionneur, je découvrais vite que l'auteur de Quand la ville dort était le type qui avait écrit Le Petit César, qui était aussi un film. Et je me mettais à la recherche de tous les bouquins de Burnett. De Chandler. De Hammett. Et puis je repérais que le scénariste de tel film, Steve Fisher, avait publié deux livres à la Série Noire, L'Ami des cœurs et Flambe la baraque ! Et donc je recherchais les bouquins. L'effet boule de neige ! Il se trouvait aussi qu'à l'époque, toutes les librairies de Paris - y compris celle en face du lycée Janson où je faisais mes études, et qui pourtant vendait plutôt des fournitures scolaires - quasiment toutes les librairies de Paris avaient à l'extérieur de leur vitrine des boîtes qui proposaient des livres d'occasion. Et la moitié de ces boîtes étaient pleines de bouquins de la Série Noire, de volumes de la collection du Masque et autres romans à énigme... Mais je dirais que ma « spécialisation » vers le polar s'est vraiment faite avant tout à travers le cinéma.
C'est le polar qui t'a donné l'envie d'étudier l'anglais quelques années après et d'envisager de devenir prof ?
Pas exactement. C'est surtout le cinéma, une fois de plus. À partir de la classe de philo, je fréquentais très régulièrement la Cinémathèque, avec un copain, Jean-Pierre Deloux. D'abord un petit peu la rue d'Ulm, puis à partir de 1964 le Palais de Chaillot. Or, à l'époque, quand Langlois proposait un hommage à Minnelli, il y avait vingt-cinq films de Minnelli, et pas un de sous-titré ! Je suis donc l'exemple vivant que la méthode audiovisuelle fonctionne. L'anglais m'a plu très vite, et il me permettait de voir des films que j'aurais eu du mal à comprendre autrement.
En dehors de la Cinémathèque, tu fréquentais j'imagine aussi les salles de quartier ?
Ah bien sûr. À Paris, il y en avait énormément... Ça, je peux en parler pendant des heures. Moi j'habitais à la limite du XVIe et du XVIIe. Du côté XVIe, il y avait le Victor-Hugo, le Saint-Didier et Le Passy. Du côté XVIIe, il y avait le Maillot-Palace, le Royal-Maillot, les Acacias, L'Etoile, le Calypso, le Reflet, le Ternes, le Royal-Pathé, l'Empire, le Studio de l'Étoile, le Mac-Mahon, le Napoléon, le Cinéac-Ternes, les Studios Obligado, etc. Certaines salles, surtout celles de seconde exclusivité, projetaient des films en version originale. Et je ne parle même pas des salles du Quartier latin, évidemment, qui étaient des salles de répertoire. Mais surtout, ce qui était vachement bien, c'est qu'à côté des salles d'exclusivité sur les Champs-Elysées, et les salles de seconde exclusivité, genre Reflets ou Calypso, il y avait les cinémas de quartier, où le film arrivait plusieurs mois après, ainsi qu'un nombre incroyable de salles qui jouaient des films qui étaient dans les rayons depuis dix ou quinze ans... Les salles de cinéma de Paris, on pourrait en faire un roman. Certaines étaient franchement folkloriques... Je me souviens d'une salle qui s'appelait le Paris-Ciné - qui existe encore maintenant, je crois, boulevard de Strasbourg, au sous-sol. À dix heures du matin, tu avais un film. La copie était tellement sombre que, quand tu râlais, le projectionniste t'avouait qu'il avait un problème avec l'ampoule et que le propriétaire ne voulait pas la changer. Mais le plus incroyable, au Paris-Ciné, c'était la salle. Tu débarquais comme un jeune crétin cinéphile qui voulait voir un petit film de genre, et tu te retrouvais avec des routiers des Halles qui étaient là pour se réchauffer. Qui enlevaient leurs chaussures, mettaient leurs chaussettes à sécher sur le radiateur et parlaient pendant toute la projection. Du genre : « Dis donc Mimile, après Autun, t'as pas eu de problèmes ? », et l'autre répondait « je suis pas passé par là »... Et si tu faisais « Chuuut », les mecs se retournaient vers toi en disant : « Non mais ça va pas, c'est qui ce petit con ? » Pour un cinéphile, c'était une époque héroïque...
Revenons au roman policier... Tu as évoqué Sherlock Holmes dans tes lectures fondatrices ...
Ah oui, tout à fait. D'ailleurs, je dirais plus Conan Doyle dans son ensemble que simplement Sherlock Holmes, parce que Conan Doyle c'est aussi Les Aventures du Brigardier Gérard, Les Exploits du professeur Challenger... Je ne sais plus à quel âge j'ai lu Sherlock Holmes, avec ces histoires, genre La Bande mouchetée (ou Le Ruban moucheté selon les traductions), qui me faisaient un peu frémir et dresser les cheveux sur la tête. En fait, c'est un auteur que j'ai lu très jeune avec Le Signe des quatre ou Une étude en rouge, et auquel je suis toujours revenu. Sherlock Holmes est un personnage inépuisable. D'autant - et c'est un phénomène extrêmement rarissime — qu'il a une descendance absolument extraordinaire. Une multitude d'auteurs ont repris le personnage, et je dirais que 90 % de ces livres sont réussis, ce qui est incroyable. Ça souligne bien la richesse du personnage.
Comment ça, plein d'auteurs ?
Sherlock Holmes a donné lieu à une multitude d'adaptations et de pastiches. J'ai découvert que même Conan Doyle a écrit des pastiches de Sherlock Holmes. On trouve des Sherlock Holmes contre Dracula, des Sherlock Holmes contre Fu Manchu, des trucs assez incroyables. Et c'est quasiment toujours intéressant. La Solution à 7 % de Nicholas Meyer, qui explique pourquoi Sherlock est devenu détective, est un très bon roman. L'Ultime défi de Sherlock Holmes, de Michael Dibdin, où Sherlock Holmes est Jack l'Eventreur, est extraordinaire. Les bouquins de René Réouven, La Vie privée de Sherlock Holmes de Mollie et Michael Hardwick... Ce qui est fascinant avec Sherlock Holmes, c'est que c'est un des cas dans la littérature où l'auteur est dépassé par son personnage. Bien sûr, c'est Conan Doyle qui invente le fait que Sherlock Holmes se drogue ou inscrit les initiales de la reine Victoria au revolver sur le mur. C'est Conan Doyle qui lui donne cette passion pour la musique ou qui le fait se retirer dans sa chambre quand, d'un seul coup, il a le cafard. C'est aussi lui qui fait vivre Sherlock Holmes avec un homme, Watson... Avec Sherlock Holmes, Doyle invente un personnage sur lequel on peut broder à l'infini, qui offre toutes les interprétations possibles. J'irai même plus loin, je trouve que finalement, les aventures de Sherlock Holmes les plus belles ne sont peut-être pas celles que Conan Doyle a écrites. Le dernier recueil de nouvelles signé Conan Doyle, qui s'intitule je crois, Son dernier coup d'archet, est magnifique. Mais Une étude en rouge, c'est quand même une intrigue assez simple. Et la moitié du livre est consacrée à la croisade antimormons de Conan Doyle... C'est bien, c'est très bien même, mais je trouve que ce n'est pas la plus belle aventure de Sherlock Holmes, alors que L'Ultime défi de Sherlock Holmes, de Michael Dibdin, c'est quasiment un chef-d'œuvre.
C'est cette récupération régulière du personnage par de nouveaux auteurs qui lui donne finalement ce côté quasi immortel.
C'est évident. C'est quand même un personnage qui fait partie des best-sellers depuis maintenant plus d'un siècle. Les blockbusters avec Jude Law et Robert Downey Jr, c'est au nom de Sherlock Holmes ! Et ça a tout le temps été comme ça ! À une époque, j'ai dirigé La Souris Noire, une collection de petits polars pour les jeunes adolescents et les enfants. À côté de textes contemporains et modernes, j'aimais bien glisser des trucs plus classiques, des fondamentaux. Quand j'ai publié L'Aventure du pied du diable, de Conan Doyle, une des cinquante-six nouvelles mettant en scène Sherlock Holmes, on m'a dit : « les gamins d'aujourd'hui vont s'emmerder à lire ça ». Eh bien, pas du tout ! Non, c'est un personnage auquel tout le monde se réfère. Il y a deux choses dans Sherlock Holmes, le canon, c'est-à-dire tout ce qui a été écrit par Conan Doyle, et le reste. Un monde en soi ! C'est assez dément quand tu y penses : Holmes est quand même le seul héros de roman policier qui ait un musée à son nom. Mieux, c'est le seul personnage de fiction qui a sa « vraie » maison. L'Association des amis de Sherlock Holmes en France est une chapelle rigoriste. C'est tout un rituel... Et en même temps, leur discours est non seulement savant, mais remarquablement intelligent. Non, c'est un personnage hors du commun. Conan Doyle a créé une vraie mythologie. C'est un coup de génie. Du coup je trouve très intéressant qu'à un moment donné, Doyle ait voulu tuer Holmes.
Il est peut-être un des premiers, mais il n'est pas le seul. Bon nombre d'auteurs de romans policiers auront la tentation de se débarrasser de leur héros, de Georges Simenon à Henning Mankell...
Le problème de Conan Doyle, c'est qu'il en avait marre que les gens ne lui parlent que de ça. À ses yeux, ce qui était important dans son œuvre, c'était ses romans historiques, La Compagnie Blanche ou Sir Nigel, des choses comme ça. Et on n'arrêtait pas de lui parler de Sherlock Holmes ! Quand finalement il le tue, il provoque en Angleterre quasiment un scandale. Il reçoit des lettres d'injures. Et il est obligé de le ramener à la vie. Et le personnage lui échappe. Dans Archives de Sherlock Holmes, Sherlock Holmes est mort et l'on va chercher à la banque, si je me souviens bien, un coffret renfermant de nouvelles aventures racontées par Watson. Juste avant, Son dernier coup d'archet, c'est l'évocation de la vieillesse de son héros. Le temps d'une certaine sérénité. Doyle est désormais en paix avec son personnage.
En quoi Sherlock Holmes est-il si moderne que ça ?
Premièrement il n'est pas de la police. Ça, c'est important. Il ne représente pas l'ordre établi. Il est moderne parce que bien qu'enquêteur, c'est un anarchiste complet dans sa façon de penser. Il est moderne parce qu'il se drogue. Il est moderne parce qu'il n'est pas croyant - il n'y a pas une nouvelle où Sherlock Holmes s'en remet à Dieu. C'est un asocial. Il vit en ermite ou presque, avec Watson et reçoit dans leur appartement. Et il est moderne parce qu'il préfigure la police scientifique. La pensée devance l'action. En plus, il a beaucoup d'humour. Bref, il est unique. Et comme il est unique, il est moderne. La grande idée, l'idée de génie de Conan Doyle, c'est de créer d'un côté un héros d'exception, et de faire d'un autre côté raconter ses aventures par quelqu'un qui en est le témoin, mais dont on sait par ses échanges avec Holmes qu'il ne comprend pas toujours ce qui se passe. « Il m'arrive de penser », dit Watson. « Bravo ! » lui répond Holmes. Et donc il y a tout un non-dit dans les aventures de Sherlock Holmes. Et ça c'est génial. Et c'est la porte ouverte à toutes les questions. Quelle est sa vie ? Quelle est sa vie sexuelle ? Que fait cet homme ? Pourquoi reste-t-il enfermé toute la journée à fumer sa pipe ? Il a du fric, c'est un bourgeois, il n'a pas besoin d'aller travailler, pourquoi s'amuse-t-il à se déguiser en mendiant, à mettre régulièrement sa vie en danger ? Et puis, ses méthodes d'investigation paraissent complètement révolutionnaires pour l'époque. En plus, dernier aspect, c'est peut-être un des rares personnages dans le roman policier qui puisse séduire à la fois les enfants et les adultes. Une aventure comme Le Ruban moucheté, par exemple, est une histoire complètement palpitante pour les jeunes enfants. Mais en même temps, quand tu t'y plonges, le personnage est tellement ambigu, tellement riche, tellement complexe que tu peux aussi y trouver ton compte. Bref, il est unique. Et moderne.
C'est cette ambiguïté qui fait son originalité ?
C'est pour ça aussi que j'adore Michael Dibdin. Parce que je trouve qu'avec L'Ultime défi de Sherlock Holmes, il frappe au cœur du personnage. À la fin de sa vie, malade, un peu perdu, Sherlock s'invente un ennemi digne de lui : Jack l'Éventreur, un être monstrueux. Et ce roman montre à quel point le personnage de Sherlock Holmes est complexe et ambigu. Sherlock Holmes accumule les zones d'ombre. Des zones d'ombre qui effrayent Watson. Qui effrayent sa logeuse. Billy Wilder l'avait très bien compris, dans la dernière scène de La Vie privée de Sherlock Holmes -que je trouve formidable -, où Holmes fait allusion à la femme qu'il aimait, prend sa pipe, rentre dans la chambre, et claque la porte. Le film s'arrête là. Personne n'entre dans cette pièce avec lui. Non, vraiment, Conan Doyle, d'un bout à l'autre, a eu des coups de génie. Sa manière de construire les récits est fabuleuse. Parfois Watson dit : « Ah, Holmes, vous vous souvenez, c'était après l'affaire du pont. » Holmes répond « Oui, l'affaire du pont », et là Conan Doyle l'invente et la raconte, ou mieux encore, laisse la possibilité à d'autres écrivains de l'inventer, cette affaire du pont. Non seulement Conan Doyle a créé Sherlock Holmes, mais il a aussi créé la continuité de la mythologie. Encore aujourd'hui, je reçois des bouquins qui mettent en scène Sherlock Holmes. Le plus étonnant, c'est que c'est rarement raté. C'est un personnage inspirant.
L'époque et le décor aussi inspirent. Londres de cette fin de XIXe siècle est assez fascinant.
Bien sûr. C'est une période romanesque riche. Il y a Oscar Wilde, Jack l'Eventreur... Et un auteur comme Nicolas Meyer lui fait même rencontrer Freud. Sherlock Holmes est un personnage charnière. En plus, il est quand même le personnage le plus excentrique de toute l'histoire du roman policier. Ne serait-ce que sa façon de s'habiller.
Ah, la casquette !
Eh bien, oui. Il n'y a que lui qui s'habille comme ça. Et il suffit de voir quelqu'un dans cet accoutrement pour se dire, c'est Sherlock Holmes, même si tu n'as jamais lu un livre de Conan Doyle.
Quelle a été l'influence de Sherlock Holmes sur le roman de l'époque, sur le roman policier, sur le roman noir ?
L'impact de Sherlock Holmes est assez considérable. À partir de Conan Doyle, les lecteurs demandent des intrigues vraisemblables, sinon rigoureuses, - même si chacun sait qu'on a affaire avec Sherlock Holmes à une fausse rigueur scientifique. Il ne faut pas oublier que le personnage qui sert de modèle à Conan Doyle pour créer Sherlock Holmes, c'est un médecin. C'est son professeur d'anatomie. Avec Sherlock Holmes, on quitte le côté aventure invraisemblable. Désormais, les enquêtes doivent tenir debout. On assiste, comme on l'a dit, presque à l'apparition de la police scientifique : l'empreinte, l'indice, le petit truc... D'autre part, il a engendré les plus célèbres détectives de l'histoire du roman policier. C'est à mon avis largement en référence à Sherlock Holmes, et à son originalité, que Rex Stout a créé son héros Nero Wolfe, un détective qui ne sort jamais de chez lui. Que d'autres ont imaginé un détective sourd, un détective aveugle ou sur une chaise roulante... C'est-à-dire que l'originalité de Sherlock Holmes a poussé les auteurs à créer des personnages de détectives qui soient extrêmement typés. Et puis, tout simplement, Holmes, c'est l'invention du détective privé. Avant lui, le roman populaire et feuilletonesque avait popularisé des héros comme Vidocq, c'est-à-dire des policiers.
Tu évoquais Rex Stout, à l'instant...
J'aime beaucoup cet auteur. J'ai publié trois ou quatre de ses romans chez Rivages. La Cassette rouge, Meurtre au vestiaire, Le Secret de la bande élastique... Dans les années trente, Rex Stout pousse plus loin le pari de Sherlock Holmes, d'une certaine façon. C'est-à-dire que le détective n'a pas besoin de bouger de chez lui. Il envoie deux ou trois personnes sur le terrain et il analyse les données qu'on lui rapporte. Donc c'est un pur roman d'analyse logique. Nero Wolfe, c'est ce qu'on appelle un « armchair détective », un détective en fauteuil. Rex Stout était un type très cultivé, qui par ailleurs a signé des romans très sérieux, notamment sur l'Empire romain. L'idée maîtresse de ses romans policiers, c'est que son héros est un type qui ne quitte pratiquement pas sa serre, où il cultive des orchidées.
Extraits

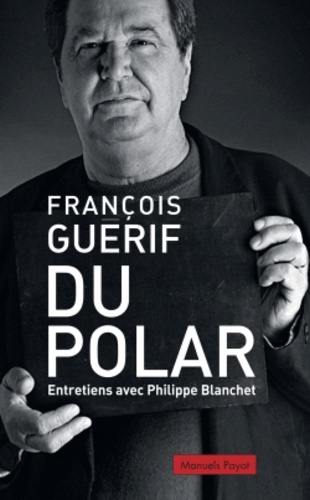



























Commenter ce livre