OSS 117 : Les monstres du Holy Loch
Jean Bruce
1
Une jeune fille entra dans le compartiment. Elle était grande, solidement bâtie, avec un visage clair et souriant, les yeux bleus, les cheveux blonds. Elle regarda les deux hommes l’un après l’autre et dit avec entrain :
— Je suis membre de la société pour la distribution des Saintes Écritures…
Hubert Bonisseur de la Bath sourit et répliqua courtoisement :
— Un joli membre.
— Merci, répondit-elle avec simplicité. Puis-je me permettre de vous offrir quelques conseils bibliques ?
Hubert haussa les sourcils, puis les épaules, légèrement.
— On a toujours plus ou moins besoin de conseils, admit-il. Surtout ce mécréant que vous voyez assis en face de moi…
Il montra Enrique Sagarra qui prit un air contrit. La jeune fille se tourna vers celui-ci.
— Il ne croit ni à Dieu ni à diable, précisa Hubert.
D’un ton alourdi de regret.
— Pourquoi ? s’étonna la jeune fille.
— Pourquoi pas ? répondit Enrique.
Elle lui tendit une petite brochure.
— Prenez, dit-elle, et achetez une bible.
Enrique saisit l’opuscule.
— Je ne suis pas riche, protesta-t-il.
— Votre ami vous prêtera de l’argent. N’est-ce pas ? s’enquit-elle en regardant Hubert.
— Bien volontiers, accepta ce dernier. Mais je crains que le cas ne soit désespéré. Ce sombre individu a fait la guerre d’Espagne dans les rangs républicains et vous seriez étonnée d’apprendre le nombre de bonnes sœurs qui ont eu alors à se plaindre sérieusement de ses entreprises…
— Ciel ! s’exclama la jeune fille horrifiée.
Elle recula vers la porte. Enrique affichait un air angélique.
— Il exagère un peu, protesta-t-il. Toutes ne se sont pas plaintes…
— Seigneur ! murmura la jeune fille.
Et, sans demander son reste, elle disparut dans le couloir. Hubert se mit à rire. Son séduisant visage de prince pirate s’anima et des pattes-d’oie se creusèrent aux coins de ses yeux bleus que le hâle de sa peau faisait paraître plus clairs encore. Il passa une main longue et nerveuse sur ses cheveux bruns et remarqua :
— Elle a eu vraiment peur.
Enrique se leva pour aller jeter un coup d’œil dans le couloir. Il était plutôt petit, svelte, avec des fesses minces de danseur espagnol, le teint sombre, le cheveu noir et ondulé.
— Elle a disparu, constata-t-il.
Il revint prendre sa place, près de la fenêtre que battait la pluie.
— Vous ne devriez pas raconter des histoires pareilles, reprocha-t-il. Cela peut nuire à ma réputation.
— Ce ne sont pas des histoires, riposta Hubert, mais la vérité.
— Sans doute, mais j’étais jeune…
Il ouvrit l’opuscule que lui avait remis la jeune fille et lut soudain à haute voix :
— Selon qu’il est écrit : « Il n’y a point de juste, pas même un seul. » Romains 3:10.
— Si ça peut vous consoler, dit Hubert…
Il regarda au travers de la vitre brouillée par la pluie le paysage typiquement écossais, avec ses collines, ses murets de pierres noires délimitant les champs, ses troupeaux de moutons. Le Midday Scot se traînait sur une pente assez forte. Hubert consulta sa montre. Six heures. Ils n’atteindraient pas Glasgow avant huit heures, huit heures et demie, il ne savait pas exactement. Glasgow où ils devraient passer la nuit car il n’y aurait plus de correspondance pour gagner Dunoon, de l’autre côté de l’estuaire de la Clyde.
— C’est formidable, s’exclama Enrique qui continuait de lire les conseils bibliques. Ces gens-là ont tout prévu. Écoutez : « Où trouver du secours quand vous vous trouvez… abandonné de vos amis : Psaumes 27, 35, 41, etc. Anxieux : Psaumes 46, etc. » Tout est prévu : découragé, désemparé, las, avoir besoin de protection divine, en recul ou vaincu, en proie à la tentation, troublé… C’est tout de même le genre de trucs qui nous arrivent de temps en temps.
— Eh bien, achetez une bible, répliqua Hubert.
— N’y a qu’une chose qui n’est pas prévue, termina Enrique, c’est d’arrêter la pluie.
Il frissonna, posa l’opuscule sur le siège voisin puis se leva pour prendre son imperméable dans le filet. Il enfila le vêtement.
— Voilà deux mois, reprit-il, quand nous étions en Grèce… on se plaignait d’avoir trop chaud. J’ai vaguement l’impression que ce sera plutôt le contraire cette fois-ci…
Hubert ne répondit pas. Il pensait à la mission qui les attendait : démasquer un réseau d’espionnage soviétique dont les services spéciaux américains avaient de bonnes raisons de soupçonner l’existence autour de la base de sous-marins atomiques installée dans le Holy Loch. Le problème posé, Hubert Bonisseur de la Bath, alias OSS 117, avait lui-même établi un plan que M. Smith, le chef du service Action de la CIA, l’agence centrale de renseignement des États-Unis, s’était empressé d’accepter.
Un employé du wagon-restaurant passa dans le couloir en agitant une sonnette pour annoncer le premier service du dîner. Enrique s’empressa de feuilleter l’opuscule des conseils bibliques.
— Il n’y a aucun secours, non plus, contre la mauvaise nourriture, constata-t-il.
Ils avaient encore sur l’estomac l’amère expérience du déjeuner. Hubert proposa :
— Attendons d’être arrivés. Il existe sûrement un bon restaurant à Glasgow et, de toute façon, ça ne pourra pas être pire…
— Je préfère encore un simple sandwich à leur gigot bouilli et à leur sauce à la menthe, affirma Enrique. Ils ne nous auront pas deux fois…
*
Le lendemain matin, à neuf heures cinquante, Everett J. Anderson, quarante-six ans, prit le même train qu’Hubert Bonisseur de la Bath et Enrique Sagarra, à destination de Gourock, avec un billet valable pour la traversée en steamer de la Clyde jusqu’à Dunoon.
Pendant un court instant, les trois hommes marchèrent presque à la même hauteur sur la plateforme numéro 13, à l’extrême droite de la gare de Glasgow. Puis, ils se trouvèrent séparés. Everett J. Anderson avait un ticket de seconde classe alors que les deux autres voyageaient en première.
Everett J. Anderson était un Américain de taille moyenne, avec l’air bien nourri, des cheveux blonds taillés en brosse et des yeux gris-vert un peu ternes. Il était ingénieur électronicien, détaché de Sperry & Autonetics auprès de l’US Navy et actuellement en poste sur le Proteus, le célèbre navire atelier chargé de l’entretien et du ravitaillement des sous-marins atomiques du Squadron 14, ancré dans le Holy Loch.
Everett J. Anderson était marié, ayant déjà divorcé deux fois, avec une jeune personne de dix-neuf ans, Marion, qu’il délaissait depuis quelques mois parce qu’il la trouvait déjà trop vieille. Everett J. Anderson aimait les fruits verts, les lolitas ; ce penchant funeste lui avait joué quelques mauvais tours depuis sa puberté et le dernier en date était le plus mauvais de tous, bien que Anderson ne le sût pas encore.
Il pleuvait et les lourds nuages noirs qui pesaient sur la grande cité industrielle retenaient la fumée des usines. Everett J. Anderson s’installa dans un compartiment désert, s’allongea sur la banquette et s’endormit aussitôt après le passage du contrôleur. Il s’était soûlé à mort au cours de la nuit et souffrait encore d’une magistrale gueule de bois malgré toutes les drogues adéquates dont il s’était bourré.
Il ne se réveilla qu’en gare de Gourock, une heure plus tard. Il avait mal au crâne et ses jambes avaient une fâcheuse tendance à se dérober sous lui. Dehors, le vent soufflait en rafales et ces gifles glacées constamment répétées le réveillèrent un peu. Il suivit le flot des voyageurs qui se hâtaient vers la sortie et montra son billet en indiquant qu’il continuait jusqu’à Dunoon.
Il tourna à droite pour gagner le quai maritime. Celui-ci n’est pas couvert et la pluie balayée par le vent le fouettait rageusement. Surpris par la force des bourrasques, Everett J. Anderson faillit perdre l’équilibre et recula de deux pas. Hubert Bonisseur de la Bath, qui arrivait derrière avec sa valise, le retint un court instant à bout de bras. L’ingénieur remercia et se pencha en avant pour repartir en direction du SS Duchess of Hamilton, un vapeur de huit cents tonnes, à deux cheminées, qui se préparait à larguer ses amarres.
Il buta sur les barres transversales de la passerelle et cette fois ce fut Enrique Sagarra qui le redressa. Il y avait beaucoup de passagers. Pendant quelques minutes, les trois hommes restèrent groupés sous le passage transversal d’où partait le grand escalier descendant à l’intérieur du bateau. Puis, tremblants de froid, Hubert et Enrique laissèrent leurs valises contre la paroi et descendirent se mettre à l’abri.
Le steamer se décolla du quai et partit dans la tempête, creusant sa route dans les vagues. L’eau était dure et moutonneuse, d’un gris sinistre ; la visibilité si mauvaise que la rive nord n’apparaissait que sous la forme d’une ligne légèrement plus claire, à peine distincte.
Une dizaine de personnes restaient sur le pont détrempé, sous l’abri devant le grand escalier. Deux joueurs de golf avec leurs sacs pleins à craquer, des jeunes gens légèrement vêtus, pâles et transis, deux ou trois femmes plus ou moins mal ficelées dans des imperméables ruisselants, la tête protégée par des foulards.
Adossé à la cloison, les mains dans les poches, Everett J. Anderson avait fermé les yeux. Il sentait l’humidité pénétrer ses chaussures et ses pieds se glacer lentement, mais il n’avait pas le courage de bouger. Il se demandait ce que faisait Marion, sa jeune épouse, si elle avait profité de son absence pour le tromper et comment elle l’accueillerait…, lorsqu’une main lui toucha le bras.
Il ouvrit les yeux et reconnut Moira Babins. Elle portait un manteau de pluie noir au col relevé et une écharpe blanche solidement nouée sous le menton, qui ne laissait découvert que l’ovale régulier de son visage à la peau mate et déjà fortement ridée bien qu’elle n’eût guère dépassé la quarantaine. Ses lèvres fripées, maquillées d’un rouge trop foncé, étaient minces et crispées et le regard de ses yeux bruns dépourvu de toute aménité.
— Suivez-moi, dit-elle, j’ai quelque chose à vous dire…
Elle avait parlé entre ses dents, juste assez haut pour dominer les bruits conjugués des machines, des vagues et du vent, assez bas pour ne pas être entendue des autres passagers les plus proches. Elle s’éloigna aussitôt à tribord en direction de la proue, affrontant la tempête à découvert.
Everett J. Anderson respira profondément et une vive douleur se vrilla dans son crâne. Son cœur battait sur un rythme accéléré. Il avait peur. « Qu’est-ce que cette garce peut bien encore me vouloir ? », grogna-t-il pour lui-même. Mais, après quelques secondes d’hésitation, il se décolla de la cloison et suivit les traces de la femme.
Moira Babins attendait un peu plus loin, à l’abri du vent mais non de la pluie. Elle était plutôt petite, assez bien faite et pouvait montrer une certaine séduction lorsqu’il lui arrivait de sourire. Elle regarda venir Anderson auquel le vent, le tangage et le roulis, ajoutés au pont rendu glissant par la pluie, posaient des problèmes d’équilibre en apparence fort ardus. Il arriva cependant auprès d’elle sans encombre et accrocha solidement la main courante.
— Vous êtes ivre, constata-t-elle avec mépris. À onze heures du matin.
— Je vous emmerde, répliqua Anderson. Videz votre sac et foutez-moi la paix.
Elle lança un coup d’œil de part et d’autre afin de s’assurer que personne ne pouvait les entendre. Des gouttes d’eau ruisselaient sur son visage tendu.
— J’ai transmis la copie de l’inventaire que vous m’avez remise, reprit-elle d’une voix sèche et dure. « Ils » ont été très contents et m’ont priée de vous remettre ceci…
Elle lui tendit un paquet enveloppé de papier brun fixé par un morceau de ruban adhésif.
— Qu’est-ce que c’est ? demanda-t-il sans le prendre.
— De l’argent. Deux cents livres sterling.
Il devint cramoisi.
— Vous vous foutez de moi !
Puis, d’un geste brutal, il s’empara du paquet et le projeta loin par-dessus bord. Les mouettes qui suivaient le bateau malgré la tempête se mirent à pousser des cris aigus et foncèrent, croyant à quelque nourriture. Everett J. Anderson tremblait de colère contenue. Moira Babins, impassible, enchaîna :
— « Ils » ont décidé de vous demander un nouveau service…
— Pas question. Plutôt crever, riposta sauvagement Anderson.
— Il s’agit pour vous, à l’occasion des vérifications d’entretien des fusées Polaris, de remplacer dans chacune d’elles la pièce numéro 72421 B de l’appareil de guidage par inertie, par une autre pièce identique fournie par « leurs » soins.
— Plutôt crever ! répéta Anderson.
Imperturbable, la femme continua :
— Grâce à l’inventaire que vous « leur » avez communiqué, « ils » savent exactement combien de pièces de ce type se trouvent en réserve dans le magasin du Proteus. « Ils » savent aussi le nombre de Polaris dont dispose actuellement le Squadron 14. Vous trouverez en rentrant, dans le coffre de votre voiture, un paquet contenant exactement le nombre de pièces nécessaires. Vous avez trois jours pour rapporter le nombre équivalent de pièces d’origine, moins celles correspondant aux sous-marins actuellement en mer et que vous devrez remettre au fur et à mesure de leur récupération.
— Plutôt crever ! affirma pour la troisième fois Anderson. Je vois trop bien où ils veulent en venir et je ne veux pas avoir le massacre de mes compatriotes sur la conscience…
— Ne soyez pas stupide. La Russie ne veut pas la guerre et ne menace personne. Le seul danger vient de certains de vos généraux qui sont partisans d’une attaque préventive. Voilà ce que nous devons empêcher à tout prix pour sauvegarder la paix et votre gloire sera d’y avoir participé pour une grande part.
— Vous me prenez pour un con, riposta Anderson.
— De toute façon, reprit Moira Babins, vous savez ce qui arrivera si vous refusez. Certaines personnes recevront certaines photos et…
— Vous êtes ignoble !
— Pour sauver la paix, monsieur Anderson, tous les coups sont permis. Il ne fallait pas vous mettre dans ce mauvais cas… En ce qui concerne la remise des pièces détachées d’origine, vous en ferez un paquet et vous irez le déposer dans trois jours à dix heures le soir au pied de la table d’orientation de Castle Hill, à Dunoon. Vous monterez par le chemin du côté de la gare maritime et vous redescendrez vers le McColl’s Hotel.
— Ouais ! répliqua grossièrement Anderson. Comptez là-dessus, buvez de l’eau et vous vivrez longtemps !
Une rafale de pluie, plus violente que les autres, les obligea un instant à se taire. Ils étaient trempés et grelottaient de froid.
Les mouettes criaient de plus belle. Anderson, qui regardait au loin, crut distinguer la jetée de bois de Hunter’s Quay et l’entrée du Holy Loch.
— Je suis certaine que vous serez raisonnable, monsieur Anderson, conclut Moira Babins. Bonne journée.
Elle s’éloigna, accrochée à la main courante. Everett J. Anderson se mit à jurer effroyablement. Puis, il la suivit pour aller se mettre à l’abri. Il était dessoûlé.
*
Dix minutes plus tard, ayant traversé l’estuaire de la Clyde, le Duchess of Hamilton aborda le quai de la station de Dunoon. Le temps était toujours aussi détestable. La passerelle jetée, Hubert Bonisseur de la Bath et Enrique Sagarra descendirent dans les premiers. Des haut-parleurs diffusaient une musique de jazz destinée probablement à regonfler le moral des nouveaux arrivants. La jetée qui relie la gare à la terre ferme est coupée en deux dans le sens de la longueur par une cloison à demi vitrée. Hubert et Enrique, portant leurs valises, passèrent à droite afin de se mettre à l’abri du vent qui soufflait de l’ouest.
— Êtes-vous sûr que nous sommes en août ? questionna Enrique.
— Tout à fait sûr, hélas ! répliqua Hubert.
Ils franchirent les guichets, hélèrent un taxi.
— McColl’s Hotel, dit Hubert au chauffeur.
L’hôtel McColl’s était exactement à trois cents mètres à gauche. C’était un grand bâtiment jaunâtre qui ressemblait à une caserne, à cinquante mètres du bord de l’eau. Le taxi pénétra dans la cour où stationnaient quelques voitures et s’arrêta devant l’entrée. Un chasseur vint s’occuper des bagages. Hubert paya trois shillings et six pence pour la course, plus six pence de pourboire.
C’était un hôtel modeste, quoique moderne. Une jeune femme bien en chair, agréable à regarder malgré sa robe noire, s’occupait de la réception. Les deux hommes sortirent leurs passeports et s’inscrivirent sur le registre, respectivement sous les noms d’Hubert La Verne, ingénieur, et d’Enrique Leone, chauffeur. Parce qu’ils étaient étrangers, la jeune femme leur remit à chacun une fiche de police rose.
— Vous les remplirez dans votre chambre et vous me les rapporterez, dit-elle gentiment. Le déjeuner est à une heure, le dîner à sept heures.
Le chasseur les fit monter dans l’ascenseur et les conduisit au troisième étage. Ils avaient des chambres voisines, petites, mal meublées, avec un lavabo dans un coin.
— La salle de bains et les toilettes sont dans le couloir, annonça le chasseur. Le téléphone aussi.
— Le grand confort, quoi ! apprécia Enrique.
Hubert donna un pourboire à l’employé qui repartit.
— Ça fait longtemps qu’on n’avait pas été aussi gâtés, reprit Enrique.
— Je regrette, répondit Hubert, mais il paraît que nous sommes dans le meilleur hôtel de Dunoon.
— Eh bien, tant pis pour nous, conclut Enrique. Quel est le programme ?
— Allez défaire vos valises et attendez que je vous fasse signe.
— J’espère que ça ne sera pas trop long. Y a de quoi devenir neurasthénique dans des tôles pareilles.
Il sortit d’une poche l’opuscule de conseils bibliques que lui avait donné la jeune fille dans le train et chercha…
— Voyons… Découragé… Psaumes 23, 37, 42, etc. Il faut absolument que je m’achète une bible.
Il sortit. Hubert referma la porte et ouvrit sa valise pour en retirer son linge et ses vêtements. Il n’avait pas voulu le montrer, mais il était également fâcheusement impressionné par la tristesse de la chambre, que celle du temps n’arrangeait pas le moins du monde. Il s’approcha de la fenêtre à guillotine et regarda dehors. À gauche, séparée de la cour par un mur, la rue luisante de pluie s’incurvait autour de Castle Hill, sorte de promontoire coiffé des ruines d’un vieux château. Droit devant, les eaux sombres et tourmentées de l’estuaire, avec un phare balise peint à la chaux, planté sur un rocher. Un peu à droite, des manèges forains. Plus près, une construction basse, le Café des Pirates, au bord d’un putting green. Quelques piétons se hâtaient, ici et là, luttant contre la tempête. De rares voitures circulaient lentement, leurs pneus chuintant sur le macadam trempé. Un grand bateau à roues parut soudain, quittant la gare maritime et se dirigeant vers le large, escorté d’une nuée de mouettes criardes.
Des pas se rapprochaient dans le couloir. Des coups furent frappés à la porte.
— Oui ? dit Hubert.
— Monsieur La Verne, on vous demande au téléphone, annonça la voix du chasseur.
Hubert sortit de la chambre, emportant la clé. Le téléphone était dans une cabine, au bout du couloir, près de l’ascenseur. Hubert s’y rendit et prit l’appareil.
— Allô, j’écoute…
Une voix d’homme, grave et bien timbrée, demanda :
— Monsieur La Verne ?
— Oui.
— Charles Eitzen. Vous avez fait bon voyage ?
— Mieux vaut n’en pas parler, répondit Hubert.
— C’est l’oncle Joe qui m’a prévenu de votre arrivée.
— Je sais. Je vous apporte des nouvelles.
— Parfait. Je passe vous prendre à l’hôtel dans cinq minutes. Ça va ?
— Ça va très bien, accepta Hubert.
Il raccrocha et revint dans sa chambre, satisfait de constater avec quelle rapidité l’action s’enclenchait. Charles W. Eitzen était lieutenant de vaisseau à bord du Proteus, chargé de la sécurité. Il appartenait à l’ONI, le service de renseignement de la marine américaine. On l’avait décrit à Hubert comme un homme de quarante-trois ans, dur, précis, efficace. Il avait été vingt ans plus tôt champion de lutte toutes catégories de l’US Navy.
Hubert termina de ranger ses affaires. Puis il alla trouver Enrique dans la chambre voisine.
— Je vais sortir avec quelqu’un, annonça-t-il. Pendant ce temps, occupez-vous de nous louer une voiture et ramenez-la ici. Achetez-nous aussi des chaussettes de laine, des chandails et, pour chacun, une bonne casquette écossaise. Si nous ne voulons pas attraper la crève, il nous faut prendre quelques précautions.
— Okay, dit Enrique. On se retrouve ici ?
— Oui.
Hubert revint dans sa chambre, prendre son imperméable encore humide et descendit à pied, dédaignant l’ascenseur. Il sourit à la jeune femme de la réception qui ne semblait pas insensible à son charme, repéra le bar, le salon pour les résidents, le salon public, la salle à manger.
Une Chevrolet noire, portant une immatriculation de l’US Navy, entra dans la cour. Hubert gagna la porte, vit un officier de marine au volant et sortit. Il ouvrit la portière.
— Lieutenant de vaisseau Charles Eitzen, dit le conducteur.
— Hubert La Verne.
— C’est moi qui vous ai téléphoné, il y a cinq minutes, de la part de l’oncle Joe.
Hubert monta, referma la portière. La Chevrolet repartit, fit demi-tour, regagna la rue, prit la direction des quais. Hubert regardait Eitzen. C’était un splendide gaillard, bâti comme une armoire de haute époque, le teint mat, le cheveu noir, l’œil de velours sombre, le nez aquilin. Des mains comme des battoirs.
— Je m’excuse de vous enlever comme ça, dit-il. Mais c’est encore en voiture que nous serons le plus tranquilles pour bavarder.
— Certainement.
Les essuie-glaces battaient à grande vitesse, sans pour autant réussir à rendre le pare-brise parfaitement clair.
— Est-ce un temps normal pour un mois d’août ? s’enquit Hubert.
— Je n’en sais rien. Je n’étais pas ici l’an dernier. Les gens du pays affirment que non.
Ils passèrent devant la gare maritime, puis devant la station d’autobus et continuèrent sur la route du littoral en direction de Hunter’s Quay.
— Je suis content de vous accueillir ici, reprit Eitzen. J’espère que notre collaboration sera fructueuse.
— Je l’espère aussi, répondit Hubert, sincèrement.
— Par quoi commençons-nous ?
— Je vous laisse le choix.
— La situation générale… Elle est simple. Nous savons que les Russes ont installé un réseau autour de Holy Loch. C’est normal et il fallait s’y attendre. Récemment nous avons capté des émissions clandestines de radio, alors qu’un certain nombre de « chalutiers » soviétiques faisaient semblant de pêcher devant l’estuaire de la Clyde, en dehors des eaux territoriales. Les émissions partaient des environs de Holy Loch, nous en sommes certains, mais nos voitures-gonio n’ont pu les localiser. Par ailleurs, certains techniciens employés sur le Proteus ont été l’objet d’accrochages plus ou moins nets et nous craignons que quelques-uns ne soient capables de céder à des chantages plus ou moins poussés. Nous surveillons évidemment avec un soin tout particulier les endroits où ces hommes peuvent trouver des filles et nous essayons avec l’aide de la police écossaise de cataloguer ces filles. Mais, cela n’a pas donné grand-chose jusqu’à maintenant… C’est pourquoi je pense que votre idée est excellente. Vous pouvez être le détonateur qui fera sauter tout le bazar.
— Je suis venu pour cela, dit Hubert.
Il écoutait attentivement, sans pour autant cesser d’observer le paysage. À droite, l’estuaire, bordé de temps à autre par d’étroites plages désertes. À gauche, des maisons particulières, des pensions de famille, des petits hôtels, tous séparés de la route par un jardin. Des constructions simples, mais assez coquettes. Une atmosphère de station balnéaire pour petits bourgeois.
— Que savez-vous en ce qui me concerne ? reprit Hubert. Je crois que vous avez reçu une note d’information, mais je ne l’ai pas lue.
— Je sais que vous êtes censé vous appeler Hubert La Verne, quarante ans, originaire de Louisiane, marié, cinq enfants, ingénieur à la General Electric, grand spécialiste des appareils de guidage par inertie employés sur les Polaris. On murmure que vous êtes l’inventeur d’un perfectionnement très important pour ces appareils et que le but de votre voyage à Holy Loch est et doit rester secret. On dit également que vous êtes très attaché à votre famille, catholique pratiquant, mais que vous avez un funeste penchant pour la boisson, encore qu’il soit très difficile de vous soûler.
— C’est exactement ça, approuva Hubert.
— Selon les instructions reçues, j’ai fait « discrètement » diffuser cette « légende » dans le pays. À l’heure qu’il est, le réseau russe est sûrement informé de votre arrivée, à moins qu’il ne soit composé d’incapables, ce dont je doute fort. Ah ! j’avais oublié : depuis un accident de la route dont vous avez été responsable et qui a coûté la vie d’un enfant, vous avez juré de ne plus jamais toucher un volant. En conséquence, vous disposez d’un chauffeur qui vous est bien sûr entièrement dévoué et qui s’appelle, si j’ai bonne mémoire, Enrique Leone.
— Vous avez bonne mémoire.
Ils avaient dépassé Kirn et arrivaient à Hunter’s Quay. La route devenait plus étroite et sinueuse. Ils passèrent devant le Royal Marine Hotel et découvrirent ensuite le Holy Loch. Un grand dock flottant était ancré près de l’entrée, plus près de l’autre rive, du côté de Strone Point que surmontait un château d’inspiration renaissance.
Extraits

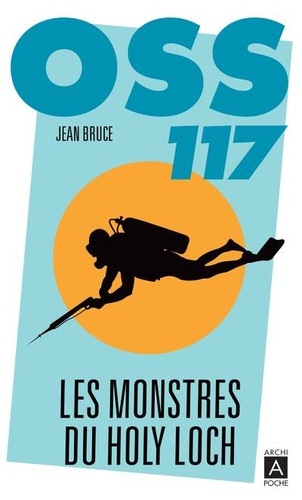



























Commenter ce livre