Les Paradis aveugles
Thu Huong Duong
Editeur
Genre
Littérature étrangère
Il était neuf heures. Mme Véra me tendit le télé- gramme :
Gravement malade, viens immédiatement.
Elle me scruta, puis me dit :
« Pauvre petite, tu n’as pas de chance. »
Elle secoua son énorme tête et tourna les talons.
Un flot de parfum bon marché envahit l’atmosphère, imprégnant les murs lépreux telle une coulée de glu. Je restai là, tassée dans mon pyjama, tout en regar- dant s’éloigner le corps plantureux de la concierge. Ma tête bouillait. J’étais fiévreuse. Depuis quelques jours, je marchais courbée comme une vieille toxicomane. Ma poitrine flasque flottait dans mes chemises. Dans la résidence, il n’y avait que quelques hommes, de vraies reliques. Ils ne daignaient même pas me regarder. J’avais huit cents roubles d’économie. Quatre cent cinquante étaient déjà partis en médicaments et nourriture d’appoint. J’avais décidé d’y puiser encore cinquante roubles pour me retaper, pour recouvrer la force de reprendre le travail. Ce télégramme me frappait comme une malédiction...
« Espèce de folle, que fais-tu dehors si tôt ?... Rentre vite ! Une rechute te réduira en mélasse. »
C’était ma compagne de chambrée. Je m’étais glissée sous la couverture, me coulant dans sa chaleur. Sensation de bonheur. C’était dimanche. Nous avions décidé de préparer des nouilles vietnamiennes pour le déjeuner. En attendant, blotties sous les couvertures, nous écoutions de la musique. Elle tombait d’une chambre, quelque part à l’étage supérieur. Nous l’écoutions hébétées de fatigue, rongées par le mal du pays. La fenêtre était grande ouverte. Pas de verdure. En revanche, un ciel intensé- ment bleu, d’un bleu limpide et glacé, infini comme notre solitude.
« Que dit le télégramme, Hàng ? demanda mon amie.
- Mon oncle est malade.
- C’est encore celui qui est à Moscou ?
- Oui.
-Tu es toi-même à peine guérie.
- ...
- On n’a plus que quatre jours de congé. La Tania vient encore de me le rappeler.
- ...
- C’est loin, Moscou. Ce voyage te tuera.
- ...
- Tu es pâle comme une femme qui vient d’accoucher. Pourquoi ne pas te maquiller un peu ? C’est effrayant... »
J’étais restée silencieuse.
Les paroles de mon amie avaient réveillé en moi une sourde révolte.
« Non, je n’irai pas, je n’irai pas. Je m’en fous, je m’en fous. »
La route filait, interminable. Les bornes kilométriques s’accumulaient dans mon dos. D’immenses forêts succé- daient à d’immenses champs de blé. Des villes sui- vaient d’autres villes, dressant les flèches de leurs églises, levant les toits de leurs édifices. Ronronnement mono- tone et triste des roues sur les rails. Après une gare, une autre gare, noyée dans la lumière artificielle ou dans la brume.
Mon amie, brusquement, se releva. Traînant sa longue robe, elle se dirigea vers les étagères et prit un disque. Elle sortit le tourne-disque qu’elle venait d’acheter. Cent vingt roubles. Elle enleva le tissu qui le recouvrait, souleva le couvercle, mit l’appareil en marche. Elle replongea aussi- tôt sous les couvertures. La tête de lecture grinçait le long des sillons muets. Et soudain le chant s’éleva :
Extraits

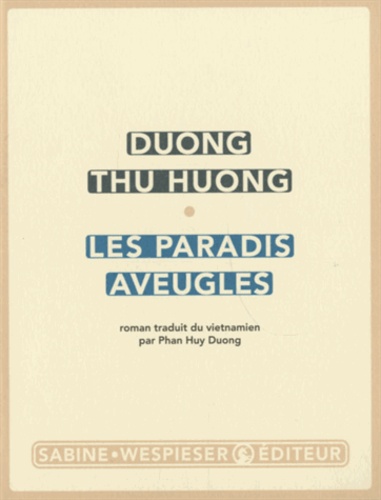




























Commenter ce livre