La déesse des petites victoires
Yannick Grannec
Editeur
Genre
Littérature française
Octobre 1980
Maison de retraite « Pine Run »
Doylestown, Etats-Unis
À l'exacte frontière du couloir et de la chambre, Anna attendait que l'infirmière plaide sa cause. La jeune femme se concentrait sur chaque bruit, tentant de museler son angoisse : conversations effilochées, éclats de voix, murmure des télévisions, chuintement des portes qui s'ouvrent sans cesse, claquements des chariots métalliques.
Son dos protestait, mais elle hésitait encore à poser son sac. Elle avança d'un pas pour se placer au centre du carreau de linoléum marquant le seuil de la chambre. Elle joua avec la fiche cartonnée rangée dans sa poche pour se donner du courage. Elle y avait rédigé un argumentaire solide en capitales bien lisibles.
La soignante caressa la main constellée de taches de la vieille dame, ajusta son bonnet et cala ses oreillers.
- Madame Gôdel, vous avez trop peu de visites pour vous permettre d'en refuser. Recevez-la. Faites-la tourner en bourrique. Ça vous donnera un peu d'exercice !
En sortant, l'infirmière offrit un sourire compatissant à Anna. Il faut savoir s'y prendre avec elle. Bonne chance, ma jolie. Elle ne l'aiderait pas davantage. La jeune femme hésita. Elle s'était pourtant préparée à cet entretien : elle exposerait les points forts de sa démonstration en prenant soin d'articuler chaque mot, avec entrain. Sous le regard peu amène de la grabataire, elle se ravisa. Elle se devait de rester neutre, de disparaître derrière la tenue passe-muraille choisie ce matin-là : jupe écossaise dans les beiges, twin-set assorti. Elle n'avait désormais qu'une seule certitude : madame Gôdel n'était pas de ces vieilles dames qu'on réduit à leur prénom parce qu'elles vont bientôt mourir. Anna ne sortirait pas sa fiche.
- Je suis très honorée de vous rencontrer, madame Gôdel. Je m'appelle Anna Roth.
- Roth ? Vous êtes juive ?
Anna sourit au plantureux accent viennois, refusant de se laisser intimider.
- Cela a de l'importance pour vous ?
- Aucune. J'aime apprendre d'où viennent les gens. Je voyage par procuration maintenant que...
La malade tenta de se redresser avec un rictus de douleur. Dans un élan, Anna voulut l'aider. Un regard polaire l'en dissuada.
- Alors comme ça, vous êtes de l'Institut ? Vous êtes bien jeunette pour moisir dans cette maison de retraite pour scientifiques. Mais abrégeons ! Nous savons toutes deux ce qui vous amène.
- Nous pouvons vous faire une proposition.
- Quelle bande d'imbéciles ! Comme si c'était une question d'argent!
Anna sentit la panique monter. Surtout, ne réponds pas. Elle osait à peine respirer malgré la nausée provoquée par les odeurs de désinfectant et de mauvais café. Elle n'avait jamais aimé ni les vieux ni les hôpitaux. Fuyant son regard, la vieille dame tortillait des cheveux invisibles sous son bonnet de laine. « Partez, mademoiselle. Vous n'êtes pas à votre place ici. »
Anna s'écroula dans un siège en skaï marron du foyer. Elle tendit la main vers la boîte de chocolats à la liqueur posée sur un guéridon à côté d'elle. Elle l'y avait abandonnée en arrivant; les douceurs étaient une mauvaise idée : madame Gôdel ne devait plus être autorisée à en manger. La boîte était vide. Anna se vengea sur l'ongle de son pouce. Elle avait tenté et échoué. L'Institut devrait patienter jusqu'au décès de la veuve en priant tous les dieux du Rhin pour que celle-ci ne détruise rien de précieux. La jeune femme aurait tant aimé être la première à inventorier le Nachlass de Kurt Gôdel. Mortifiée, elle pensa encore à ses dérisoires préparatifs. Finalement, elle s'était fait éjecter d'une pichenette.
Elle déchira soigneusement sa fiche et en répartit chaque morceau dans les alvéoles de la boîte du confiseur. On l'avait mise en garde contre la vulgarité butée de la veuve Gôdel. Personne n'était jamais parvenu à la raisonner, ni ses proches ni le directeur de l'Institut lui-même. Comment cette folle pouvait-elle s'arc-bouter ainsi sur un trésor du patrimoine de l'humanité ? Pour qui se prenait-elle ? Anna se redressa. Foutu pour foutu, j'y retourne.
Elle toqua à peine avant d'entrer dans la chambre. Madame Gôdel ne sembla pas surprise de cette irruption.
- Vous n'êtes ni cupide ni folle. En réalité, vous voulez juste les provoquer ! Ce petit pouvoir de nuisance, c'est tout ce qu'il vous reste.
- Et eux ? Qu'ont-ils manigancé cette fois ? Me balancer dans les pattes une vague secrétaire ? Une gentille fille pas trop jolie pour épargner ma susceptibilité de vieille femme ?
- Vous êtes tout à fait consciente de la valeur de ces archives pour la postérité.
- Vous savez quoi ? La postérité, je l'emmerde ! Et vos archives, je vais peut-être les brûler. J'ai particulièrement envie d'utiliser certaines lettres de ma belle-mère comme papier chiotte.
- Vous n'avez pas le droit de détruire ces documents !
- Qu'est-ce qu'ils croient à l'IAS ? Que la grosse Autrichienne est incapable de mesurer l'importance de ces papiers? J'ai vécu avec cet homme pendant plus de cinquante ans. J'en ai foutrement conscience de sa grandeur ! J'ai porté sa traîne et astiqué sa couronne toute ma vie ! Vous êtes comme tous ces trous du cul serrés de Princeton, vous vous demandez pourquoi un tel génie a épousé une truie pareille ? Adressez-vous à la postérité pour avoir la réponse ! Personne ne s'est jamais posé la question de savoir ce que moi j'ai bien pu lui trouver!
- Vous êtes en colère, mais pas vraiment contre l'Institut.
La veuve Gôdel la fixa de ses yeux bleus délavés, veinés de rouge, assortis à sa chemise de nuit fleurie.
- Il est mort, madame. Personne n'y peut rien.
La vieille dame fit tourner son alliance sur un doigt jauni.
- De quel fond de tiroir à doctorats vous ont-ils sortie ?
- Je n'ai pas de compétences scientifiques particulières. Je suis documentaliste à l'IAS.
- Kurt prenait toutes ses notes en Gabelsberger, une sténo allemande oubliée. Si je vous les donnais, vous ne sauriez pas quoi en faire !
- Je maîtrise le Gabelsberger.
Les mains abandonnèrent la bague pour agripper le col de la robe de chambre.
- Comment est-ce possible ? Il doit rester trois personnes sur terre...
- Meine Groflmutter war Deutsche. Sie hat ihn mir damais gelehrt.
- Ils se croient toujours aussi malins ! Je devrais vous faire confiance parce que vous bredouillez un peu d'allemand ? Pour votre gouverne, mademoiselle la documentaliste, je suis viennoise, pas allemande. Et sachez que les trois personnes capables de traduire le Gabelsberger ne font pas partie des dix qui peuvent comprendre Kurt Gôdel. D'ailleurs, ni vous ni moi n'en sommes capables.
- Je n'ai pas cette prétention. J'aimerais me rendre utile en répertoriant le contenu du Nachlass afin que d'autres, des gens réellement compétents, l'étudient. Ce n'est ni un caprice ni un rapt, mais une marque de respect. Madame.
- Vous êtes toute voûtée. Ça vous vieillit. Redressez-vous !
La jeune femme corrigea sa posture. Elle avait toute une vie de « Anna, redresse-toi » derrière elle.
- Ils venaient d'où ces chocolats ?
- Comment avez-vous deviné ?
- Une question de logique. Primo, vous semblez être une brave fille bien éduquée, vous n'avez pas débarqué les mains vides. Secundo...
Elle lui indiqua la porte d'un coup de menton. Anna se retourna : une toute petite chose fripée patientait dans l'embrasure. Son pull angora rose pailleté était souillé de chocolat.
- Adèle, c'est l'heure du thé.
- J'arrive, Gladys. Puisque vous tenez à être utile, mademoiselle, commencez par m'aider à sortir de ce cercueil chromé.
Anna approcha le fauteuil roulant, rabattit la barrière métallique et repoussa les draps. Elle hésitait à toucher la vieille dame. Celle-ci fit pivoter son corps, posa ses pieds tremblants à terre puis invita d'un sourire la jeune femme à la soutenir. Anna la prit sous les bras. Une fois installée dans son fauteuil, Adèle soupira d'aise; Anna de soulagement, surprise d'avoir retrouvé sans peine des gestes qu'elle pensait effacés de sa mémoire. Sa grand-mère Josepha laissait dans son sillage cette même odeur de lavande. Elle refoula sa nostalgie ; une gorge serrée, c'était peu cher payer pour un premier contact si prometteur.
- Vous voulez me faire vraiment plaisir, mademoiselle Roth? Alors, apportez-moi une bouteille de bourbon la prochaine fois. Tout ce qu'on arrive à passer en fraude ici, c'est du sherry. J'ai horreur du sherry. D'ailleurs, j'ai toujours détesté les Anglais.
- Je peux donc revenir ?
- Magsein...
2.
1928
Le temps où j'étais belle
« Etre amoureux, c'est se créer une religion dont le dieu est faillible. » Jorge Luis Borges, Neuf essais sur Dante
Je l'ai remarqué bien avant que son regardne tombe sur moi. Nous habitions dans la même rue à Vienne, dans le Josefstadt, à deux pas de l'université : lui, avec son frère Rudolf, moi, chez mes parents. Ce petit matin-là, comme à mon habitude, je rentrais seule depuis le Nachtfalter, le cabaret qui m'employait. Je n'avais jamais été assez naïve pour croire au désintéressement des clients qui insistaient pour me raccompagner après mon service. Mes jambes connaissaient le chemin par cœur, mais je ne pouvais m'autoriser à baisser la garde. La ville était grise. On racontait des histoires terrifiantes à l'époque sur des gangs guettant les demoiselles à vendre aux bordels de Berlin-Babylone. Alors me voilà, Adèle, plus vraiment une jeune fille, mais l'air d'avoir vingt ans, rasant les murs et questionnant les ombres. Porkert, dans cinq minutes tu quittes ces maudites chaussures, dans dix, tu es dans ton lit. À quelques pas de chez moi, j'ai aperçu une silhouette sur le trottoir d'en face, celle d'un homme de taille modeste, enfoui dans un lourd manteau, la tête couverte d'un feutre sombre et le visage masqué par une écharpe. Les bras croisés dans le dos, il marchait avec lenteur, comme pour une promenade digestive. J'ai accéléré l'allure. J'avais les entrailles nouées. Mon ventre me trompait rarement. Personne ne se promène à 5 heures du matin. À l'aube, si vous êtes du bon côté de la comédie humaine, vous revenez d'un club, sinon, vous partez travailler. Et puis, personne ne se serait emmitouflé ainsi par une si douce nuit. J'ai serré les fesses et parcouru les derniers mètres en évaluant les chances de réveiller les voisins par mes cris. Dans une main, je tenais ma clef, un petit sachet de poivre dans l'autre. Mon amie Lieesa m'avait expliqué un jour comment aveugler un agresseur avant de lui lacérer les joues. Parvenue à mon immeuble, je me suis dépêchée de claquer la mince porte de bois derrière moi. Il m'avait flanqué une de ces frousses! Je l'ai observé, cachée par le rideau de ma chambre : il déambulait toujours. Le lendemain, à la même heure, je n'ai pas pressé le pas en retrouvant mon fantôme. Dès lors, je l'ai croisé tous les matins pendant deux semaines. À aucun moment il n'a paru remarquer ma présence. Il semblait ne rien voir. J'ai changé de trottoir. Je voulais en avoir le cœur net, je l'ai frôlé. Il est passé à côté de moi sans même lever la tête. J'ai bien fait rire les filles du club avec mon histoire de poivre. Un jour, je ne l'ai pas revu. Je suis rentrée un peu plus tôt, puis un peu plus tard ; il s'était volatilisé.
Jusqu'au soir où, au vestiaire du Nachtfalter, il m'a tendu son lourd manteau, beaucoup trop chaud pour la saison. Son propriétaire était un beau brun d'une vingtaine d'années, aux yeux bleus flous derrière de sévères lunettes cerclées de noir. Je n'ai pu m'empêcher de le provoquer.
- Bonsoir, monsieur le fantôme de la Lange Gasse.
Il m'a regardée comme le Commandeur en personne puis s'est tourné vers les deux amis qui l'accompagnaient. J'identifiai Marcel Natkin, un client de la boutique de mon père
Ils ont ricané comme le font tous les jeunes hommes quand ils sont un peu gênés, même les plus instruits. Il n'était pas, lui, du genre à faire du gringue aux demoiselles de vestiaire.
Comme il ne répondait pas et que j'étais pressée par raffluence à l'entrée, je n'ai pas insisté. J'ai pris les affaires de ces messieurs et je me suis cachée entre les cintres.
Vers 1 heure, j'ai revêtu mon costume de scène, une panoplie très décente comparée à ce qu'on pouvait exhiber dans certaines boîtes à la mode. C'était une tenue coquine de matelot : chemisette, short blanc satiné avec une lavallière bleu nuit et j'étais, bien sûr, maquillée comme à la parade. C'est fou ce que je pouvais me mettre comme peinture à l'époque! J'ai fait mon numéro avec les filles - Lieesa a encore raté la moitié des pas — puis nous avons laissé la place au chansonnier comique. J'ai repéré le trio, assis près de l'estrade, appréciant pleinement nos jambes dévoilées, mon fantôme n'étant pas le moins assidu. J'ai repris mon poste au vestiaire. Le Nachtfalter était un petit club : il fallait faire un peu de tout, danser et vendre des cigarettes entre deux passages.
Ce fut au tour de mes amies de ricaner quand il me rejoignit quelques instants plus tard.
- Veuillez m'excuser, mademoiselle, nous nous connaissons ?
- Je vous croise souvent sur la Lange Gasse.
Je farfouillai sous mon comptoir pour me donner une contenance. Il attendait, stoïque.
- J'habite au 65. Vous, au 72. Mais pendant la journée, je ne suis pas habillée ainsi.
J'avais envie de le taquiner; son mutisme était attendrissant. Il paraissait inoffensif.
- Que faites-vous toutes les nuits dehors, à part regarder vos chaussures avancer ?
- J'aime réfléchir en marchant, enfin... je réfléchis mieux en marchant.
- À quoi donc de si absorbant ?
- Je ne suis pas sûr...
- Que je puisse comprendre ? Vous savez, les danseuses ont aussi une tête !
- Vérité et indécidabilité.
- Laissez-moi deviner... Vous êtes un de ces étudiants en philosophie. Vous dilapidez l'argent de votre père dans des études qui ne vous mènent à rien, sinon à reprendre l'entreprise familiale de bonneterie.
- C'est presque correct, je m'intéresse à la philosophie, cependant je suis étudiant en mathématiques. Mon père dirige effectivement une fabrique de vêtements.
Il semblait étonné d'avoir autant parlé. Il se cassa en deux dans une parodie de salut militaire.
- Je m'appelle Kurt Gôdel. Et vous, mademoiselle Adèle. C'est correct ?
- Presque correct, mais vous ne pouvez pas tout savoir !
- Cela reste à démontrer.
Il s'esquiva à reculons, bousculé par un flot de clients.
Je le revis, comme je l'avais espéré, à la fermeture. Ses petits camarades de jeu avaient dû le stimuler pendant la soirée.
- Me permettez-vous de vous raccompagner ?
- Je vais vous empêcher de réfléchir. Je suis très bavarde !
- Ce n'est pas grave. Je ne vous écouterai pas.
Nous sommes repartis ensemble en remontant la rue de l'université. Nous avons bavardé, plus exactement, je l'ai questionné. Nous avons parlé de l'exploit de Lindbergh, du jazz qu'il n'appréciait pas et de sa mère qu'il semblait aimer beaucoup. Nous avons évité d'évoquer les violentes manifestations de l'année passée.
Je ne sais plus de quelle couleur étaient mes cheveux à l'époque de notre rencontre. J'en ai changé si souvent dans ma vie. Je devais être blonde : un peu Jean Harlow, en moins vulgaire; j'étais plus fine. De profil, je ressemblais à Betty Bronson. Qui se souvient encore d'elle ? J'adorais les acteurs. J'épluchais chaque numéro de la Semaine cinématographique. La bonne société viennoise où évoluait Kurt se méfiait du cinéma : elle chipotait peinture, littérature et surtout musique. Ce fut ma première abdication, j'allais voir des films sans lui. À mon grand soulagement, Kurt préférait l'opérette à l'opéra.
J'avais déjà mis pas mal de rêves sous mon mouchoir ; à vingt-sept ans, j'étais divorcée. Pour fuir la rigidité de ma famille, je m'étais mariée trop jeune avec un homme inconsistant. Nous sortions à peine des années d'inflation et de débrouille : choux-raves, pommes de terre et marché noir. Nous allions y replonger très vite. J'étais affamée, j'avais envie de faire la fête, je m'étais trompée d'homme : j'avais pris le premier venu, un beau parleur — Kurt, lui, ne faisait jamais de promesse qu'il ne pouvait tenir : il était scrupuleux jusqu'à la nausée. Mes rêves de jeune fille, je les avais bazardés. J'aurais aimé faire du cinéma, comme toutes les girls de l'époque. J'étais un peu folasse, assez jolie, surtout du profil droit. L'esclavage de la permanente venait de remplacer celui des cheveux longs. J'avais les yeux clairs, la bouche toujours dessinée par du rouge, de belles dents et de petites mains. Une tonne de poudre sur la tache de vin qui gâtait ma joue gauche. En définitive, cette maudite tache m'a bien servie. J'ai pu lui reprocher toutes mes illusions perdues.
Kurt et moi n'avions rien en commun, du moins si peu. J'avais sept ans de plus, je n'avais pas fait d'études ; il préparait son doctorat. Mon père était photographe de quartier, le sien industriel prospère. Il était luthérien, j'étais catholique, à cette époque, sans trop de zèle. Pour moi, la religion était un souvenir de famille voué à prendre la poussière sur la cheminée. En ce temps-là, on entendait tout au plus cette prière dans la loge des danseuses : « Marie, vous qui l'avez eu sans le faire, faites que je le fasse sans l'avoir ! » On avait toutes peur de se faire refiler un locataire, moi la première. Beaucoup finissaient dans l'arrière-cuisine de la mère Dora, une vieille tricoteuse. À vingt ans, j'avançais un peu au hasard : bonne pioche, mauvaise pioche, je jouais. Je n'imaginais pas devoir faire des réserves de bonheur ou d'insouciance pour plus tard; je devais tout brûler, tout saccager. J'aurais le temps de rejouer. J'aurais surtout celui de regretter.
La promenade s'est achevée comme elle avait commencé, dans le très inconfortable silence où chacun cachait ses pensées. Même si je n'ai jamais été douée pour les mathématiques, je connais ce postulat : une toute petite inflexion de l'angle de départ fait une énorme différence à l'arrivée. Dans quelle dimension, quelle version de notre histoire, ne m'a-t-il pas raccompagnée ce soir-là ?
Extraits


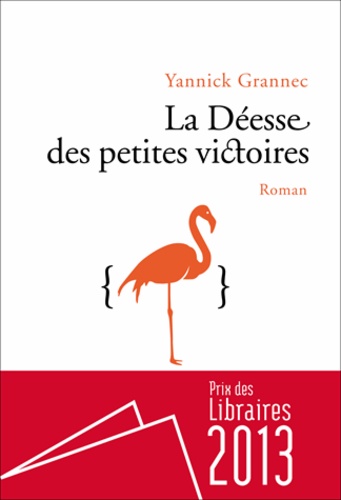


























Commenter ce livre