Des inconnues
Patrick Modiano
I
Cette année-là, l'automne est venu plus tôt que d'habitude, avec la pluie, les feuilles mortes, la brume sur les quais de la Saône. J'habitais encore chez mes parents, au début de la colline de Fourvière. Il fallait que je trouve du travail. En janvier, j'avais été engagée pour six mois comme dactylo à la Société de Rayonne et Soierie, place Croix-Paquet, et j'avais économisé l'argent de mon salaire. J'étais partie en vacances à Torremolinos, au sud de l'Espagne. J'avais dix-huit ans et je quittais la France pour la première fois de ma vie.
Sur la plage de Torremolinos, j'avais fait la connaissance d'une femme, une Française, qui vivait là depuis plusieurs années avec son mari et s'appelait Mireille Maximoff. Une brune, très jolie. Elle et son mari tenaient un petit hôtel où j'avais pris une chambre. Elle m'avait expliqué qu'elle ferait un long séjour à Paris, l'automne prochain, et qu'elle logerait chez des amis dont elle m'avait donné l'adresse. Je lui avais promis d'aller la voir à Paris, si j'en avais l'occasion.
Au retour, Lyon m'a paru bien sombre. Tout près de chez moi, à droite, sur la montée Saint-Barthélemy, se trouvait le pensionnat des Lazaristes. Des bâtiments construits à flanc de colline et dont les façades lugubres dominaient la rue. Le portail était creusé dans un grand mur. Pour moi, Lyon de ce mois de septembre-là, c'est le mur des Lazaristes. Un mur noir où se posaient quelquefois les rayons du soleil d'automne. Alors, ce pensionnat semblait abandonné. Mais sous la pluie, le mur était celui d'une prison et j'avais l'impression qu'il me barrait l'avenir.
J'ai appris par une cliente de la boutique de mes parents qu'une maison de couture cherchait des mannequins. D'après elle, c'était payé huit cents francs par mois, deux cents francs de plus qu'à la Société de Rayonne et Soierie. Elle m'a donné l'adresse, et j'ai décidé de m'y présenter. Au téléphone, une femme m'a dit d'une voix autoritaire de venir une fin d'après-midi de la semaine prochaine au 4 de la rue Grolée.
Les jours suivants, j'ai fini par me persuader que je devais faire ce métier de mannequin, moi qui n'y avais jamais songé auparavant. Ainsi aurais-je peut-être une bonne raison de quitter Lyon pour Paris. À mesure que se rapprochait l'heure du rendez-vous, j'étais de plus en plus anxieuse. Ma vie se jouerait à pile ou face. Je me disais que si je n'étais pas engagée, il ne se présenterait plus d'autre occasion comme celle-là. Est-ce que j'avais une petite chance ? De quelle manière s'habiller pour passer l'examen ? Je n'avais pas le choix. Mes seuls vêtements un peu soignés étaient une jupe grise et un chemisier blanc. J'ai acheté des chaussures bleu marine à petits talons.
La veille au soir, dans ma chambre, j'ai mis le chemisier blanc, la jupe grise, les chaussures bleu marine et j'étais là, debout, immobile, devant la glace de l'armoire à me demander si cette fille, c'était bien moi. Cela m'a fait sourire, mais le sourire s'est figé à la pensée que, demain, on déciderait de ma vie.
Je craignais d'être en retard au rendez-vous et j'étais partie de chez moi une heure à l'avance. Place Bellecour, il pleuvait et je me suis réfugiée dans le hall de l'hôtel Royal. Je ne voulais pas me présenter à la maison de couture les cheveux mouillés. J'ai expliqué au concierge de l'hôtel que j'étais une cliente et il m'a prêté un parapluie. Au 4 de la rue Grolée, on m'a fait attendre dans une grande pièce aux boiseries grises et aux portes-fenêtres protégées par des rideaux de soie de la même couleur. Une rangée de chaises était disposée contre le mur, des chaises en bois doré avec un capiton de velours rouge. Au bout d'une demi-heure, je me suis dit que l'on m'avait oubliée.
Je m'étais assise sur l'une des chaises et j'entendais tomber la pluie. Le lustre jetait une lumière blanche. Je me demandais s'il fallait que je reste là.
Un homme est entré, la cinquantaine, les cheveux bruns ramenés en arrière, une petite moustache et des yeux d'épervier. Il était vêtu d'un costume bleu marine et il portait des chaussures de daim foncé. Quelquefois, dans mes rêves, il pousse la porte et il entre, les cheveux toujours aussi noirs après trente ans.
Il m'a priée de ne pas me lever et il s'est assis à côté de moi. D'une voix sèche, il m'a demandé mon âge. Est-ce que j'avais déjà travaillé comme mannequin ? Non. Il m'a demandé d'enlever mes chaussures et de marcher jusqu'aux fenêtres, puis de revenir vers lui. J'ai marché et je me sentais très embarrassée. Il était penché sur sa chaise, le menton sur la paume de sa main, l'air soucieux. Après cet aller-retour, je suis restée debout devant lui, sans qu'il me dise rien. Pour me donner une contenance, je ne quittais pas du regard mes chaussures, au pied de la chaise vide.
– Asseyez-vous, m'a-t-il dit.
J'ai repris ma place, à côté de lui, sur la chaise. Je ne savais pas si je pouvais remettre mes chaussures.
– C'est votre couleur naturelle ? a-t-il demandé en désignant mes cheveux.
J'ai répondu oui.
– Je voudrais vous voir de profil.
J'ai tourné la tête en direction des fenêtres.
– Vous avez un assez joli profil...
Il me l'avait dit comme s'il m'annonçait une mauvaise nouvelle.
– C'est tellement rare, les jolis profils.
Il paraissait exaspéré à la pensée qu'il n'y eût pas assez de jolis profils dans le monde. Il me fixait de ses yeux d'épervier.
– Pour des photos ce serait très bien, mais vous ne correspondez pas à ce que recherche monsieur Pierre.
Je me suis raidie. Avais-je encore une toute petite chance ? Peut-être demanderait-il son avis à ce monsieur Pierre qui était le patron sans doute. Que recherchait-il exactement ? J'étais bien décidée à me conformer à tout ce que voulait monsieur Pierre.
– Je regrette... Nous ne pouvons pas vous engager.
Le verdict était tombé. Je n'avais plus la force de rien dire. Le ton sec et courtois de cet homme me faisait bien comprendre que je n'étais même pas digne qu'on demande son avis à monsieur Pierre.
J'ai remis mes chaussures. Je me suis levée. Il m'a serré la main, en silence, et m'a guidée jusqu'à la porte qu'il a ouverte lui-même pour me laisser le passage. Dans la rue, je me suis aperçue que j'avais oublié le parapluie, mais cela n'avait plus aucune importance. Je traversai le pont. Je marchai sur le quai, le long de la Saône. Puis je me suis retrouvée, près de chez moi, montée Saint-Barthélemy, devant le mur des Lazaristes, comme souvent dans mes rêves, les années suivantes. On n'aurait pas pu me distinguer de ce mur. Il me recouvrait de son ombre et je prenais la même couleur que lui. Et personne, jamais, ne m'arracherait à cette ombre. Par contraste, le salon de la rue Grolée, où l'on m'avait fait attendre, baignait dans la lumière du lustre, une lumière crue. Le type en costume bleu et chaussures de daim n'en finissait pas de quitter la pièce, à reculons. On aurait dit un vieux film que l'on passe à l'envers.
Toujours le même rêve. Au bout de quelques années, le mur des Lazaristes était moins sombre et, certaines nuits, un rayon de soleil couchant l'éclairait. Dans le salon de la rue Grolée, le lustre répandait une lumière douce. Le costume bleu de l'homme aux yeux d'épervier semblait bien pâle, délavé. Son visage aussi avait pâli, sa peau était presque translucide. Seuls les cheveux restaient noirs. Sa voix s'était cassée. Ce n'était plus lui qui parlait, mais un disque qui tournait. Les mêmes paroles se répétaient pour l'éternité : « votre couleur naturelle... Mettez-vous de profil... Vous ne correspondez pas à ce que recherche monsieur Pierre », et elles avaient perdu leur sens. Chaque fois, à mon réveil, je m'étonnais que cet épisode de plus en plus lointain de ma vie m'ait causé une telle déception et m'ait rendue si malheureuse. J'avais même pensé, quand je traversais le pont ce soir-là, me jeter dans la Saône. Pour si peu de chose.
Je n'avais même plus le courage de rentrer chez moi, de retrouver mes parents et l'armoire à glace de ma chambre. J'ai descendu les escaliers vers la vieille ville comme si je prenais la fuite. De nouveau, je marchais sur le quai, au bord de la Saône. Je suis entrée dans un café. Je gardais toujours sur moi le bout de papier où Mireille Maximoff avait écrit l'adresse et le numéro de téléphone de ses amis à Paris. Les sonneries se succédaient sans que personne ne réponde et, brusquement, j'ai entendu une voix de femme. Je restais muette. Puis, j'ai quand même réussi à dire : « Est-ce que je pourrais parler à Mireille Maximoff ? » d'une voix blanche que l'on ne devait pas entendre, là-bas, à Paris. Elle était absente pour le moment mais elle serait là un peu plus tard, dans la soirée.
Le lendemain, j'ai pris un train de nuit à la gare de Perrache. Le compartiment était plongé dans l'obscurité. Des ombres dormaient sur la banquette, tout au fond. Je me suis assise près du couloir. Le train restait à quai et je me demandais si, vraiment, on me laisserait partir. J'avais l'impression de faire une fugue. Le wagon s'est ébranlé, j'ai vu disparaître la Saône et je me suis sentie délivrée d'un poids. Je ne crois pas que j'aie dormi cette nuit-là, ou alors d'un demi-sommeil lorsque le train s'est arrêté, sans qu'on sache pourquoi, le long d'un quai désert à Dijon. Dans la lumière bleue de la veilleuse, je pensais à Mireille Maximoff. Pas un jour sans soleil, là-bas, sur la plage de Torremolinos. Elle m'avait dit qu'à mon âge, elle habitait dans une petite ville des Landes dont j'ai oublié le nom. La veille du baccalauréat, elle s'était couchée très tard et le réveil n'avait pas sonné. Elle avait dormi jusqu'à midi au lieu de passer son baccalauréat. Plus tard, elle avait fait la connaissance d'Eddy Maximoff, son mari. C'était un grand et bel homme d'origine russe que l'on appelait « Le Consul » et qui avait l'habitude de boire un mélange de Coca-Cola et de rhum. Il voulait m'en servir à l'heure de l'apéritif, mais chaque fois je lui disais que je préférais le Coca-Cola tout simple. Il parlait français sans accent. Il avait vécu à Paris, et j'avais oublié de demander à Mireille Maximoff par quel hasard ils étaient tous deux en Espagne.
Je suis arrivée très tôt. À la gare de Lyon, il faisait encore nuit. D'ailleurs, les premiers temps que j'ai passés à Paris, il me semble qu'il faisait toujours nuit. Je n'avais qu'un sac de voyage qui était léger à porter. Ce matin de mon arrivée, j'étais assise dans un café de la place du Trocadéro avec Mireille Maximoff. J'avais attendu au buffet de la gare qu'il soit dix heures pour lui téléphoner. Elle n'avait pas compris tout de suite d'où je l'appelais. J'étais la première dans le café. Je craignais qu'elle me témoigne de la froideur quand je lui avouerais que je ne savais pas où habiter. Elle s'est avancée vers moi avec un sourire comme si elle venait me rejoindre sur la plage. On aurait dit que nous nous étions quittées la veille. Elle paraissait contente de me voir et elle me posait des questions. Je lui ai tout raconté : mon rendez-vous dans la maison de couture, la voix sèche du type aux yeux d'épervier, que j'entendais encore la nuit précédente, après Dijon, dans mon demi-sommeil : « C'est votre couleur naturelle ? Mettez-vous de profil... »
Et là, devant elle, j'ai fondu en larmes. Elle a posé sa main sur mon épaule et m'a dit que tout cela n'avait aucune importance. C'était comme le baccalauréat qu'elle avait manqué à dix-sept ans parce que le réveil n'avait pas sonné ce matin-là. Elle voulait bien me recueillir dans l'appartement de ses amis.
Nous avons traversé la place, et mon sac de voyage n'était vraiment pas lourd à porter. Il pleuvait comme à Lyon, mais la pluie, elle aussi, me semblait légère. C'était au bout de la rue Vineuse. Les premiers jours, je gardais le papier où étaient écrits l'adresse et le numéro de téléphone, au cas où je me perdrais dans Paris. Un appartement aux murs clairs. Dans le salon, il n'y avait presque pas de meubles. Elle a ouvert la porte d'une petite chambre où l'un des murs était recouvert de rayonnages de livres. De l'autre côté, un canapé en velours gris. Pas d'armoire à glace. La fenêtre donnait sur une cour. Elle voulait chercher des draps mais je lui ai dit que ce n'était pas la peine, pour le moment. Elle a tiré les rideaux. J'avais posé mon sac de voyage près du canapé, sans l'ouvrir. Je me suis endormie très vite. J'entendais la pluie tomber dans la cour et cela me berçait. Je m'éveillais de temps en temps et chaque fois je glissais doucement dans le sommeil. Je suivais de nouveau la montée Saint-Barthélemy et à droite j'étais étonnée que le mur des Lazaristes ait disparu. Il ne restait plus qu'une trouée qui s'ouvrait sur la place du Trocadéro. Il pleuvait mais le ciel était très clair, bleu pâle. Les jours suivants, Mireille Maximoff m'emmenait avec elle dans Paris. Nous traversions la Seine et nous allions à Saint-Germain-des-Prés. Elle retrouvait des amis au Nuage, à La Malène. J'étais assise avec eux et je n'osais pas ouvrir la bouche. Je les écoutais. Quelquefois, elle revenait vers sept heures du soir dans l'appartement et moi je restais seule tout l'après-midi. Je marchais jusqu'au bois de Boulogne. Il y avait souvent du soleil. Une pluie fine tombait sans que je m'en aperçoive tout de suite. Le soleil, de nouveau, sur les feuillages roux des arbres et dans les allées du Pré Catelan qui sentaient la terre mouillée. Au retour, il faisait déjà nuit. Une vague inquiétude me prenait à la pensée de l'avenir. Il me paraissait bien fermé comme si j'étais encore devant le mur des Lazaristes. Je chassais mes idées noires. On pouvait faire des rencontres dans cette ville. Le long de l'avenue qui menait du bois de Boulogne au Trocadéro, je levais la tête vers les fenêtres allumées. Chacune d'elles me semblait une promesse, un signe que tout était possible. Malgré les feuilles mortes et la pluie, il y avait de l'électricité dans l'air. Un automne étrange. Il est clos sur lui-même et détaché pour toujours du reste de ma vie. Là où je suis maintenant, il n'y a plus d'automne. Un petit port de la Méditerranée où le temps s'est arrêté pour moi. Chaque jour, du soleil, jusqu'à ma mort. Les rares fois que je suis retournée à Paris, les années suivantes, j'avais peine à croire que c'était la ville où j'avais passé cet automne-là. Tout était alors plus violent, plus mystérieux, les rues, les visages, les lumières, comme si je rêvais ou que j'avais absorbé une drogue. Ou bien, simplement, j'étais trop jeune et le voltage trop fort pour moi. À mon retour, ce soir-là, rue Vineuse, j'ai croisé dans l'escalier de l'immeuble un homme brun en imperméable. Je l'avais déjà vu avec les autres que nous allions retrouver à Saint-Germain-des-Prés. Il m'a reconnue et il m'a souri. Il avait dû raccompagner Mireille Maximoff dans l'appartement. J'ai sonné. Elle a mis longtemps à m'ouvrir. Elle ne portait qu'un peignoir d'éponge rouge et elle était décoiffée. Il n'y avait pas de lumière dans le salon. Elle m'a expliqué qu'elle s'était endormie. Je n'ai pas osé lui dire que j'avais croisé le type dans l'escalier. Une expression de langueur passait dans son regard, elle m'a prise par l'épaule et elle m'a embrassée. Elle m'a demandé ce que j'avais fait pendant l'après-midi et elle s'est étonnée que je me promène toute seule au bois de Boulogne.
– Il faudrait que tu trouves un amoureux, m'a-t-elle dit. Tu sais, il n'y a rien de mieux que l'amour.
J'étais d'accord avec elle, mais je n'osais pas lui dire qu'il faudrait aussi que je cherche du travail. Je ne voulais plus retourner à Lyon. Nous étions assises, toutes les deux, sur le divan du salon et elle n'avait pas allumé la lampe. Les lumières de l'immeuble d'en face nous laissaient dans la pénombre. Elle m'entourait l'épaule de son bras et la ceinture de son peignoir s'était dénouée. Elle sentait un parfum entêtant, peut-être de la tubéreuse. J'avais envie de me confier à elle, mais je gardais le silence. Personne ne savait que nous étions ici. Nous vivions en fraude. Elle s'était introduite par effraction dans cet appartement. J'avais peur. Je n'aurais jamais dû quitter Lyon. J'étais mal à l'aise dans ce salon vide. L'appartement n'avait pas été occupé depuis longtemps et des cambrioleurs avaient emporté les meubles. Elle m'a demandé pourquoi je paraissais si soucieuse. Alors, j'ai essayé de trouver les mots pour lui répondre. C'était gentil de sa part de m'avoir fait venir ici, mais j'avais l'impression d'être une intruse. Je m'étais déjà mise dans une situation difficile en quittant Lyon sur un coup de tête, et je ne voulais pas devenir un poids pour elle. Est-ce qu'elle informerait les propriétaires qu'elle m'avait accueillie ici ? Les connaissait-elle vraiment ? Pour parler franc, je me demandais quelquefois si toutes les deux nous avions bien le droit d'être là et je craignais que les propriétaires ne reviennent à l'improviste pour nous chasser. Elle a éclaté de rire. De sa voix douce, avec ce sang-froid et cette nonchalance que je lui enviais, elle a dissipé ma panique. La femme qui habitait ici était une amie de longue date. Une personne un peu fantaisiste qui avait été mariée avec un riche marchand de fourrures. Et si je voulais tout savoir, elle aussi, Mireille Maximoff, avait débarqué un jour à Paris. Du train de Bordeaux. En ce temps-là, elle était seule et pas plus vieille que moi. Elle avait d'abord habité une chambre dans un hôtel du quartier Latin et elle avait rencontré cette femme quand elle s'était présentée à la suite d'une petite annonce, pour un poste de vendeuse, dans le magasin de fourrures de son mari. Cette femme lui avait fait connaître tous les gens de Saint-Germain-des-Prés, et son futur mari Eddy Maximoff. Elle les emmenait en week-end à Montfort-l'Amaury ou à Deauville dans sa voiture américaine. C'était la belle vie. Il n'y avait vraiment aucune raison pour que je m'inquiète. Cette femme était très contente de lui prêter l'appartement. Alors, j'ai eu le courage de lui dire que je m'inquiétais quand même pour mon avenir. Qu'est-ce que je deviendrais à Paris sans travail ? Elle m'a regardée un moment en silence.
– Moi aussi, m'a-t-elle dit, j'avais peur quand je suis arrivée à Paris. Mais les choses finissent par s'arranger. Tu n'imagines pas ta chance d'avoir ces années devant toi. Et puis, je t'aiderai. Je connais des gens à Paris. Et tu peux toujours partir avec moi en Espagne.
J'étais rassurée. Je sentais qu'elle me voulait du bien. Il suffisait que je lui fasse confiance et la vie serait belle. Un soir, nous sommes allées au théâtre pour voir jouer une fille qui s'appelait Pascale. La pièce se déroulait de nos jours dans un château d'un pays imaginaire où quelques personnes élégantes se trouvaient bloquées à cause d'une tempête de neige. Tous portaient des vêtements de velours noir avec de grands cols blancs, les femmes avaient l'air de pages et les hommes d'écuyers. De temps en temps, la musique d'un clavecin. Le grand salon était éclairé par des candélabres, il y avait des meubles anciens et des toiles d'araignées, mais aussi le téléphone et, à la lumière des bougies, ces gens fumaient des cigarettes et buvaient du whisky en se parlant d'un air distingué. À la sortie du théâtre, il pleuvait. Nous sommes montées, Mireille Maximoff et moi, dans la voiture d'un de ses amis. Nous devions retrouver au restaurant d'autres amis à eux, et cette Pascale est venue nous rejoindre beaucoup plus tard. Elle était accompagnée par un homme très grand d'une quarantaine d'années aux cheveux blonds coupés en brosse. Il était metteur en scène de cinéma et il avait un visage sévère, presque une tête de mort. Il voulait engager cette Pascale pour un film dont ils ont tous parlé pendant le repas.
Extraits

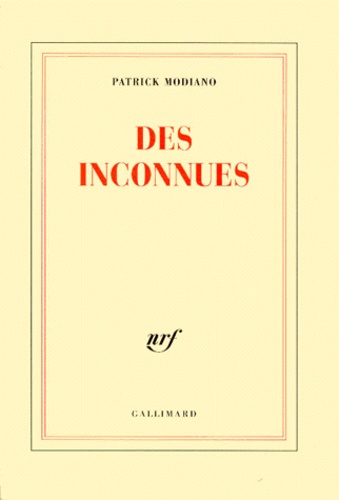


























Commenter ce livre