Vengeance à Beyrouth
Gérard de Villiers
De 1965, année du premier SAS, "SAS à Istanbul", à sa disparition en octobre 2013 Gérard de Villiers, l'auteur de cette collection de livres d'espionnage, a écrit et publié 200 SAS. Le héros, Malko Linge, est un Prince Autrichien et agent de la CIA. Souvent accompagné de son fidèle majordome et garde du corps le redoutable Elko Chrisantem. Propriétaire du château de Liezen et fiancé à Alexandra, une blonde sulfureuse. Ces romans ont la particularité de mêler voyages exotiques et intrigues des services de renseignement. Un article de janvier 2013 paru dans The New York Times revient sur la longue et prolifique carrière de l'auteur et sur l'intérêt que portent les services secrets du monde entier à ses écrits. En effet, certains des événements décrits dans les aventures de Malko se sont étrangement reproduits, parfois presque à l'identique. Une référence en géopolitique.
PROLOGUE
L’Hercules C 130 de l’US Air Force fit jaillir des gerbes d’eau lorsque ses roues touchèrent la piste de l’aéroport militaire de Dover, dans le Delaware. Ce 28 décembre 1991, il faisait un temps exécrable dans l’est des États-Unis. Sous un ciel bas et couvert, le C 130 fit demi-tour en bout de piste et se dirigea vers un des hangars. On avait dressé à l’entrée une petite estrade, protégée de la pluie par un auvent.
Une douzaine d’hommes et une femme attendaient debout, engoncés dans des imperméables. La pluie fouettait leurs visages graves. Pas un mot ne fut prononcé tandis que le quadripropulseur roulait vers eux à une vitesse d’escargot. Face au hangar, le son strident de ses moteurs augmenta et il fit majestueusement demi-tour, présentant son arrière à la tribune et projetant sur ses occupants un brouillard humide. Puis ses quatre hélices quadripales s’arrêtèrent progressivement, en même temps que sa trappe arrière s’abaissait jusqu’à toucher le sol.
Un peloton de Marines en tenue d’apparat sortit du hangar au pas de course et prit rapidement position, sur deux rangs, en face de l’ouverture béante. Deux soldats disposèrent des tréteaux sur le sol et six Marines s’engouffrèrent dans le fuselage. Ils en ressortirent quelques instants plus tard, portant sur leurs épaules un cercueil de chêne verni recouvert d’un drapeau américain.
À pas lents, ils descendirent la rampe et se dirigèrent vers les tréteaux. Ils y installèrent, avec des gestes précis, le cercueil recouvert de la bannière étoilée.
Le silence était poignant. Les gens rassemblés sur l’estrade paraissaient transformés en statues. Le menton de l’unique femme tremblait légèrement, tandis qu’elle serrait les lèvres pour ne pas laisser éclater son chagrin. Il y eut un ordre bref, les claquements des paumes des Marines sur les crosses de leur MP. 16 pour présenter les armes, puis le choc sourd des crosses heurtant le sol. Et de nouveau, le silence, troublé par les rafales de pluie. Les regards étaient fixés sur le cercueil entouré de sa garde d’honneur.
Le cercueil de William J. Buckley, responsable de la Central Intelligence Agency pour le Moyen-Orient, enlevé à Beyrouth par trois hommes, le 16 mars 1984, alors qu’il gagnait son bureau à l’ambassade américaine, dans Beyrouth-Ouest.
Personne ne l’avait revu vivant. L’enlèvement avait été le fait du Hezbollah, groupe intégriste libanais manipulé par Téhéran. Les services de renseignements occidentaux n’avaient appris qu’une chose : William J. Buckley avait été affreusement torturé pendant de longs mois ; il en était mort. Le 8 septembre 1985, le Hezbollah avait envoyé au journal beyrouthin Al-Nahar une photo de son cadavre.
Le 31 août 1987, un service funèbre « in absentia » avait été célébré dans la chapelle de Langley, QG de la CIA, en Virginie. Il avait encore fallu attendre quatre ans pour que, suite aux pressions américaines sur les Syriens, un cadavre mal embaumé soit abandonné dans un fossé, sur la route de l’aéroport de Beyrouth. Son état de décomposition était tel qu’il avait été impossible de préciser la cause de la mort.
Les experts de la CIA avaient cependant pu identifier formellement William Buckley. Les restes de celui-ci avaient d’abord été transportés dans une base américaine à Franc-fort, avant d’entreprendre le dernier voyage vers les États-Unis. Après cette brève cérémonie à Dover, la dépouille de William Buckley partirait pour le cimetière d’Arlington, en Virginie, où reposaient, à côté de John Kennedy, tous ceux qui avaient donné leur vie pour les États-Unis...
Le silence se prolongea près d’une minute. Puis, un des assistants s’approcha du micro : Dick Cheney, secrétaire d’État à la Défense. Il ne prononça que quelques mots, d’une voix étranglée par l’émotion : « Je m’incline devant la mort tragique de ce patriote américain courageux et dévoué qui a donné sa vie pour son pays. Les responsables de ce meurtre devront en rendre compte. »
CHAPITRE PREMIER
Beyrouth !
Par la baie ouverte au dixième étage de l’immeuble moderne de la rue Trabaud, au cœur d’Ashrafieh, le quartier chrétien à l’est de la ville, Malko apercevait le labyrinthe des buildings neufs surgis au milieu des vieilles maisons ottomanes et des bâtiments éventrés par dix-sept ans d’une féroce guerre civile, jusqu’au port.
La rumeur incessante des klaxons montait jusqu’à lui, coupée parfois par l’appel d’un marchand ambulant de kaak1, ou par le vain coup de sifflet d’un policier essayant d’accélérer la circulation sur le « ring » Fouad Chehab ; l’autoroute urbaine traversant Beyrouth d’est en ouest passait à cinquante mètres de l’appartement où il se trouvait.
Huit ans après son dernier passage à Beyrouth, c’était toujours la même atmosphère d’activité frénétique et brouillonne, moins les explosions, les rafales d’armes automatiques et les sirènes des ambulances.
La chaleur était accablante : trente-huit degrés à l’ombre. L’été était arrivé d’un coup, à la mi-juin. Sur sa gauche, à l’endroit qui avait été le cœur de Beyrouth, les gratte-ciel détruits par la guerre se dressaient comme des orbites vides au milieu de quartiers dévastés. La tour Murr, le Holiday Inn, le Hilton, le Phœnicia. Ce paysage de Pompéi moderne contrastait avec la circulation anarchique, et la toile d’araignée des fils électriques s’enchevêtrant au-dessus des rues étroites des vieux quartiers. L’électricité étant rationnée à six heures par jour, et de nombreux immeubles en étant privés, chaque Beyrouthin essayait de voler un peu de courant en se branchant à la sauvette sur les transformateurs. Les vieilles maisons ottomanes, les baraques en ruine et quelques immeubles récents semblaient ne constituer qu’une seule masse, piquetée de dizaines de milliers d’impacts de toutes dimensions, comme si une nuée de pics-verts géants s’était acharnée sur la ville.
Du large balcon, Malko apercevait ce qui avait été la fameuse « ligne verte », le no man’s land qui séparait Beyrouth-Ouest et ses quartiers musulmans de l’Est chrétien. De la mer, au sud de la ville, sur une dizaine de kilomètres et deux cents mètres de large, il n’y avait pas un immeuble intact. Tout avait été massacré, fenêtre par fenêtre, toit par toit, au mortier, au canon, à la mitrailleuse lourde, au fusil, à la grenade. Les pilleurs avaient achevé le travail, enlevant tout ce qui pouvait se revendre. Pourtant, quelques familles s’étaient réinstallées dans ces coquilles vides, sans eau ni électricité, sans fenêtres ni sanitaires. On les apercevait parfois le soir, cuisinant sur des balcons dont il ne restait que la dalle de ciment.
Malko avait du mal à réaliser que quatre jours plus tôt, il se trouvait encore dans son château de Liezen, au milieu des sapins, avec Alexandra, sa fiancée, plus amoureuse que jamais, en train de savourer un Dom Pérignon bien glacé.
Un coup de fil du chef de station de la CIA à Vienne l’avait appelé à se rendre d’urgence à Langley. Procédure hautement inhabituelle, appuyée par un billet en Concorde sur Air France. Il éprouvait toujours le même plaisir à emprunter le supersonique, l’avion de l’homme du XXIe siècle à la clientèle cosmopolite. Un vrai club. Les 6 500 km entre Paris et New York avaient passé comme dans un rêve. Servi par un stewart en spencer blanc et une hôtesse en Nina Ricci, cocooné par la nouvelle décoration, il avait savouré trois heures trente de bonheur. C’était dur, ensuite, de retrouver la navette New York-Washington.
Deux heures plus tard, il pénétrait dans le bureau du directeur de la Division des Opérations, Robert Douglas. Un sosie de l’acteur américain Burt Reynolds – moustache fournie et allure de play-boy – s’y trouvait : le patron de la CIA pour tout le Moyen-Orient, basé à Beyrouth. Vincent Faulkner, arabisant, francophone, était le meilleur expert de la Company pour le monde arabe. Il avait ouvert la discussion, sans fioritures inutiles.
– Vous vous souvenez de William Buckley ?
– Bien sûr, avait répondu Malko. C’est une vieille affaire qui remonte à 1984.
– Exact. Ça a été le coup le plus dur porté à la Company. Et Buckley a subi un véritable calvaire.
– Tout le monde a oublié cela, aujourd’hui.
– Pas nous, avait dit sèchement Vincent Faulkner. Avant de quitter la Maison-Blanche, le président George Bush a signé un finding nous donnant carte blanche pour retrouver et liquider physiquement tous ceux qui ont trempé dans le kidnapping, la détention et l’assassinat de William Buckley. Par tous les moyens.
Il avait eu un sourire froid pour préciser :
– Un finding, c’est comme une fatwa de ces salauds d’islamistes. Ça reste valable après la mort ou le départ de son auteur.
– Je comprends, avait dit Malko. Mais pourquoi avoir attendu si longtemps ?
– D’abord, il fallait que tous les otages soient rentrés. Il n’y a que deux ans que c’est fait. Ensuite, nous avons laissé passer le temps, pour que les Hezbollahs soient persuadés que nous avions classé l’affaire. Moi-même, j’ai intoxiqué les Syriens grâce à un colonel des services de renseignements avec qui je suis en bons termes. J’ai dit qu’on avait tiré un trait sur Buckley. Ils ont sûrement transmis le message aux Hezbollahs... Ceux-ci savent qu’il n’y a plus d’Américains à Beyrouth, à part quelques diplomates ; ni même de civils qui pourraient être sous « couverture ». Ils dorment sur leurs deux oreilles. Pour que cette vengeance soit exemplaire, il faut une opération chirurgicale, pas menée au hasard, comme pour le cheikh Fadlallah. Il faut leur foutre une trouille noire, cette fois, en pénétrant leur système !
Un ange était passé, penaud.
Après l’explosion d’un camion piégé qui avait tué plus de deux cents Marines à Beyrouth, le 23 octobre 1983, la CIA avait organisé un contre-attentat visant le cheikh Fadlallah, porte-parole du Hezbollah pro-iranien. Hélas, la voiture piégée qui lui était destinée avait tué quatre-vingts personnes, mais l’avait raté...
– Cette fois, avait martelé Vincent Faulkner, il ne faut pas se tromper... Et ça n’est pas le plus facile.
Malko avait marqué sa surprise.
– Depuis le temps, vous n’avez pas identifié les coupables ? Ils ne sont pas localisés ?
– Ça paraît fou, mais c’est vrai, avait reconnu Vincent Faulkner. Il faut comprendre que nous n’avons jamais eu aucune source directe au sein du Hezbollah, qui est un système hermétique. Même les services syriens et libanais n’en savaient guère plus que nous et nous disaient ce qu’ils voulaient bien nous dire. Au départ, nous avons su très vite que William Buckley était détenu quelque part dans la banlieue sud, dans le quartier chiite. Encore aujourd’hui, nous ignorons exactement où.
« Nous n’avons qu’un nom, celui de l’homme qui a organisé son enlèvement, Hadj Imad Fayez Mughnieh. Un chiite très pieux, né à Deir Debba dans le Sud-Liban, dont la famille habite toujours la banlieue sud, à Bourj Brajneh. En plus du kidnapping de William Buckley, il a organisé les attentats du 23 octobre 1983 contre nos Marines et les paras français, deux assassinats de diplomates français, plusieurs prises d’otages et, en juin 1985, les détournements sur Beyrouth d’un Boeing de la TWA et d’un appareil des Koweit Airways.
Palmarès éloquent.
– Où se trouve-t-il ? avait interrogé Malko.
La réponse était tombée comme un couperet.
– Il a disparu de Beyrouth depuis deux ans, et personne ne l’a revu depuis. C’est lui qu’il faut retrouver. Maintenant, il doit se méfier beaucoup moins.
– Ça ne va pas être facile.
Vincent Faulkner ne s’était pas troublé.
– Avant d’aller plus loin, je dois vous poser une question. Nous avons baptisé entre nous cette opération Wrath of God. Acceptez-vous d’en prendre la tête, à des conditions un peu particulières ?
– Lesquelles ?
– Nous vous offrons un dollar, en cas de réussite. C’est une vengeance. Une affaire de famille, une famille dont vous faites partie. Nous ne voulons pas de mercenaire pour la diriger, et aucun Américain ne doit y être impliqué directement, pour des raisons de sécurité.
– J’accepte, avait dit Malko sans réfléchir.
Ce qu’on lui proposait correspondait parfaitement à son éthique : rien n’était plus honorable que de venger un compagnon de combat.
Vincent Faulkner s’était fendu d’un faible sourire.
– D’après ce que Bob Douglas m’avait dit de vous, je pensais bien que vous accepteriez, mais c’est bon de vous l’avoir entendu dire. Vous êtes conscient des risques ? Les Hezbollahs sont extrêmement dangereux, c’est comme plonger la main dans un sac plein de cobras. S’ils réalisent ce que vous êtes en train de faire, ils mettront tout en œuvre pour vous tuer. À Beyrouth, nous n’avons aucun allié sûr...
– De qui et de quoi vais-je disposer ? avait demandé Malko.
– Nous avons déjà commencé à travailler, lui avait alors appris Vincent Faulkner. J’ai quatre hommes sur le terrain. Deux pour le sale travail, Samir et Nabil Maalouf. Deux anciens membres de l’équipe de tueurs d’Elie Hobeika qui dirigeait le service de sécurité des Forces libanaises. Ils se sont particulièrement distingués lors des massacres de Sabra et Chatila. Ils ont émigré aux États-Unis mais sont en situation illégale. On leur a donné le choix : l’expulsion ou un permis de séjour et 100000 dollars chacun, s’ils collaborent.
« Ils sont à Beyrouth depuis quinze jours. “En vacances.” Ils attendent.
« J’ai recruté aussi un ancien adjoint de Samir Geagea, un des chefs des Forces libanaises, Adal Chartouni. Il était chargé à l’époque de “pénétrer” le Hezbollah. Il y a gardé beaucoup de contacts. Nous l’avons retrouvé dans le Bronx, où il tient un magasin de chaussures. Il ne tenait pas vraiment à revenir à Beyrouth, mais je l’ai convaincu...
« À côté de ces trois-là, les Douze Salopards étaient des enfants de chœur...
– Et le quatrième ?
– C’est le plus sympa. Il travaille avec nous depuis longtemps. Comme chauffeur. Sohbi Jalloul. Comme il a de la famille à Boston, nous le tenons par les couilles. Il fera la liaison entre vous et les autres.
— Comment vais-je procéder ?
– Je pensais vous infiltrer en hélicoptère, via l’ambassade, mais finalement il vaut mieux que vous arriviez ouvertement, par avion. Nous vous avons préparé de faux papiers au nom de Manfred Linz, agent touristique, domicilié à Vienne.
« Dès votre arrivée, vous serez pris en charge par Sohbi, qui vous conduira dans un appartement d’Ashrafieh appartenant à des Libanais émigrés ici. Des amis. Ils le mettent à votre disposition. C’est plus discret qu’en hôtel.
Tout s’était passé comme prévu. Malko était reparti de New York sur le Concorde d’Air France, échappant au décalage horaire, puis, à Paris, avait embarqué sur l’Airbus pour Beyrouth. Aucune compagnie américaine ne desservait plus le Liban.
À Khaldé, l’aéroport de Beyrouth, il avait eu un choc. Des photos d’Hafez El Assad étaient placardées partout. Le Liban faisait déjà partie de la Syrie...
Un appel modulé venant de la rue Trabaud arracha Malko à ses pensées. Aussitôt, Sohbi Jalloul surgit de la cuisine, un panier muni d’une très longue ficelle à la main. Le chauffeur fourni par la CIA avait trente-quatre ans et en paraissait cinquante. Ses cheveux avaient blanchi en une nuit, en 1980. Sunnite, il avait été intercepté à un barrage et enlevé par des miliciens chrétiens. Toute la nuit, ils avaient procédé à des simulacres d’exécution, lui posant un pistolet sur la tempe et appuyant sur la détente... Pour appuyer leur bluff, ils avaient abattu trois autres prisonniers...
Un membre de l’ambassade américaine l’avait racheté le lendemain matin, pour 500 dollars... Grand, voûté, costaud, toujours souriant, il conduisait une Buick vieille de quinze ans dont le volant recouvert d’une fausse fourrure de tigre essayait de faire oublier l’absence d’amortisseurs et la peinture rapiécée. Beyrouth grouillait des mêmes vieilles américaines depuis vingt ans.
Sohbi se pencha sur le balcon, héla quelqu’un dans la rue et descendit son panier au bout de sa ficelle, avec quelques billets dedans. Il le remonta chargé à ras bord de fruits, de légumes, de kaak, de brochettes crues ; et en prime, Al-Nahar et l’Orient-Le Jour, le quotidien en français de Beyrouth.
Les ascenseurs fonctionnant de manière intermittente à cause des pannes d’électricité, c’était le moyen le plus pratique pour se ravitailler sans fatigue. Sohbi disparut dans la cuisine avec ses victuailles et Malko retourna dans le salon, totalement vide à l’exception d’un grand tapis, d’une télé Samsung neuve et d’un canapé usé. L’appartement mesurait près de trois cents mètres carrés mais ne contenait guère de meubles. Miraculeusement, pas un seul trou d’obus n’ornait l’immeuble, le seul bâtiment moderne de cette petite rue tranquille qui offrait une discrétion relative.
En dépit de ce confort spartiate, c’était nettement mieux que huit ans plus tôt. Malko avait alors quitté Beyrouth, au plus fort de l’offensive hezbollah contre les Occidentaux. Dans la ville coupée en deux, à feu et à sang, infestée de snipers, de voitures piégées, flottait l’odeur de la mort. À cette époque, l’aéroport était fermé, et toute la banlieue sud chiite, un fouillis crasseux de vingt-deux kilomètres carrés, là où les otages étaient détenus, était interdite de fait. C’était le fief du Hezbollah qui régnait sans partage sur ses 600 000 habitants. Des barrages de toutes obédiences stoppaient les rares véhicules, mais la vie continuait. Elle ne s’était jamais arrêtée d’ailleurs, seulement déplacée vers l’Est. L’Ouest musulman, broyé par les obus, était livré aux miliciens avides d’expulser tous les Occidentaux.
De cette violence aveugle, il ne restait que d’immenses portraits de Khomeyni et des autres chefs religieux chiites, plantés le long de la route de l’aéroport qui longeait la banlieue sud.
Maintenant, l’ordre syrien régnait à Beyrouth. De l’aéroport au centre, ils avaient franchi quatre barrages, trois de l’armée libanaise et un syrien, reconnaissable aux portraits d’Hafez El Assad placardés sur ses guérites.
À chaque barrage, Sohbi grommelait entre ses dents. Ils n’avaient pas été arrêtés une seule fois. La ville était étroitement quadrillée. Les Syriens sous-traitaient souvent avec l’armée libanaise réorganisée. En remontant l’ex-avenue Camille-Chamoun qui avait perdu son nom, Malko avait remarqué quelques immeubles somptueux tout juste sortis de terre, en marbre et pierre de taille, avec vue sur la corniche Mazra, qui jouxtaient des bâtiments aplatis par les bombardements.
Beyrouth réapprenait timidement à vivre.
Son cœur avait battu plus vite en traversant le Ring où il avait risqué sa vie si souvent en passant d’Est en Ouest. Les immeubles détruits de chaque côté étaient toujours là, mais sans snipers... Tout le centre n’était plus qu’un désert de ruines ; mais il y avait plus de Mercedes au mètre carré que n’importe où ailleurs dans le monde...
13/07/2016
237
pages
7,50
€
Extraits

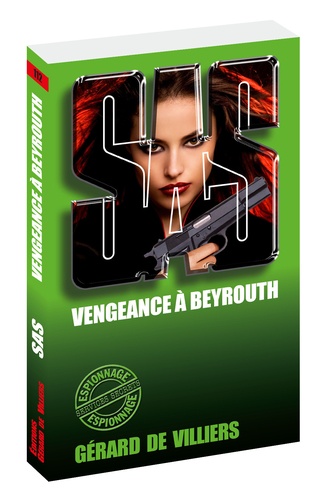




























Commenter ce livre